Définition de « synonyme »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot synonyme de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur synonyme pour aider à enrichir la compréhension du mot Synonyme et répondre à la question quelle est la définition de synonyme ?
Une définition simple : (fr-rég|si.n?.nim) synonyme (m)
Approchant : antonyme, homonyme, paronyme
Définitions de « synonyme »
Trésor de la Langue Française informatisé
SYNONYME, adj. et subst. masc.
LINGUISTIQUEWiktionnaire
Adjectif - français
synonyme \si.n?.nim\ masculin et féminin identiques
- Qui a le même sens qu'un autre mot ou une signification presque semblable.
- Certes, d'après ces excellentes raisons, qui prouvent plus que suffisamment l'importance d'une science, encore nouvelle dans sa théorie, on pourrait imaginer le mot Synonymologie pour signifier l'art de reconnaître les différences qui existent entre les mots synonymes d'une langue, [?]. ? (Charles Appert, La Synonymologie appliquée ou mes observations à Mr Guizot, Naples : chez l'auteur, 1826, page 9)
- La bioclimatologie ou biométéorologie humaine - on conviendra, au moins provisoirement, de considérer les deux termes comme synonymes - a pour objet l'étude des rapports existant entre le temps qu'il fait ou le climat et le fonctionnement de l'organisme humain, dans l'état de santé comme dans la maladie. ? (Jean-Pierre Besancenot, « Introduction » à Risques pathologiques, rythmes et paroxysmes climatiques, Paris : Éditions John Libbey Eurotext, 1992, p. 2)
Nom commun - français
synonyme \si.n?.nim\ masculin
-
(Linguistique) Mot ou terme qui a un sens identique ou voisin à celui d'un autre mot ou d'un autre terme.
- Mais il y a plus : ce besoin de synonymiser s'est incrusté si profondément dans l'âme du traducteur qu'il choisira toute de suite un synonyme : il traduira «mélancolie» si dans le texte original il y a «tristesse», il traduira «tristesse» là où il y a «mélancolie». ? (Jean Delisle, La traduction raisonnée : Manuel d'initiation à la traduction professionnelle de l'anglais vers le français, Presses de l'Université d'Ottawa, 2e édition, 2003, p. 460)
- Téléviseur et poste de télévision sont deux synonymes. ? Long, large, vaste, haut sont des synonymes de grand.
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
. Il se dit d'un Mot qui a la même signification qu'un autre mot, ou une signification presque semblable. Épée peut être regardé comme synonyme de Glaive. Aimer et Chérir, Dispute et Contestation, Péril et Danger sont des mots synonymes, sont synonymes. Il s'emploie aussi comme nom masculin. Peur est le synonyme de Crainte. Craindre et Redouter sont deux synonymes. Dictionnaire des synonymes.
SYNONYMES, au pluriel, est le Titre de certains ouvrages en forme de dictionnaire, dans lesquels la différence des synonymes est expliquée. Les Synonymes latins de Gardin Dumesnil. Les Synonymes français de Girard, de Beauzée.
Littré
-
1Il se dit d'un mot qui a, à très peu près, le même sens qu'un autre, comme péril et danger, funeste et fatal, mort et trépas.
Ce qui constitue deux ou plusieurs mots synonymes, c'est d'abord un sens général qui est commun à ces mots?; et ce qui fait ensuite que ces mots ne sont pas toujours synonymes, ce sont des nuances souvent délicates et quelquefois presque imperceptibles, qui modifient ce sens primitif et général
, D'Alembert, Élém. de philos. ch. 13.Fig. Il se dit de ce qui est une seule et même chose.
Chez plusieurs, savant et pédant sont synonymes
, La Bruyère, XII.Si quelquefois il [Pontchartrain] faisait du bien, c'était vanterie qui en faisait perdre tout le mérite, et qui devenait synonyme au reproche
, Saint-Simon, 305, 233.Dans le langage de l'ancienne chevalerie, bailler sa foi était synonyme de tous les prodiges de l'honneur
, Chateaubriand, Génie, I, II, 2. -
2 S. m. Mot synonyme.
Les synonymes sont plusieurs dictions ou plusieurs phrases différentes qui signifient une même chose
, La Bruyère, I.Les esprits médiocres ne trouvent point l'unique expression, et usent de synonymes
, La Bruyère, ib.La maxime, qu'il n'y a point de synonymes, veut dire seulement qu'on ne peut se servir, dans toutes les occasions, des mêmes mots
, Voltaire, Dict. phil. fécond.Demi-synonymes, mots qui sont exactement synonymes dans une partie de leur emploi, sans l'être dans l'autre partie.
On pourrait donner peut-être pour exemple de ces demi-synonymes les mots de pleurs et de larmes, qui, au sens moral, semblent pouvoir être employés indifféremment, sans pouvoir l'être de même au sens physique?; car on dit également les pleurs ou les larmes d'une mère?; mais il semble qu'on dit beaucoup mieux les pleurs que les larmes de l'aurore
, D'Alembert, Élog. Girard, note 4. -
3En histoire naturelle, se dit des noms différents qui servent à désigner le même être.
Il ne faut pas oublier que la multitude des noms nuit à l'avancement des sciences, qu'il faut diminuer les synonymes, et rétablir ainsi la précision de la nomenclature que le nombre des mots rend toujours plus difficile
, Sennebier, Ess. art d'obs. t. II, p. 58, dans POUGENS. - 4 Au plur. Titre de certains ouvrages, en forme de dictionnaire, dans lesquels la différence des mots synonymes est expliquée (il prend une majuscule). Les Synonymes latins de Gardin Dumesnil. Les Synonymes français de Girard. Les Synonymes de Lafaye.
SYNONYME
SYNONYME, ÉQUIVALENT. L'équivalent remplace un mot par une locution qui signifie la même chose?; par exemple quand on met la définition au lieu du terme lui-même. Le synonyme offre des nuances d'acception qui le distinguent plus ou moins d'un mot à signification voisine.
HISTORIQUE
XVe s. Et que aucun ne puist cuidier qu'ilz soient sinonimes, c'est assavoir, qu'ilz signifient tout un
, Christine de Pisan, Charles V, III, 2.
Encyclopédie, 1re édition
SYNONYME, adj. (Gram.) mot composé de la préposition greque ???, cum, & du mot ?????, nomen : de là ?????????, cognominatio, & ?????????, cognominans ; ensorte que vocabula synonyma sunt diversa ejusdem rei nomina. C'est la premiere idée que l'on s'est faite des synonymes, & peut-être la seule qu'en aient eu anciennement le plus grand nombre des gens de lettres. Une sorte de dictionnaire que l'on met dans les mains des écoliers qui frequentent nos colleges, & que l'on connoit sous le nom général de synonymes, ou sous les noms particuliers de Regia Parnassi, de Gradus ad Parnassum, &c. est fort propre à perpétuer cette idée dans toutes les têtes qui tiennent pour irréformable ce qu'elles ont appris de leurs maîtres. Que faut-il penser de cette opinion ? Nous allons l'apprendre de M. l'abbé Girard, celui de nos grammairiens qui a acquis le plus de droit de prononcer sur cette matiere.
« Pour acquérir la justesse, dit-il, (synonymes franç. préf. page x.) il faut se rendre un peu difficile sur les mots, ne point s'imaginer que ceux qu'on nomme synonymes, le soient dans toute la rigueur d'une ressemblance parfaite, ensorte que le sens soit aussi uniforme entr'eux que l'est la saveur entre les gouttes d'eau d'une même source ; car en les considérant de près, on verra que cette ressemblance n'embrasse pas toute l'étendue & la force de la signification, qu'elle ne consiste que dans une idée principale, que tous énoncent, mais que chacun diversifie à sa maniere par une idée accessoire qui lui constitue un caractere propre & singulier. La ressemblance que produit l'idée générale, fait donc les mots synonymes ; & la différence qui vient de l'idée particuliere qui accompagne la générale, fait qu'ils ne le sont pas parfaitement, & qu'on les distingue comme les diverses nuances d'une même couleur. »
La notion que donne ici des synonymes cet excellent académicien, il l'a justifiée amplement dans l'ouvrage ingénieux qu'il a fait exprès sur cette matiere, dont la premiere édition étoit intitulée, justesse de la langue françoise, à Paris, chez d'Houry 1718, & dont la derniere édition est connue sous le nom de synonymes françois, à Paris, chez la veuve d'Houry, 1741.
On ne sauroit lire son livre sans desirer ardemment qu'il y eût examiné un plus grand nombre de synonymes, & que les gens de lettres qui sont en état d'entrer dans les vues fines & délicates de cet ingénieux écrivain, voulussent bien concourir à la perfection de l'édifice dont il a en quelque maniere posé les premiers fondemens. Je l'ai déja dit ailleurs : il en résulteroit quelque jour un excellent dictionnaire, ouvrage d'autant plus important, que l'on doit regarder la justesse du langage non-seulement comme une source d'agrémens, mais encore comme l'un des moyens les plus propres à faciliter l'intelligence & la communication de la vérité. Les chefs-d'?uvres immortels des anciens sont parvenus jusqu'à nous ; nous les entendons, nous les admirons même ; mais combien de beautés réelles y sont entierement perdues pour nous, parce que nous ne connoissons pas toutes ces nuances fines qui caractérisent le choix qu'ils ont fait & dû faire des mots de leur langue ! Combien par conséquent ne perdons-nous pas de sentimens agréables & délicieux, de plaisirs réels ! Combien de moyens d'apprécier ces auteurs, & de leur payer le juste tribut de notre admiration ! Nous n'avons qu'à juger par-là de l'intérêt que nous pouvons avoir nous-mêmes à constater dans le plus grand détail l'état actuel de notre langue, & à en assurer l'intelligence aux siecles à venir, nonobstant les révolutions qui peuvent l'altérer ou l'anéantir : c'est véritablement consacrer à l'immortalité les noms & les ouvrages de nos Homeres, de nos Sophocles, de nos Eurypides, de nos Pindares, de nos Démosthènes, de nos Thucydides, de nos Chrysostomes, de nos Platons, de nos Socrates : & les consécrateurs ne s'assûrent-ils pas de droit une place éminente au temple de Mémoire ?
Les uns peuvent continuer sur le plan de l'abbé Girard, assigner les caracteres distinctifs des synonymes avec cette précision rare qui caractérise cet écrivain lui-même, & y adapter des exemples qui en démontrent la justesse, & l'usage qu'il faut en faire.
Les autres recueilleront les preuves de fait que leurs lectures pourront leur présenter dans nos meilleurs écrivains, de la difference réelle qu'il y a entre plusieurs synonymes de notre langue. Le p. Bouhours, dans ses remarques nouvelles sur la langue françoise, en a caractérisé plusieurs qui pourroient bien avoir fait naître l'idée de l'ouvrage de l'abbé Girard. Dans le journal de l'académie françoise, par l'abbé de Choisy, que M. l'abbé d'Olivet a inséré dans les opuscules sur la langue françoise, on trouve l'examen exprès des différences des mots mauvais & méchant, gratitude & reconnoissance, crainte & frayeur, &c. Il y aura aussi une bonne récolte à faire dans les remarques de Vaugelas, & dans les notes de MM. Patru & Th. Corneille.
Mais il ne faut pas croire qu'il n'y ait que les Grammairiens de profession qui puissent fournir à cette compilation ; la Bruyere peut fournir sans effort une douzaine d'articles tout faits : docteur & docte ; héros & grand-homme ; galante & coquette ; foible, inconstant, léger & volage ; infidele & perfide ; émulation, jalousie & envie ; vice, défaut & ridicule ; grossiereté, rusticité & brutalité ; suffisant, important & arrogant ; honnête-homme & homme de bien ; talent & goût ; esprit & bon-sens.
Le petit, mais excellent livre de M. Duclos, considération sur les m?urs de ce siecle, sera aussi fécond que celui des caractères : il a défini poli & policé ; conviction & persuasion ; probité & vertu ; avilir & deshonorer ; réputation & renommée ; illustre & fameux ; crédit & faveur ; abaissement & bassesse ; suivre & obéir ; naïveté, candeur & ingénuité ; finesse & pénétration, &c.
En général, tous nos écrivains philosophes contribueront beaucoup à ce recueil, parce que l'esprit de justesse est le véritable esprit philosophique ; & peut-être faut-il à ce titre même citer l'Encyclopédie, comme une bonne source, non-seulement à cause des articles exprès qu'on y a consignés sur cette matiere, mais encore à cause des distinctions précises que l'examen métaphysique des principes des sciences & des arts a nécessairement occasionnées.
Mais la besogne la plus utile pour constater les vraies différences de nos synonymes, consiste à comparer les phrases où les meilleurs écrivains les ont employés sans autre intention que de parler avec justesse. Je dis les meilleurs écrivains, & j'ajoute qu'il ne faut compter en cela que sur les plus philosophes ; ce qui caractérise le plus petit nombre : les autres, en se donnant même la peine d'y penser, se contentent néanmoins assez aisément, & ne se doutent pas que l'on puisse leur faire le moindre reproche ; en voici une preuve singulierement frappante.
M. le duc de la Rochefoucault s'exprime en cette sorte (pens. 28, édit. de l'abbé de la Roche.) : « La jalousie est en quelque maniere juste & raisonnable, puisqu'elle ne tend qu'à conserver un bien qui nous appartient, ou que nous croyons nous appartenir ; au lieu que l'envie est une fureur qui ne peut souffrir le bien des autres ». Rien n'est plus commun, dit là-dessus son commentateur, que d'entendre confondre ces passions? Cependant elles ont des objets bien différens. Mais lui-même sert bientôt de preuve à ce qu'il observe ici ; car à l'occasion de la pensée 55, où l'auteur parle de la haine pour les favoris, quel est, dit l'abbé de la Roche, le principe de cette haine, sinon un fond de jalousie qui nous fait envier tout le bien que nous voyons dans les autres ? Il est clair qu'il explique ici la jalousie par l'idée que M. de la Rochefoucault devoit lui avoir fait prendre de l'envie, d'où il a même emprunté le verbe envier. Au reste ce n'est pas la seule faute qu'il ait faite dans ses remarques sur un texte qui n'exigeoit de lui que de l'étude & du respect.
Quoi qu'il en soit, je remarquerai qu'il suit naturellement de tous les exemples que je viens d'indiquer dans différens écrivains, que ce qu'enseigne l'abbé Girard au sujet des différences qui distinguent les synonymes, n'est rien moins qu'arbitraire ; qu'il est fondé sur le bon usage de notre langue ; & qu'il ne s'agit, pour en établir les décisions sur cet objet, que d'en extraire avec intelligence les preuves répandues dans nos ouvrages les plus accrédités & les plus dignes de l'être. Ce n'est pas non plus une chose qui appartient en propre à notre idiôme. M. Gottsched vient de donner (1758, à Leipsick) des observations sur l'usage & l'abus de plusieurs termes & façons de parler de la langue allemande : elles sont dit M. Roux (annales typogr. Août 1760. bell. lett. n. clviij.), dans le goût de celles de Vaugelas sur la langue françoise, & on en trouve plusieurs qui ressemblent beaucoup aux synonymes de l'abbé Girard.
Il y a long-tems que les savans ont remarqué que la synonymie n'étoit pas exacte dans les mots les plus ressemblans. « Les Latins, dit M. du Marsais (trop. part. III. art. xij. pag. 304), sentoient mieux que nous ces différences délicates, dans le tems même qu'ils ne pouvoient les exprimer? Varron (de ling. lat. 1. v. sub fin.), dit que c'est une erreur de confondre agere, facere & gerere, & qu'ils ont chacun leur destination particuliere ». Voici le texte de Varron : propter similitudinem agendi, & faciendi, & gerendi, quidam error his qui putant esse unum ; potest enim quis aliquid facere & non agere, ut poëta facit fabulam, & non agit ; contrà actor agit, & non facit ; & sic à poëtâ fabula fit & non agitur, ab actore agitur & non fit ; contrà imperator qui dicitur res gerere, in eo neque agit neque facit, sed gerit, id est sustinet, translatum ab his qui onera gerunt quòd sustinent.
Cicéron observe (tusc. II. n. 15.) qu'il y a de la différence entre dolere & laborare, lors même que ce dernier mot est pris dans le sens du premier. Interest aliquid inter laborem & dolorem ; sunt finitima omninò, sed tamen differt aliquid ; labor est functio quædam vel animi vel corporis gravioris operis vel muneris ; dolor autem motus asper in corpore? Aliud, inquam, est dolere, aliud laborare. Cùm varices secabantur Cn. Mario, dolebat ; cùm ætu magno ducebat agmen, laborabat. Cette remarque de l'orateur romain n'est que l'application du principe général qu'il n'y a point de mots tout-à-fait synonymes dans les langues, principe qu'il a exprimé très-clairement & tout-à-la-fois justifié dans ses topiques (n. 34) : quanquam enim vocabula propè idem valere videantur, tamen quia res differebant, nomina rerum distare voluerunt.
Non-seulement Cicéron a remarqué, comme grammairien, les différences délicates des synonymes, il les a suivies dans la pratique comme écrivain intelligent & habile. Voici comme il différencie dans la pratique amare & diligere.
Quis erat qui putaret ad eum amorem quem erga te habebam posse aliquid accedere ? Tantum accessit, ut mihi nunc denique amare videar, anteà dilexisse. (ep. famil. ix. 14.) & ailleurs : Quid ego tibi commendem eum quem tu ipse diligis ? Sed tamen ut scires eum non à me diligi solùm, verùm etiam amari, ob eam rem tibi hæc scribo. (ib. xiij. 47.)
Les deux adjectifs gratus & jucundus que nous sommes tentés de croire entierement synonymes, & que nos traducteurs les plus scrupuleux traduiroient peut-être indifféremment de la même maniere, si des circonstances marquées ne les déterminoient à y faire une attention spéciale ; Cicéron en a très-bien senti la différence, & en a tiré un grand parti. Répondant à Atticus qui lui avoit appris une triste nouvelle, il lui dit : ista veritas etiamsi jucunda non est, mihi tamen grata est. (ep. ad Attic. iij. 24.) & dans une lettre qu'il écrit à Lucretius après la mort de sa fille Tullia : amor tuus gratus & optatus ; dicerem jucundum, nisi hoc verbum ad tempus perdidissem. (ep. famil. v. 15.)
On voit par-là avec quelle circonspection on doit étudier la propriété des termes, & de la langue dont on veut traduire, & de celle dans laquelle on traduit, ou même dans laquelle on veut écrire ses propres pensées. « Nous avons, dit M. du Marsais (Trop. III. xij. pag. 304.) quelques recueils des anciens grammairiens sur la propriété des mots latins : tels sont Festus, de verborum significatione ; Nonius Marcellus, de varia significatione sermonum, (voyez Veteres grammatici.) On peut encore consulter un autre recueil qui a pour titre, Autores linguæ latinæ. De plus, nous avons un grand nombre d'observations répandues dans Varron, de lingua latina : [il fait partie des grammatici veteres] dans les commentaires de Donat & de Servius : elles font voir les différences qu'il y a entre plusieurs mots que l'on prend communément pour synonymes. Quelques auteurs modernes on fait des réflexions sur le même sujet : tels sont le P. Vavasseur, jésuite, dans ses Remarq. sur la langue latine ; Scioppius, Henri Etienne, de latinitate falsò suspectâ, & plusieurs autres ». Je puis ajouter à ces auteurs, celui des Recherches sur la langue latine. (2 vol. in-12. Paris, chez Mouchet 1750.) Tout l'ouvrage est partagé en quatre parties ; & la troisieme est entierement destinée à faire voir, par des exemples comparés, qu'il n'y a point d'expressions tout-à-fait synonymes entre elles, dans la langue latine.
Au reste, ce qui se prouve dans chaque langue, par l'autorité des bons écrivains dont la maniere constate l'usage, est fondé sur la raison même ; & par conséquent il doit en être de même dans toutes les langues formées & polies. « S'il y avoit des synonymes parfaits, dit encore M. du Marsais, (ibid. p. 308.) il y auroit deux langues dans une même langue. Quand on a trouvé le signe exact d'une idée, on n'en cherche pas un autre. Les mots anciens & les mots nouveaux d'une langue sont synonymes : maints est synonyme de plusieurs ; mais le premier n'est plus en usage ; c'est la grande ressemblance de signification, qui est cause que l'usage n'a conservé que l'un de ces termes, & qu'il a rejetté l'autre comme inutile. L'usage, ce [prétendu] tyran des langues, y opere souvent des merveilles, que l'autorité de tous les souverains ne pourroit jamais y opérer.
Qu'une fausse idée des richesses ne vienne pas ici, dit l'abbé Girard, (Préf. des Synon. pag. 12.) faire parade de la pluralité & de l'abondance. J'avoue que la pluralité des mots fait la richesse des langues ; mais ce n'est pas la pluralité purement numérale............ C'est celle qui vient de la diversité, telle qu'elle brille dans les productions de la nature....... Je ne fais donc cas de la quantité des mots que par celle de leur valeur. S'ils ne sont variés que par les sons ; & non par le plus ou le moins d'énergie, d'étendue & de précision, de composition ou de simplicité, que les idées peuvent avoir ; ils me paroissent plus propres à fatiguer la mémoire, qu'à enrichir & faciliter l'art de la parole. Protéger le nombre des mots sans égard au sens, c'est, ce me semble, confondre l'abondance avec la superfluité. Je ne saurois mieux comparer un tel goût qu'à celui d'un maître-d'hôtel qui feroit consister la magnificence d'un festin dans le nombre des plats plutôt que dans celui des mets. Qu'importe d'avoir plusieurs termes pour une seule idée ? N'est-il pas plus avantageux d'en avoir pour toutes celles qu'on souhaite d'exprimer ? » On doit juger de la richesse d'une langue, dit M. du Marsais, (Trop. pag. 309.) par le nombre des pensées qu'elle peut exprimer, & non par le nombre des articulations de la voix : & il semble en effet que l'usage de tous les idiomes, tout indélibéré qu'il paroît, ne perde jamais de vue cette maxime d'économie ; jamais il ne légitime un mot synonyme d'un autre, sans proscrire l'ancien, si la synonymie est entiere ; & il ne laisse subsister ensemble ces mêmes mots, qu'autant qu'ils sont réellement différenciés par quelques idées accessoires qui modifient la principale.
« Les synonymes des choses, dit M. le Président de Brosses, dans un mémoire dont j'ai déja tiré bon parti ailleurs, viennent de ce que les hommes les envisagent sous différentes faces, & leur donnent des noms relatifs à chacune de ces faces. Si la rose est un être existant réellement & de soi dans la nature, sa maniere d'exciter l'idée étant nette & distincte, elle n'a que peu ou point de synonymes, par exemple, fleur ; mais si la chose est une perception de l'homme relative à lui-même, & à l'idée d'ordre qu'il se forme à lui-même pour sa convenance, & qui n'est qu'en lui, non dans la nature, alors comme chaque homme a sa maniere de considérer & de se former un ordre, la chose abonde en synonymes » (mais dans ce cas-là même, les différentes origines des synonymes démontrent la diversité des aspects accidentels de la même idée principale, & justifient la doctrine de la distinction réelle des synonymes) ; « par exemple, une certaine étendue de terrein se nomme région, eu égard à ce qu'elle est régie par le même prince ou par les mêmes lois : province, eu égard à ce que l'on y vient d'un lieu à un autre (provenire.) » [L'i & le c de provincia me feroient plutôt croire que ce mot vient de procul & de vincere, conformément à ce qu'en dit Hégésippe cité par Callepin (verb. provincia) ; scribit enim Hegesippus, dit-il, Romanos cùm vincendo in suam potestatem redigerent procui positas regiones, appellavisse provincias : ou bien du verbe vincire, qui rendroit le nom de provincia applicable aux régions mêmes qui se soumettroient volontairement & par choix à un gouvernement : ce qui se confirme par ce que remarque Cicéron (Verrin. iv.) que la Sicile est la premiere qui ait été appellée province, parce qu'elle fut la premiere qui se confia à l'amitié & à la bonne foi du peuple romain ; mais toutes ces étymologies rentrent également dans les vues de M. le président de Brosses, & dans les miennes] : « contrée, parce qu'elle comprend une certaine étendue circonvoisine (tractus, contractus, contrada) : district, en tant que cette étendue est considérée comme à part & séparée d'une autre étendue voisine (districtus, distractus) : pays, parce qu'on a coutume de fixer les habitations près des eaux : car c'est ce que signifie le latin pagus du grec ????, fons : état, en tant qu'elle subsiste dans la forme qui y est établie, &c.... Tous ces termes passent dans l'usage : on les généralise dans la suite, & on les emploie sans aucun égard à la cause originelle de l'institution. Cette variété de mots met dans les langues beaucoup d'embarras & de richesses : elle est très incommode pour le vulgaire & pour les philosophes qui n'ont d'autre but en parlant que de s'expliquer clairement : elle aide infiniment au poëte & à l'orateur, en donnant une grande abondance à la partie matérielle de leur style. C'est le superflu qui fournit au luxe, & qui est à charge dans le cours de la vie à ceux qui se contentent de la simplicité. »
De la diversité des points de vue énoncés par les mots synonymes, je conclurois bien plutôt que l'abondance en est pour les philosophes une ressource admirable, puisqu'elle leur donne lieu de mettre dans leurs discours toute la précision & la netteté qu'exige la justesse la plus métaphysique ; mais j'avoue que le choix peut leur donner quelque embarras, parce qu'il est aisé de se méprendre sur des différences quelquefois assez peu sensibles. « Je ne disconviens pas qu'il n'y ait des occasions où il soit assez indifférent de choisir ; mais je soutiens qu'il y en a encore plus où les synonymes ne doivent ni ne peuvent figurer l'un pour l'autre, surtout dans les ouvrages médités & composés avec réflexion. S'il n'est question que d'un habit jaune, on peut prendre le souci ou le jonquille ; mais s'il faut assortir, on est obligé à consulter la nuance (préf. des synon.) »
M. de la Bruyere remarque (caract. des ouvrages d'esprit) qu'entre toutes les différentes expressions qui peuvent rendre une seule de nos pensées, il n'y en a qu'une qui soit la bonne : que tout ce qui ne l'est point, est foible, & ne satisfait pas un homme d'esprit qui veut se faire entendre. « Ainsi, dit M. du Marsais, (trop. pag. 307), ceux qui se sont donné la peine de traduire les auteurs latins en un autre latin, en affectant d'éviter les termes dont ces auteurs se sont servis, auroient pu s'épargner un travail qui gâte plus le goût qu'il n'apporte de lumiere. L'une & l'autre pratique (il parle de la méthode de faire le thème en deux façons) est une fécondité stérile qui empêche de sentir la propriété des termes, leur énergie, & la finesse de la langue. » (E. R. M. B.)
Étymologie de « synonyme »
Lat. synonymon, de ?????????, de ???, avec, et ?????, nom.
- (fin XIIIe siècle) Emprunté au latin syn?nymon ou syn?nymum, du grec ancien ?????????, sun?numon, neutre singulier de ?????????, sun?numos, même sens, composé de ??? (« avec ») et de ????? (« nom »).
synonyme au Scrabble
Le mot synonyme vaut 27 points au Scrabble.
Informations sur le mot synonyme - 8 lettres, 2 voyelles, 6 consonnes, 6 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot synonyme au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
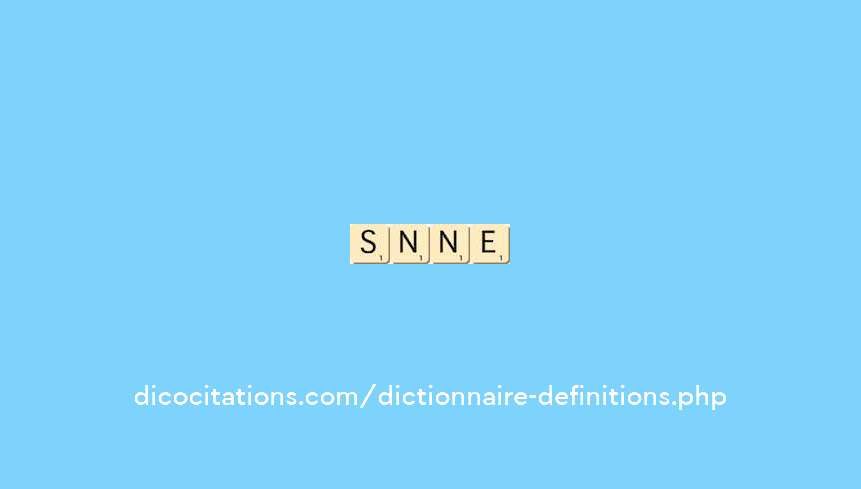
Les rimes de « synonyme »
On recherche une rime en IM .
Les rimes de synonyme peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en im
Rimes de maritime Rimes de anonyme Rimes de intimes Rimes de pseudonyme Rimes de riment Rimes de abyme Rimes de pusillanimes Rimes de anonyme Rimes de magnanimes Rimes de mésestime Rimes de intimes Rimes de réprime Rimes de raniment Rimes de minime Rimes de reprîmes Rimes de maximes Rimes de quinquagésime Rimes de cold-cream Rimes de périme Rimes de frimes Rimes de rendîmes Rimes de onesime Rimes de déprime Rimes de carissime Rimes de gym Rimes de réussîmes Rimes de pusillanime Rimes de ex-enzymes Rimes de synonyme Rimes de dîme Rimes de triment Rimes de griment Rimes de estime Rimes de ice-cream Rimes de endormîmes Rimes de ressentîmes Rimes de sublimes Rimes de passim Rimes de sérénissime Rimes de applaudîmes Rimes de Alpes-Maritimes Rimes de teams Rimes de supprime Rimes de partîmes Rimes de sublimissime Rimes de Seine-Maritime Rimes de septime Rimes de mime Rimes de abîme Rimes de comprimeMots du jour
maritime anonyme intimes pseudonyme riment abyme pusillanimes anonyme magnanimes mésestime intimes réprime raniment minime reprîmes maximes quinquagésime cold-cream périme frimes rendîmes onesime déprime carissime gym réussîmes pusillanime ex-enzymes synonyme dîme triment griment estime ice-cream endormîmes ressentîmes sublimes passim sérénissime applaudîmes Alpes-Maritimes teams supprime partîmes sublimissime Seine-Maritime septime mime abîme comprime
Les citations sur « synonyme »
- Quelle règle convient-il donc de suivre dans cette grande question des jeux de l'enfance ? Le jeu forme les trois quarts de leur vie. Faut-il les y abandonner aux seules ressources de leur imagination ? Faut-il les forcer à se tirer d'affaire et les laisser s'amuser seuls, ou bien est-il bon au contraire, là comme ailleurs, de leur ouvrir la voie, de leur tendre la main, de leur apprendre à inventer ? Le problème est des plus difficiles. On ne peut nier d'une part que les enfants n'aient en eux les plus ingénieuses et les plus fécondes ressources d'amusement. Qui de nous ne s'est arrêté à contempler un enfant assis à terre et passant des heures entières à creuser dans le sable un trou sans objet, sans forme, sans fin (car il le recreuse toujours), et attaché à cet ouvrage comme Archimède à son problème. Que fait-il ? A quoi songe-t-il ? Que se passe-t-il dans sa tête ?Nul ne peut le dire; lui-même ne le pourrait pas. Ces heures, pourtant, se sont écoulées pour lui avec cette rapidité légère dont le mot jeu est synonyme, et il a joué tout seul. Mais d'un autre côté, qui n'a pas vingt fois pris en pitié les regards de détresse et l'attitude mélancolique d'enfants réunis pour s'amuser, et ne pouvant trouver d'amusement ?.Auteur : Ernest Legouvé - Source : Les pères et les enfants au XIXe siècle (1867)
- Chez le primitif, étranger est synonyme d'ennemi et de mauvais. Tout ce que fait notre propre nation est bien fait; tout ce que font les autres nations est mal.Auteur : Carl Gustav Jung - Source : L'Homme à la découverte de son âme (1931)
- Conversation et médisance sont synonymes, comme dire et médire. Auteur : Philippe Delerm - Source : Et vous avez eu beau temps ? La perfidie ordinaire des petites phrases
- La langue que nous utilisons influe sur notre manière de penser. Par exemple, le français, en multipliant les synonymes et les mots à double sens, autorise des nuances très utiles en matière de diplomatie. Auteur : Bernard Werber - Source : Encyclopédie du savoir relatif et absolu
- La vie n'a qu'un sens : y être heureux. Si la vie n'est pas synonyme de bonheur, autant ne pas vivre.Auteur : Henry de Montherlant - Source : Carnets (1957), années 1930 à 1944
- Une autre affirmation sur laquelle les gens prenant de l'âge s'accordent est que le temps passe plus vite quand on vieillit. Comme toute personne sensée, je l'ai évidemment remarqué, cependant je ne pense pas que l'explication de ce phénomène soit d'ordre biologique : elle découle d'une certaine routine - amicale, amoureuse, professionnelle -, notre quotidien devient moins étonnant, moins synonyme d'aventure. Quand la vie nous surprend, quand elle génère de l'euphorie ou la peur de mourir, le rapport avec le temps se transforme. Je doute que les grands aventuriers, constamment en danger, ou les soldats sur le front, aient trouvé que les jours filaient trop rapidement. Auteur : Antoine Renand - Source : S'adapter ou mourir (2021)
- Vivre signifie enfourcher un destin, aimer est pour nous synonyme de se projeter dans des amours vertigineuses. Le normal est notre hantise, l'exorbitant notre mesure, et notre ridicule vanité.Auteur : Alexandre Jardin - Source : Le Zubial (1997)
- Jeunesse: âge de folie et de rêves, de poésie et de bêtise, synonymes dans la bouche des gens qui jugent le monde sainement.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Mémoires d'un fou (1836)
- Pour les femmes, inventer est synonyme de mentir.Auteur : Charles Dumercy - Source : Paradoxes judiciaires (1899)
- Il ne faut pas oublier que religieux n'est pas plus synonyme de saint que soldat ne l'est de héros.Auteur : Pierre Reverdy - Source : En vrac (1956)
- L'élégance n'est pas synonyme de délinquance. Auteur : Proverbes ivoiriens - Source : Proverbes
- Paris est synonyme de Cosmos. Paris est Athènes, Rome, Sybaris, Jérusalem, Pantin. Toutes les civilisations y sont en abrégé, toutes les barbaries aussi. Paris serait bien fâché de n'avoir pas une guillotine.Auteur : Victor Hugo - Source : Les Misérables (1862)
- Il n'y a pas de synonymes. Il n'y a que des mots nécessaires, et le bon écrivain les connaît.Auteur : Jules Renard - Source : Journal
- Je passe ma vie à chercher les mots justes, les mots qui ne veulent pas dire quelque chose d'autre, qu'on ne pourrait remplacer par un synonyme parce que sinon tous les mots finiraient par dire la même chose.Auteur : Nathacha Appanah - Source : La Noce d'Anna (2005)
- Les primates vociférateurs et casseurs de l'antimondialisation, en déshérence de maoïsme, s'en prennent en réalité à l'Amérique, synonyme de capitalisme.Auteur : Jean-François Ricard, dit Jean-François Revel - Source : Le Point, 13 septembre 2001.
- Je dis que l'Humanité a un synonyme: Egalité; et qu'il n'y a sous le ciel qu'une chose devant laquelle on doive s'incliner, le génie, et qu'une chose devant laquelle on doive s'agenouiller, la bonté.Auteur : Victor Hugo - Source : Choses vues (1887-1900)
- S'il y avait des synonymes parfaits, il y aurait deux langues dans une même langue.Auteur : César Chesneau, sieur Dumarsais - Source : Traité des tropes (1730)
- Zéro est en soi synonyme de rien; mais l'acte d'écrire ce zéro est un acte positif qui signifie que, dans tous les cas, toute relation d'égalité entre grandeurs satisfait à une opération qui les annule simultanément et qui est la même pour tous.Auteur : Paul Valéry - Source : Regards sur le monde actuel (1931)
- Dans le vocabulaire des couturiers seulement, patron est synonyme de modèle.Auteur : Aymond d'Alost - Source : En la machine ronde (1978)
- Nous avons donc vécu là, dans cette couronne de banlieue, la grande, près des champs de pommes de terre et des avions qui décollent. Encore la campagne et déjà la ville et ses grues synonymes de grands ensembles qui avaient pris la mesure des choses, cette ville grandissante et moderne aux portes de ce petit village agricole vacillant qui va mourir avec le progrès. Oh ma banlieue, mon pays, mes racines, tu avais encore un visage d'enfant venu d'un temps dont la langue ne se parle presque plus, ici, près des pistes d'Orly. Auteur : Marc Lavoine - Source : L'homme qui ment (2015)
- La guerre est synonyme de perte, mais la capitulation est synonyme de dévastation.Auteur : Daniel Woodrell - Source : Chevauchée avec le diable (1987)
- La mort était synonyme de mystère qu’il fallait résoudre, démêler comme une pelote de laine enchevêtrée. Car on pouvait toujours élucider l’affaire, la clarifier. Il suffisait d’avoir de l’énergie, de la persévérance et de savoir tirer sur les bons fils au bon moment. La réalité n’était rien d’autre qu’un tissu complexe de ces fils. En résumé : on pouvait la maîtriser, l’ordonner. Auteur : Camilla Grebe - Source : Un cri sous la glace (2017)
- Faire sa fortune n'est pas le synonyme de faire son bonheur; l'un peut cependant s'accroître avec l'autre.Auteur : Claude Adrien Helvétius - Source : Notes, maximes et pensées
- Avoir la littérature dans la peau a son synonyme : la vie vaut plus le coup d'être lue que vécue. Ecrire en rajoute une couche. La vie ? C'est ce dont on se souvient.Auteur : André Blanchard - Source : A la demande générale (carnets 2009-2011) (2013)
- Nous dissimulons nos bonnes actions sous l'ironie et l'indifférence, comme si l'amour était synonyme de faiblesse.Auteur : Paulo Coelho - Source : Maktub (1994)
Les mots proches de « synonyme »
Synagogue Synalèphe Synarthrose Syncatégorématique Syncelle Synchondrose Synchroniquement Synchroniser Synchronisme Synchroniste Synchyse Synclinal, ale Syncope Syncopé, ée Syncoper Syncrétisme Syncrétiste Syndérèse Syndic Syndicat Syndicataire Syndiquer Synecdoche ou synecdoque Synergique Synodal, ale Synode Synodiquement Synonyme Synoptique Synoque Syntaxe Synthèse Synthésique Synthétique SynthétiserLes mots débutant par syn Les mots débutant par sy
synagogale synagogaux synagogue synagogues synapse synapses synaptique synaptiques synchro synchrone synchrones synchronie synchronique synchronisaient synchronisation synchronise synchronisé synchronisée synchronisées synchroniser synchronisera synchronisés synchroniseur synchronisez synchronisme synchronisons synchros synchrotron syncopal syncope syncopé syncopé syncopée syncopée syncopées syncoper syncopes syncopés syncopés syncrétisme syncrétiste syncytial syndic syndical syndicale syndicales syndicalisation syndicaliser syndicalisme syndicaliste
Les synonymes de « synonyme»
Les synonymes de synonyme :- 1. adéquat
2. approprié
3. ad
synonymes de synonyme
Fréquence et usage du mot synonyme dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « synonyme » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot synonyme dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Synonyme ?
Citations synonyme Citation sur synonyme Poèmes synonyme Proverbes synonyme Rime avec synonyme Définition de synonyme
Définition de synonyme présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot synonyme sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot synonyme notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 8 lettres.
