Définition de « chêne »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot chene de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur chêne pour aider à enrichir la compréhension du mot Chêne et répondre à la question quelle est la définition de chene ?
Une définition simple : (fr-rég|???n)
Définitions de « chêne »
Trésor de la Langue Française informatisé
CHÊNE, subst. masc.
Wiktionnaire
Nom commun - français
chêne \??n\ masculin
-
(Botanique) Grand arbre forestier de la famille des Fagacées, à feuilles lobées, qui peut atteindre quarante mètres de hauteur et vivre plus de cinq cents ans.
- [?] ; des centaines de chênes aux larges têtes, aux troncs ramassés, aux branches étendues, qui avaient peut-être été témoins de la marche triomphale des soldats romains, jetaient leurs rameaux robustes sur un épais tapis de la plus délicieuse verdure. ? (Walter Scott, Ivanhoé, traduit de l'anglais par Alexandre Dumas, 1820)
- L'écorce de chêne, employée pour le tannage des cuirs, est un élément important de la richesse forestière du département. ? (Edmond Nivoit, Notions élémentaires sur l'industrie dans le département des Ardennes, E. Jolly, Charleville, 1869, page 173)
- Le Tussah au cocon gris ou brun qui vit aux Indes sur le ricin et le chêne et dont les produits soumis dans plusieurs localités à un élevage méthodique paraissent appelés à un grand avenir. ? (D. de Prat, Nouveau manuel complet de filature; 1re partie: Fibres animales & minérales, Encyclopédie Roret, 1914)
- Sur un des côtés du chemin s'élevait un talus haut et raide, où des noisetiers et des chênes rabougris, leurs racines à moitié à nu, se cramponnaient péniblement. ? (Emily Brontë, Les Hauts de Hurlevent, 1847, traduit de l'anglais par Frédéric Delebecque en 1925)
- Quand il se dresse face à quelque « vieille écorce », chêne, frêne, ou hêtre, plus large qu'une huche, lorsque d'un simple regard, il le cube de la souche au houpier, tant de solives pour le tronc, tant de stères pour les branches [?] Arsène André éprouve une virile volupté. ? (Jean Rogissart, Passantes d'Octobre, Librairie Arthème Fayard, Paris, 1958)
- Et Francis Hallé de conclure : « Les chênes, ce sont des arbres tropicaux. L'origine des chênes, c'est Bornéo et le Mexique. C'est devenu le symbole de la flore d'Europe, mais c'est comme le coq gaulois. Vous savez qu'il est de Thaïlande ? »? (Propos recueillis par Lucien Jedwab, Rencontre entre les botanistes Gilles Clément et Francis Hallé : « Les plantes paraissent toujours exotiques au début », Le Monde, 4 juillet 2017)
-
(Par extension) Le bois de cet arbre travaillé.
- Un nouveau réservoir d'eau claire de 200 litres conservera l'eau, mieux que des barils de chêne. ? (Alain Gerbault, À la poursuite du soleil; tome 1 : De New-York à Tahiti, 1929)
- Il poussa la porte si fort que le fer à cheval suspendu au linteau de chêne tinta faiblement. ? (Jean Rogissart, Passantes d'Octobre, Librairie Arthème Fayard, Paris, 1958)
-
(Héraldique) Meuble représentant l'arbre du même nom dans les armoiries. Il est représenté avec des feuilles et glands disproportionnés pour faciliter l'identification de l'espèce. Il se blasonne comme l'arbre. Il est dit englandé ou englanté quand ses glands sont d'un autre émail (il est à noter que fruité est tout aussi valable). À rapprocher de arbre, if, pin, pommier, sapin?
- D'argent, au chêne terrassé de sinople, englandé d'or, au chef d'azur chargé de trois fleurs de lys d'or, qui est de la commune de Privas de l'Ardèche ? voir illustration « armoiries avec un chêne »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Arbre forestier, de la famille des Amentacées, qui porte le gland et dont certaines espèces acquièrent une grosseur et une hauteur considérables. Un chêne centenaire. Un bois de chênes. Du bois de chêne. Feuille de chêne. Fort comme un chêne. Pomme de chêne. Voyez NOIX DE GALLE. Chêne vert. Voyez YEUSE. Chêne-liège, Chêne dont l'écorce fournit le liège. Des chênes-lièges. Il se dit aussi du Bois de chêne travaillé. Une poutre de chêne. Un buffet de chêne. Une bibliothèque de vieux chêne.
Littré
-
1Arbre de la famille des amentacées, qui produit le gland.
Le chêne craint le voisinage des pins, des sapins, des hêtres, et de tous les arbres qui poussent de grosses racines dans la profondeur du sol
, Buffon, Exp. sur les végét. 2e mém.Le chêne un jour dit au roseau?: Vous avez bien sujet d'accuser la nature?; Un roitelet pour vous est un pesant fardeau
, La Fontaine, Fables, I, 22.Chêne vert, yeuse, variété de chêne qui conserve ses feuilles en toute saison.
Chêne rouvre, autre variété très grande (quercus robur).
Familièrement. Payer en feuilles de chêne, payer en effets sans valeur.
Pomme de chêne, voy. NOIX de galle.
Il se porte, il est fort comme un chêne, se dit d'une santé très robuste.
Fig.
L'Académie, moins hardie que nos grands écrivains, ou, si l'on veut, plus timide en masse que dans chacun de ses membres, n'avait-elle pas trop restreint les richesses de notre langue, trop ébranché le vieux chêne gaulois??
Villemain, Préf. du Dict. de l'Acad. 1835. -
2Le bois de chêne travaillé. Un buffet de chêne.
Le bois de chêne à brûler. Je ne brûle que du chêne.
-
3Chêne-saule, arbre d'Amérique.
Les chênes-saules dont la rivière était bordée y répandaient l'ombre
, Chateaubriand, Amér. II, 137.Petit chêne, un des noms vulgaires de la germandrée.
- 4 Terme d'astronomie. Chêne de Charles II, petite constellation méridionale.
PROVERBES
Petit homme abat grand chêne, c'est-à-dire une force petite mais intelligente vient à bout de grandes choses.
On n'abat pas un chêne du premier coup.
HISTORIQUE
XIIe s. Cume li muls vint suz [sous] un grand chaigne e ki mult out branches, une des branches aerst Absalon par la tresce
, Rois, 186.
XIIIe s. Li pors li vint gole baée, Et li chevaliers tint s'espée?; à un chesne s'est afichié
, Ren. 22507.
XIVe s. L'amour d'une pucelle n'est pas si tost gaingnie?; Au premier cop li kaisnes, che dist-on, ne kiet [tombe] mie
, Baud. de Seb. V, 666.
XVIe s. Les autres meirent à l'entour de leurs testes des chapeaux de branches de chesne
, Amyot, Pyrrhus, 22. Et jusques à mon temps encore monstroit on un vieil chesne, que ceulx du païs appeloient communement le chesne d'Alexandre
, Amyot, Alex. 13. Le nom de chesne a esté particulierement donné au quercus, estant le robur appellé roure, et l'ilex l'yeuse. L'yeuse est aussi appellé en France chesnevert
, De Serres, 794 et 795.
PROVERBES
Petit homme abbat bien un grand chesne, et douce parolle grand ire,
Gabriel Meurier, Trésor de sentences dorées, dans LEROUX DE LINCY, t. I, p. 62. D'un petit gland sourd [sort] un grand chesne
, Leroux de Lincy, ib.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
CHÊNE. Ajoutez?: Chêne liége, quercus suber, L.
Encyclopédie, 1re édition
CHÊNE, s. m. quercus, (Hist. nat. Bot.) genre d'arbre qui porte des chatons composés de sommets attachés en grand nombre à un petit filet. Les embryons naissent séparément des fleurs sur le même arbre, & deviennent dans la suite un gland enchassé dans une espece de coupe, & qui renferme un noyau que l'on peut séparer en deux parties. Ajoûtez aux caracteres de ce genre que les feuilles sont découpées en sinus assez profonds. Tournefort, Inst. rei herb. Voyez Plante. (I)
Le chêne est le premier, le plus apparent, & le plus beau de tous les végétaux qui croissent en Europe. Cet arbre naturellement si renommé dans la haute antiquité ; si chéri des nations Greques & Romaines, chez lesquelles il était consacré au pere des dieux, si célebre par le sacrifice de plusieurs peuples ; cet arbre qui a fait des prodiges, qui a rendu des oracles, qui a reçû tous les honneurs des mysteres fabuleux, fut aussi le frivole objet de la vénération de nos peres, qui faussement diriges par des druides trompeurs, ne rendoient aucun culte que sous les auspices du gui sacré : mais ce même arbre, considéré sous des vûes plus saines, ne sera plus à nos yeux qu'un simple objet d'utilité ; il méritera à cet égard quelques éloges, bien moins relevés, il est vrai, mais beaucoup mieux fondés.
En effet, le chêne est le plus grand, le plus durable, & le plus utile de tous les arbres qui se trouvent dans les bois ; il est généralement répandu dans les climats tempérés, où il fait le fondement & la meilleure essence des plus belles forêts. Cet arbre est si universellement connu, qu'il n'a pas besoin des secours équivoques de la Botanique moderne pour se faire distinguer ; il s'annonce dans un âge fait, par une longue tige, droite, & d'une grosseur proportionnée à sa hauteur, qui surpasse ordinairement celle de tous les autres arbres. Sa feuille se fait remarquer sur-tout par sa configuration particuliere ; elle est oblongue, plus large à son extrémité, & découpée dans les bords par des sinuosités arrondies en-dehors & en-dedans, qui ne sont constantes ni dans leur nombre, ni dans leur grandeur, ni dans leur position. Comme cet arbre est un peu lent à croître, il vit aussi fort long-tems, & son bois est le plus durable de tous, lorsqu'il est employé, soit à l'air, soit à l'abri, dans la terre, & même dans l'eau, où on ne compte sa durée que par un nombre de siecles. Le chêne, par rapport à la masse, au volume, à la force, & à la durée de son bois, tient donc le premier rang parmi les arbres forestiers, c'est en effet la meilleure essence de bois qu'on puisse employer pour des plantations de taillis & de futaie. Dans un terrein gras il prend trois piés de tour en trente ans ; il croît plus vite alors, & il fait ses plus grands progrès jusqu'à quarante ans. Comme l'exposition & la qualité du terrein décident principalement du succès des plantations, voici sur ce point essentiel des observations à l'égard du chêne.
Exposition. Terrein. Presque toutes les expositions, tous les terreins conviennent au chêne ; le fond des vallées, la pente des collines, la crête des montagnes, le terrein sec ou humide, la glaise, le limon, le sable ; il s'établit par-tout : mais il en résulte de grandes différences dans son accroissement & dans la qualité de son bois. Il se plaît & il réussit le mieux dans les terres douces, limonneuses, profondes, & fertiles ; son bois alors est d'une belle venue, bien franc, & plus traitable pour la fente & la Menuiserie : il profite très-bien dans les terres dures & fortes, qui ont du fond, & même dans la glaise ; il y croît lentement, à la vérité, mais le bois en est meilleur, bien plus solide & plus fort : il s'accommode aussi des terreins sablonneux, cretassés ou graveleux, pourvû qu'il y ait assez de profondeur : il y croît beaucoup plus vîte que dans la glaise ; & son bois est plus compacte & plus dur ; mais il n'y devient ni si gros ni si grand. Il ne craint point les terres grasses & humides, où il croît même très-promptement ; mais c'est au desavantage du bois, qui étant trop tendre & cassant, n'a ni la force, ni la solidité requise pour la charpente ; il se rompt par son propre poids lorsqu'il y est employé. Si le chêne se trouve au contraire sur les crêtes des montagnes, dans des terres maigres, seches ou pierreuses, où il croît lentement, s'éleve, peut & veut être coupé souvent ; son bois alors étant dur, pesant, noueux, on ne peut guere l'employer qu'en charpente, & à d'autres ouvrages grossiers. Enfin cet arbre se refuse rarement, & tout au plus dans la glaise trop dure, dans les terres basses & noyées d'eau, & dans les terreins si secs & si legers, si pauvres & si superficiels, que les arbrisseaux les plus bas n'y peuvent croître ; c'est même la meilleure indication sur laquelle on puisse se regler lorsqu'on veut faire des plantations de chêne : en voici la direction.
Plantations. Si nous en croyons les meilleurs auteurs Anglois qui ayent traité cette matiere, Evelyn, Hougton, Laurence, Mortimer, & sur-tout M. Miller qui est entré dans un grand détail sur ce point ; il faudra de grandes précautions, beaucoup de culture & bien de la dépense pour faire des plantations de chênes. Cependant, comme les Anglois se sont occupés, avant nous, de cette partie de l'agriculture, parce qu'ils en ont plûtôt senti le besoin, & que M. Miller a rassemblé dans la sixieme édition de son dictionnaire, tout ce qui paroît y avoir du rapport, j'en vais donner un précis. Après avoir conseillé de bien enclorre le terrein par des hayes pour en défendre l'entrée aux bestiaux, aux lievres & aux lapins, qui sont les plus grands destructeurs des jeunes plantations ; l'auteur Anglois recommande de préparer la terre par trois ou quatre labours, de la bien herser à chaque fois, & d'en ôter toutes les racines des mauvaises herbes ; il dit que si le terrein étoit inculte, il seroit à propos d'y faire une récolte de légume, avant que d'y semer le gland : qu'il faut préférer celui qui a été recueilli sur les arbres les plus grands & les plus vigoureux, sur le fondement que les plants qui en proviennent profitent mieux, & qu'on doit rejetter le gland qui a été pris sur les arbres dont la tête est fort étendue, quoique ce soit celui qui leve le mieux. On pourra semer le gland en automne ou au printems ; suivant notre auteur, le meilleur parti sera de le semer aussi-tôt qu'il sera mûr, pour éviter l'inconvénient de rompre les germes en le mettant en terre au printems, après l'avoir conservé dans du sable. Pour les grandes plantations on fera avec la charrue des sillons de quatre piés de distance, dans lesquels on placera les glands à environ deux pouces d'intervalle ; & si le terrein a de la pente, il faudra diriger les sillons de façon à ménager l'humidité, ou à s'en débarrasser selon que la qualité du terrein l'exigera. Il faudra ensuite recouvrir exactement les glands, de crainte que ceux qui resteroient découverts, n'attirassent les oiseaux & les souris qui y feroient bien-tôt un grand ravage. L'auteur rend raison des quatre piés de distance qu'il conseille de donner aux sillons ; c'est, dit-il, afin de pouvoir cultiver plus facilement la terre entre les rangées, & nettoyer les jeunes plants des mauvaises herbes ; sans quoi on ne doit pas s'attendre que les plantations fassent beaucoup de progrès. Les mauvaises herbes qui dominent bien-tôt sur les jeunes plants, les renversent & les étouffent, ou du moins les affament en tirant les sucs de la terre. C'est ce qui doit déterminer à faire la dépense de cultiver ces plantations pendant les huit ou dix premieres années. Les jeunes plants, continue notre auteur, leveront sur la fin de Mars ou au commencement d'Avril ; mais il faudra les sarcler même avant ce tems-là, s'il en étoit besoin, & répeter ensuite cette opération aussi souvent que les herbes reviennent, en sorte que la terre s'en trouve nettoyée, jusqu'à ce que tous les glands soient levés & qu'on puisse les appercevoir distinctement ; auquel tems il sera à propos de leur donner un labour avec la charrue entre les rangées, & même une legere culture à la main dans les endroits où la charrue ne pourroit atteindre sans renverser les jeunes plants. Quand ils auront deux ans, il faudra enlever ceux qui seront trop serrés, & donner à ceux qui resteront un pié de distance, qui suffira pour les laisser croître pendant deux ou trois ans ; après lesquels on pourra juger des plants qui pourront faire les plus beaux arbres, & faire alors un nouveau retranchement qui puisse procurer aux plants quatre piés de distance dans les rangées ; ce qui leur suffira pour croître pendant trois ou quatre ans ; auquel tems si la plantation a fait de bons progrès, il sera a propos d'enlever alternativement un arbre dans les rangées ; mais notre auteur ne prétend pas qu'il faille faire cette réforme si régulierement qu'on ne puisse pas excéder ou réduire cette distance, en laissant par préférence les plants qui promettent le plus ; il ne propose même cet arrangement que comme une regle générale qu'on ne doit suivre qu'autant que la disposition & le progrès de la plantation le permettent. Quand par la suite les plants auront encore été réduits dans leur nombre, & portés à environ huit piés de distance, ils ne demanderont plus aucun retranchement ; mais après deux ou trois ans, il sera à propos de couper pour en faire des sepées de taillis, les plants qui paroîtront les moins disposés à devenir futaye, & qui se trouveront dominés par les arbres destinés à rester. C'est l'attention qu'on doit avoir toutes les fois qu'on fait quelque réforme parmi les arbres, avec la précaution de ne dégarnir que par dégrés & avec beaucoup de ménagement les endroits fort exposés aux vents, qui y feroient de grands ravages & retarderoient l'accroissement. L'auteur Anglois voudroit qu'on donnât vingt-cinq à trente piés de distance aux arbres qu'on a dessein d'élever en futaie ; ils pourront joüir en ce cas de tout le bénéfice du terrein ; ils ne seront pas trop serrés, même dans les endroits où ils réussissent bien ; leurs têtes ne se toucheront qu'à trente ou trente-cinq ans ; & il n'y aura pas assez d'éloignement pour les empêcher de faire des tiges droites. Mais après une coupe ou deux du taillis, notre auteur conseille d'en faire arracher les souches, afin que tous les sucs de la terre puissent profiter à la futaie : la raison qu'il en apporte, est que le taillis ne profite plus, dès qu'il est dominé par la futaye qui en souffre également ; car on gâte souvent l'un & l'autre, en voulant ménager le taillis dans la vûe d'un profit immédiat.
Toute cette suite de culture méthodique peut être fort bonne pour faire un canton de bois de vingt ou trente arpens, encore dans un pays où le bois seroit très-rare, & tout au plus aux environs de Paris où il est plus cher que nulle part dans ce royaume : mais dans les provinces, la dépense en seroit énorme pour un canton un peu considérable. J'ai vû que pour planter en Bourgogne, dans les terres de M. de Buffon, un espace d'environ cent arpens, où il commença à suivre exactement la direction dont on vient de voir le précis, une somme de mille écus ne fut pas suffisante pour fournir aux frais de plantation & de culture pendant la premiere année seulement : qu'on juge du résultat de la dépense, si l'on avoit continué la même culture pendant huit ou dix ans, comme M. Miller le conseille ; le canton des plantations en question auroit coûté six fois plus cher qu'un bois de même étendue qu'on auroit acheté tout venu & prêt à couper dans un terrein pareil : encore la plantation n'a-t-elle pas pleinement réussi par plusieurs inconvéniens auxquels une culture plus longue & plus assidue n'auroit pas rémédié. Un de ces inconvéniens, c'est de nettoyer le terrein des ronces, épines, genievres, bruyeres, &c. Un plus grand ?uvre, qui le croiroit ? c'est de donner plusieurs labours à la terre ; cette opération coûteuse sert, on en convient, à faire bien lever le gland, mais elle tourne bien-tôt contre son progrès : les mauvaises herbes qui trouvent la terre meuble, la couvrent au-dehors, & la remplissent de leurs racines au-dedans ; on ne peut guere s'en débarrasser sans déranger les jeunes plants, parce qu'il faut y revenir souvent dans un terrein qu'on commence à mettre en culture. Mais d'ailleurs, plus la terre a été remuée, plus elle est sujette à l'impression des chaleurs, des sécheresses & sur-tout des gelées du premier hyver, qui déracinent les jeunes plants, & leur font d'autant plus de dommage que la plantation se trouve mieux nettoyée & découverte. Le printems suivant y fait appercevoir un grand dépérissement ; la plûpart des jeunes plants se trouvent flétris & desséchés ; d'autres fort languissans ; & ceux qui se sont soûtenus, auront encore infiniment à souffrir, malgré tous les efforts de la culture la plus suivie, qui n'accelerent point le progrès dans les terres fortes & glaireuses, dures ou humides. En essayant au contraire à faire dans un pareil terrein des plantations par une méthode toute opposée, M. de Buffon a éprouvé des succès plus satisfaisans, & peut-être vingt fois moins dispendieux, dont j'ai été témoin. Ce qui fait juger que dans ces sortes de terreins comme dans ceux qui sont legers & sablonneux, où il a fait aussi de semblables épreuves, on ne réussit jamais mieux pour des plantations en grand, qu'en imitant de plus près la simplicité des opérations de la nature. Par son seul procédé, les bois, comme l'on sçait, se sement & se forment sans autre secours ; mais comme elle y employe trop de tems, il est question de l'accélérer : voici les moyens d'y parvenir : ménager l'abri, semer abondamment & couper souvent ; rien n'est plus avantageux à une plantation que tout ce qui peut y faire du couvert & de l'abri ; les genets, le jonc, les épines & tous les arbrisseaux les plus communs garantissent des gelées, des chaleurs, de la secheresse, & sont une aide infiniment favorable aux plantations. On peut semer le gland de trois façons ; la plus simple & peut-être la meilleure dans les terreins qui sont garnis de quelques buissons, c'est de cacher le gland sous l'herbe dont les terres fortes sont ordinairement couvertes ; on peut aussi le semer avec la pioche dont on frappe un coup qui souleve la terre sans la tirer dehors, & laisse assez d'ouverture pour y placer deux glands ; ou enfin avec la charrue en faisant des sillons de quatre piés en quatre piés, dans lesquels on répand le gland avec des graines d'arbrisseaux les plus fréquens dans le pays, & on recouvre le tout par un second sillon. On employe la charrue dans les endroits les plus découverts ; on se sert de la pioche dans les plants impraticable à la charrue, & on cache le gland sous l'herbe autour des buissons. Nul autre soin ensuite que de garantir la plantation des approches du bétail, de repiquer des glands avec la pioche pendant un an ou deux dans les plants où il en aura trop manqué, & ensuite de receper souvent les plants languissans, rassaux, étiolés ou gelés, avec ménagement cependant, & l'attention sur-tout de ne pas trop dégarnir la plantation, que tout voisinage de bois, de hayes, de buissons favorise aussi. Voyez dans les Mémoires de l'académie des Sciences, celui de M. de Buffon sur la culture & le rétablissement des forêts, année 1739. On pourroit ajoûter sur cette matiere des détails intéressans que cet ouvrage ne permet pas. J'appuierai seulement du témoignage de Bradley cette méthode aussi simple que facile, qui a réussi sous mes yeux : « Pour éviter, dit-il, la dépense de sarcler les plantations, on en a fait l'essai sur des glands qui avoient été semés ; & les herbes, loin de faire aucun mal, ont défendu les jeunes chênes contre les grandes sécheresses, les grandes gelées, &c. ». Je citerai encore Ellis, autre auteur Anglois plus moderne, qui assûre qu'il ne faut pas sarcler une plantation ou un semis de chênes. Ces auteurs auroient pû dire de plus, que non-seulement on diminue la dépense par-là, mais même que l'on accélere l'accroissement, surtout dans les terreins dont nous venons de parler.
A tous égards, l'automne est la saison la plus propre à semer le gland, même aussi-tôt qu'il est mûr ; mais si l'on avoit des raisons pour attendre le printems, il faudroit le faire passer l'hyver dans un conservatoire de la façon qu'on l'a expliqué au mot Châtaigner ; & ensuite le semer aussi-tôt que la saison pourra le permettre, sans attendre qu'il soit trop germé ; ce qui seroit un grand inconvénient.
Le chêne peut aussi se multiplier de branches couchées, qui ne font pas de si beaux arbres que ceux venus de gland ; & par la greffe, sur des arbres de son espece ; mais on ne se sert guere de ces moyens que pour se procurer des especes curieuses & étrangeres.
Transplantation. Il y a quelques observations à faire sur la transplantation de cet arbre, qui ne gagne jamais à cette opération ; il y résiste mieux à deux ans qu'à tout autre âge, par rapport au long pivot qu'il a toûjours, & qui le prive ordinairement de racines latérales : d'où il suit que, quand on se propose d'employer le chêne en avenues ou autres usages semblables, il faut avoir la précaution de le transplanter plusieurs fois auparavant afin qu'il soit bien enraciné. On ne doit jamais l'étêter en le transplantant ; c'est tout ce qu'il craint le plus, mais seulement retrancher ses principales branches : on ne doit même s'attendre ensuite qu'à de petits progrès, & rarement à voir de beaux arbres.
Usages du bois. Nul bois n'est d'un usage si général que celui du chêne ; il est le plus recherché & le plus excellent pour la charpente des bâtimens, la construction des navires ; pour la structure des moulins, des pressoirs, pour la menuiserie, le charronnage, le mairrain ; pour des treillages, des échalas, des cercles ; pour du bardeau, des éclisses, des lattes, & pour tous les ouvrages où il faut de la solidité, de la force, du volume, & de la durée ; avantages particuliers au bois de chêne, qui l'emporte à ces égards sur tous les autres bois que nous avons en Europe. Sa solidité répond de celle de toutes les constructions dont il forme le corps principal ; sa force le rend capable de soûtenir de pesans fardeaux dont la moitié feroit fléchir la plûpart des autres bois ; son volume ne le cede à nul autre arbre, & sa durée va jusqu'à six cents ans, sans altération, lorsqu'il est à couvert des injures de l'air : la seule condition que ce bois exige, est d'être employé bien sec & saisonné, pour l'empêcher de se fendre, de se tourmenter, & de se décomposer ; précaution qui n'est plus nécessaire, quand on veut le faire servir sous terre & dans l'eau en pilotis, où on estime qu'il dure quinze cents ans, & où il se pétrifie plus ordinairement qu'aucun autre bois. Quand on est forcé cependant d'employer à l'air du bois verd, sans avoir le tems de le faire saisonner, on peut y suppléer en faisant tremper ce bois dans de l'eau pendant quelque tems. Ellis en a vû une épreuve qu'il rapporte : « Un plancher qui avoit été fait de planches de chêne, qu'on avoit fait tremper dans l'eau d'un étang, se trouva fort sain au bout de quatorze ans, tandis qu'un autre plancher tout voisin, fait de mêmes planches, mais qui n'avoient pas été mises dans l'eau, étoit pourri aux côtés & aux extrémités des planches ». C'est aussi l'un des meilleurs bois à brûler & à faire du charbon. Les jeunes chênes brûlent & chauffent mieux, & font un charbon ardent & de durée ; les vieux chênes noircissent au feu ; & le charbon qui s'en va par écailles, rend peu de chaleur, & s'éteint bientôt ; & les chênes pelards, c'est-à-dire dont on a enlevé l'écorce sur pié, brûlent assez bien, mais rendent peu de chaleur.
Aubier du bois. On distingue dans le bois du chêne l'aubier & le c?ur : l'aubier est une partie de bois qui environne le tronc à l'extérieur, qui est composé de douze ou quinze cercles ou couches annuelles, & qui a ordinairement un pouce & demi d'épaisseur, quand l'arbre a pris toute sa grosseur : l'aubier est plus marqué & plus épais dans le chêne, que dans les autres arbres qui en ont un, & il est d'une couleur différente & d'une qualité bien inférieure à celle du c?ur du bois : l'aubier se pourrit promptement dans les lieux humides ; & quand il est placé séchement, il est bien-tôt vermoulu, & il corrompt tous les bois voisins ; aussi fait-il la plus grande défectuosité du bois de chêne ; & il est défendu aux ouvriers par leurs statuts d'employer aucun bois où il y ait de l'aubier. Mais on peut corriger ce défaut, & donner à l'aubier presque autant de solidité, de force, & de durée, qu'en a le c?ur du bois de chêne : « Il ne faut pour cela, dit M. de Buffon, qu'écorcer l'arbre du haut en-bas, & le laisser sécher entierement sur pié avant de l'abattre » ; & par les épreuves qu'il a faites à ce sujet, il résulte que « le bois des arbres écorcés & sechés sur pié, est plus dur, plus solide, plus pesant, & plus fort que le bois des arbres abattus dans leur écorce ». Voyez les mémoires de l'académie des Sciences, année 1738.
Ecorce. On fait aussi usage de l'écorce du chêne : les Tanneurs l'employent à façonner les cuirs ; mais l'écorce n'est pas l'unique partie de l'arbre qui ait cette propriété. M. de Buffon, par les épreuves qu'il a fait faire sur des cuirs, & dont il a été fait mention dans les mémoires de l'académie, s'est assûré que le bois du chêne a la même qualité, avec cette différence pourtant, que l'écorce agit plus fortement sur les cuirs que le bois, & le c?ur du bois moins que l'aubier. On appelle tan l'écorce qui a passé les cuirs, & qui alors n'est pas tout-à-fait inutile ; le tan sert à faire des couches dans les serres chaudes & sous des chassis de verre, pour élever & garantir les plantes étrangeres & délicates.
Gland. Il y a du choix à faire & des précautions à prendre pour la récolte du gland, lorsqu'on veut faire des plantations. Si nous en croyons Evelyn, « il faut que les glands soient parfaitement murs, qu'ils soient sains & pesans ; ce qui se reconnoît, lorsqu'en secouant doucement les rameaux, le gland tombe : il ne faudra cueillir que vers la fin d'Octobre, ou au commencement de Novembre, ceux qui ne tomberont pas aisément ; & il faut ramasser sur le champ celui qui tombe de lui-même ; mais toujours le prendre par préférence sur le sommet des arbres les plus beaux, les plus jeunes, & les plus vigoureux, & non pas comme l'on fait ordinairement, sur les arbres qui en portent le plus ». On peut ajoûter aux circonstances qui doivent contribuer au choix du gland, celle de sa grosseur ; parce qu'en effet, c'est la plus belle espece de chêne qui produit le gros gland à longue queue, & qu'il est probable que ce gland produira des arbres de même espece. Ce fruit est aussi de quelque utilité ; il sert à nourrir les bêtes sauves, à engraisser les cochons ; & il est aussi fort bon pour la volaille. Voyez Gland.
Gui de chêne. On attribuoit autrefois de grandes vertus à cette plante parasite, lorsqu'on la trouvoit sur le chêne. Les druides faisoient accroire qu'il fécondoit les animaux, & que c'étoit un fameux contre-poison ; on lui en attribue encore quelques-unes en Medecine, & il est recherché dans les Arts pour sa dureté & pour la beauté de ses veines. Quoi qu'il en soit, on trouve très-rarement du gui sur le chêne ; & cette rareté pourroit bien être son seul mérite : nous n'en pouvons que trop juger par bien des choses que l'on voit tous les jours prendre faveur par ce seul titre.
Excrescences. Le chêne est peut-être de tous les arbres celui qui est le plus sujet à être attaqué par différentes especes d'insectes : ils font des excrescences de toutes sortes, sur les branches, le gland, les feuilles, & jusque sur les filets des chatons, où quelquefois le travail des insectes forme de ces excrescences qui imitent si bien une grappe de groseille rougeâtre, que bien des gens s'y trompent de loin. Les insectes forment aussi sur certaines especes de chêne des gales dont on tire quelque service dans les Arts. Voyez Noix de gale. Cette défectuosité, aussi bien que l'irrégularité de la tête de l'arbre, & la lenteur de ses progrès après la transplantation, peuvent bien être les vraies causes de ce que l'on fait si peu d'usage du chêne pour l'ornement des jardins.
Especes. Il y a des chênes de bien des especes ; les Botanistes en comptent au moins quarante, qui ne sont pour la plûpart ni répandus, ni fort connus : on doit y avoir d'autant moins de regret, que nos chênes communs valent beaucoup mieux pour la qualité du bois, que tous ceux qui ont été découverts dans le Levant & en Amérique ; il faut cependant convenir que les chênes d'Amérique ont plus de variété & d'agrément que les autres.
1. Le chêne à gros gland. Celui que C. Bauhin appelle chêne à long pédicule, est le plus grand & le plus beau de tous les chênes qui croissent en Europe. On le distingue dans son jeune âge par son écorce qui est vive, luisante & unie, d'une couleur d'olive rembrunie, irrégulierement entre-mêlée, avec une couleur de cendre claire : ses feuilles sont plus grandes, & ont le pédicule plus long que dans les autres especes ; le gland est aussi plus gros & plus long ; l'arbre le produit sur un pédicule de la longueur du doigt, qui souvent n'en porte qu'un seul, & quelquefois jusqu'à trois. Son bois est franc, d'un bel ?il, & de la meilleure qualité.
2. Le chêne à gland moyen, désigné par le même botaniste sous la phrase de chêne mâle à pédicule court. Cet arbre dans toutes ses parties est subordonné à la premiere espece ; sa feuille est moins grande, son gland est plus petit, plus rond, & a le pédicule de moitié plus court, l'arbre même est d'une stature un peu moindre : il se fait remarquer sur-tout dans sa jeunesse par la couleur de son écorce, qui imite celle d'une peau d'oignon, & qui est entre-mêlée de parties blanchâtres. Le bois de cet arbre est solide, fort, & de bonne qualité.
3. Le chêne à petit gland que le nomenclateur cité appelle le chêne femelle. On reconnoît aisément cet arbre, à ce que son écorce est inégale, & qu'avant qu'il soit même parvenu à la grosseur du bras, elle est aussi crevassée & raboteuse que celle des vieux arbres : ses feuilles plus petites que dans les especes précédentes, n'ont point de pédicule ; le gland, qui est aussi bien plus petit & rond, tient immédiatement à la branche ; l'arbre s'éleve & grossit moins ; son bois est dur, rebours, & de mauvaise fente : il semble à tous égards que la nature ait épargné sur cette espece, ce qu'elle a prodigué en faveur de la premiere.
4. Le chêne a feuilles panachées. C'est une variété que le hasard a fait rencontrer, mais que l'on peut cependant multiplier par la greffe en fente ou en écusson sur les especes communes. Ses feuilles sont généralement panachées de blanc, & d'une très-belle façon ; aussi cet arbre est-il fort estimé des curieux qui aiment les plantes panachées.
5. Le chêne toûjours verd. Cet arbre croît naturellement en Espagne, entre Cadix & Gibraltar ; mais on le trouve rarement à présent parmi les collections d'arbres, même les plus recherchées & les plus completes. On fait cependant qu'il est assez robuste ; il faut donc qu'il soit difficile à élever. Au reste on ne doit pas confondre cette espece de chêne avec ce que nous appellons le chêne-verd, qui est un arbre tout différent.
6. Le chêne cerrus. Quoique cet arbre soit originaire d'Espagne, d'Italie, & des provinces méridionales de ce royaume, il est cependant assez robuste pour résister parfaitement au froid des climats septentrionaux : sa feuille ressemble à celle du chêne commun, si ce n'est qu'elle est plus longue, & que les sinuosités qui l'environnent sont plus étroites & plus profondes : son gland est fort amer, & il est presqu'entierement engagé dans une calote qui est entourée de follicules pointus & de couleur cendrée : on s'en sert au lieu de galle pour teindre les draps en noir, mais la teinture n'en est pas si-bonne. C'est une des plus belles especes de chêne, & en général il a le port & à-peu-près la hauteur du chêne commun.
7. Le petit chêne, cerrus. Son gland est plus petit que celui de l'espece précédente. Ce petit arbre est peu connu.
8. Le petit chêne portant plusieurs galles jointes ensemble. Ce n'est qu'un arbrisseau, dont on ne sait rien d'intéressant.
9. Le chêne, esculus. Ce petit arbre auquel on a conservé le nom que Pline le naturaliste lui avoit donné, croît en Grece & en Dalmatie.
10. Le chêne de Bourgogne. C'est un grand arbre qui croît naturellement en Franche-Comté, & qui est sur-tout remarquable par le calice de son gland, qui est hérissé de pointes assez longues, mais foibles ; du reste l'arbre est assez ressemblant au chêne commun.
11. Le chêne nain. C'est un très-petit arbrisseau, que j'ai vû s'élever tout au plus à trois piés en 15 ans de tems, dans un terrein cultivé : mais dans les campagnes où il croît naturellement, il est si bas que rarement il a plus d'un pié : ses feuilles sont plus douces & un peu plus grandes que celles de nos chênes communs ; le calice du gland est plus plat, & ce gland est très-amer.
12. Le chêne roure. Il prend autant de hauteur que nos chênes communs. Il croît en plusieurs provinces de ce royaume, & on le trouve fréquemment aux environs d'Aubigny : sa feuille le fait distinguer principalement par une espece de duvet qui la couvre, son gland est si fort enveloppé dans le calice, qu'il ne mûrit pas bien en Angleterre dans les années humides.
13. Le petit chêne roure. Il differe du précédent par sa stature qui est inférieure, & par sa feuille qui est garnie de petites pointes.
14. Le chêne roure portant galles. C'est un petit arbre qui croît dans la Pannonie & dans l'Istrie, & sur lequel on trouve la noix de galle dont on fait usage pour la teinture.
15. Le chêne roure à feuilles lices. On trouve la noix de galle sur cet arbre, qui differe des trois précédens par ses feuilles qui n'ont point de duvet.
16. Le chêne à gros gland, dont le calice est tout couvert de tubercules. Ce n'est qu'une variété, qui est plus rare qu'intéressante.
17. Le chêne d'Orient à gland cylindrique, avec un long pédicule. C'est un petit arbre très-rare.
18. Le chêne d'Orient à feuilles de châtaigner. C'est un arbre de hauteur moyenne, dont le gland est renfermé dans un calice épais & écailleux.
19. Le chêne d'Orient à très-gros gland, dont le calice est hérissé de filets. C'est un grand arbre peu connu.
20. Le chêne d'Orient à feuilles étroites & à petit gland, avec un calice hérissé de pointes. Cet arbre est de petite stature.
21. Le chêne d'Orient à très-gros gland, & à feuilles agréablement découpées. Le calice du gland est aussi hérissé de filets. Cet arbre ne s'éleve qu'à une moyenne hauteur.
22. Le chêne d'Orient à petites feuilles arrondies, & à gland cannelé. Cet arbre s'éleve peu.
23. Le chêne d'Orient à gland cylindrique, & à feuilles arrondies, legerement découpées. Cet arbre prend peu de hauteur.
Ces sept dernieres especes de chêne ont été découvertes dans le Levant par Tournefort, & y ont été retrouvées depuis, suivant le témoignage de M. Miller, par quelques voyageurs, qui en ont rapporté des glands en Angleterre, où trois de ces especes ont réussi, & paroissent aussi robustes que nos chênes communs. Quoi qu'il en soit, ces arbres sont encore très-rares, & très-peu connus.
24. Le chêne rouge de Virginie. Il croît plus promptement que le chêne commun, & il fait un gros arbre en peu d'années : sa feuille a moins de sinuosités que n'en ont celles de nos chênes, & les angles du dehors qui sont plus grands se terminent en pointes : la queue de cette feuille est toûjours rougeâtre, & ce n'est qu'en automne que toute la feuille prend aussi cette couleur. Cet arbre est délicat dans sa jeunesse ; j'ai vû que les hyvers rigoureux ont constamment fait périr les plants d'un an & de deux ans, dans les terreins secs comme dans ceux qui étoient un peu humides. Le bois de cet arbre a des veines rouges.
25. Le chêne de Virginie à feuilles de châtaigner. Il croît aussi vîte, & devient aussi gros que le précédent. Il ne vient à la Virginie que dans des fonds, & dans les bons terreins : c'est le plus gros des chênes qui croissent dans l'Amérique : l'écorce en est blanche & écaillée ; le grain du bois n'est pas beau, quoiqu'on s'en serve beaucoup pour la charpente ; les feuilles sont larges & dentelées comme celles du châtaigner. Il n'y a point d'autre chêne qui produise des glands aussi gros que celui-ci. Catesby.
26. Le chêne blanc de Virginie. C'est celui qui ressemble le mieux au chêne commun d'Angleterre, à la figure de ses feuilles, à ses glands, & à sa maniere de croître : son écorce est blanchâtre, le grain de son bois fin ; & c'est pour cela, aussi-bien que pour sa durée, qu'on le regarde à la Caroline & à la Virginie comme la meilleure espece de chêne. Il croît sur toutes sortes de terroirs, & principalement parmi les pins, dans les lieux élevés & stériles. Catesby.
Cette espece de chêne a bien réussi dans les plantations de M. de Buffon en Bourgogne. L'écorce de cet arbre est en effet blanchâtre ; sa feuille est plus grande, & d'un verd plus pâle que celle de nos chênes communs ; mais il croît plus vîte d'environ un tiers : il s'accommode mieux des mauvais terreins, & il est très-robuste ; ce qui doit faire juger qu'il seroit bien avantageux de multiplier cet arbre.
27. Le chêne de Virginie à feuilles de saule. C'est un arbre de moyenne hauteur, dont la feuille qui ressemble à celle du saule, est encore plus longue, & dont le gland est très-petit.
28. Le chêne toûjours verd, à feuilles oblongues, & sans sinuosités. Sa hauteur ordinaire est d'environ quarante piés. Le grain du bois est grossier, plus dur & plus rude que celui d'aucun autre chêne : il devient plus gros au bord des marais salés où il croît ordinairement. Son tronc est irrégulier, & la plûpart du tems panché, & pour ainsi dire couché ; ce qui vient de ce que le terrein étant humide, a peu de consistance, & que les marées emportent la terre qui doit couvrir les racines : dans un terrein plus élevé ces arbres sont droits, & ont la cime réguliere & pyramidale, & conservent leurs feuilles toute l'année. Leur gland est plus doux que celui de tous les autres chênes. Les Indiens en font ordinairement provision, & s'en servent pour épaissir les soupes qu'ils font avec de la venaison : ils en tirent une huile très-agréable & très-saine, qui est presque aussi bonne que celle d'amande. Catesby.
29. Le chêne noir. C'est un arbre de moyenne hauteur, dont la feuille pour la forme approche de celle du sassafras. Cet arbre, au rapport de Catesby, croît ordinairement dans un mauvais terrein : il est petit, & a l'écorce noire, le grain grossier, & le bois ne sert guere qu'à brûler. Quelques-uns de ces arbres ont des feuilles larges de dix pouces.
30. Le chêne d'eau d'Amérique. C'est un arbre de moyenne hauteur, dont la feuille sans dentelure se termine par une espece de triangle : il ne croît que dans les fonds pleins d'eau. La charpente qu'on en fait n'est pas durable ; ainsi on ne s'en sert guere que pour clorre les champs. Quand les hyvers sont doux, il conserve la plûpart de ses feuilles. Les glands qu'il porte sont petits & amers. Catesby.
31. Le chêne blanc de la Caroline. C'est un arbre de moyenne hauteur, qui a des veines verdâtres. Suivant Catesby, ses feuilles ont les entaillures profondes, & les pointes fort aiguës ; son écorce & son bois sont blancs, mais le grain n'est pas si serré que celui du précédent.
32. Le petit chêne à feuilles de saule. C'est un arbrisseau dont la feuille, quoique ressemblante à celle du saule, est néanmoins plus courte. Cet arbre, dit Catesby, est ordinairement petit ; son écorce est d'une couleur obscure, & ses feuilles d'un verd pâle, de la même figure que celle du saule : il croît dans un terrein sec & maigre ; il ne produit que peu de gland, encore est-il fort petit.
33. Le chêne rouge de Marylande. C'est un grand arbre dont les feuilles découpées comme celles du chêne esculus, sont plus grandes, & garnies de pointes. Les feuilles de ce chêne, au rapport de Catesby, n'ont point de figure déterminée ; mais elles sont beaucoup plus variées entre elles que celles des autres chênes : il en est de même du gland. L'écorce de cet arbre est d'un brun obscur, très-épaisse & très forte ; elle est préférable à toute autre pour tanner. Son bois a le grain grossier ; il est spongieux, & peu durable. Il croît dans un terroir élevé.
34. Le chêne d'eau d'Espagne. C'est un petit arbre dont la feuille ressemble à celle de l'olivier, & dont le gland est comprimé & joliment terminé par une houpe de filets.
35. Le chêne de Marylande. C'est un arbre de moyenne hauteur, dont la feuille qui ressemble à celle du châtaigner est velue en-dessous.
36. Le chêne saule. On ne trouve jamais cet arbre que dans les fonds humides : les feuilles en sont longues, étroites, & unies aux extrémités comme celles du saule : le bois en est tendre, le grain gros, & il est moins bon pour l'usage que celui de la plûpart des autres especes de chêne.
37. Le chêne d'Afrique. Cet arbre ne differe de nos chênes communs que par son gland, qui est du double plus long.
Toutes ces especes de chênes sont assez robustes pour résister au froid de la partie septentrionale de ce royaume, & on peut les élever comme nos chênes ordinaires. (c)
Chêne. (mat. med.) Les feuilles & l'écorce du chêne sont astringentes, résolutives, propres pour la goutte sciatique, pour les rhumatismes, étant employées en fomentation.
L'écorce entre dans les gargarismes qu'on employe contre le relâchement de la luette, & contre les ulceres de la bouche & de la gorge.
Elle entre dans les clysteres astringens, & dans les injections pour la chûte de la matrice ou du fondement.
Le gland de chêne est employé en Medecine : on doit le choisir gros, bien nourri ; on en sépare l'écorce, & on le fait sécher doucement, prenant garde que les vers ne s'y mettent, car il y est sujet : on le réduit en poudre pour s'en servir. Il est astringent, propre pour appaiser la colique & les tranchées des femmes nouvellement accouchées, pour tous les cours de ventre ; la dose en est depuis un scrupule jusqu'à un gros.
La cupule ou calotte du gland de chêne est astringente ; on s'en sert dans les remedes extérieurs pour fortifier ; on pourroit aussi en prendre intérieurement comme du gland.
Les galles de chêne ou fausses galles, les pommes de chêne, & les raisins de chêne, sont des excroissances que produit la piquûre de certains insectes qui y déposent leurs ?ufs, & qui y produisent des vers : ces excroissances sont astringentes.
Au demeurant, il en est de ces propriétés du chêne, de sa feuille, & de ses autres parties, comme de celles des autres productions que la matiere médicale compte parmi ses ressources ; elles demanderoient presque toutes plus d'observations que nous n'en avons.
La vraie noix de galle est différente de ces communes. Voyez Galle, ou Noix de galle. (N)
Chêne verd, ilex, genre d'arbre qui porte des chatons composés de plusieurs étamines qui sortent d'un calice fait en forme d'entonnoir, & attachés à un petit filet. Les glands naissent sur le même arbre séparément des fleurs ; ils sont enchassés dans une espece de coupe, & ils renferment un noyau que l'on peut séparer en deux parties. Ajoûtez au caractere de ce genre que les feuilles sont dentelées, mais cependant bien moins profondément découpées que celles du chêne. Tournefort, Inst. rei herb. V. Plante ; voyez Yeuse. (I)
Chêne royal ou Chêne de Charles, (Astr.) constellation de l'hémisphere méridional, qu'on ne voit point sur notre horison : elle est une de celles que M. Halley a été observer en 1667 à l'île de Sainte-Hélene, & il l'a nommée ainsi en mémoire du chêne où Charles II, roi d'Angleterre se tint caché lorsqu'il fut poursuivi par Cromwel après la déroute de Worcester. Voyez Constellation, Etoile. (O)
Étymologie de « chêne »
Berry et saintongeois, châgne?; picard, quêne, caine?; Berry, chaigne?; provenç. casser?; bas-lat. casnus. Casnus est dans des textes du IXe siècle, c'est la plus ancienne forme que nous connaissions?; le provençal casser est pour casne?; et les formes de la langue d'oïl répondent aussi à casnus. Mais d'où vient casnus?? Diez le tire d'un adjectif quercinus, de quercus, chêne, attesté par l'italien quercino, contracté en querçnus, d'où casnus, chêne, que étant changé en ca ou cha comme dans cascun, chascun, de quisque-unus. L's qui est dans casnus, la plus ancienne forme, écarte l'étymologie celtique par tann, chêne, qui, prononcé chann, aurait donné chêne?; mais il n'est pas impossible que le celtique ait agi pour s'assimiler le mot originairement latin et pour lui donner la forme singulière qu'il a prise.
ÉTYMOLOGIE
Ajoutez?: À côté de la forme provençale casser, mettez la forme béarnaise quasso?: qui abaterà lô frunt de quasso? Fors et coutumes de Béarn, Pau, 1715, p. 103, et la forme de l'Armagnac casse
, Bladé, Contes recueillis en Armagnac.
- (1694) Du moyen français chesne[1], altération, d'après fresne, frêne[2], de l'ancien français chasne (1160), chaisne (1177-88), du latin populaire casnus (508), emprunté au gaulois cassanos, d'où l'occitan casse, cassanh, le franco-provençal tsâno, le picard caisne. Formation avec suffixe différent en aragonais avec caixico, caixigo, en espagnol avec quejigo (« chêne faginé »).
- L'étymologie du gaulois cassanos est incertaine ; son origine est peut-être préceltique[2][3].
- On aurait un radical *cax-inus[2] (? voir fraxinus et Cacunus) pour casnus et *cax-icus pour quejigo, caixigo.
- D'après Ascoli[2], ce *cassanus représente, en gaulois, le grec ????????, kástanon (« châtaigne ») dérivé de ??????, káston (« bois »).
- D'après Diez[4], il provient du latin quercinus devenu *quercnus
- L's qui est dans casnus, la plus ancienne forme, écarte l'étymologie celtique par tann (« chêne »), qui, prononcé \t??an?\, ? voir tsâno aurait donné chêne ; mais il n'est pas impossible que le celtique ait agi pour assimiler le mot originairement latin et pour lui donner la forme singulière qu'il a prise[4].
chêne au Scrabble
Le mot chêne vaut 10 points au Scrabble.
Informations sur le mot chene - 5 lettres, 2 voyelles, 3 consonnes, 4 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot chêne au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
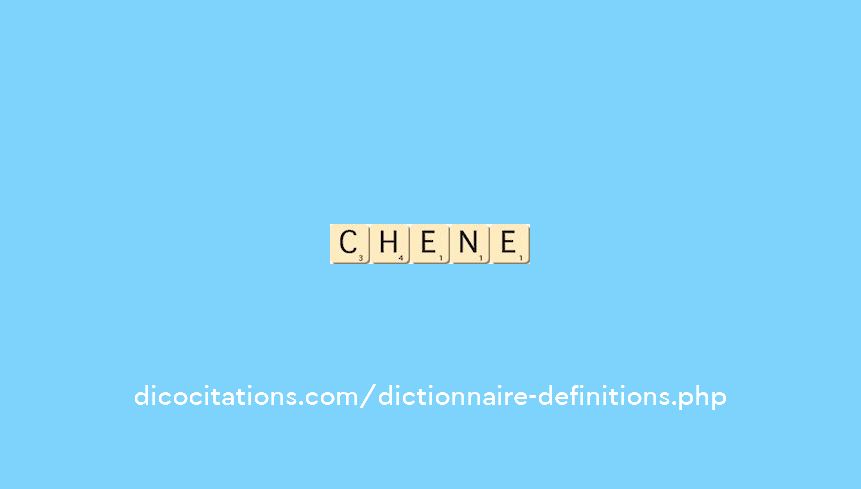
Les rimes de « chêne »
On recherche une rime en EN .
Les rimes de chêne peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en En
Rimes de pennes Rimes de mésopotamienne Rimes de styrène Rimes de neuvaine Rimes de phosphènes Rimes de interurbaine Rimes de batracienne Rimes de enseigne Rimes de parnassienne Rimes de mécaniciennes Rimes de astrophysicienne Rimes de proviennent Rimes de démènes Rimes de retiennes Rimes de adrienne Rimes de viennent Rimes de demi-douzaine Rimes de déchaîne Rimes de péruvienne Rimes de salvadorienne Rimes de proustienne Rimes de Colfontaine Rimes de arthurienne Rimes de butadiène Rimes de géorgiennes Rimes de mi-indigène Rimes de règnes Rimes de mycéniennes Rimes de chevesnes Rimes de reines Rimes de vaine Rimes de abdomen Rimes de amen Rimes de cistercienne Rimes de circassienne Rimes de varenne Rimes de ionienne Rimes de amen Rimes de onusiennes Rimes de dépeigne Rimes de hellène Rimes de quasi-jungienne Rimes de épagomènes Rimes de cancérogène Rimes de meusiennes Rimes de suzeraine Rimes de étreignent Rimes de alsacienne Rimes de amalfitaine Rimes de noumèneMots du jour
pennes mésopotamienne styrène neuvaine phosphènes interurbaine batracienne enseigne parnassienne mécaniciennes astrophysicienne proviennent démènes retiennes adrienne viennent demi-douzaine déchaîne péruvienne salvadorienne proustienne Colfontaine arthurienne butadiène géorgiennes mi-indigène règnes mycéniennes chevesnes reines vaine abdomen amen cistercienne circassienne varenne ionienne amen onusiennes dépeigne hellène quasi-jungienne épagomènes cancérogène meusiennes suzeraine étreignent alsacienne amalfitaine noumène
Les citations sur « chêne »
- L'écureuil n'a pas encore trouvé le gland qui deviendra le chêne dont on fera un berceau dans lequel grandira celui qui me terrassera.Auteur : Neil Gaiman - Source : Stardust (2001)
- Le philosophe doit extirper les erreurs du sein des esprits pour y faire germer la vérité, comme un laboureur extirpe les ronces de la terre pour y planter des chênes.Auteur : Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre - Source : Paul et Virginie (1787)
- Eltsine se déplaçait pour faire tchin-tchin. - Poutine, c'est plutôt pour parler Tchétchènes.Auteur : Laurent Ruquier - Source : Vu à la radio (2001)
- Les pentes sont entièrement couvertes de broussailles, et les sommets se couronnent avec gravité de chênes verts, de chênes-lièges et d'arbres résineux.Auteur : Eugène Fromentin - Source : Un été dans le Sahara (1857)
- Tout dans la vie est une affaire de choix, ça commence par la tétine ou le téton, ça se termine par le chêne ou le sapin.Auteur : Pierre Desproges - Source : Chroniques de la haine ordinaire (2004)
- Je marchais sur des oeufs. Surtout ne pas trop parler, ni trop promettre. Ne pas entrer dans les détails non plus. Comme le vent abat un chêne, une simple phrase détruit un rêve.Auteur : Gilles Martin-Chauffier - Source : Une vraie Parisienne (2007)
- Le chêne clair de ton cercueil est depuis quinze ans sur des tréteaux dans une allée de mon cerveau. Des anges lui jettent des pelletées de lumière.Auteur : Christian Bobin - Source : Carnet du soleil (2011)
- Et ce songe était tel, que Booz vit un chêne - Qui, sorti de son ventre, allait jusqu'au ciel bleu; - Une race y montait comme une longue chaîne; - Un roi chantait en bas, en haut mourait un dieu.Auteur : Victor Hugo - Source : La Légende des siècles (1859), Booz endormi
- Et maintenant pleuraient les chênes centenaires en de longs sanglots de feuilles brunes qui ruisselaient dans les gaulis avant de se noyer dans la houle rousse des fougères pétrifiées. Auteur : Claude Michelet - Source : Des grives aux loups (1979)
- Le chêne un jour dit au roseau :
« Vous avez bien sujet d'accuser la nature ;
Un roitelet pour vous est un pesant fardeau.
Le moindre vent qui d'aventure
Fait rider la face de l'eau
Vous oblige à baisser la tête :
Cependant que mon front, au Caucase pareil,
Non content d'arrêter les rayons du soleil,
Brave l'effort de la tempête.
Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr.
Encor si vous naissiez à l'abri du feuillage
Dont je couvre le voisinage,
Vous n'auriez pas tant à souffrir :
Je vous défendrais de l'orage.
Mais vous naissez le plus souvent
Sur les humides bords des royaumes du vent.
La nature envers vous me semble bien injuste.Auteur : Jean de La Fontaine - Source : Fables (1668 à 1694), Livre premier, XXII, le Chêne et le Roseau - On ne redresse pas aisément, dans un chêne, le pli qu'on a laissé croître avec l'arbrisseau.Auteur : Proverbe écossais - Source : Quelque six mille proverbes et aphorismes usuels ... (1856) - Charles Cahier
- Allons sous la charmille où l'églantier fleurit,
Dans l'ombre où sont les grands chuchotements des chênes.Auteur : Victor Hugo - Source : La Légende des siècles (1859), Le Groupe des idylles - Ah! fuis, qui que tu sois, les constantes caresses: - Alors qu'elles viendraient à bout des rochers et des chênes, - Que peux-tu espérer, pauvre homme, pauvre souffle?Auteur : Properce - Source : La Poésie latine
- Je suis un Armure. Seuls mes actes comptent, don Onchêne. Vous le comprendrez bientôt.Auteur : Pierre Bottero - Source : Les Ames croisées (2010)
- Souvent sur la montagne, à l'ombre du vieux chêne,
Au coucher du soleil, tristement je m'assieds ;
Je promène au hasard mes regards sur la plaine,
Dont le tableau changeant se déroule à mes piedsAuteur : Alphonse de Lamartine - Source : L'Isolement (1820) - Qui voit le chêne dans le gland voit Dieu dans le chêne.Auteur : Joseph Delteil - Source : Le Sacré Corps (1976)
- Lorsqu'un chêne sent le sapin, il sait que sa dernière heure est arrivée.Auteur : Raymond Devos - Source : Les meilleurs sketches de Raymond Devos
- C'était une vaste salle à manger comme en témoignaient de hauts dressoirs en chêne sculpté, où luisaient vaguement des blocs d'orfèvrerie: aiguières, salières, boîtes à épices, hanaps, vases à panses renflées, grands plats d'argent ou de vermeil ...Auteur : Théophile Gautier - Source : Le Capitaine Fracasse (1863), XVI, Vallombreuse
- La chair des mortels est si faible que, sur la terre, bon commencement ne dure pas plus de temps qu'il n'en faut à un chêne qui vient de naître pour porter des glands.Auteur : Dante - Source : La Divine Comédie, Le Paradis (1321), XXII
- Il m'arrive souvent d'affûter les ramiers, en lisière de notre bois, sous les grands chênes qui bordent la route.Auteur : Georges Bernanos - Source : Monsieur Ouine (1943)
- On y voyait, rangée sur des tablettes de chêne, une armée innombrale ou plutôt un grand concile de livres ...Auteur : Anatole France - Source : La Rôtisserie de la reine Pédauque (1892)
- Le bouleau est féminin, le chêne est viril. Il y a quelqu'un de plus intrigant que l'intrigant; c'est l'intrigante.Auteur : Charles Dollfus - Source : De la Nature humaine (1868)
- Quand le chêne est tombé, chacun se fait bûcheron.Auteur : Ménandre - Source : Monostiques, 123
- D'un seul coup ne s'abat pas un chêne.Auteur : Proverbes espagnols - Source : Proverbe
- L'avenir est contenu dans le présent comme le chêne l'est dans le gland. Le temps fait sortir le chêne du gland, mais ne le crée pas.Auteur : Gustave Le Bon - Source : Les Incertitudes de l'heure présente
Les mots proches de « chene »
Cheaus Chebli Chéchia Chef Chef-d'oeuvre Chéfesse Chef-lieu Cheik ou scheik Cheintre Chélidoine Chêmer (se) Chemin Chemineau Cheminée Cheminer Chemise Chemisette Chênaie Chenal Chenard Chêne Chéneau Chêneau Chenet Chêneteau Chenette Chènevière Chènevis Chènevotte Chenil Chenille Chenin Chenu, ue Cheptel Chéquage Chèque Cher, chère Cherche Cherché, ée Chercher Chercheur, euse Chère Chèrement Chéri, ie Chérimolier Cherin Chérir Chérissable Chermotte ChertéLes mots débutant par che Les mots débutant par ch
cheap cheap chébran chèche chèches chéchia chéchias check up check-list check-up Chécy cheddar cheddite Chédigny cheese-cake cheese-cakes cheeseburger cheeseburgers chef chef-adjoint Chef-Boutonne chef-d'oeuvre chef-d'oeuvres Chef-du-Pont Chef-Haut chef-lieu chéfesse Cheffes Cheffois Cheffreville-Tonnencourt Chefresne chefs chefs-d'oeuvre chefs-lieux cheftaine cheftaines Chéhéry Cheignieu-la-Balme cheik cheikh cheiks Cheillé Cheilly-lès-Maranges Chein-Dessus Cheissoux Cheix Cheix-en-Retz Chélan chélate chelem
Les synonymes de « chene»
Les synonymes de chêne :- 1. rouvre
2. yeuse
synonymes de chêne
Fréquence et usage du mot chêne dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « chene » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot chêne dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Chêne ?
Citations chêne Citation sur chêne Poèmes chêne Proverbes chêne Rime avec chêne Définition de chêne
Définition de chêne présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot chêne sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot chêne notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 5 lettres.
