La définition de Expansibilité du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Expansibilité
Nature : s. f.
Prononciation : èk-span-si-bi-li-té
Etymologie : Expansible.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de expansibilité de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec expansibilité pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Expansibilité ?
La définition de Expansibilité
Terme de physique. Propriété des gaz, des vapeurs qui tendent à occuper un plus grand espace.
Toutes les définitions de « expansibilité »
Wiktionnaire
Nom commun - français
expansibilité \?k.sp??.si.bi.li.te\ féminin
-
Qualité de ce qui est expansible.
- Aucune dilatation linéaire n'est générée : une expansibilité radiale de 10 % maximum est possible.
- Nous pouvons déterminer la variation de la tension d'expansibilité avec le niveau d'une façon différente de la précédente. ? (Journal de chimie physique et de physico-chimie biologique, volume 18, 1963)
Littré
- Terme de physique. Propriété des gaz, des vapeurs qui tendent à occuper un plus grand espace.
La différente expansibilité des fluides soumis aux expériences
, Condorcet, Bucquet.
Encyclopédie, 1re édition
EXPANSIBILITÉ, s. f. (Physique.) propriété de certains fluides, par laquelle ils tendent sans cesse à occuper un espace plus grand. L'air & toutes les substances qui ont acquis le degré de chaleur nécessaire pour leur vaporisation, comme l'eau au-dessus du terme de l'eau bouillante, sont expansibles. Il suit de notre définition, que ces fluides ne sont retenus dans de certaines bornes que par la force comprimante d'un obstacle étranger, & que l'équilibre de cette force avec la force expansive, détermine l'espace actuel qu'ils occupent. Tout corps expansible est donc aussi compressible ; & ces deux termes opposés n'expriment que deux effets nécessaires d'une propriété unique dont nous allons parler. Nous traiterons dans cet article,
Premierement, de l'expansibilité considérée en elle-même & comme une propriété mathématique de certains corps, de ses lois, & de ses effets.
Secondement, de l'expansibilité considérée physiquement, des substances auxquelles elle appartient, & des causes qui la produisent.
Troisiemement, de l'expansibilité comparée dans les différentes substances auxquelles elle appartient.
Quatriemement, nous indiquerons en peu de mots les usages de l'expansibilité, & la part qu'elle a dans la production des principaux phénomenes de la nature.
De l'expansibilité en elle-même, de ses lois, & de ses effets. Un corps expansible laissé à lui-même, ne peut s'étendre dans un plus grand espace & l'occuper uniformément tout entier, sans que toutes ses parties s'éloignent également les unes des autres : le principe unique de l'expansibilité est donc une force quelconque, par laquelle les parties du fluide expansible tendent continuellement à s'écarter les unes des autres, & lutent en tout sens contre les forces compressives qui les rapprochent. C'est ce qu'exprime le terme de répulsion, dont Newton s'est quelquefois servi pour la désigner.
Cette force répulsive des particules peut suivre différentes lois, c'est-à-dire qu'elle peut croître & décroître en raison de telle ou telle fonction des distances des particules. La condensation ou la réduction à un moindre espace, peut suivre aussi dans tel ou tel rapport, l'augmentation de la force comprimante ; & l'on voit au premier coup-d'?il que la loi qui exprime le rapport des condensations ou des espaces à la force comprimante, & celle qui exprime le rapport de la force répulsive à la distance des particules, sont relatives l'une à l'autre, puisque l'espace occupé, comme nous l'avons déjà dit, n'est déterminé que par l'équilibre de la force comprimante avec la force répulsive. L'une de ces deux lois étant donnée, il est aisé de trouver l'autre. Newton a le premier fait cette recherche (liv. II. des principes, prop. 23.) ; & c'est d'après lui que nous allons donner le rapport de ces deux lois, ou la loi générale de l'expansibilité.
La même quantité de fluide étant supposée, & la condensation inégale, le nombre des particules sera le même dans des espaces inégaux ; & leur distance mesurée d'un centre à l'autre, sera toûjours en raison des racines cubiques des espaces ; ou, ce qui est la même chose, en raison inverse des racines cubiques des condensations : car la condensation suit la raison inverse des espaces, si la quantité du fluide est la même ; & la raison directe des quantités du fluide, si les espaces sont égaux.
Cela posé : soient deux cubes égaux, mais remplis d'un fluide inégalement condensé ; la pression qu'exerce le fluide sur chacune des faces des deux cubes, & qui fait équilibre avec l'action de la force comprimante sur ces mêmes faces, est égale au nombre des particules qui agissent immédiatement sur ces faces, multiplié par la force de chaque particule. Or chaque particule presse la surface contiguë avec la même force avec laquelle elle fuit la particule voisine : car ici Newton suppose que chaque particule agit seulement sur la particule la plus prochaine ; il a soin, à la vérité, d'observer en même tems que cette supposition ne pourroit avoir lieu, si l'on regardoit la force répulsive comme une loi mathématique dont l'action s'étendît à toutes les distances, comme celle de la pesanteur, sans être arrêtée par les corps intermédiaires. Car dans cette hypothèse il faudroit avoir égard à la force répulsive des particules les plus éloignées, & la force comprimante devroit être plus considérable pour produire une égale condensation ; la force avec laquelle chaque particule presse la surface du cube, est donc la force même déterminée par la loi de répulsion, & par la distance des particules entr'elles ; c'est donc cette force qu'il faut multiplier par le nombre des particules, pour avoir la pression totale sur la surface, ou la force comprimante. Or ce nombre à condensation égale seroit comme les surfaces ; à surfaces égales, il est comme les quarrés des racines cubiques du nombre des particules, ou de la quantité du fluide contenu dans chaque cube, c'est-à-dire comme les quarrés des racines cubiques des condensations ; ou, ce qui est la même chose, en raison inverse du quarré des distances des particules, puisque les distances des particules sont toûjours en raison inverse des racines cubiques des condensations. Donc la pression du fluide sur chaque face des deux cubes, ou la force comprimante, est toûjours le produit du quarré des racines cubiques des condensations, ou du quarré inverse de la distance des particules, par la fonction quelconque de la distance, à laquelle la répulsion est proportionnelle.
Donc, si la répulsion suit la raison inverse de la distance des particules, la pression suivra la raison inverse des cubes de ces distances, ou, ce qui est la même chose, la raison directe des condensations. Si la répulsion suit la raison inverse des quarrés des distances, la force comprimante suivra la raison inverse des quatriemes puissances de ces distances, ou la raison directe des quatriemes puissances des racines cubiques des condensations ; & ainsi dans toute hypothèse, en ajoûtant toûjours à l'exposant quelconque n de la distance, qui exprime la loi de répulsion, l'exposant du quarré ou le nombre 2.
Et réciproquement pour connoître la loi de la répulsion, il faut toûjours diviser la force comprimante par le quarré des racines cubiques des condensations ; ou, ce qui est la même chose, soustraire toûjours 2 de l'exposant qui exprime le rapport de la force comprimante à la racine cubique des condensations : car on aura par-là le rapport de la répulsion avec les racines cubiques des condensations, & l'on sait que la distance des centres des particules suit la raison inverse de ces racines cubiques.
D'après cette regle, il sera toûjours aisé de connoître la loi de la répulsion entre les particules d'un fluide, lorsque l'expérience aura déterminé le rapport de la condensation à la force comprimante : ainsi les particules de l'air, dont on sait que la condensation est proportionnelle au poids qui le comprime (voyez Air), se fuient avec une force qui suit la raison inverse de leurs distances.
Il y a pourtant une restriction nécessaire à mettre à cette loi : c'est qu'elle ne peut avoir lieu que dans une certaine latitude moyenne entre l'extrème compression & l'extrème expansion. L'extrème compression a pour bornes le contact, où toute proportion cesse, quoiqu'il y ait encore quelque distance entre les centres des particules. L'expansion, à la vérité, n'a point de bornes mathématiques ; mais si elle est l'effet d'une cause méchanique interposée entre les particules du fluide, & dont l'effort tend à les écarter, on ne peut guere supposer que cette cause agisse à toutes les distances ; & la plus grande distance à laquelle elle agira, sera la borne physique de l'expansibilité. Voilà donc deux points où la loi de la répulsion ne s'observe plus du tout : l'un à une distance très courte du centre des particules, & l'autre à une distance très-éloignée ; & il n'y a pas d'apparence que cette loi n'éprouve aucune irrégularité aux approches de l'un ou de l'autre de ces deux termes.
Quant à ce qui concerne le terme de la compression ; si l'attraction de cohésion a lieu dans les petites distances, comme les phénomenes donnent tout lieu de le croire (voyez Tuyaux capillaires, Réfraction de la Lumiere, Cohésion, Induration, Glace, Crystallisation des Sels, Rapports chimiques, &c.) ; il est évident au premier coup-d'?il que la loi de la répulsion doit commencer à être troublée, dès que les particules en s'approchant atteignent les limites de leur attraction mutuelle, qui agissant dans un sens contraire à la répulsion, en diminue d'abord l'effet & le détruit bientôt entierement, même avant le contact ; parce que croissant dans une proportion plus grande que l'inverse du quarré des distances, tandis que la répulsion n'augmente qu'en raison inverse des distances simples, elle doit bientôt surpasser beaucoup celle-ci. De plus, si, comme nous l'avons supposé, la répulsion est produite par une cause méchanique, interposée entre les particules, & qui fasse également effort sur les deux particules voisines pour les écarter, cet effort ne peut avoir d'autre point d'appui que la surface des particules ; les rayons, suivant lesquels son activité s'étendra, n'auront donc point un centre unique, mais ils partiront de tous les points de cette surface ; & les décroissemens de cette activité ne seront relatifs aux centres mêmes des particules, que lorsque les distances seront assez grandes pour que leur rapport, avec les dimensions des particules, soit devenu inassignable ; & lorsqu'on pourra sans erreur sensible, regarder la particule toute entiere comme un point. Or, dans la démonstration de la loi de l'expansibilité, nous n'avons jamais considéré que les distances entre les centres des particules, puisque nous avons dit qu'elles suivoient la raison inverse des racines cubiques des condensations. La loi de la répulsion, & par conséquent le rapport des condensations avec les forces comprimantes, doit donc être troublée encore par cette raison, dans le cas où la compression est poussée très-loin. Et je dirai en passant, que si l'on peut porter la condensation de l'air jusqu'à ce degré, il n'est peut-être pas impossible de former d'après cette idée des conjectures raisonnables sur la tenuité des parties de l'air, & sur les limites de leur attraction mutuelle.
Quant aux altérations que doit subir la loi de la répulsion aux approches du dernier terme de l'expansion, quelle que soit la cause qui termine l'activité des forces répulsives à un certain degré d'expansion, peut-on supposer qu'une force dont l'activité décroît suivant une progression qui par sa nature n'a point de dernier terme, cesse cependant tout-à-coup d'agir sans que cette progression ait été altérée le moins du monde dans les distances les plus voisines de cette cessation totale ? & puisque la Physique ne nous montre nulle part de pareils sauts, ne seroit-il pas bien plus dans l'analogie de penser que ce dernier terme a été préparé dès long-tems par une espece de correction à la loi du décroissement de la force ; correction qui la modifie peut-être à quelque distance qu'elle agisse, & qui fait de la loi des décroissemens une loi complexe, formée de deux ou même de plusieurs progressions différentes, tellement inégales dans leur marche, que la partie de la force qui suit la raison inverse des distances, surpasse incomparablement dans toutes les distances moyennes les forces reglées par les autres lois, dont l'effet sera insensible alors ; & qu'au contraire ces dernieres l'emportent dans les distances extrèmes, & peut-être aussi dans les extrèmes proximités ?
Les observations prouvent effectivement que la loi des condensations proportionnelles aux poids dont l'air est chargé, cesse d'avoir lieu dans les degrés extrèmes de compression & d'expansion. On peut consulter là-dessus les physiciens qui ont fait beaucoup d'expériences sur la compression de l'air, & ceux qui ont travaillé sur le rapport des hauteurs du barometre à la hauteur des montagnes. Voyez Air, Machine Pneumatique, & Barometre. On a de plus remarqué avec raison à l'article Atmosphere, que si les condensations de l'air étoient exactement proportionnelles aux poids qui le compriment, la hauteur de l'atmosphere devroit être infinie ; ce qui ne sauroit s'accorder avec les phénomenes. Voyez Atmosphere.
Quelle que soit la loi, suivant laquelle les parties d'un corps expansible se repoussent les unes les autres, c'est une suite de cette répulsion que ce corps forcé par la compression à occuper un espace moindre, se rétablisse dans son premier état, quand la compression cesse, avec une force égale à la force comprimante. Un corps expansible est donc élastique par cela même (voyez Elasticité), mais tout corps élastique n'est point pour cela expansible ; témoin une lame d'acier. L'élasticité est donc le genre. L'expansibilité & le ressort sont deux especes ; ce qui les caractérise essentiellement, c'est que le corps expansible tend toûjours à s'étendre, & n'est retenu que par des obstacles étrangers : le corps à ressort ne tend qu'à se rétablir dans un état déterminé ; la force comprimante est dans le premier un obstacle au mouvement, & dans l'autre un obstacle au repos. Je donne le nom de ressort à une espece particuliere d'élasticité, quoique les Physiciens ayent jusqu'ici employé ces deux mots indifféremment l'un pour l'autre, & qu'ils ayent dit également le ressort de l'air & l'élasticité d'un arc ; & je choisis pour nommer l'espece le mot de ressort, plus populaire que celui d'élasticité, quoiqu'en général, quand de deux mots jusque-là synonymes, on veut restraindre l'un à une signification particuliere, on doive faire attention à conserver au genre le nom dont l'usage est le plus commun, & à désigner l'espece par le mot scientifique. Voyez Synonymes. Mais dans cette occasion, il se trouve que le nom de ressort n'a jamais été donné par le peuple, qu'aux corps auxquels je veux en limiter l'application ; parce que le peuple ne connoît guere ni l'expansibilité ni l'élasticité de l'air : ensorte que les savans seuls ont ici confondu deux idées sous les mêmes dénominations. Or le mot d'élasticité est le plus familier aux savans.
Il est d'autant plus nécessaire de distinguer ces deux especes d'élasticité, qu'à la réserve d'un petit nombre d'effets, elles n'ont presque rien de commun, & que la confusion de deux choses aussi différentes, ne pourroit manquer d'engager les Physiciens qui voudroient chercher la cause de l'élasticité en général dans un labyrinthe d'erreurs & d'obscurités. En effet, l'expansibilité est produite par une cause qui tend à écarter les unes des autres les parties des corps ; dés-lors elle ne peut appartenir qu'à des corps actuellement fluides, & son action s'étend à toutes les distances, sans pouvoir être bornée que par la cessation absolue de la cause qui l'a produite. Le ressort, au contraire, est l'effet d'une force qui tend à rapprocher les parties des corps, écartées les unes des autres ; il ne peut appartenir qu'à des corps durs ; & nous montrerons ailleurs qu'il est une suite nécessaire de la cause qui les constitue dans l'état de dureté. Voyez Glace, Induration, & Ressort. Par cela même que cette cause tend à rapprocher les parties des corps, la nature des choses établit pour borne de son action le contact de ces parties, & elle cesse de produire aucun effet sensible, précisément lorsqu'elle est la plus forte.
On pourroit pousser plus loin ce parallele ; mais il nous suffit d'avoir montré que l'expansibilité est une espece particuliere d'élasticité, qui n'a presque rien de commun avec le ressort. J'observerai seulement qu'il n'y a & ne peut y avoir dans la nature que ces deux especes d'élasticité ; parce que les parties d'un corps, considérées les unes par rapport aux autres, ne peuvent se rétablir dans leurs anciennes situations, qu'en s'approchant ou en s'éloignant mutuellement. Il est vrai que la tendance qu'ont les parties d'un fluide pesant à se mettre de niveau, les rétablit aussi dans leur premier état lorsqu'elles ont perdu ce niveau ; mais ce rétablissement est moins un changement d'état du fluide, & un retour des parties à leur ancienne situation respective, qu'un transport local d'une certaine quantité de parties du fluide en masse par l'effet de la pesanteur ; transport absolument analogue au mouvement d'une balance qui se met en équilibre. Or, quoique ce mouvement ait aussi des lois qui lui sont communes avec les mouvemens des corps élastiques, ou plûtôt avec tous les mouvemens produits par une tendance quelconque (Voyez Tendance), il n'a jamais été compris sous le nom d'élasticité ; parce que ce dernier mot n'a jamais été entendu que du rétablissement de la situation respective des parties d'un corps, & non du retour local d'un corps entier dans la place qu'il avoit occupé.
L'expansibilité ou la force par laquelle les parties des fluides expansibles se repoussent les unes les autres, est le principe des lois qui s'observent soit dans la retardation du mouvement des corps qui traversent des milieux élastiques, soit dans la naissance & la transmission du mouvement vibratoire excité dans ces mêmes milieux. La recherche de ces lois n'appartient point à cet article. Voy. Résistance des Fluides & Son.
De l'expansibilité considérée physiquement, des substances auxquelles elle appartient, des causes qui la produisent ou qui l'augmentent. L'expansibilité appartient à l'air ; voyez Air : elle appartient aussi à tous les corps dans l'état de vapeur ; voyez Vapeur : ainsi l'esprit-de-vin, le mercure, les acides les plus pesans, & un très-grand nombre de liquides très-différens par leur nature & par leur gravité spécifique, peuvent cesser d'être incompressibles, acquérir la propriété de s'étendre comme l'air en tout sens & sans bornes, de soûtenir comme lui le mercure dans le barometre, & de vaincre des résistances & des poids énormes. Voy. Explosion & Pompe à feu. Plusieurs corps solides même, après avoir été liquéfiés par la chaleur, sont susceptibles d'acquérir aussi l'état de vapeur & d'expansibilité, si l'on pousse la chaleur plus loin : tels sont le soufre, le cinnabre plus pesant encore que le soufre, & beaucoup d'autres corps. Il en est même très-peu qui, si on augmente toûjours la chaleur, ne deviennent à la fin expansibles, soit en tout, soit en partie : car dans la plûpart des mixtes, une partie des principes devenus expansibles à un certain degré de chaleur, abandonnent les autres principes, tandis que ceux-ci restent fixes ; soit qu'ils ne soient pas susceptibles de l'expansibilité, soit qu'ils ayent besoin pour l'acquérir d'un degré de chaleur plus considérable.
L'énumération des différens corps expansibles, & l'examen des circonstances dans lesquelles ils acquierent cette propriété, nous présentent plusieurs faits généraux. Premierement, de tous les corps qui nous sont connus (car je ne parle point ici des fluides électriques & magnétiques, ni de l'élément de la chaleur ou éther dont la nature est trop ignorée), l'air est le seul auquel l'expansibilité paroisse au premier coup-d'?il appartenir constamment ; & cette propriété, dans tous les autres corps, paroît moins une qualité attachée à leur substance, & un caractere particulier de leur nature, qu'un état accidentel & dépendant de circonstances étrangeres. Secondement, tous les corps, qui de solides ou de liquides deviennent expansibles, ne le deviennent que lorsqu'on leur applique un certain degré de chaleur. Troisiemement, il est très-peu de corps qui ne deviennent expansibles à quelque degré de chaleur : mais ce degré n'est pas le même pour les différens corps. Quatriemement, aucun corps solide ne devient expansible par la chaleur, sans avoir passé auparavant par l'état de liquidité. Cinquiemement, c'est une observation constante, que le degré de chaleur auquel une substance particuliere devient expansible, est un point fixe & qui ne varie jamais lorsque la force qui presse la surface du liquide n'éprouve aucune variation. Ainsi le terme de l'eau bouillante, qui n'est autre que le degré de chaleur nécessaire pour la vaporisation de l'eau (Voyez le mémoire de M. l'abbé Nollet sur le bouillonnement des liquides, mém. de l'acad. des Sc. 1748.), reste toûjours le même, lorsque l'air comprime également la surface de l'eau. Sixiemement, si l'on examine les effets de l'application successive des différens degrés de température à une même substance, telle par exemple que l'eau, on la verra d'abord, si le degré de température est au-dessous du terme zéro du thermometre de M. de Reaumur, dans un état de glace ou de solidité. Quand le thermometre monte au-dessus du zéro, cette glace fond & devient un liquide. Ce liquide augmente de volume comme la liqueur du thermometre elle-même, à mesure que la chaleur augmente ; & cette augmentation a pour terme la dissipation même de l'eau, qui réduite en vapeur, fait effort en tout sens pour s'étendre, & brise souvent les vaisseaux où elle se trouve resserrée : alors si la chaleur reçoit de nouveaux accroissemens, la force d'expansion augmentera encore, & la vapeur comprimée par la même force occuperoit un plus grand espace. Ainsi l'eau appliquée successivement à tous les degrés de température connus, passe successivement par les trois états de corps solide (Voyez Glace), de liquide (Voyez Liquide), & de vapeur ou de corps expansible. Voy. Vapeur. Chacun des passages d'un de ces états à l'autre, répond à une époque fixe dans la succession des différentes nuances de température ; les intervalles d'une époque à l'autre, ne sont remplis que par de simples augmentations de volume ; mais à chacune de ces époques, la progression des augmentations du volume s'arrête pour changer de loi, & pour recommencer une marche relative à la nature nouvelle que le corps semble avoir revêtue. Septiemement, si de la considération d'un seul corps, & des changemens successifs qu'il éprouve par l'application de tous les degrés de température, nous passons à la considération de tous les corps comparés entre eux & appliqués aux mêmes degrés de température, nous en recueillons qu'à chacun de ces degrés répond dans chacun des corps un des trois états de solide, de liquide, ou de vapeur, & dans ces états un volume déterminé : qu'on peut ainsi regarder tous les corps de la nature comme autant de thermometres dont tous les états & les volumes possibles marquent un certain degré de chaleur ; que ces thermometres sont construits sur une infinité d'échelles & suivent des marches entierement différentes ; mais qu'on peut toûjours rapporter ces échelles les unes aux autres, par le moyen des observations qui nous apprennent que tel état d'un corps & tel autre état d'un autre corps, répondent au même degré de chaleur ; ensorte que le degré qui augmente le volume de certains solides, en convertit d'autres en liquides, augmente seulement le volume d'autres liquides, rend expansibles des corps qui n'étoient que dans l'état de liquidité, & augmente l'expansibilité des fluides déjà expansibles.
Il résulte de ces derniers faits, que la chaleur rend fluides des corps, qui sans son action seroient restés solides ; qu'elle rend expansibles des corps qui resteroient simplement liquides, si son action étoit moindre ; & qu'elle augmente le volume de tous les corps tant solides que liquides & expansibles. Dans quelque état que soient les corps, c'est donc un fait général que la chaleur tend à en écarter les parties, & que les augmentations de leur volume, leur fusion & leur vaporisation, ne sont que des nuances de l'action de cette cause, appliquée sans cesse à tous les corps, mais dans des degrés variables. Cette tendance ne produit pas les mêmes effets sensibles dans tous les corps ; il faut en conclure qu'elle est inégalement contre-balancée par l'action des forces qui en retiennent les parties les unes auprès des autres, & qui constituent leur dureté ou leur liquidité, lorsqu'elles ne sont pas entierement surpassées par la répulsion que produit la chaleur. Je n'examine point ici quelle est cette force, ni comment elle varie dans tous les corps. Voyez Glace & Induration. Il me suffit qu'on puisse toûjours la regarder comme une quantité d'action, comparable à la répulsion dans chaque distance déterminée des particules entr'elles, & agissant dans une direction contraire.
Cette théorie a toute l'évidence d'un fait, si on ne veut l'appliquer qu'aux corps qui passent sous nos yeux d'un état à l'autre ; nous ne pouvons douter que leur expansibilité, ou la répulsion de leurs parties, ne soit produite par la chaleur, & par conséquent par une cause méchanique au sens des Cartésiens, c'est-à-dire dépendante des lois de l'impulsion, puisque la chaleur qui n'est jamais produite originairement que par la chûte des rayons de lumiere, ou par un frotement rapide, ou par des agitations violentes dans les parties internes des corps, a toûjours pour cause un mouvement actuel. Il est encore évident que la même théorie peut s'appliquer également à l'expansibilité du seul corps que nous ne voyons jamais privé de cette propriété, je veux dire de l'air. L'analogie qui nous porte à expliquer toûjours les effets semblables par des causes semblables, donne à cette idée l'apparence la plus séduisante ; mais l'analogie est quelquefois trompeuse : les explications qu'elle nous présente ont besoin, pour sortir du rang des simples hypothèses, d'être développées, afin que le nombre & la force des inductions suppléent au défaut des preuves directes. Nous allons donc détailler les raisons qui nous persuadent que l'expansibilité de l'air n'a pas d'autre cause que celle des vapeurs, c'est-à-dire la chaleur ; que l'air ne differe de l'eau à cet égard, qu'en ce que le dégré, qui réduit les vapeurs aqueuses en eau & même en glace, ne suffit pas pour faire perdre à l'air son expansibilité ; & qu'ainsi, l'air est un corps que le plus petit degré de chaleur connu met dans l'état de vapeur : comme l'eau est un fluide que le plus petit degré de chaleur connu au-dessus du terme de la glace met dans l'état de fluidité, & que le degré de l'ébullition met dans l'état d'expansibilité.
Il n'est pas difficile de prouver que l'expansibilité de l'air ou la répulsion de ses parties, est produite par une cause méchanique, dont l'effort tend à écarter chaque particule de la particule voisine, & non par une force mathématique inhérente à chacune d'elles, qui tendroit à les éloigner toutes les unes des autres, comme l'attraction tend à les rapprocher, soit en vertu de quelque propriété inconnue de la matiere, soit en vertu des lois primitives du Créateur : en effet, si l'attraction est un fait démontré en Physique, comme nous nous croyons en droit de le supposer, il est impossible que les parties de l'air se repoussent par une force inhérente & mathématique. C'est un fait que les corps s'attirent à des distances auxquelles jusqu'à présent on ne connoît point de bornes ; Saturne & les cometes, en tournant autour du Soleil, obéissent à la loi de l'attraction : le Soleil les attire en raison inverse du quarré des distances ; ce qui est vrai du Soleil, est vrai des plus petites parties du Soleil, dont chacune pour sa part, & proportionnellement à sa masse, attire aussi Saturne suivant la même loi. Les autres planetes, leurs plus petites parties & les particules de notre air, sont doüées d'une force attractive semblable, qui dans les distances éloignées, surpasse tellement toute force agissante suivant une autre loi, qu'elle entre seule dans le calcul des mouvemens de tous les corps célestes : or il est évident que si les parties de l'air se repoussoient par une force mathématique, l'attraction bien loin d'être la force dominante dans les espaces célestes, seroit au contraire prodigieusement surpassée par la répulsion ; car c'est un point de fait, que dans la distance actuelle qui se trouve entre les parties de l'air, leur répulsion surpasse incomparablement leur attraction : c'est encore un fait que les condensations de l'air sont proportionnelles aux poids, & que par conséquent la répulsion des particules décroît en raison inverse des distances, & même, comme Newton l'a remarqué, dans une raison beaucoup moindre, si c'est une loi purement mathématique : donc les décroissemens de l'attraction sont bien plus rapides, puisqu'ils suivent la raison inverse du quarré des distances ; donc si la répulsion a commencé à surpasser l'attraction, elle continuera de la surpasser, d'autant plus que la distance deviendra plus grande ; donc si la répulsion des parties de l'air étoit une force mathématique, cette force agiroit à plus forte raison à la distance des planetes.
On n'a pas même la ressource de supposer que les particules de l'air sont des corps d'une nature différente des autres, & assujettis à d'autres lois ; car l'expérience nous apprend que l'air a une pesanteur propre ; qu'il obéit à la même loi qui précipite les autres corps sur la terre, & qu'il fait équilibre avec eux dans la balance. Voyez Air. La répulsion des parties de l'air a donc une cause méchanique, dont l'effort suit la raison inverse de leurs distances : or l'exemple des autres corps rendus expansibles par la chaleur, nous montre dans la nature une cause méchanique d'une répulsion toute semblable : cette cause est sans cesse appliquée à l'air ; son effet sur l'air, sensiblement analogue à celui qu'elle produit sur les autres corps, est précisément l'augmentation de cette force d'expansibilité ou de répulsion, dont nous cherchons la cause ; & de plus, cette augmentation de force est exactement assujettie aux mêmes lois que suivoit la force avant que d'être augmentée. Il est certain que l'application d'un degré de chaleur plus considérable à une masse d'air, augmente son expansibilité ; cependant les physiciens qui ont comparé les condensations de l'air aux poids qui les compriment, ont toûjours trouvé ces deux choses exactement proportionnelles, quoiqu'ils n'ayent eu dans leurs expériences aucun égard au degré de chaleur, & quel qu'ait été ce degré. Lorsque M. Amontons s'est assûré (Mém. de l'Acad. des Scienc. 1702.) que deux masses d'air, chargées dans le rapport d'un à deux, soûtiendroient, si on leur appliquoit un égal degré de chaleur, des poids qui seroient encore dans le rapport d'un à deux ; ce n'étoit pas, comme on le dit alors, une nouvelle propriété de l'air qu'il découvroit aux Physiciens ; il prouvoit seulement que la loi des condensations proportionelles aux poids, avoit lieu dans tous les degrés de chaleur ; & que par conséquent, l'accroissement qui survient par la chaleur à la répulsion, suit toûjours la raison inverse des distances.
Si nous regardons maintenant la répulsion totale qui répond au plus grand degré de chaleur connu, comme une quantité formée par l'addition d'un certain nombre de parties a, b, c, e, f, g, h, i, &c. qui soit le même dans toutes les distances, il est clair que chaque partie de la répulsion croît & décroît en même raison que la répulsion totale, c'est-à-dire en raison inverse des distances, & que chacun des termes sera , &c. or il est certain qu'une partie de ces termes, dont la somme est égale à la différence de la répulsion du grand froid au plus grand chaud connu, répondent à autant de degrés de chaleur ; ce seront, si l'on veut, les termes a, b, c, e : or comme le dernier froid connu peut certainement être encore fort augmenté ; je demande si, en supposant qu'il survienne un nouveau degré de froid, la somme des termes qui composent la répulsion totale, ne sera pas encore diminuée de la quantité , & successivement par de nouveaux degrés de froid des quantités & : je demande à quel terme s'arrêtera cette diminution de la force répulsive toûjours correspondante à une certaine diminution de la chaleur, & toûjours assujettie à la loi des distances inverses, comme la partie de la force qui subsiste après la diminution : je demande en quoi les termes g, h, i, different des termes a, b, c ; pourquoi différentes parties de la force répulsive, égales en quantité, & reglées par la même loi, seroient attribuées à des causes d'une nature différente ; & par quelle rencontre fortuite des causes entierement différentes produiroient sur le même corps des effets entierement semblables & assujettis à la même loi. Conclure de ces réflexions, que l'expansibilité de l'air n'a pas d'autre cause que la chaleur, ce n'est pas seulement appliquer à l'expansibilité d'une substance la cause qui rend une autre substance expansible ; c'est suivre une analogie plus rapprochée, c'est dire que les causes de deux effets de même nature, & qui ne different que du plus au moins, ne sont aussi que la même cause dans un degré différent : prétendre au contraire que l'expansibilité est essentielle à l'air, parce que le plus grand froid que nous connoissions, ne peut la lui faire perdre ; c'est ressembler à ces peuples de la zone torride, qui croyent que l'eau ne peut cesser d'être fluide, parce qu'ils n'ont jamais éprouvé le degré de froid qui la convertit en glace.
Il y a plus : l'expérience met tous les jours sous les yeux des Physiciens, de l'air qui n'est en aucune maniere expansible ; c'est cet air que les Chimistes ont démontré dans une infinité de corps, soit liquides, soit durs, qui a contracté avec leurs élémens une véritable union, qui entre comme un principe essentiel dans la combinaison de plusieurs mixtes, & qui s'en dégage, ou par des décompositions & des combinaisons nouvelles dans les fermentations & les mélanges chimiques, ou par la violence du feu : cet air ainsi retenu dans les corps les plus durs, & privé de toute expansibilité, n'est-il pas précisément dans le cas de l'eau, qui combinée dans les corps n'est plus fluide, & cesse d'être expansible à des degrés de chaleur très-supérieurs au degré de l'eau bouillante, comme l'air cesse de l'être à des degrés de chaleur très-supérieurs à celle de l'atmosphere ? Qu'au degré de chaleur de l'eau bouillante, l'eau soit dégagée des autres principes par de nouvelles combinaisons, elle passera immédiatement à l'état d'expansibilité : de même l'air dégagé & rendu à lui même dans la décomposition des mixtes, n'a besoin que du plus petit degré de chaleur connu, pour devenir expansible : il le deviendra encore, sans l'application d'un intermede chimique, par l'effet de la seule chaleur, lorsqu'elle sera assez forte pour vaincre l'union qu'il a contractée avec les principes du mixte : c'est précisément de la même maniere que l'eau dans la distillation se sépare des principes avec lesquels elle est combinée, parce que malgré son union avec eux, elle est encore réduite en vapeurs par un degré de chaleur bien inférieur à celui qui pourroit élever les autres principes : or dans l'un & l'autre phénomene, c'est également la chaleur qui donne à l'air & à l'eau toute leur expansibilité, & il n'y a aucune différence que dans le degré de chaleur qui vaporise l'une & l'autre substance ; degré qui dépend bien moins de leur nature particuliere, que de l'obstacle qu'oppose à l'action de la chaleur l'union qu'elles ont contractée avec les autres principes, ensorte que presque toûjours l'air a besoin, pour devenir expansible, d'un degré de chaleur fort supérieur à celui qui vaporise l'eau. Il résulte de ces faits, 1°. que l'air perd son expansibilité par son union avec d'autres corps, comme l'eau perd, dans le même cas, son expansibilité & sa liquidité ; 2°. qu'ainsi, ni l'expansibilité, ni la fluidité n'appartiennent aux élémens de ces deux substances, mais seulement à la masse ou à l'aggrégation formée de la réunion de ces élémens, comme l'a remarqué M. Venel dans son mémoire sur l'analyse des eaux de Selters (Mém. des corresp. de l'acad. des Sciences, tome II.) ; 3°. que la chaleur donne également à ces deux substances l'expansibilité, par laquelle leur union, avec les principes des mixtes, est rompue ; 4°. enfin, que l'analogie entre l'expansibilité de l'air & celle de l'eau, est complete à tous égards ; que par conséquent, nous avons eu raison de regarder l'air comme un fluide actuellement dans l'état de vapeur, & qui n'a besoin, pour y persévérer, que d'un degré de chaleur fort au-dessous du plus grand froid connu. Si je me suis un peu étendu sur cette matiere, c'est afin de porter le dernier coup à ces suppositions gratuites de corpuscules branchus, de lames spirales, dont on composoit notre air, & afin de substituer à ces rêveries, honorées si mal-à-propos du nom de méchanisme, une théorie simple, qui rappelle tous les phénomenes de l'expansibilité dans différentes substances, à ce seul fait général, que la chaleur tend à écarter les unes des autres les parties de tous les corps. Je n'entreprends point d'expliquer ici la nature de la chaleur ni la maniere dont elle agit : le peu que nous savons sur l'élément qui paroît être le milieu de la chaleur, appartient à d'autres articles. V. Chaleur, Feu électrique, Froid, & Température. Nous ignorons si cet élément est, ou n'est pas lui même un fluide expansible, & qu'elles pourroient être en ce dernier cas les causes de son expansibilité ; car je n'ai prétendu assigner la cause de cette propriété, que dans les corps où elle est sensible pour nous. Quant à ces fluides qui se dérobent à nos sens, & dont l'existence n'est constatée que par leurs effets, comme le fluide magnétique, le fluide électrique, & l'élément même de la chaleur, nous connoissons trop peu leur nature, & nous ne pouvons en parler autrement que par des conjectures ; à la vérité, ces conjectures semblent nous conduire à penser qu'au moins le fluide électrique est éminemment expansible. Voyez les articles Feu électrique, Magnétisme, Ether, & Température.
Quoique l'expansibilité des vapeurs & de l'air, doive être attribuée à la chaleur comme à sa véritable cause, ainsi que nous l'avons prouvé, l'expérience nous montre une autre cause capable, comme la chaleur d'écarter les parties du corps, de produire une véritable répulsion, & d'augmenter du moins l'expansibilité, si elle ne suffit pas seule pour donner aux corps cette propriété ; ce qui ne paroît effectivement pas par l'expérience. Je parle de l'électricité : on sait que deux corps également électrisés se repoussent mutuellement, & qu'ainsi un système de corps électriques fourniroit un tout expansible : on sait que l'eau électrisée sort par un jet continu de la branche capillaire d'un syphon, d'où elle ne tomboit auparavant que goutte à goutte ; l'électricité augmente donc la fluidité des liqueurs, & diminue l'attraction de leurs parties, puisque c'est par cette attraction que l'eau se soûtient dans les tuyaux capillaires (voyez Tuyaux capillaires) : on ne peut donc douter que l'électricité ne soit une cause de répulsion entre les parties de certains corps, & qu'elle ne soit capable de produire un certain degré d'expansibilité ; soit qu'on lui attribue une action particuliere, indépendante de celle du fluide de la chaleur, soit qu'on imagine, ce qui est peut-être plus vraissemblable, qu'elle produit cette répulsion par l'expansibilité que le fluide électrique reçoit lui-même du fluide de la chaleur, comme les autres corps de la nature.
Plusieurs personnes seront peut-être étonnées de me voir distinguer ici la répulsion produite par l'électricité, de celle dont la chaleur est la véritable cause ; & peut-être regarderont-elles cette ressemblance dans les effets de l'une & de l'autre, comme une nouvelle preuve de l'identité qu'elles imaginent entre le fluide électrique & le fluide de la chaleur, qu'elles confondent très-mal à-propos avec le feu, avec la matiere du feu, & avec la lumiere, toutes choses cependant très différentes. Voyez Feu, Lumiere, & Phlogistique. Mais rien n'est plus mal fondé que cette identité prétendue entre le fluide électrique & l'élément de la chaleur. Indépendamment de la diversité des effets, il suffit pour se convaincre que l'un de ces élémens est très-distingué de l'autre, de faire réflexion que le fluide de la chaleur pénetre toutes les substances, & se met en équilibre dans tous les corps, qui se communiquent tous réciproquement les uns par les autres, sans que jamais cette communication puisse être interrompue par aucun obstacle : le fluide électrique, au contraire, reste accumulé dans les corps électrisés & autour de leur surface, s'ils ne sont environnés que des corps qu'on a appellés électriques par eux-mêmes, c'est-à-dire qui ne transmettent pas l'électricité, du moins de la même maniere que les autres corps ; comme l'air est de ce nombre, le fluide électrique a besoin, pour se porter d'un corps dans un autre, & s'y mettre en équilibre, de ce qu'on appelle un conducteur (voyez Conducteur) ; & c'est à la promptitude du rétablissement de l'équilibre, dûe peut-être à la prodigieuse expansibilité de ce fluide, qu'il faut attribuer l'étincelle, la commotion, & les autres phénomenes qui accompagnent le rétablissement subit de la communication entre le corps électrisé en plus, & le corps électrisé en moins. Voyez Electricité & Coup foudroyant. J'ajoûte que si le fluide électrique communiquoit universellement d'un corps à l'autre, comme le fluide de la chaleur, ou même s'il traversoit l'air aussi librement qu'il traverse l'eau, il seroit resté à jamais inconnu, comme il le seroit nécessairement pour un peuple de poissons, quelque philosophes qu'on pût les supposer ; le fluide existeroit, mais aucun des phénomenes de l'électricité ne seroit produit, puisqu'ils se réduisent tous à l'accumulation du fluide électrique aux environs de certains corps, & à la communication interrompue ou rétablie entre les corps qui peuvent être pénétrés par ce fluide.
Puisque l'électricité est une cause de répulsion très différente de la chaleur, il est naturel de se demander si elle agit suivant la même loi de la raison inverse des distances, ou suivant une autre loi. On n'a point encore fait les observations nécessaires pour décider cette question : mais les Physiciens doivent à MM. le Roy & d'Arcy, l'instrument qui peut les mettre un jour en état d'y répondre. Voyez au mot Electrometre, l'ingénieuse construction de cet instrument, qui peut servir à donner de très-grandes lumieres sur cette partie de la Physique. Personne n'est plus capable que les inventeurs de profiter du secours qu'ils ont procuré à tous les Physiciens ; & puisque M. le Roy s'est chargé de plusieurs articles de l'Encyclopédie qui concernent l'électricité, j'ose l'inviter à nous donner la solution de ce problème au mot Répulsion électrique.
J'ai dit qu'il ne paroissoit pas par l'expérience que l'électricité seule pût rendre expansible aucun corps de la nature ; & cela peut sembler étonnant au premier coup-d'?il, vû les prodigieux effets du fluide électrique & l'action tranquille de la chaleur, lors même qu'elle suffit pour mettre en vapeur des corps assez pesans. Je crois pourtant que cette différence vient de ce que dans la vérité la répulsion produite par l'électricité est si foible en comparaison de celle que produit la chaleur, qu'elle ne peut jamais que diminuer l'adhérence des parties, mais non la vaincre, & faire passer le corps, comme le fait la chaleur, de l'état de liquide à celui de corps expansible. On se tromperoit beaucoup, si l'on jugeoit des forces absolues d'un de ces fluides pour écarter les parties des corps par la grandeur & la violence de ses effets apparens. Les effets apparens ne dépendent pas de la force seule, mais de la force rendue sensible par les obstacles qu'elle a rencontrés. J'ai déjà remarqué que tous les phénomenes de l'électricité venoient du défaut d'équilibre dans le partage du fluide entre les différens corps & de son rétablissement subit : or ce défaut d'équilibre n'existeroit pas, si la communication étoit continuelle. C'est pour cette raison que le fluide électrique ne produiroit aucun effet sensible dans l'eau, quoiqu'il n'en eût pas une force moins réelle. Nous sommes par rapport à l'élément de la chaleur, précisément dans le cas où nous serions par rapport au fluide électrique, si nous vivions dans l'eau. La communication de l'élément de la chaleur se fait sans obstacle dans tous les corps ; & quoiqu'il ne soit pas actuellement en équilibre dans tous, cette rupture d'équilibre est plûtôt une agitation inégale, & tout au plus une condensation plus ou moins grande dans quelques portions d'un fluide répandu par-tout, qu'une accumulation forcée d'un fluide dont l'activité soit retenue par des obstacles impénétrables. L'équilibre d'agitation & de condensation entre les différentes portions du fluide de la chaleur, se rétablit de proche en proche & sans violence ; il a besoin du tems, & n'a besoin que du tems. L'équilibre dans le partage du fluide électrique entre les différens corps se rétablit par un mouvement local & par une espece de transvasion subite, dont l'effet est d'autant plus violent, que le fluide étoit plus inégalement partagé. Cette transvasion ne peut se faire qu'en supprimant l'obstacle, & en rétablissant la communication ; & dès que l'obstacle est supprimé, elle se fait dans un instant inassignable. Enfin le rétablissement de l'équilibre entre les parties du fluide électrique, se fait d'une maniere analogue à celle dont l'eau se précipite pour reprendre son niveau lorsqu'on ouvre l'écluse qui la retenoit, & il en a toute l'impétuosité. Le rétablissement de l'équilibre entre les différentes portions du fluide de la chaleur, ressemble à la maniere dont une certaine quantité de sel se distribue uniformément dans toutes les portions de l'eau qui le tient en dissolution, & il en a le caractere lent & paisible. La prodigieuse activité du fluide électrique, ne décide donc rien sur la quantité de répulsion qu'il est capable de produire ; & puisqu'effectivement l'électricité n'a jamais pû qu'augmenter un peu la fluidité de l'eau sans jamais la réduire en vapeur, nous devons conclure que la répulsion produite par l'électricité est incomparablement plus foible que celle dont la chaleur est la cause : nous sommes fondés par conséquent à regarder la chaleur comme la vraie cause de l'expansibilité, & à définir l'expansibilité, considérée physiquement, l'état des corps vaporisés par la chaleur.
De l'expansibilité comparée dans les différentes substances auxquelles elle appartient. On peut comparer l'expansibilité dans les différentes substances, sous plusieurs points de vûe. On peut comparer 1°. la loi de l'expansibilité, ou des décroissemens de la force répulsive dans les différens corps ; 2°. le degré de chaleur où chaque substance commence à devenir expansible ; 3°. le degré d'expansibilité des différens corps, c'est-à-dire le rapport de leur volume à leur masse, au même degré de chaleur.
A l'égard de la loi que suit la répulsion dans les différens corps expansibles, il paroît presque impossible de s'assûrer directement par l'expérience, qu'elle est dans tous les corps la même que dans l'air. La plûpart des corps expansibles qu'on pourroit soûmettre aux expériences, n'acquierent cette propriété que par un degré de chaleur assez considérable, & rien ne seroit si difficile que d'entretenir cette chaleur au même point, aussi long-tems qu'il le faudroit pour les soûmettre à nos expériences. Si l'on essayoit de les charger successivement, comme l'air, par différentes colonnes de mercure, le refroidissement produit par mille causes & par la seule nécessité de placer le vaisseau sur un support, & d'y appliquer la main ou tout autre corps qui n'auroit point le même degré de chaleur, viendroit se joindre au poids des colonnes pour condenser la vapeur : or comment démêler la condensation produite par l'action des poids, de la condensation produite par un refroidissement dont on ne connoît point la mesure ? Les vapeurs de l'acide nitreux très-concentré & surchargé de phlogistique, auroient à la vérité cet avantage sur les vapeurs aqueuses, qu'elles pourroient demeurer expansibles à des degrés de chaleur au-dessous même de celle de l'atmosphere dans des jours très-chauds. Mais de quelle maniere s'y prendroit-on pour les comprimer dans une proportion connue ; puisque le mercure, le seul de tous les êtres qu'on pût employer à cet usage, ne pourroit les toucher sans être dissous avec une violente effervescence qui troubleroit tous les phénomenes de l'expansibilité ?
On lit dans les essais de physique de Musschenbroek, §. 1330, que des vapeurs élastiques produites par la pâte de farine, comprimées par un poids double, ont occupé un espace quatre fois moindre. Mais j'avoue que j'ai peine à imaginer comment ce célebre physicien a pû exécuter cette expérience avec les précautions nécessaires pour la rendre concluante, c'est-à-dire en conservant la vapeur, le vaisseau, les supports du vaisseau, & la force comprimante, dans un degré de chaleur toûjours le même. De plus, on sait que ces mêmes vapeurs qui s'élevent des corps en fermentation, sont un mélange d'air dégagé par le mouvement de la fermentation, & d'autres substances volatiles ; souvent ces substances absorbent de nouveau l'air avec lequel elles s'étoient élevées, & forment par leur union chimique avec lui un nouveau mixte, dont l'expansibilité peut être beaucoup moindre, ou même absolument nulle. Voyez les articles Effervescence & Clyssus. M. Musschenbroek n'entre dans aucun détail sur le procédé qu'il a suivi dans cette expérience ; & je présume qu'il s'est contenté d'observer le rapport de la compression à l'espace, sans faire attention à toutes les autres circonstances qui peuvent altérer l'expansibilité de la vapeur : car s'il eût tenté d'évaluer ces circonstances, il y eût certainement trouvé trop de difficultés pour ne pas rendre compte des moyens qu'il auroit employés pour les vaincre ; peut-être même auroit-il été impossible d'y réussir.
Il est donc très-probable que l'expérience ne peut nous apprendre si les vapeurs se condensent ou non, comme l'air, en raison des forces comprimantes, & si leurs particules se repoussent en raison inverse de leurs distances : ainsi nous sommes réduits sur cette question à des conjectures pour & contre.
D'un côté la chaleur étant, comme nous l'avons prouvé, la cause de l'expansibilité dans toutes les substances connues, on ne peut guere se défendre de croire que cette cause agit dans tous les corps, suivant la même loi ; d'autant plus que toutes les différences qui pourroient résulter des obstacles que la contexture de leurs parties & les lois de leur adhésion mettroient à l'action de la chaleur, sont absolument nulles, dès que les corps sont une fois dans l'état de vapeur : les dernieres molécules du corps sont alors isolées dans le fluide, où elles nagent ; elles ne résistent à son action que par leur masse ou leur figure, qui étant constamment les mêmes, ne forment point des obstacles variables en raison des distances, & qui ne peuvent par conséquent altérer par le mélange d'une autre loi, le rapport de l'action propre de la chaleur avec la distance des molécules sur lesquelles elle agit. D'ailleurs l'air sur lequel on a fait des expériences, n'est point un air pur ; il tient toûjours en dissolution une certaine quantité d'eau, & même d'autres matieres, qu'il peut aussi soûtenir au moyen de leur union avec l'eau. Voyez Rosée. La quantité d'eau actuellement dissoute par l'air, est toûjours relative à son degré de chaleur. Voyez Evaporation & Humidité. Ainsi la proportion de l'air à l'eau dans un certain volume d'air, varie continuellement ; cependant cette différente proportion ne change rien à la loi des condensations, dans quelque état que soit l'air qu'on soûmet à l'expérience. Il est naturel d'en conclure, que l'expansibilité de l'eau suit la même loi que celle de l'air, & que cette loi est toûjours la même, quelle que soit la nature du corps exposé à l'action de la chaleur.
De l'autre côté on peut dire que l'eau ainsi élevée & soûtenue dans l'air par la simple voie de vaporisation[1], c'est-à-dire par l'union chimique de ses molécules avec celles de l'air, n'est, à proprement parler, expansible que par l'expansibilité propre de l'air, & peut être assujettie à la même loi, sans qu'on puisse rigoureusement en conclure, que l'eau devenue expansible par la vaporisation proprement dite, & par une action de la chaleur qui lui seroit appliquée immédiatement, ne suivroit pas des lois différentes. On peut ajoûter qu'il y a des corps qui ne se conservent dans l'état d'expansibilité, que par des degrés de chaleur très-considérables & très-supérieurs à la chaleur qu'on a jusqu'ici appliquée à l'air. Or quoique la chaleur dans un degré médiocre produise entre les molécules des corps une répulsion qui suit la raison inverse des distances, il est très-possible que la loi de cette répulsion change lorsque la chaleur est poussée à des degrés extrèmes, ou son action prend peut-être un nouveau caractere ; ce qui donneroit une loi différente pour la répulsion dans les différens corps.
Aucune des deux opinions n'est appuyée sur des preuves assez certaines pour prendre un parti. J'avouerai pourtant que je panche à croire la loi de répulsion uniforme dans tous les corps. Tous les degrés de chaleur que nous pouvons connoître, sont vraissemblablement bien-loin des derniers degrés dont elle est susceptible, dans lesquels seuls nous pouvons supposer que son action souffre quelque changement ; & quoique l'uniformité de la loi dans l'air uni à l'eau, quelle que soit la proportion de ces deux substances, ne suffise pas pour en tirer une conséquence rigoureuse, généralement applicable à tous les corps ; elle prouve du moins que le corps expansible peut être fort altéré dans la nature & les dimensions de ses molécules, sans que la loi soit en rien dérangée ; & c'en est assez pour donner à la proposition générale bien de la probabilité.
Mais si l'on peut avec vraissemblance supposer la même loi d'expansibilité pour tous les corps, il s'en faut bien qu'il y ait entre eux la même uniformité par rapport au degré de chaleur dont ils ont besoin pour devenir expansibles. J'ai déjà remarqué plus haut que ce commencement de la vaporisation des corps comparé à l'échelle de la chaleur, répondoit toûjours au même point pour chaque corps placé dans les mêmes circonstances, & à différens points pour les différens corps ; ensorte que si l'on augmente graduellement la chaleur, tous les corps susceptibles de l'expansibilité parviendront successivement à cet état dans un ordre toûjours le même. On peut représenter cet ordre que j'appelle l'ordre de vaporisation des corps, en dressant, d'après des observations exactes, une table de tous ces points fixes, & former ainsi une échelle de chaleur bien plus étendue que celle de nos thermometres. Cette table, qui seroït très-utile aux progrès de nos connoissances sur la nature intime des corps, n'est point encore exécutée : mais les Physiciens en étudiant le phénomene de l'ébullition des liquides, & les Chimistes en décrivant l'ordre des produits dans les différentes distillations (Voyez Ebullition & Distillation), ont rassemblé assez d'observations pour en extraire les faits généraux, qui doivent former la théorie physique de l'ordre de vaporisation des corps. Voici les faits qui résultent de leurs observations.
1°. Un même liquide dont la surface est également comprimée, se réduit en vapeur & se dissipe toûjours au même degré de chaleur : de-là la constance du terme de l'eau bouillante. Voyez Ébullition & le mémoire de M. l'abbé Nollet. 2°. La vaporisation n'a besoin que d'un moindre degré de chaleur, si la surface du liquide est moins comprimée, comme il arrive dans l'air raréfié par la machine pneumatique ; au contraire, la vaporisation n'a lieu qu'à un plus grand degré de chaleur, si la pression sur la surface du liquide augmente, comme il arrive dans le digesteur ou machine de Papin. Voyez Digesteur. Delà l'exacte correspondance entre la variation legere du terme de l'eau bouillante & les variations du barometre. 3°. L'eau qui tient en dissolution des matieres qui ne s'élevent point au même degré de chaleur qu'elle, ou même qui ne s'él
Trésor de la Langue Française informatisé
EXPANSIBILITÉ, subst. fém.
PHYS., CHIM. Propriété de certaines substances d'augmenter en volume. [Les] fluides eux-mêmes, soit qu'ils conservent la même densité, soit qu'ils se trouvent dans l'état d'expansibilité (Condorcet, Esq. tabl. hist.,1794, p. 177).La vapeur n'agit alors qu'en vertu de son expansibilité : c'est la période de détente (Poincaré, Thermodyn.,1892, p. 275):Expansibilité au Scrabble
Le mot expansibilité vaut 26 points au Scrabble.
Informations sur le mot expansibilite - 13 lettres, 6 voyelles, 7 consonnes, 10 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot expansibilité au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
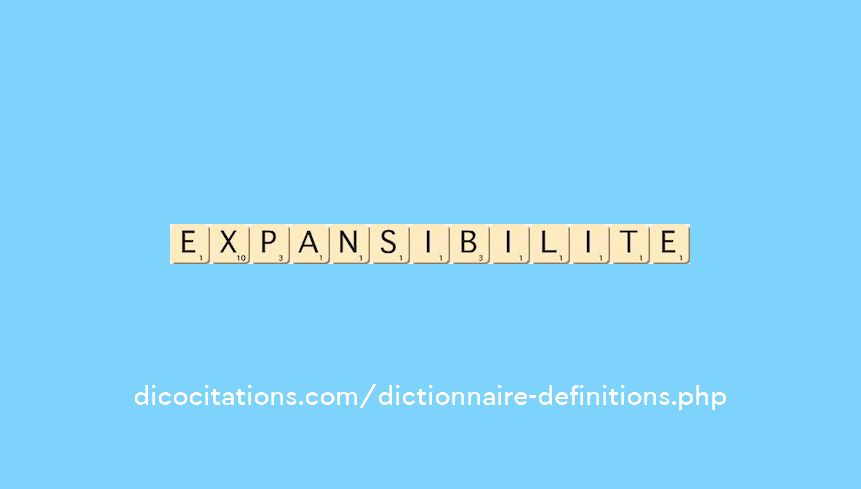
Les mots proches de Expansibilité
Expansibilité Expansible Expansif, ive Expansion Expansivité Expatriation Expatrié, ée Expatrier Expectance Expectant, ante Expectateur Expectatif, ive Expectation Expectative Expectoration Expectorer Expédié, ée Expédience Expédient Expédient Expédier Expéditeur Expéditif, ive Expédition Expéditivement Expérience Expérimental, ale Expérimenté, ée Expérimenter Expert, perte Expertise Expiable Expiateur, trice Expiation Expiatoire Expié, ée Expier Expirant, ante Expiration Expiré, ée Expirer Explanation Explétif, ive Explicateur Explicatif, ive Explication Explicitement Expliqué, ée Expliquer Expliqueur, euse expansé expansible expansif expansifs expansion expansionnisme expansionniste expansionniste expansionnistes expansive expansives expatriait expatriation expatrié expatrié expatrié expatriée expatrier expatrièrent expatriés expectatif expectation expectative expectatives expectora expectorant expectorant expectoration expectoré expectorées expectorer expédia expédiai expédiaient expédiais expédiait expédiant expédie expédié expédiée expédiée expédiées expédiées expédient expédient expédient expédientes expédients expédier expédieraMots du jour
Platée Titrer Colorateur, trice Ascendant, ante Sacrificateur Théophage Déshéritement Lien Coron Immaniéré, ée
Les citations avec le mot Expansibilité
Les citations du Littré sur Expansibilité
- La différente expansibilité des fluides soumis aux expériencesAuteur : CONDORCET - Source : Bucquet.
Les mots débutant par Exp Les mots débutant par Ex
Une suggestion ou précision pour la définition de Expansibilité ? -
Mise à jour le dimanche 8 février 2026 à 09h22

- Eau - Ecologie - Economie - Ecouter - Ecrire - Ecriture - Education - Égalité - Egalite - Ego - Egoisme - Elegance - Elevation - Elitisme - Embobiner - Emergence - Emotion - Energie - Enfance - Enfant - Enfer - Engager - Ennemi - Ennui - Enseignement - Enseigner - Envie - Environnement - Ephemere - Epouse - Épouse - Époux - Epoux - Epreuve - Eprouver - Éprouver - Equilibre - Erotisme - Erreur - Erudiction - Esclave - Espace - Espece - Espérance - Esperance - Esperer - Espérer - Espoir - Esprit - Essentiel - Estime - Etat - Eternel - Eternite - Ethique - Ethologie - Etonnement - Etrange - Etre - Etudier - Europe - Evidence - Evolution - Exces - Excuses - Exhibitionnisme - Exil - Existence - Exister - Experience - Expliquer - Exponentiel - Extase - Extra+terrestre
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur expansibilité
Poèmes expansibilité
Proverbes expansibilité
La définition du mot Expansibilité est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Expansibilité sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Expansibilité présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.




