Définition de « possessif »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot possessif de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur possessif pour aider à enrichir la compréhension du mot Possessif et répondre à la question quelle est la définition de possessif ?
Une définition simple : (fr-accord-if|possess|p?.se.s) possessif
Définitions de « possessif »
Trésor de la Langue Française informatisé
POSSESSIF, -IVE, adj.
Wiktionnaire
Nom commun - français
possessif \p?.se.sif\ masculin
- Élément grammatical possessif : pronom possessif, etc.
Adjectif - français
possessif \p?.s?.sif\
-
(Grammaire) Qui marque la possession de la chose dont on parle.
- Mon, ton, son, nos, vos, leurs sont des déterminants (ou adjectifs) possessifs.
- Le mien, la mienne, les nôtres sont des pronoms possessifs.
-
(Psychologie) Qui éprouve le besoin de s'approprier quelqu'un, de le posséder exclusivement.
- C'est une mère possessive pour ne pas dire abusive !
Littré
- Terme de grammaire. Qui sert à marquer la possession. Pronom, adjectif possessif.
Substantivement. Un possessif.
Composé possessif, composé dans lequel un substantif et un adjectif réunis sont donnés comme qualité possédée par un sujet, par exemple un b?uf courtes-cornes.
HISTORIQUE
XVe s. Mais quant au fait du possessif
, Orléans, Rond. 60.
Encyclopédie, 1re édition
POSSESSIF, ve (Gramm.) adjectif usité en Grammaire pour qualifier certains mots que l'on regarde communément comme une sorte de pronoms, mais qui sont en effet une sorte d'adjectifs distingués des autres par l'idée précise d'une dépendance relative à l'une des trois personnes.
Les adjectifs possessifs qui se rapportent à la premiere personne du singulier, sont mon, ma, mes ; mien, mienne, miens, miennes : ceux qui se rapportent à la premiere personne du pluriel, sont notre, nos ; nôtre, nôtres.
Les adjectifs possessifs qui se rapportent à la seconde personne du singulier, sont ton, ta, tes ; tien, tienne, tiens, tiennes : ceux qui se rapportent à la seconde personne du pluriel, sont votre, vos ; vôtre, vôtres.
Les adjectifs possessifs qui se rapportent à la troisieme personne du singulier, sont son, sa ses ; sien, sienne, siens, siennes : ceux qui se rapportent à la troisieme personne du pluriel, sont leur, leurs.
Sur cette premiere division des adjectifs possessifs, il faut remarquer que chacun d'eux a des terminaisons relatives à tous les nombres, quoique la dépendance qu'ils expriment soit relative à une personne d'un seul nombre. Ainsi mon livre veut dire le livre (au singulier) qui appartient à moi (pareillement au singulier) ; mes livres, c'est-à-dire les livres (au pluriel) qui appartiennent à moi (au singulier) : notre livre signifie le livre (au singulier) qui appartient à nous (au pluriel) ; nos livres, c'est la même chose que les livres (au pluriel) qui appartiennent à nous (pareillement au pluriel). C'est que la quotité des êtres qualifiés par l'idée précise de la dépendance, est toute différente de la quotité des personnes auxquelles est relative cette dépendance.
Dans la plûpart des langues, il n'y a qu'un adjectif possessif pour chacune des trois personnes du singulier, & un pour chacune des trois personnes du pluriel ; mais en françois, nous en avons de deux sortes pour chaque personne : l'un qui ne s'emploie jamais qu'avant un nom, & qui exclut tout autre article ; l'autre qui est toujours précédé de l'un des articles, le, la, les, & qui n'est jamais accompagné d'aucun nom, mais qui est toujours en concordance avec un nom déja exprimé auquel il se rapporte. C'est la même chose dans la langue allemande.
Les possessifs de la premiere espece sont mon, ma, mes, pour la premiere personne du singulier ; notre, nos, pour la premiere du pluriel : ton, ta, tes, pour la seconde personne du singulier ; votre, vos, pour la seconde du pluriel : son, sa, ses, pour la troisieme du singulier ; & leur, leurs, pour la troisieme du pluriel.
Les possessifs de la seconde espece sont le mien, la mienne, les miens, les miennes, pour la premiere personne du singulier ; le nôtre, la nôtre, les nôtres, pour la premiere du pluriel : le tien, la tienne, les tiens, les tiennes, pour la seconde personne du singulier ; le vôtre, la vôtre, les vôtres, pour la seconde du pluriel : le sien, la sienne, les siens, les siennes, pour la troisieme personne du singulier ; & le leur, la leur, les leurs, pour la troisieme du pluriel.
L'exacte différence qu'il y a entre les deux especes, c'est que les possessifs de la premiere espece me paroissent renfermer dans leur signification celle des possessifs de la seconde & celle de l'article ; ensorte que mon signifie le mien, ton signifie le tien, son signifie le sien, nos signifie les nôtres, &c. Mon livre, selon cette explication, veut donc dire le mien livre ou le livre mien ; nos livres, c'est les livres nôtres, &c. Et c'est ainsi que parlent les Italiens, il mio libro, imostri libri ; ou bien il libro mio, i libri nostri. « On disoit autrefois, comme l'écrivent encore aujourd'hui ceux qui n'ont pas soin de la pureté du langage, un mien frere, une tienne s?ur, un sien ami ». Vaugelas, rem. 338). Cette observation est fondamentale pour rendre raison des différens usages des deux sortes d'adjectifs.
1°. Ce principe explique à merveille ce que Vaugelas a dit (rem. 513) qu'il faut répéter le? possessif de la premiere espece comme on répete l'article, & aux mêmes endroits où l'on répéteroit l'article : par exemple, on dit le pere & la mere, & non pas les pere & mere ; & il faut dire de même son pere & sa mere, & non pas ses pere & mere, ce qui est, selon M. Chapelain, du style de pratique, & selon M. de Vaugelas, une des plus mauvaises façons de parler qu'il y ait dans toute notre langue. On dit aussi, les plus beaux & les plus magnifiques habits, ou les plus beaux & plus magnifiques habits, sans répéter l'article au second adjectif ; & l'on doit dire de même ses plus beaux & ses plus magnifiques habits, ou ses plus beaux & plus magnifiques habits, selon la même regle. Cette identité de pratique n'a rien de surprenant, puisque les adjectifs possessifs dont il est ici question, ne sont autre chose que l'article même auquel on a ajouté l'idée accessoire de dépendance relativement à l'une des trois personnes.
2°. C'est pour cela aussi que cette sorte d'adjectif possessif exclut absolument l'article, quand il se trouve lui-même avant le nom ; ce seroit une véritable périssologie, puisque l'adjectif possessif comprend l'article dans sa signification.
3°. On explique encore par-là pourquoi ces possessifs operent le même effet que l'article pour la formation du superlatif ; ainsi ma plus grande passion, vos meilleurs amis, leur moindre souci, sont des expressions ou les adjectifs sont au même degré que dans celles-ci, la plus grande passion, les meilleurs amis, le moindre souci : c'est que l'article qui sert à élever l'adjectif au degré superlatif, est réellement renfermé dans la signification des adjectifs possessifs, mon, ton, son, &c.
C'est apparemment pour donner à la phrase plus de vivacité, & conséquemment plus de vérité, que l'usage a autorisé la contraction de l'article avec le possessif dans les cas où le nom est exprimé ; & c'est pour les intérets de la clarté que, quand on ne veut pas répéter inutilement un nom déja exprimé, on exprime chacun à part l'article & le possessif pur, afin que l'énonciation distincte de l'article réveille plus surement l'idée du nom dont il y a ellipse, & qui est annoncée par l'article.
Presque tous les grammairiens regardent comme des pronoms les adjectifs possessifs de l'une & de l'autre espece, & voici l'origine de cette erreur : ils regardent les noms comme un genre qui comprend les substantifs & les adjectifs, & ils observent qu'il se fait des adjectifs de certains noms qui signifient des substances, comme de terre, terrestre. Ainsi meus est formé de mei, qui est le génitif du pronom ego ; tuns de tui, génitif de tu, &c. Or, dans le système de ces grammairiens, le substantif primitif & l'adjectif qui en est dérivé sont également des noms : & ils en concluent que ego & meus, tu & tuus, &c. sont & doivent être également des pronoms. D'ailleurs ces adjectifs possessifs doivent être mis au rang des pronoms, selon M. Restaut (ch. v. art. 3), parce qu'ils tiennent la place des pronoms personnels ou des noms au génitif : ainsi mon ouvrage, notre devoir, ton habit, votre maître, son cheval, en parlant de Pierre, leur roi en parlant des François, signifient l'ouvrage de moi, le devoir de nous, l'habit de toi, le maître de vous, le cheval de ui ou de Pierre, le roi d'eux ou des François.
Par rapport au premier raisonnemnnt, le principe en est absolument faux ; & l'on peut voir au mot Substantif que ce que l'on appelle communément le substantif & l'adjectif sont des parties d'oraison essentiellement différentes. J'ajoute qu'il est évident que bonus, tuus, scribendus & anterior ont une même maniere de signifier, de se décliner, de s'accorder en genre, en nombre & en cas avec un sujet déterminé ; & que la nature des mots devant dépendre de la nature & de l'analogie de leur service, on doit regarder ceux-ci comme étant à cet égard de la même espece. Si on veut regarder tuus comme pronom, parce qu'il est dérivé d'un pronom, c'est une absurdité manifeste, & rejettée ailleurs par ceux même qui la proposent ici, puisqu'ils n'osent dire qu'anterior soit une préposition, quoiqu'il soit dérivé de la préposition ante. Les racines génératives des mots servent à en fixer l'idée individuelle ; mais l'idée spécifique qui les place dans une classe ou dans une autre, dépend absolument & uniquement de la maniere de signifier qui est commune à tous les mots de la même classe. Voyez Mot.
Quant au principe prétendu raisonné de M. Restaut, j'y trouve deux vices considérables. Premierement il suppose que la nature du pronom consiste à tenir la place du nom ; & c'est une erreur que je crois solidement détruite ailleurs. Voyez Pronom. En second lieu, l'application qu'en fait ici ce grammairien doit être très-suspecte d'abus, puisqu'il en peut sortir des conséquences que cet auteur sans doute ne voudroit pas admettre. Regius, humanus, evandrius, &c. signifient certainement regis, hominis, evandri ; M. Restaut concluroit-il que ces mots sont des pronoms ?
Tous les grammairiens françois & allemans reconnoissent dans leurs langues les deux classes de possessifs que j'ai distinguées dès le commencement ; mais c'est sous des dénominations différentes.
Nos grammairiens appellent mon, ton, son, & leurs semblables possessifs absolus ; & ils regardent le mien, le tien, le sien, &c. comme des possessifs relatifs : ceux-ci sont nommés relatifs, parce que n'étant pas joints avec leur substantif, dit M. Restaut, ils le supposent énoncé auparavant, & y ont relation : mais personne ne dit pourquoi on appelle absolus les possessifs de la premiere espece ; & M. l'abbé Regnier paroît avoir voulu éviter cette dénomination, en les nommant simplement non-relatifs. Le mot de relatif est un terme dont il semble qu'on ne connoisse pas assez la valeur, puisqu'on en abuse si souvent ; tout adjectif est essentiellement relatif au sujet déterminé auquel on l'applique, soit que ce sujet soit positivement exprimé par un nom ou par un pronom, soit que l'ellipse l'ait fait disparoître & qu'il faille le retrouver dans ce qui précede. Ainsi les deux especes de possessifs sont également relatives, & la distinction de nos grammairiens est mal caractérisée.
Les grammairiens allemands ont apparemment voulu éviter ce défaut, & M. Gottsched appelle conjonctifs les possessifs de la premiere espece, mon, ton, son, &c. & il nomme absolus ceux de la seconde, le mien, le tien, le sien, &c. Les premiers sont nommés conjonctifs, parce qu'ils sont toujours unis avec le nom auquel ils se rapportent ; les autres sont appellés absolus, parce qu'ils sont employés seuls & sans le nom auquel ils ont rapport. Voilà comment les différentes manieres de voir une même chose, amenent des dénominations différentes & même opposées. M. de la Touche qui a composé en Angleterre l'art de bien parler françois, a adopté cette seconde maniere de distinguer les possessifs.
Avec un peu plus de justesse que la premiere, je ne crois pourtant pas qu'elle doive faire plus de fortune. Les termes téchniques de grammaire ne doivent pas être fondés sur des services accidentels, qui peuvent changer au gré de l'usage ; la nomenclature des sciences & des arts doit être immuable comme les natures dont elle est chargée de reveiller les idées, parce qu'elle doit en effet exprimer la nature intrinséque, & non les accidens des choses. Or il est évident que mien, tien, sien, &c. ne sont absolus, au sens des grammairiens allemans, que dans l'usage présent de leur langue & de la nôtre ; & que ces mêmes mots étoient conjonctifs lorsqu'il étoit permis de dire un mien frere, un sien livre, comme les Italiens disent encore il mio fratello, il suo libro.
M. Duclos, qui apparemment a senti le vice des deux nomenclatures dont je viens de parler, a pris un autre parti. « Mon, ton, son, ne sont point des pronoms, dit-il Remarque sur le chap. viij. de la II. part. de la gramm. gén. puisqu'ils ne se mettent pas à la place des noms, mais avec les noms mêmes : ce sont des adjectifs possessifs. Le mien, le tien, le sien, sont de vrais pronoms » Ce savant académicien juge que ces mots se mettent au lieu du nom qui n'est point exprimé ; mais, comme je l'ai dejà dit, ce n'est point là le caractere distinctif des pronoms : & d'ailleurs les adjectifs mien, tien, sien, &c. ne se mettent pas au lieu du nom. On les emploie sans nom à la vérité, mais ils ont à un nom une relation marquée qui les assujettit aux lois de la concordance comme tous les autres adjectifs ; & l'article qui les accompagne nécessairement est la marque la plus assurée qu'il y a alors ellipse d'un nom appellatif, la seule espece de mot qui puisse recevoir la détermination qui est indiquée par l'article.
C'est donc la différence que j'ai observée entre les deux especes de possessifs, qui doit fonder celle des dénominations distinctives de ces especes. Mon, ton, son, &c. sont des articles possessifs, puisqu'ils renferment en effet dans leur signification, celle de l'article & celle d'une dépendance relative à quelqu'une des trois personnes du singulier ou du pluriel ; que d'ailleurs ils font avec les noms qu'ils accompagnent l'office de l'article, qu'on ne peut plus énoncer sans tomber dans le vice de la périssologie. Mien, tien, sien, &c. sont de purs adjectifs possessifs, puisqu'ils ne servent qu'à qualifier le sujet auquel ils ont rapport, par l'idée d'une dépendance relative à quelqu'une des trois personnes du singulier ou du pluriel.
Content d'avoir examiné la nature des adjectifs possessifs, ce qui est véritablement de l'objet de l'Encyclopédie, je ne m'arrêterai point ici à détailler les différens usages de ces adjectifs par rapport à notre langue ; c'est à nos grammaires françoises à discuter ces lois accidentelles de l'usage ; mais je m'arrêterai à deux points particuliers, dont l'un concerne notre langue, & l'autre la langue allemande.
L'examen du premier point peut servir à faire voir combien il est aisé de se méprendre dans les décisions grammaticales, & combien il faut être attentif pour ne pas tomber dans l'erreur sur ces matieres. « Plusieurs ne peuvent comprendre, dit Vaugelas, remarque 320, comment ces?? possessifs, mon, ton, son, qui sont masculins, ne laissent pas de se joindre avec les noms féminins qui commencent par une voyelle (ou par un h muet)? Quelques-uns croient qu'ils sont du genre commun, servant toujours au masculin, & quelquefois au feminin, c'est-à-dire à tous les mots feminins qui commencent par une voyelle (ou par un h muet), afin d'éviter la cacophonie que feroient deux voyelles.... D'autres soutiennent que ces pronoms sont toujours du masculin, mais qu'à cause de la cacophonie on ne laisse pas de les joindre avec les feminins qui commencent par une voyelle (ou par un h muet), tout de même, disent-ils, que les Espagnols qui se servent de l'article masculin el pour mettre devant les noms féminins commençant par une voyelle, disant el alma, & non pas la alma. De quelque façon qu'il se fasse, il suffit de savoir qu'il se fait ainsi, & il n'importe guere, ou point du tout, que ce soit plutôt d'une maniere que de l'autre ».
Cela peut n'être en effet d'aucune importance s'il ne s'agit que de connoître l'usage de la langue & de s'y conformer : mais cela ne peut être indifférent à la Philosophie, si ce n'est à la philosophie sceptique qui aime à douter de tout. Thomas Corneille crut apparemment qu'une décision valoit mieux que l'incertitude, & il décide, dans sa note sur cette remarque, que cet usage de notre langue n'autorise pas à dire que mon, ton, son, sont du genre commun. « Je ne puis comprendre, dit l'abbé Girard à ce sujet, tom. I. discours vij. pag. 376. par quel goût, encore moins par quelle raison, un de nos puristes veut que mon, ton, son, ne puissent être feminins, & qu'ils sont toujours masculins, même en qualifiant des substantifs féminins. Il dit que la vraie raison qui les fait employer dans ces occasions est pour éviter la cacophonie : j'en conviens ; mais cette raison n'empêche pas qu'ils n'y soient employés au féminin : bien loin de cela, c'est elle qui a déterminé l'usage à les rendre susceptibles de ce genre. Quel inconvénient y a-t-il à les regarder comme propres aux deux, ainsi que leur pluriel ? Quoi ! on aimera mieux confondre & bouleverser ce que la syntaxe a de plus constant, que de convenir d'une chose dont la preuve est dans l'évidence du fait ? Voilà où conduit la méthode de supposer des maximes & des regles indépendantes de l'usage, & de ne point chercher à connoître les mots par la nature de leur emploi ». L'opinion de M. l'abbé Girard, & la conséquence qu'il en tire contre la méthode trop ordinaire des grammairiens, me paroissent également plausibles ; & je révoque volontiers & sans détour, ce que je me rappelle d'avoir écrit de contraire à l'article Gallicisme.
Je passe à l'observation qui concerne la langue allemande : c'est que l'usage y a introduit deux articles & deux adjectifs possessifs qui ont rapport à la troisieme personne du singulier ; l'un s'emploie quand la troisieme personne est du feminin, & l'autre, quand elle est du masculin. Cette différence ne sert qu'à déterminer le choix du mot, & n'empêche pas qu'il ne s'accorde en genre avec le nom auquel on l'applique. Ainsi son, quand la troisieme personne est du masculin, se dit en allemand sein, m. seine, f. & sein, n. & sien se dit seiner, m. seine, f. seines, n. ou bien der sernige, m. die seinige, f. das seinige, n. & tous ces mots sont dérivés du génitif masculin seiner (de lui). Mais si la troisieme personne est du feminin, son se dit en allemand ihr, m. ihre, f. ihr, n. & sien se dit ihrer, m. ihre, f. ihres, n. ou bien der ihrige, m. die ihrige, f. das ihrige, n. & tous ces mots sont dérivés du génitif feminin ihrer (d'elle). On peut concevoir, par cette propriété de la langue allemande, combien l'usage a de ressources pour enrichir les langues, pour y mettre de la clarté, de la précision, de la justesse, & combien il importe d'examiner de près les idiotismes pour en demêler les finesses & le véritable sens. C'est la conclusion que j'ai prétendu tirer de cette observation. (B. E. R. M.)
Étymologie de « possessif »
Provenç. possessiu?; espagn. posesivo?; ital. possessivo?; du lat. possessivus, qui vient de possessum, supin de possidere, posséder.
- Du latin possessivus (« qui marque la possession »).
Mise à jour de la notice étymologique par le programme de recherche TLF-Étym :
Histoire :
A. 0. a. possessif subst. masc. « pronom qui exprime la possession ». Attesté depuis milieu 14e siècle (GlParR, page 436, no 6.607 : possessivum : possessif). -
A. 0. b. possessif adj. « qui exprime la possession » (grammaire). Attesté depuis 2e moitié 14e siècle (AalmaR, page 322, no 9.494 : possessivus, ?va, ?vum : possessis ). -
A. 2. pronom possessif loc. nom. masc. « pronom qui exprime la possession ». Attesté depuis 1ère moitié 15e siècle (GramM4S, page 142, § 3 : .v. pronon possessif, c'est assavoir meus, tuus, suus, noster et vester ). -
A. 1. a. adjectif possessif loc. nom. masc. « adjectif qui exprime la possession ». Attesté depuis 1740 (Racine, Esther, page XXXI, in Google, Recherche de Livres : Racine emploie souvent l'adjectif possessif). -
A. 1. b. possessif subst. masc. « déterminant exprimant, entre autres rapports, la possession ». Attesté depuis 1572 (La Ramée, Grammaire1, page 134 : Quant au reste des præpositions, que les possessifs, Mien, tien,sien, nostre, vostre, peuvent recevoir, elles entrejettent [« intercalent »] larticle comme, Par le mien, pour le tien, Entre le sien). On observe qu'au 17e siècle la différence du pronom et de l'adjectif n'est pas encore bien prononcée, et c'est ainsi qu'Oudin, Grammaire1 déclare : « Je croy que les Poëtes de nostre temps ne se serviroient pas des phrases des anciens : le pere tien, le mien c?ur, le frere sien [?]. Je remarque, contre les reigles de nos vieux Grammairiens, que les possessifs [?] ne se peuvent pas tous accommoder avec le nom d'unité, mais seulement mien, tien, et sien : un mien amy, un tien parent, un sien frere ; pour les autres, on ne dit point maintenant, un nostre garçon, un vostre serviteur, un leur amy » (Winkler, Doctrine grammaticale, page 108). Par ailleurs, on relève déjà au milieu du 15e siècle le jeu de mots entre la relation grammaticale qui marque la possession et la jouissance des faveurs d'une femme dans CharlD'OrlC, volume 2, page 302, vers 7 : Pour respondre au narratif De vostre briefve expositive, Elle fut premier voquative, Par le moien de genitif. Les six ducatz sont nombratif, Mais quant au fait du possessif La chose est un peu neutrative, cf. Städtler, Grammatiksprache, pages 55?56. -
B. 1. possessif adj. « qui éprouve le besoin de posséder ». Attesté depuis ca 1372/1374 (OresmePolM, page 62 = DMF2 : Or appert donques que une espece laquelle est selon nature possessive est aucunement partie de yconomique et est devant, aussi comme servante et subministrative a elle). -
B. 2. possessif adj. « qui manifeste le besoin de posséder ». Attesté depuis 1501 (DestreesP, page 130, vers 1615 : Triste de coeur, annuyet et pensif, Tresaggravé de tout mal possessif, Cesar [?] Jetta ung cry impetueux, terrible). -
Origine :
A. 0. a. Transfert linguistique : emprunt au latin des grammairiens possessivum subst. neutre « pronom possessif » (attesté depuis Quintilien, TLL 10/2, 101). Cf. Kuhn in FEW 9, 238a, possessivus 1.
A. 0. b./A. 2./A. 1. a. Transfert linguistique : emprunt au latin des grammairiens possessivus adj. « qui exprime la possession » (attesté depuis Pline, dans la loc. nom. pronomen possessivum, TLL 10/2, 101). Cf. von Wartburg in FEW 9, 444b, pronomen 1.
A. 1. b. Formation française : ellipse de pronom possessif loc. nom. masc. « pronom qui exprime la possession » (cf. ci?dessus A. 2.). L'acception psychologique « qui s'exerce, agit dans un sens visant à l'appropriation » (B.) s'est développée à partir du sens grammatical et est usuelle aujourd'hui.
Rédaction TLF 1988 : Équipe diachronique du TLF. - Mise à jour 2008 : Thomas Städtler. - Relecture mise à jour 2008 : Nadine Steinfeld ; Éva Buchi ; Gilles Roques.
possessif au Scrabble
Le mot possessif vaut 14 points au Scrabble.
Informations sur le mot possessif - 9 lettres, 3 voyelles, 6 consonnes, 6 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot possessif au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
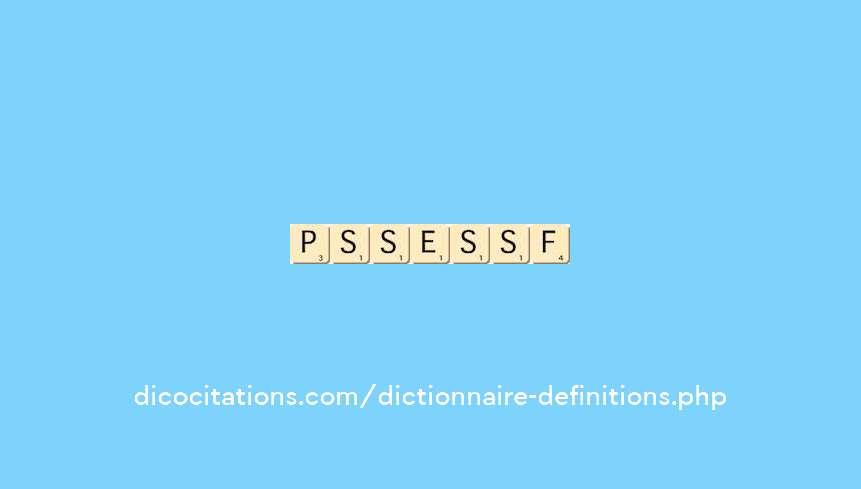
Les rimes de « possessif »
On recherche une rime en IF .
Les rimes de possessif peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en if
Rimes de rosbifs Rimes de digestif Rimes de administratifs Rimes de productifs Rimes de collectif Rimes de expansif Rimes de électif Rimes de administratifs Rimes de rétifs Rimes de contemplatifs Rimes de massifs Rimes de inoffensif Rimes de adhésif Rimes de logogriphe Rimes de captif Rimes de involutifs Rimes de explosif Rimes de exécutif Rimes de objectifs Rimes de punitif Rimes de maniaco-dépressifs Rimes de calcif Rimes de rebiffes Rimes de accusatif Rimes de nocif Rimes de comparatifs Rimes de directif Rimes de additifs Rimes de pensif Rimes de incisifs Rimes de sous-effectifs Rimes de agglutinatif Rimes de impératifs Rimes de perceptif Rimes de interprétatif Rimes de consultatif Rimes de contraceptifs Rimes de limitatif Rimes de actif Rimes de expéditif Rimes de revendicatifs Rimes de compétitifs Rimes de sédatifs Rimes de dégénératif Rimes de vomitif Rimes de portatifs Rimes de prédictif Rimes de primitifs Rimes de agrégatif Rimes de démonstratifMots du jour
rosbifs digestif administratifs productifs collectif expansif électif administratifs rétifs contemplatifs massifs inoffensif adhésif logogriphe captif involutifs explosif exécutif objectifs punitif maniaco-dépressifs calcif rebiffes accusatif nocif comparatifs directif additifs pensif incisifs sous-effectifs agglutinatif impératifs perceptif interprétatif consultatif contraceptifs limitatif actif expéditif revendicatifs compétitifs sédatifs dégénératif vomitif portatifs prédictif primitifs agrégatif démonstratif
Les citations sur « possessif »
- Nous avons beau dire: «Mon temps... je perds mon temps... je prends mon temps...» - ce possessif est dérisoire: c'est toujours lui qui nous possède.Auteur : Sacha Guitry - Source : Toutes réflexions faites
- Malherbe exigeait que le possessif eût un antécédent bien déterminé.Auteur : Ferdinand Brunot - Source : La Pensée et la Langue
- L'amour exclusif et possessif, lorsqu'il réunit deux caractères semblables, réalise l'idéal amoureux qui oblitère le reste du monde.Auteur : Bernard Willems-Diriken, dit Romain Guilleaumes - Source : Le Bûcher des Illusions, A vrai dire (2007-2008)
- Le verbe aimer se conjugue trop souvent à l'imparfait du possessifAuteur : Marc Escayrol - Source : Mots et Grumots (2003)
- Mes respects : Formule de politesse qui n'a perduré qu'en perdant son possessif et le pluriel : respect !Auteur : Philippe Bouvard - Source : Bouvard de A à Z (2014)
- Ce qu'il était, c'était - comment dire? - possessif. Il n'y a pas d'autre mot. Ce qu'il avait, c'était l'instinct - oh! très fort - de la propriété, de la chose personnelle.Auteur : Georges Duhamel - Source : Chronique des Pasquier (1933-1945)
- Avec tous ses défauts, je trouvais cet homme extraordinaire. Orgueilleux – il aime être au centre de tout-, possessif, brutal, autoritaire, soupe au lait, il était génial. Vous savez, j'ai une grosse expérience de ces gens-là, mon père était pire que lui, mais Pierre Bergé était un personnage romanesque.Auteur : Lambert Wilson - Source : Interview Putsch, propos recueillis par Emmanuelle De Boysson, le 22 avril 2018
- Peindre, c'est se remettre à aimer. Pour voir comme le peintre voit, il faut regarder avec les yeux de l'amour. Son amour à lui n'a rien de possessif: le peintre est obligé de partager ce qu'il voit.Auteur : Henry Miller - Source : Peindre c'est aimer à nouveau (1960)
- Nous avons beau dire : « Mon temps... je perds mon temps... je prends mon temps... » — ce possessif est dérisoire : c'est toujours lui qui nous possède. Auteur : Sacha Guitry - Source : Toutes réflexions faites (1947)
- Si je doute de mon existence, je ne conteste pas l'existence, mais seulement qu'elle soit mienne. L'usage du possessif m'est interdit.Auteur : Jacques Rigaut - Source : Ecrits posthumes (1970)
Les mots proches de « possessif »
Pose Pose Posé, ée Posée Posément Poser Positif, ive Positif Position Positivement Pospolite Possédable Possédé, ée Posséder Possesseur Possessif, ive Possession Possessionné, ée Possessoire Possibilité Possible Possiblement Postalement Post-biblique Postcommunion Post-consulat Poste Poste Poste Posté, ée Poster Postères Postérieur, eure Postériorité Postérité Postéromanie Postface Post-glaciaire Posthume Posthumement Postiche Postier Postille Postillon Postillonné, ée Postillonner Postiquerie Post-méridien, ienne Postposer PostscriptLes mots débutant par pos Les mots débutant par po
posa posada posadas posai posaient posais posait posâmes Posanges posant posas posât pose pose posé posé pose-la-moi posée posée posées posées posément posemètre posent poser posera poserai poseraient poserais poserait poseras posèrent poserez poseriez poserions poserons poseront poses poses posés posés Poses poseur poseur poseurs poseurs poseuse poseuse posez posiez
Les synonymes de « possessif»
Les synonymes de possessif :- 1. exclusif
2. captatif
3. fanatique
4. intolérant
synonymes de possessif
Fréquence et usage du mot possessif dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « possessif » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot possessif dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Possessif ?
Citations possessif Citation sur possessif Poèmes possessif Proverbes possessif Rime avec possessif Définition de possessif
Définition de possessif présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot possessif sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot possessif notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 9 lettres.
