La définition de Figure du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Figure
Nature : s. f.
Prononciation : fi-gu-r'
Etymologie : Provenç. espagn. et ital. figura ; du latin figura, du radical fig qui est dans fingere, former (voy. ).
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de figure de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec figure pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Figure ?
La définition de Figure
La forme extérieure d'un corps. La figure de la terre.
Toutes les définitions de « figure »
Wiktionnaire
Nom commun - français
figure \fi.?y?\ féminin
-
Forme extérieure d'un corps, d'un être.
- Durant la même nuit, Feempje qui n'avait jamais de cauchemar s'était débattu, en grognant et en poussant des plaintes, contre il n'aurait pu dire quelles terrifiantes figures. ? (Francis Carco, Brumes, Éditions Albin Michel, Paris, 1935, page 55)
- La figure de la terre.
- Les diverses figures qu'affectent les cristaux.
- Il n'a pas figure d'homme.
- Il n'a pas figure humaine.
- Minerve, cachée sous la figure de Mentor.
-
(En particulier) Visage de l'homme.
- Rien de gracieux comme ses mouvements d'épaules, lorsqu'elle attire le menton pour se cacher entièrement la figure, qui, par instants, se montre à la dérobée. ? (Flora Tristan; Les Femmes de Lima, dans Revue de Paris, tome 32, 1836)
- Un cantinier qui se rase sur l'accotement, sa glace pendue à un cerisier, attend avec nervosité, la figure débordant de mousse, que nous ayons fini de faire trembler la route. ? (Jean Giraudoux, Retour d'Alsace - Août 1914, 1916)
- Les indigènes se montraient très sympathiques, aimables et complaisants ; leurs figures du type mongol caractérisé, souriaient, intelligentes et franches. ? (Jean-Baptiste Charcot, Dans la mer du Groenland, 1928)
- Physiquement malade, d'aspect débile, la figure ravagée et longue, qui se termine par une petite barbiche poivre et sel. ? (Victor Méric, Les Compagnons de l'Escopette, Éditions de l'Épi, Paris, 1930, page 208)
- J'examine à la dérobée son sein qui se soulève et qui s'abaisse, et sa figure immobile, et le livre vivant qui est uni à elle. ? (Henri Barbusse, L'Enfer, Éditions Albin Michel, Paris, 1908)
- [?] le vieux souriait, et, dans sa figure madrée, plissée de rides, creusée de sillons, embroussaillée de poils, ses petits yeux vifs et clignotants brillaient étrangement. ? (Louis Pergaud, La Vengeance du père Jourgeot, dans Les Rustiques, nouvelles villageoises, 1921)
-
(Par extension) Air, contenance, manières, etc.
- Je ne savais trop quelle figure je devais faire.
- Il faisait une triste figure au cours de ce voyage, car il souffrait de ses blessures.
- « La figure que nous faisons dans le monde n'est pas indifférente, poursuivit le sentencieux David. On nous jugera sur nos façons, sur les mots dont nous ferons usage, sur notre mise. ? (Julien Green, Moïra, 1950, réédition Le Livre de Poche, page 69)
-
État bon ou mauvais dans lequel se trouve une personne à l'égard de ses affaires, de son crédit, etc.
- Cet homme fait bonne figure dans le monde ; il y fait mauvaise figure, pauvre figure, triste figure ; il n'y fait aucune figure.
-
Représentation de certains objets.
- Le monstre c'est le drac, la tarasque espèce de tortue-dragon, dont on promène la figure à grand bruit dans certaines fêtes. ? (Jules Michelet, Tableau de la France, dans le vol. 2 de Histoire de France, Hetzel, 1831 ? éd. Paris : Les Belles Lettres & Offenbourg/Mayence : Lehrmittel, 1947, page 47)
- Des figures de plantes, d'animaux, pour illustrer leur description.
- Leurs étendards portaient des figures bizarres et monstrueuses.
- Un livre avec figures, orné de figures : avec des illustrations, des vignettes.
-
(En particulier) Personnage représenté dans un ouvrage de peinture, de sculpture, de gravure, etc.
- Il y a plusieurs figures dans ce tableau.
- Cette figure est mal dessinée.
- Ces figures n'ont pas d'expression, de mouvement?
- (Jeu de cartes) Carte qui représente un roi, une dame, un cavalier ou un valet.
-
(Mystique) Ce qui est regardé comme représentation, comme image symbolique ou allégorique.
- Joseph et Salomon sont des figures de Jésus-Christ.
- L'agneau pascal était une figure de l'Eucharistie.
-
(En particulier) Personnage célèbre, important ou marquant, généralement dans un contexte daté.
- Harland, qui a fort bien connu Vavilov, condamne sans réserves les théories mitchouriniennes, taxe Lyssenko de charlatan et dénonce les odieuses man?uvres qui ont abouti à la révocation des principales figures de la génétique soviétique. ? (Joël Kotek & Dan Kotek, L'affaire Lyssenko, page 196, Éditions Complexe, 1986)
- [?] ; et le gros des troupes était une horde de barbares dans toute la force du terme. C'était de ces figures étranges qui avaient parcouru la Gaule au temps d'Attila et de Chlodowig, [?]. ? (Augustin Thierry, Récits des temps mérovingiens, 2e récit : Suites du meurtre de Galeswinthe ? Guerre civile ? Mort de Sighebert (568-575), 1833 - éd. Union Générale d'Édition, 1965)
- Alpagué sur le marché, au coin d'une rue ou directement à l'hôtel de ville, le maire est une figure centrale dans les villages. ? (Camille Bordenet, Solène Cordier et Solène Lhénoret, Les maires des petites communes, Don Quichotte fatigués, Le Monde. Mis en ligne le 27 septembre 2018)
-
(Géométrie) Espace borné par une ou plusieurs lignes, soit que ces lignes existent naturellement ou fictivement, soit qu'on les ait tracées sur une surface plane pour faire une démonstration, une opération, etc.
- Imaginez une figure de géométrie assez compliquée, tracée avec du crayon blanc sur une grande ardoise : eh bien ! je vais expliquer cette figure de géométrie. ? (Stendhal, De l'Amour, 1re préface de 1826)
- Le diagramme de la figure ci-contre montre 960 épreuves. ? (D. de Prat, Nouveau Manuel complet de filature ; 1re partie : Fibres animales & minérales, Encyclopédie Roret, 1914)
- Note : On le dit également des lignes qui n'enferment pas un espace.
- La ligne spirale et la cycloïde sont des figures de mathématique.
-
(Danse) Les différentes lignes qu'on décrit en dansant.
- Figure de contredanse.
- Connaître bien toutes les figures du menuet.
- Figure de ballet.
- (Jonglerie) Les différentes suites de passes qu'on exécute en jonglant.
-
(Grammaire, Rhétorique) Une certaine forme de langage vive et imagée.
- Il y a autant et peut-être plus de figures dans le langage populaire que dans celui des écrivains et des orateurs.
- Une figure hardie.
Littré
-
1La forme extérieure d'un corps. La figure de la terre.
Leur utilité particulière [des égoïstes] se présente partout à eux, comme à cet ancien malade sa propre figure, qu'il voyait perpétuellement devant lui
, Guez de Balzac, De la cour, 5e disc.Il y a cette différence entre la forme et la figure, que la forme est la disposition extérieure des corps qui sont animés, et la figure la disposition extérieure des corps qui sont inanimés
, Molière, Mar. forcé, sc. 6.Pour Dieu?! ne prenez point de vilaine figure
, Molière, Ét. II, 5.Son stratagème ici se trouve salutaire?; Mais, près de maint objet chéri, Pareil déguisement serait pour ne rien faire?; Et ce n'est pas partout un bon moyen de plaire Que la figure d'un mari
, Molière, Amph. Prologue.Et de ces blonds cheveux, de qui la vaste enflure Des visages humains offusque la figure
, Molière, Éc. des mar. I, 1.Sans cesse on prend le masque, et, quittant la nature, On craint de se montrer sous sa propre figure
, Boileau, Ép. IX.? Caligula, Néron, Monstres dont à regret je cite ici le nom, Et qui? ne conservant que la figure d'homme?
, Racine, Bér. II, 2.C'est sans doute quelque divinité sous une figure humaine
, Fénelon, Tél. XVII.Il prend d'un simple enfant la figure et la voix
, Voltaire, Henr. IX.Sa courbure naturelle, qui se termine en pointe aux deux extrémités, lui donne la figure d'un croissant
, Raynal, Hist. phil. XVI, 2.C'est une plaisante figure d'homme, se dit d'un homme très mal fait, ou ridicule par sa tenue et ses manières.
Dans le langage de la dévotion.
La figure du monde, les choses qui y adviennent Le monde est une figure trompeuse qui passe
, Fléchier, M. de Montausier.Si la figure du monde nous amuse et nous éblouit
, Massillon, Carême, Prière 2.Faire amende honorable avec les figures, se disait autrefois d'un criminel qui faisait amende honorable, la corde au cou, tenant à la main une torche allumée.
-
2Le visage de l'homme. Une figure imposante. La jolie figure d'enfant?! Être bien de figure. Je connais cette figure-là.
Est-on d'une figure à faire qu'on se raille??
Molière, Psyché, I, 1.Jusques à sa figure [à deviner quelle était sa figure] encor la chose alla, Et je vis, par les vers qu'à la tête il nous jette, De quel ?il il fallait que fût fait le poëte
, Molière, F. sav. I, 3.Elle laissait aller cela [ses charmes] comme il plaisait au Seigneur, sans employer l'art pour faire valoir ce qu'elle tenait de la nature?; mais, malgré cette nonchalance pour ses attraits, sa figure avait quelque chose de si piquant, que le chevalier de Grammont s'y laissa prendre d'abord
, Hamilton, Gramm. 4.Et quoi cette vieille figure Viendra-t-elle toujours troubler nos entretiens??
Destouches, Glor. IV, 2.Pour M. le chevalier de la Tremblaye, tout ce que je sais, c'est qu'il doit réussir auprès des hommes par la douceur de ses m?urs, et auprès des dames par sa figure
, Voltaire, Lett. d'Alembert, 9 janv. 1765.[À un coup de vent qui amena l'hiver] tout changea, les chemins, les figures, les courages?; l'armée devint morne, la marche pénible?; la consternation commença
, Ségur, Hist. de Nap. IX, 7.Absolument. Avoir de la figure, avoir une figure qui se fait remarquer.
Placez-vous?; comment donc?? elle a de la figure
, Favart, Soliman II, I, 6. -
3L'apparence, la contenance, les manières. Un orgueil qui se cache sous la figure de l'humilité.
Chacun fait ici-bas la figure qu'il peut
, Molière, Fem. sav. III, 2.Je vous laisse à penser si, dans la nuit obscure, J'ai d'un vrai trépassé su tenir la figure
, Molière, Éc. des f. V, 2.Enfin, comme il en fut tout à fait déchu, il se résolut à dire ce qu'il avait dans le c?ur, et à se donner la figure d'un martyr
, Bossuet, Var. VII, § 103.Mlle Varthon rougissait, et ne savait quelle figure faire
, Marivaux, Marianne, 8e part.Observez quelle sotte figure il y fera
, Rousseau, Ém. v.Familièrement et par ironie. De bonnes figures, des personnes dont on se raille, qui ont quelque ridicule.
Nous aurons de bonnes figures là dedans
, Genlis, Théât. d'éduc. les Dangers du monde, III, 7.Que t'en semble?? quelles tournures?! Ils sont bien généreux vraiment De montrer gratis des figures Qu'on irait voir pour de l'argent
, Scribe Et G. Delavigne, la Somnambule, I, 9.Faire figure, se dit quelquefois pour figurer, occuper une certaine place.
Le corps avec l'esprit fait figure, mon frère?; Mais, si vous en croyez tout le monde savant, L'esprit doit sur le corps prendre le pas devant
, Molière, F. sav. II, 7.Fig. Faire figure, une figure, avec une épithète, être dans une position signifiée par l'épithète.
Je fais figure en France assez considérable
, Molière, Fâch. I, 5.C'est votre malheur et le sien [du chevalier de Grignan] qui l'empêche d'être en un lieu [Versailles] où il ferait une si bonne figure, et si utile pour sa famille et pour son neveu
, Sévigné, 504.M. d'Avaux fait en cette occasion la plus belle figure du monde
, Sévigné, 525.Elle fera à son retour une grande figure
, Sévigné, 238.Et, riche en apparence, Je fais une figure égale à ma naissance
, Destouches, Glor. IV, 7.L'espoir d'y faire bientôt une figure digne de moi
, Rousseau, Conf. II.Les ennemis de la raison font dans ce moment assez sotte figure
, D'Alembert, Lett. à Voltaire, 31 mars 1762.Honorablement employé dans la police, ou gendarme, vous tiendriez un rang, feriez une figure
, Courier, Pamphl. des pamphl.Faire quelque figure, avoir une certaine position, un certain crédit.
On sait qu'auprès du roi je fais quelque figure
, Molière, Mis. I, 2.Absolument. Faire figure, être dans une situation avantageuse, paraître beaucoup, dépenser beaucoup.
Et qu'importe?? je fais figure, je vis, je me réjouis, les dupes payent tout, mon fonds ne s'altère pas
, Dancourt, Déroute du pharaon, sc. 3.Pourvu qu'on trouve le moyen de faire figure dans le monde
, Bossuet, Variat. 15.Le chevalier de la triste figure, nom que prit Don Quichote.
Se dit aussi en général, et par allusion, de quelqu'un qui a l'air maussade. C'est un vrai chevalier de la triste figure.
Faire triste figure, avoir une mine piteuse et fig. jouer un rôle misérable en quelque affaire.
- 4Représentation de certains objets. Figures d'animaux, de plantes. Figures symboliques. Un livre orné de figures.
-
5 Terme d'arts. Représentation d'un personnage. Il n'y a que deux figures dans son tableau. Figure équestre. Figure en bronze.
Figure de proportion académique, se dit quelquefois des figures de 20 à 24 pouces, cette dimension étant celle qui est en usage pour les études des élèves de l'Académie.
Demi-figure, celle qui ne présente que le haut du corps, depuis la ceinture.
Par plaisanterie. Figure à louer, figure inutile dans un tableau.
Terme de marine. La statue, le buste que l'on place au bout de la guibre, en dessous du beaupré.
-
6 Terme d'architecture. Trait que l'on fait de la forme d'un bâtiment pour en lever les mesures.
Terme de relieur. Figures plates, celles qui, se rapportant avec le cadre du livre, ne nécessitent aucuns plis.
-
7 Terme de danse. Chemin décrit par les danseurs suivant certaines lignes déterminées, qui, représentées sur le papier, y formeraient une sorte de figure géométrique. Les figures les plus simples sont celles des danses tournantes comme la valse, la polka, etc. qui se réduisent à un cercle ou une ellipse.
La plus simple et selon toute apparence la plus ancienne figure chorégraphique, celle qui consiste à tourner en rond jusqu'à ce que l'haleine manque ou que le jarret fléchisse
, Ch. de Bernard, le Gentilhomme campagnard, II, § 4.Par une métonymie naturelle, on appelle aussi figures les danses qui sont figurées d'une manière particulière. L'été est une figure, la poule en est une autre?; il y a cinq figures dans un quadrille.
Danse figurée, danse composée de figures, c'est-à-dire de différents pas inventés par l'art.
Figure de ballet, les diverses situations qu'occupent successivement les unes par rapport aux autres les personnes qui dansent une entrée de ballet.
- 8 Terme d'escrime. Se dit des différentes positions du corps, du bras ou de l'épée.
-
9 Terme de jeux. Se dit des cartes qui représentent les rois, les dames et les valets.
L'on souffre dans la république les chiromanciens et les devins, ceux qui font l'horoscope et qui tirent la figure
, La Bruyère, XIV. - 10 Terme d'arithmétique. Chacun des chiffres qui composent un nombre. Un nombre exprimé par six figures.
-
11 Terme de musique. Se dit des notes de différentes valeurs, des silences, et, généralement, d'un signe quelconque employé dans l'écriture musicale.
Nombre de notes qui forment une sorte de sens musical moins marqué que celui de la phrase qui est elle-même composée de figures, ou, suivant Fétis, groupe de notes qui forme un certain dessin.
-
12 Terme de géométrie. Espace borné par des lignes. Figure plane, carrée, circulaire. Tracer des figures sur le tableau.
On le dit également des lignes qui n'enferment point un espace. La ligne spirale et la cycloïde sont des figures de mathématique.
-
13 Terme d'astrologie. Description et représentation de l'état et de la disposition du ciel à une certaine heure.
Figure de géomancie, figure prétendue de divination, composée de points qui sont jetés au hasard et disposés sur seize lignes rangées de quatre en quatre.
-
14Figures du syllogisme, arrangements divers que l'on peut faire du moyen terme dans la majeure et la mineure?; il ne peut qu'être sujet ou attribut dans chacune des deux prémisses?; il n'y a donc que quatre figures.
Qu'il me soit permis auparavant de faire un argument en la troisième figure
, Perrot D'Ablancourt, Lucien, La double accusation. -
15 Terme de rhétorique et de grammaire. Certaines formes de langage qui donnent au discours plus de grâce et de vivacité, d'éclat et d'énergie. Figures oratoires.
L'orateur recourut à ces figures violentes Qui savent exciter les âmes les plus lentes?; Il fit parler les morts, tonna, dit ce qu'il put
, La Fontaine, Fabl. VIII, 4.Quand j'appellerais à mon secours les expressions les plus fortes et les figures les plus violentes de la rhétorique, je ne puis assez expliquer quelle sera la confusion de ceux dont les crimes scandaleux ont déshonoré le ciel et la terre
, Bossuet, Sermons, Jugement dernier, 2.De figures sans nombre égayez votre ouvrage
, Boileau, Art p. III.Il n'en est pas des ornements de l'architecture comme de ceux du discours?; il est naturel à l'homme de faire des figures de rhétorique
, Perrault, Parall. des anciens et des mod. t. II, p. 129.L'usage des figures demande beaucoup de discernement et de prudence?; elles servent comme de sel et d'assaisonnement au discours, pour relever le style, pour éviter une façon de parler vulgaire et commune, pour prévenir le dégoût que causerait une ennuyeuse uniformité
, Rollin, Traité des Ét. III, 3.Il ne faut qu'écouter une dispute entre des femmes de la plus vile condition?; quelle abondance de figures?! elles prodiguent la métonymie, la catachrèse, l'hyperbole?
, Louis Racine, Réfl. sur la poésie, III, 1.Ce corps [l'Académie française] a quarante têtes, toutes remplies de figures, de métaphores et d'antithèses
, Montesquieu, Lett. pers. 73.L'envieux et sa femme prétendirent que, dans son discours, il n'y avait pas assez de figures, qu'il n'avait pas assez fait danser les montagnes et les collines
, Voltaire, Zadig, 7.Figures de mots, celles qui tirent quelque effet de l'arrangement des mots ou de leur forme matérielle (répétition, opposition, onomatopée). Figures ou tropes, celles qui consistent, soit à étendre soit à détourner la signification d'un mot (catachrèse, métonymie, etc.). Figures de construction, ou de syntaxe, ou de grammaire, celles dans lesquelles les constructions s'écartent de l'ordre simple, naturel ou direct (ellipse, etc.).
Figures de pensée, celles qui sont indépendantes de l'expression, par exemple l'antithèse, l'apostrophe, etc.
Figures de rhétorique, se dit, en général, de toutes les figures de pensée et de celles de mots qui ne résultent pas d'une construction particulière de la phrase.
Figures de construction ou de grammaire, par opposition à figures de rhétorique, celles qui résultent de la forme particulière de la phrase.
-
16Dans le sens mystique, ce qui est regardé comme la représentation, le symbole.
Tant qu'on soutiendra que le pain n'est le corps de Jésus-Christ qu'en figure, assurément on ne dira pas avec l'article de Smalcade, que le pain, etc?
, Bossuet, Var. IV, § 37.Jérusalem fut la figure de l'Église
, Bossuet, Hist. III, 9.À l'exemple des Israélites qui n'ont été pour nous qu'une figure de ce que nous devrions pratiquer
, Bourdaloue, Dominic. IV, Éloignement du monde, 43.Joseph, vendu par ses frères aux Égyptiens, regardé par Jacob comme mort, oublié par toute sa famille, honoré pendant cet intervalle et régnant en Égypte, est incontestablement la figure de Jésus-Christ, livré aux gentils par les Juifs
, Rollin, Traité des Ét. liv. V, part. II, ch. 2, art. 2.Jésus-Christ nous a montré d'abord la grande figure de son union avec l'Église
, Chateaubriand, Génie, I, I, 50.Il se dit aussi dans le langage général, en un sens analogue.
Bélise?: Je vois où doucement veut aller la demande, Et je sais sous ce nom [le nom d'Henriette] ce qu'il faut que j'entende?; La figure est adroite?; et, pour n'en point sortir? Je dirai qu'Henriette à l'hymen est rebelle
, Molière, F. sav. I, 4.Familièrement. Quittons la figure, parlons sans déguisement.
Ce fut alors que sa charité, comme un fleuve sorti d'une source vive et abondante? parlons sans figure, messieurs?: ce fut alors qu'unissant à ses aumônes celles qu'elle avait sollicitées et recueillies?
, Fléchier, Aig.Mon cher ange, il n'y a plus moyen de vous parler en figure, depuis que vous êtes un peu content de ce que je vous ai envoyé?; vous m'avez rendu le courage et l'espérance
, Voltaire, Lett. d'Argental, 31 août 1777.
SYNONYME
FIGURE, FORME. Dans la philosophie aristotélique, forme se dit de toutes les qualités de l'objet, et figure de la forme qu'il affecte en un moment donné. La figure d'un franc est celle d'un cylindre beaucoup plus large que haut?; sa forme est d'être en argent allié d'un dixième de cuivre, pesant cinq grammes, d'être solide, etc.
HISTORIQUE
Xe s. In figure de colomb [elle] volat à ciel
, Eulalie.
XIe s. Ô bele buce [bouche], bel vis, bele faiture, Cum est mudede [changée] vostre bele figure?!
St Alexis, XCVII.
XIIe s. Mar [à la male heure] acointai sa très bele figure Pour ces dolors et pour ces maus atraire
, Couci, p. 126.
XIIIe s. Premier [il] parole par figure [figurément]
, Amadas et Ydoine, ms. 6987. Sa très laide figure me fait espoenter
, Six manières de fols. Moult haute chose fit nature, Quant forma si noble figure, En qui si grans biautez resplent
, Complainte douteuse, dans JUBINAL, t. II, p. 253.
XIVe s. Il doit jugier par la connoissance publique que il a come juge en figure de jugement
, Oresme, Eth. 162. Il parle en similitude et en figure
, Oresme, ib. 24.
XVe s. J'aim par amours la plus belle figure Que nulz homs puist de ses yeux regarder
, Deschamps, Poésies mss. f° 220.
XVIe s. Le chasteau du tyran [Denys] fut plein de poulciere, pour la multitude d'estudians qui trassoient les figures de la geometrie
, Amyot, Comm. disc. le flatteur de l'ami, 15. Une piece d'or où estoient gravées quelques figures celestes
, Montaigne, I, 95. Ces rares figures [les grands hommes de l'antiquité] et triées pour l'exemple du monde par le consentement des sages
, Montaigne, I, 265. Parer son parler du fard des figures et feinctes d'un oraison apprinse
, Montaigne, IV, 217. Qu'ils eussent à desloger de Fontainebleau dans vingt-quatre heures sur peine d'estre pendus sans figure de procès
, D'Aubigné, Hist. I, 89.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
FIGURE. Ajoutez?:Figure d'accident, figure triste, effarée et rendue telle comme à la nouvelle de quelque fâcheux accident,Ch. Nisard, Parisianismes, 1876, p. 112.
Pour vous, avec votre figure d'accident et votre tête à croquignolles,Les sept en font deux, comédie par Guillemain, sc. 7, 1786.
? Couper [les fers météoriques], polir la surface coupée, et l'attaquer avec un acide, il doit y apparaître alors des dessins géométriques provenant de la cristallisation du métal et appelés figures de Widmanstaetten, nom du naturaliste qui le premier les a remarquées, Acad. des sc. Comptes rend. t. LXXXIV, p. 478.
Encyclopédie, 1re édition
FIGURE, s. f. (Physique.) se dit de la forme extérieure des corps ; je dis extérieure, les anciens philosophes ayant distingué par ce moyen la figure de la forme proprement dite, qui n'est autre chose que l'arrangement intérieur de leurs parties. Plusieurs philosophes modernes ont prétendu que les corps ne différoient les uns des autres, que par l'arrangement & la figure de leurs particules. Sur quoi voyez l'article Configuration. Cette question est de celles qui ne seront jamais décidées en Physique, parce qu'elle tient à d'autres qui ne le seront jamais, celles de la nature des élémens de la matiere, de la dureté, &c. Voyez Elémens, Matiere, Principe, Dureté, &c.
Figure, en Géométrie, se prend dans deux acceptions différentes.
Dans la premiere, il signifie en général un espace terminé de tous côtés, soit par des surfaces, soit par des lignes. S'il est terminé par des surfaces, c'est un solide ; s'il est terminé par des lignes, c'est une surface : dans ce sens les lignes, les angles ne sont point des figures. La ligne, soit droite, soit courbe, est plûtôt le terme & la limite d'une figure, qu'elle n'est une figure. La ligne est sans largeur, & n'existe que par une abstraction de l'esprit ; au lieu que la surface, quoique sans profondeur, existe, puisque la surface d'un corps est ce que nous en voyons à l'extérieur. Voy. Ligne, Point, Surface, Géométrie, &c. Un angle n'est point une figure, puisque ce n'est autre chose que l'ouverture de deux lignes droites, inclinées l'une à l'autre, & que ces deux lignes droites peuvent être indéfinies. L'angle n'est pas l'espace compris entre ces lignes ; car la grandeur de l'angle est indépendante de celle de l'espace dont il s'agit ; l'espace augmente quand les lignes croissent, & l'angle demeure le même.
Au reste on applique encore plus souvent, en Géométrie, le nom de figure aux surfaces qu'aux solides, qui conservent pour l'ordinaire ce dernier nom. Or une surface est un espace terminé en tout sens par des lignes droites ou courbes : ainsi on peut, suivant l'acception la plus ordinaire, définir la figure, un espace terminé en tout sens par des lignes.
Si la figure est terminée en tout sens par des lignes droites, on l'appelle surface plane : cette condition, en tout sens, est ici absolument nécessaire, car il faut que l'on puisse en tout sens appliquer une ligne droite à la figure pour qu'elle soit plane ; en effet une figure pourroit être terminée extérieurement par des lignes droites, sans être plane : telle seroit une voûte qui auroit un quarré pour base.
Si on ne peut appliquer une ligne droite en tout sens à la surface, elle se nomme figure courbe, & plus communément surface courbe. Voyez Courbe & Surface.
Si les figures planes sont terminées par des lignes droites, en ce cas on les nomme figures planes rectilignes, ou simplement figures rectilignes : tels sont le triangle, le parallélogramme, & les polygones quelconques, &c. Si les figures planes sont terminées par des lignes courbes, comme le cercle, l'ellipse, &c. on les nomme figures planes curvilignes. Voy. Courbe & Curviligne. On appelle aussi quelquefois figures curvilignes les surfaces courbes, comme le triangle sphérique. Enfin on appelle figures mixtilignes ou mixtes, celles qui sont terminées en partie par des lignes droites, & en partie par des lignes courbes.
On appelle côtés d'une figure, les lignes qui la terminent : cette dénomination a lieu sur-tout quand ces lignes sont droites. Elle n'a guere lieu pour les surfaces courbes, que dans le triangle sphérique. Figure équilatere ou équilatérale, est celle dont les côtés sont égaux. Figures équilateres sont celles dont les côtés sont égaux, chacun à son correspondant. Voyez Equilatéral. Figure équiangle, est celle dont les angles sont tous égaux entre eux. Figures équiangles entre elles, sont celles dont les angles sont égaux, chacun à son correspondant. Figure réguliere, est celle dont les côtés & les angles sont égaux. Figures semblables, sont celles qui ont leurs angles égaux & leurs côtés homologues proportionnels. Voyez Semblable. Une figure est dite inscrite dans une autre, lorsqu'elle est renfermée au-dedans, & que ses côtés aboutissent à la circonférence de la figure dans laquelle elle est inscrite : en ce cas la figure dans laquelle la proposée est inscrite, est dite circonscrite à cette même proposée.
Figure, (Géom.) pris dans la seconde acception, signifie la représentation faite sur le papier de l'objet d'un théorème, d'un problème, pour en rendre la démonstration ou la solution plus facile à concevoir. En ce sens une simple ligne, un angle, &c. sont des figures, quoiqu'elles n'en soient point dans le premier sens.
Il y a un art à bien faire les figures de Géométrie, à éviter les points d'intersection équivoques, & les points qui sont trop près l'un de l'autre, & qu'on ne peut distinguer commodément par des lettres ; à éviter aussi les positions de lignes qui peuvent induire le lecteur en erreur, comme de faire paralleles ou perpendiculaires les lignes qui ne le doivent pas être nécessairement ; à marquer par des lettres semblables les points correspondans ; à séparer en plusieurs figures, celles qui seroient trop compliquées ; à désigner par des lignes ponctuées, les lignes qui ne servent qu'à la démonstration, &c. & mille autres détails que l'usage seul peut apprendre.
La difficulté est encore plus grande, sr on a des solides ou des plans différens à représenter. La difficulté du relief & de la perspective empêche souvent que ces figures ne soient bien faites. On peut y remédier par des ombres, qui font sortir les différentes parties, & marquent différens plans : mais les ombres ont un inconvénient, c'est celui d'être souvent trop noires, & de cacher les lignes qui doivent y être tirées, & les points qui désignent ces lignes.
Les figures en bois, gravées à côté de la démonstration, & répétées à chaque page si la démonstration en a plusieurs, sont plus commodes que les figures placées à la fin du livre, même lorsque ces figures sortent entierement. Mais d'un autre côté, les figures en bois ont communément le desavantage d'être mal faites, & d'avoir peu de netteté. (O)
Figure, se dit quelquefois en Arithmétique, des chiffres qui composent un nombre. Voyez Chiffre, Caractere, &c.
Figures des Syllogismes, voyez Syllogisme, & plus bas Figure, (Gramm. & Logiq.)
Figure de la Terre, (Astron. Géog. Physiq. & Méch.) Cette importante question a fait tant de bruit dans ces derniers tems, les Savans s'en sont tellement occupés, sur-tout en France, que nous avons crû devoir en faire l'objet d'un article particulier, sans renvoyer au mot Terre, qui nous fournira d'ailleurs assez de matiere sur d'autres objets.
Nous n'entrerons point dans le détail des opinions extravagantes que les anciens ont eues, ou qu'on leur attribue sur la figure de la Terre. On peut s'en instruire dans l'Almageste de Riccioli & ailleurs. Anaximandre, dit-on, crut la terre semblable à une colonne, Leucippe à un cylindre, Cléanthe à un cone, Héraclite à un esquif, Démocrite à un disque creux, Anaximene & Empedocle à un disque plat, enfin Xenophane de Colophon s'est imaginé qu'elle avoit une racine infinie sur laquelle elle portoit. Cette derniere opinion rappelle celle des peuples indiens, qui croyent la terre portée sur quatre éléphans. Mais on nous permettra de douter que la plûpart des philosophes qu'on vient de nommer, ayent eu des idées si absurdes. L'Astronomie avoit déjà fait de leur tems de grands progrès, puisque Thales qui les précéda, avoit prédit des éclipses. Or il n'est pas vraissemblable, ce me semble, que dans des tems où l'Astronomie étoit déjà si avancée, on fût encore si ignorant sur la figure de la Terre ; car on va voir que les premieres observations astronomiques ont dû faire connoître qu'elle étoit ronde en tout sens. Aussi Aristote qui a été contemporain, ou même prédécesseur de plusieurs des philosophes nommés ci-dessus, établit & prouve la rondeur de la terre dans son second livre de c?lo, chap. xjv. par des raisons très-solides, & à-peu-près semblables à celles que nous allons en donner.
On s'apperçut d'abord que parmi les étoiles qu'on voyoit tourner autour de la terre, il y en avoit quelques-unes qui restoient toûjours dans la même place, ou à-peu-près, & que par conséquent toute la sphere des étoiles tournoit autour d'un point fixe dans le ciel ; on appella ce point le pole ; on remarqua bien-tôt après, que lorsque le soleil se trouvoit chaque jour dans sa plus grande élévation au-dessus de notre tête, il étoit constamment alors dans le plan qui passoit par le pole & par une ligne à-plomb ; on appella ce plan méridien : on observa ensuite que quand on voyageoit dans la direction du méridien, les étoiles vers lesquelles on alloit, paroissoient s'approcher du haut de la tête, & que les autres au contraire paroissoient s'en éloigner ; que de plus ces dernieres étoiles, à force de s'abaisser, disparoissoient tout-à-fait, & que d'autres commençoient à paroître vers la partie opposée. De-là il étoit aisé de conclure que la ligne à-plomb, c'est-à-dire la ligne perpendiculaire à la surface de la Terre, & passant par le sommet de notre tête, changeoit de direction à mesure qu'on avançoit sur le méridien, & ne demeuroit pas toûjours parallele à elle-même ; que par conséquent la surface de la Terre n'étoit pas plane, mais courbe dans le sens du méridien. Or les plans de tous les méridiens concourant au pole, comme on vient de le remarquer, il ne faut qu'un peu de réflexion (même sans aucune teinture de Géométrie), pour voir que la terre ne sauroit être courbe dans le sens du méridien, qu'elle ne soit courbe aussi dans le sens perpendiculaire au méridien, & que par conséquent elle est courbe dans tous les sens. D'ailleurs d'autres observations astronomiques, comme celles du lever & du coucher des astres, & de la différence des tems où il arrivoit selon le lieu de la Terre où on étoit placé, confirmoient la rondeur de la Terre dans le sens perpendiculaire au méridien. Enfin l'observation des éclipses de Lune dans lesquelles on voyoit l'ombre de la Terre avancer sur le disque de la Lune, fit connoître que cette ombre étoit non-seulement courbe, mais sensiblement circulaire ; d'où on conclut avec raison que la Terre avoit aussi à-peu-près la figure sphérique ; je dis à-peu-près, parce qu'il y a eu en effet quelques anciens qui ont crû que la Terre n'avoit pas exactement cette figure ; voyez les Mém. de l'Acad. des Belles-Lettres, t. XVIII. p. 97. Mais nonobstant cette opinion des anciens, la non-sphéricité de la Terre doit être regardée comme une découverte qui appartient absolument & uniquement à la philosophie moderne, par les raisons qui ont été exposées dans l'article Erudition, tom. V. p. 918. col. 1. Quoi qu'il en soit, il est certain du moins qu'en général les philosophes anciens attribuoient à la Terre une sphéricité parfaite ; & il étoit naturel de le croire jusqu'à ce que l'observation en eût détrompé.
Si la rondeur de la Terre avoit besoin d'une autre preuve encore plus à la portée de tout le monde, ceux qui ont souvent fait le tour de la Terre nous assûroient aussi de sa rondeur. La premiere fois qu'on en a fait le tour, ç'à été en 1519. Ce fut Ferdinand Magellan qui l'entreprit, & il employa 1124 jours à faire le tour entier ; François Drake, anglois, en fit autant l'an 1577 en 1056 jours ; Thomas Cavendish en 1586 fit le même voyage en 777 jours ; Simon Cordes de Rotterdam l'a fait en l'année 1590 ; Olivier Hoort, Hollandois, en 1077 jours. Guillaume Corn. Van Schout, en l'an 1615, en 749 jours. Jacques Heremites & Jean Huyghens, l'an 1653, en 802 jours. En dernier lieu ce voyage a été fait par l'amiral Anson, dont on a imprimé la relation si intéressante & si curieuse. Tous ces navigateurs alloient de l'est à l'oüest, pour revenir enfin en Europe d'où ils étoient partis, & les phénomenes, soit célestes soit terrestres qu'ils observerent pendant leur voyage, leur prouverent que la Terre est ronde.
La sphéricité de la Terre admise, il étoit assez facile de connoître la valeur d'un degré du méridien, & par conséquent la circonférence & le diametre de la Terre. On a expliqué en général au mot Degré, comment on mesure un degré du méridien, nous y renvoyons, & cela nous suffit quant à présent, reservant un plus grand détail pour la suite de cet article ; le degré du méridien s'est trouvé par cette méthode d'environ 25 de nos lieues, & comme il y a 360 degrés, on concluoit que la circonférence de la terre est par conséquent de 9000 lieues, & le rayon ou demi-diametre de la Terre, de 14 à 15 cents lieues, le tout en nombres ronds ; car il ne s'agit pas encore ici de la mesure exacte & rigoureuse.
La physique du tems se joignoit aux observations pour prouver la sphéricité de la Terre ; on supposoit que la pesanteur faisoit tendre tous les corps à un même centre ; on croyoit de plus presque généralement la terre immobile. Or cela posé, la surface des mers devoit être sphérique, pour que les eaux y restassent en équilibre : & comme les mers couvrent une grande partie de la surface de la terre, on en concluoit que la partie solide de cette surface étoit aussi sphérique ; & cette conclusion, ainsi que le principe qui l'avoit produite, furent regardés comme incontestables, même après qu'on eut découvert le mouvement de la Terre autour de son axe. Voyez Copernic, &c. Voyons maintenant comment on s'est desabusé de cette sphéricité, & quel est l'état actuel de nos connoissances sur ce point : commençons par quelques réflexions générales.
Le génie des philosophes, en cela peu différent de celui des autres hommes, les porte à ne chercher d'abord ni uniformité ni loi dans les phénomenes qu'ils observent ; commencent-ils à y remarquer, ou même à y soupçonner quelque marche réguliere, ils imaginent aussi-tôt la plus parfaite & la plus simple ; bientôt une observation plus suivie les détrompe, & souvent même les ramene à leur premier avis avec assez de précipitation, & comme par une espece de dépit ; enfin une étude longue, assidue, dégagée de prévention & de système, les remet dans les limites du vrai, & leur apprend que pour l'ordinaire la loi des phénomenes n'est ni assez peu composée pour être apperçue tout-d'un-coup, ni aussi irréguliere qu'on pourroit le penser ; que chaque effet venant presque toûjours du concours de plusieurs causes, la maniere d'agir de chacune est simple, mais que le résultat de leur action réunie est compliqué, quoique régulier, & que tout se réduit à décomposer ce résultat pour en démêler les différentes parties. Parmi une infinité d'exemples qu'on pourroit apporter de ce que nous avançons ici, les orbites des planetes en fournissent un bien frappant : a peine a-t-on soupçonné que les planetes se mouvoient circulairement, qu'on leur a fait décrire des cercles parfaits, & d'un mouvement uniforme, d'abord autour de la Terre, puis autour du Soleil, comme centres. L'observation ayant montré bien-tôt après que les planetes étoient tantôt plus, tantôt moins éloignées du Soleil, on a déplacé cet astre du centre des orbites, mais sans rien changer ni à la figure circulaire, ni à l'uniformité de mouvement qu'on avoit supposées ; on s'est apperçû ensuite que les orbites n'étoient ni circulaires ni décrites uniformément ; on en a fait des ovales, & on leur a donné la figure elliptique, la plus simple des ovales que nous connoissions ; enfin on a vû que cette figure ne répondoit pas encore à tout, que plusieurs des planetes, entr'autres Saturne, Jupiter, la Terre même & surtout la Lune, ne s'y assujettissoient pas exactement dans leurs cours. On a taché de trouver la loi de leurs inégalités, & c'est le grand objet qui occupe aujourd'hui les savans. Voyez Terre, Lune, Jupiter, Saturne, &c.
Il en a été à-peu-près de même de la figure de la Terre : à peine a-t-on reconnu qu'elle étoit courbe, qu'on l'a supposée sphérique ; enfin on a reconnu dans les derniers siecles, par les raisons que nous dirons dans un moment, qu'elle n'étoit pas parfaitement ronde ; on l'a supposée elliptique, parce qu'après la figure sphérique, c'étoit la plus simple qu'on pût lui donner. Aujourd'hui les observations & les recherches multipliées commencent à faire douter de cette figure, & quelques philosophes prétendent même que la Terre est absolument irréguliere. Discutons toutes ces différentes prétentions, & entrons dans le détail des raisons sur lesquelles elles sont fondées ; mais voyons d'abord en détail comment on s'y prend pour connoître la longueur d'un degré de la Terre.
Tout se réduit à deux opérations ; la mesure de l'amplitude de l'arc céleste, compris entre deux lieux placés sous le même méridien à différentes latitudes, & la mesure de la distance terrestre de ces deux lieux. En effet, si on connoît en degrés, minutes & secondes l'amplitude de l'arc céleste compris entre ces deux lieux, & qu'on connoisse outre cela leur distance terrestre, on fera cette proportion ; comme le nombre de degrés, minutes & secondes que contient l'amplitude, est à un degré, ainsi la distance terrestre connue entre les deux lieux, est à la longueur d'un degré de la Terre.
Pour mesurer l'amplitude de l'arc céleste, on observe dans l'un des deux lieux la hauteur méridienne d'une étoile, & dans l'autre lieu, on observe la hauteur méridienne de la même étoile ; la différence des deux hauteurs donne l'amplitude de l'arc, c'est-à-dire le nombre de degrés du ciel qui répond à la distance des deux lieux terrestres. Voyez l'article Degré, où l'on en a expliqué la raison. Il est inutile de dire qu'on doit corriger les hauteurs observées par les réfractions. Voyez Réfraction. De plus, afin que l'erreur causée par la réfraction soit la moindre qu'il est possible, on a soin de prendre, autant qu'on le peut, une étoile près du zénith, parce que la réfraction au zénith est nulle, & presqu'insensible à 4 ou 5 degrés du zénith. Il est bon aussi que les observations de l'étoile dans les deux endroits soient simultanées, c'est-à-dire qu'elles soient faites dans le même tems, autant qu'il est possible, par deux observateurs différens placés chacun en même tems dans chacun des deux lieux ; par ce moyen on évite toutes les réductions & corrections à faire en vertu des mouvemens apparens des étoiles, tels que la précession, l'aberration & la nutation. Voyez ces mots. Cependant s'il n'est pas possible de faire des observations simultanées, alors il faut avoir égard aux corrections que ces mouvemens produisent. Ajoûtons que quand les lieux ne sont pas situés exactement sous le même méridien, ce qui arrive presqu'infailliblement, l'observation de l'amplitude, faite avec les précautions qu'on vient d'indiquer, donne l'amplitude de l'arc céleste compris entre les paralleles de ces deux lieux, & cela suffit pour faire connoître le degré qu'on cherche, au moins dans la supposition que les paralleles soient des cercles ; cette supposition a toûjours été faite jusqu'ici dans toutes les opérations qui ont été entreprises pour déterminer la figure de la Terre ; il est vrai qu'on a cherché dans ces derniers tems à l'ébranler ; c'est ce que nous examinerons plus bas ; nous nous contenterons de dire quant à présent, que cette supposition des paralleles circulaires est absolument nécessaire pour pouvoir conclure quelque chose des opérations par lesquelles on mesure les degrés, puisque si les paralleles ne sont pas des cercles, il est absolument impossible, comme on le verra aussi plus bas, de connoître par cette mesure la figure de la Terre, ni même d'être assûré que ce qu'on a mesuré est un degré de latitude.
L'amplitude de l'arc céleste étant connue, il s'agit de mesurer la distance terrestre des deux lieux, ou s'ils ne sont pas placés sur le même méridien, la distance entre les paralleles. Pour cela on choisit sur des montagnes élevées différens points, qui forment avec les deux lieux dont il s'agit, une suite de triangles dont on observe les angles le plus exactement qu'il est possible. Comme la somme des angles de chaque triangle est égale à 180 degrés (voyez Triangle), on sera certain de l'exactitude de l'observation, si la somme des angles observés est égale à 180 degrés ou n'en differe pas sensiblement. Il faut remarquer de plus que les différens points qui forment ces triangles ne sont point pour l'ordinaire placés dans un même plan, ni dans un même niveau, ainsi il faut les y réduire, en observant la hauteur de ces différens points au-dessus du niveau d'une surface concentrique à celle de la Terre, qu'on imagine passer par l'un des deux lieux. Cela fait, on mesure quelque part sur le terrein une base de quelque étendue, comme de 6 à 7000 toises ; on observe les angles d'un triangle formé par les deux extrémités de cette base, & par un des points de la suite de triangles. Ainsi on a (y compris les deux extrémités de la base) une suite de triangles dans laquelle on connoît tous les angles & un côté, savoir la base mesurée ; donc par le calcul trigonométrique on connoîtra les côtés de chacun de ces triangles : on connoît de plus l'élévation de chaque point au-dessus du niveau ; ainsi on connoît les côtés de chaque triangle réduits au même niveau ; enfin on connoît encore par l'observation les angles que font les verticaux où sont placés les côtés des triangles, avec le méridien qu'on imagine passer par l'un des deux lieux, & en conséquence on connoît par les réductions que la Géométrie enseigne, les angles que les côtés des triangles réduits au même niveau font avec la direction de la méridienne passant par ce lieu. Donc employant le calcul trigonométrique, & ayant égard, si on le juge nécessaire, à la petite courbure du méridien dans l'espace compris entre les deux lieux, on connoîtra la longueur de l'arc du méridien compris entre les paralleles des deux lieux. Enfin l'on fait à cette longueur une petite réduction, eu égard à la quantité dont s'éleve au-dessus du niveau de la mer celui des deux lieux d'où l'on fait partir la méridienne. Cette réduction faite, on a la longueur de l'arc, réduite au niveau de la mer. Pour vérifier cette longueur, on mesure ordinairement une seconde base en un autre endroit que la premiere, & par cette seconde base liée avec les triangles, on calcule de nouveau un ou plusieurs côtés de ces triangles ; si le second résultat s'accorde avec le premier, on est assûré de la bonté de l'opération. La longueur de l'arc terrestre, & l'amplitude de l'arc céleste étant ainsi connues, on en conclut la longueur du degré, comme on l'a expliqué plus haut.
On peut voir dans les différens ouvrages qui ont été publiés sur la figure de la Terre, & que nous indiquerons à la fin de cet article, les précautions qu'on doit prendre pour mesurer l'arc céleste & l'arc terrestre avec toute l'exactitude possible. Ces précautions sont si nécessaires, & doivent être portées si loin, que selon M. Bouguer, on ne peut répondre de 5? dans la mesure de l'amplitude de l'arc céleste qu'en y mettant le plus grand scrupule. Or une seconde d'erreur dans la mesure de l'arc céleste donne environ 16 toises d'erreur dans le degré terrestre, parce qu'une seconde de degré terrestre est d'environ 16 toises ; donc on ne pourroit selon M. Bouguer répondre de 80 toises sur le degré, si on n'avoit mesuré qu'un degré. Si l'on mesuroit 3 degrés, comme on l'a fait sous l'équateur, alors l'erreur sur chacun ne seroit que d'environ le tiers de 80 toises, c'est-à-dire environ 27 toises. Il faut pourtant ajoûter que si l'instrument dont on se sert pour mesurer l'arc céleste est fait avec un soin extreme, tel que le secteur employé aux opérations du nord, on peut compter alors sur une plus grande exactitude, surtout quand cet instrument sera mis en ?uvre comme il l'a été par les plus habiles observateurs.
Je ne parle point de quelques autres méthodes que les anciens ont employées pour connoître la figure de la Terre ; elles sont trop peu exactes pour qu'on en fasse mention ici, & celle dont nous venons de donner le procédé mérite à tous égards la préférence. Je ne parle point non plus, ou plûtôt je ne dirai qu'un mot d'une autre méthode qu'on peut employer pour déterminer cette figure, celle de la mesure des degrés de longitude à différentes latitudes. Quelque exactitude qu'on puisse mettre à cette derniere mesure, elle sera toûjours beaucoup plus susceptible d'erreur que celle de la mesure des degrés de latitude. M. Bouguer estime que l'erreur peut être d'une 240e partie sur la mesure d'un arc de deux degrés de longitude, & six ou sept fois plus grande que sur la mesure d'un arc de latitude de deux degrés.
Voici maintenant les différentes valeurs du degré de la Terre, trouvées jusqu'à M. Picard inclusivement, dans l'hypothèse de la Terre sphérique. Nous n'avons pas besoin de dire que les mesures des anciens doivent être regardées comme très-fautives, attendu l'imperfection des méthodes & des instrumens dont ils se servoient ; mais nous avons cru que le lecteur verroit avec plaisir le progrès des connoissances humaines sur cet objet.
Selon Aristote la circonférence de la Terre est de 400000 stades, ce qui donnera le degré de 1111 stades en divisant par 360.
Selon Eratosthene, cette circonférence est de 250000 stades, ou 252000 en prenant 700 stades pour le degré.
Selon Hipparque, la circonférence de la Terre est de 2520 stades plus grande que 252000 ; cependant il s'en est tenu à cette derniere mesure d'Eratosthene.
Selon Posidonius, la circonférence de la Terre est de 240000 stades. Strabon, corrigeant le calcul de Posidonius, ne donne à la circonférence de la Terre que 180000 stades. Cette derniere mesure a été adoptée par Ptolomée. Voyez l'ouvrage de M. Cassini, qui a pour titre de la grandeur & de la figure de la Terre, 1718.
Les mathématiciens du calife Almamon dans le jx. siecle, trouverent le degré dans les plaines de Sennaar de 56 milles, & l'estimerent 10 mille toises moindre que Ptolomée ne l'avoit donné.
Le géographe de Nubie dans le xij. siecle, donne 25 lieues au degré.
Fernel, medecin d'Henri II. trouva le degré de 56746 toises, mais par une mesure très-peu exacte rapportée au mot Degré. Snellius de 57000 toises (cette mesure a depuis été corrigée par M. Musschenbroek, & mise à 57033) ; Riccioli, de 62650 (c'est-à-dire plus grand de 5650 toises que Snellius, ce qui donne de différence sur la circonférence de la Terre) ; Norwood, en 1633, de 57300.
Enfin en 1670, M. Picard ayant mesuré la distance entre Paris & Amiens par la méthode exposée ci-dessus, a trouvé le degré de France de 57060 toises à la latitude de 49d 23?, moyenne entre celle de ces deux villes ; mais on ne pensoit point encore que la Terre pût avoir une autre figure que la sphérique.
En 1672, M. Richer étant allé à l'isle de Cayenne, environ à 5d de l'équateur, pour y faire des observations astronomiques, trouva que son horloge à pendule qu'il avoit reglée à Paris, retardoit de 2? 28? par jour. De là on conclut, toute déduction faite de la quantité dont le pendule devoit être alongé à Cayenne par la chaleur, voyez Pendule, &c. que le même pendule se mouvoit plus lentement à Cayenne qu'à Paris ; que par conséquent l'action de la pesanteur étoit moindre sous l'équateur que dans nos climats. L'académie avoit déjà soupçonné ce fait (comme le remarque M. le Monnier dans l'hist. céleste publiée en 1741) d'après quelques expériences faites en divers lieux de l'Europe ; mais il semble, pour le dire en passant, qu'on auroit pû s'en douter sans avoir besoin du secours de l'expérience, puisque les corps à l'équateur étant plus éloignés de l'axe de la terre, la force centrifuge produite par la rotation y est plus grande, & par conséquent, toutes choses d'ailleurs égales, ôte davantage à la pesanteur ; voyez Force centrifuge, &c. C'est ainsi que par une espece de fatalité attachée à l'avancement des sciences, certains faits qui ne sont que des conséquences simples & immédiates des principes connus, demeurent néanmoins souvent ignorés avant que l'observation les découvre. Quoi qu'il en soit, dès qu'on eut reconnu que la pesanteur étoit moindre à l'équateur qu'au pole, on fit le raisonnement suivant : la terre est en grande partie fluide à sa surface, & l'on peut supposer sans beaucoup d'erreur, qu'elle a à-peu-près la même figure que si elle étoit fluide dans son entier. Or, dans ce cas la pesanteur étant moindre à l'équateur qu'au pole, & la colonne de fluide qui iroit d'un des points de l'équateur au centre de la terre, devant nécessairement contrebalancer la colonne qui iroit du pole au même centre, la premiere de ces colonnes doit être plus longue que la seconde ; donc la terre doit être plus élevée sous l'équateur que sous les poles ; donc la Terre est un sphéroïde applati vers les poles.
Ce raisonnement étoit confirmé par une observation. On avoit découvert que Jupiter tournoit fort vîte autour de son axe (voyez Jupiter) ; cette rotation rapide devoit imprimer aux parties de cette planette une force centrifuge considérable, & par conséquent l'applatir sensiblement ; or en mesurant les diametres de Jupiter, on les avoit trouvés très-sensiblement inégaux ; nouvelle preuve en faveur de la Terre applatie.
On alla même jusqu'à essayer de déterminer la quantité de son applatissement ; mais à la vérité les résultats différoient entr'eux, selon la nature des hypotheses sur lesquelles on s'appuyoit. M. Huyghens supposant que la pesanteur primitive, c'est-à-dire non altérée par la force centrifuge, fût dirigée vers le centre, avoit trouvé que la Terre étoit un sphéroïde elliptique, dont l'axe étoit au diametre de l'équateur environ comme 577 à 578. Voyez Terre, Hydrostatique & sphéroïde ; M. Newton étoit parti d'un autre principe, il supposoit que la pesanteur primitive vînt de l'attraction de toutes les parties du globe, & trouvoit que la Terre étoit encore un sphéroïde elliptique, mais dont les axes étoient entr'eux comme 229 à 230 ; applatissement plus que double de celui de M. Huyghens.
Ces deux théories, quoique très-ingénieuses, ne résolvoient pas suffisamment la question de la figure de la Terre : premierement il falloit décider Jequel des deux résultats étoit le plus conforme à la vérité, & le système de M. Newton, alors dans sa naissance, n'avoit pas fait encore assez de progrès pour qu'on donnât l'exclusion à l'hypothese de M. Huyghens ; en second lieu, dans chacune des ces deux théories, on supposoit que la Terre eût absolument la même figure que si elle étoit entierement fluide & homogene, c'est-à-dire également dense dans toutes ses parties ; or l'on sentoit que cette supposition gratuite renfermoit peut-être beaucoup d'arbitraire, & que si elle s'écartoit un peu de la vérité (ce qui n'étoit pas impossible), la figure réelle de la Terre pouvoit être fort différente de celle que la théorie lui donnoit.
De là on conclut avec raison, que le moyen le plus sûr de connoître la vraie figure de la Terre, étoit la mesure actuelle des degrés.
En effet, si la Terre étoit sphérique, tous les degrés seroient égaux, & par conséquent, comme on l'a prouvé au mot Degré, il faudroit faire par-tout le même chemin sur le méridien, pour que la hauteur d'une même étoile donnée augmentât ou diminuât d'un degré ; mais si la Terre n'est pas sphérique, alors ses degrés seront inégaux, il faudra faire plus ou moins de chemin sur le méridien, selon le lieu de la Terre où l'on sera, pour que la hauteur d'une étoile qu'on observe, diminue ou augmente d'un degré. Maintenant, pour déterminer suivant quel sens les degrés doivent croître & décroître dans cette hypothese, supposons d'abord la Terre sphérique & d'une substance molle, & imaginons qu'une double puissance appliquée aux extrémités de l'axe, comprime la Terre de dehors en dedans, suivant la direction de cet axe : qu'arrivera-t-il ? certainement l'axe diminuera de longueur, & l'équateur s'élevera : mais de plus la Terre sera moins courbe aux extrémités de l'axe qu'elle n'étoit auparavant, elle sera plus applatie vers l'axe, & au contraire elle sera plus courbe à l'équateur. Or, plus la Terre a de courbure dans la direction du méridien, moins il faut faire de chemin dans cette même direction, pour que la hauteur observée d'une étoile augmente ou diminue d'un degré ; par conséquent si la Terre est applatie vers les poles, il faudra faire moins de chemin sur le méridien près de l'équateur que près du pole pour gagner ou pour perdre un degré de latitude ; par conséquent si la Terre est applatie, les degrés doivent aller en augmentant de l'équateur vers le pole & réciproquement ; la raison qu'on vient d'en donner est suffisante pour ceux qui ne sont pas géometres ; en voici une rigoureuse pour ceux qui le sont.
Soit (fig. 12 Géog.) C le centre de la Terre ; CP l'axe ; EC le rayon de l'équateur ; EHP une portion du méridien ; par le point H quelconque, soit menée HO perpendiculaire au meridien EHP, laquelle ligne HO touche en O la dévelopée GOF. Voyez Développée ; HO sera le rayon osculateur en H. V. Osculateur : soit pris ensuite le point h tel que le rayon osculateur ho fasse un angle d'un degré avec HO ; il est aisé de voir que Hh représentera un degré du méridien ; c'est-à-dire, comme il a été prouvé au mot Degré, qu'un observateur qui avanceroit de H en h, trouveroit en h un degré de plus ou de moins qu'en H dans la hauteur de toutes les étoiles placées sous le méridien Or, Hh étant à très-peu près un arc de cercle décrit du rayon HO (ou ho qui lui est sensiblement égal) il saute aux yeux, que si les degrés Hh vont en augmentant de l'équateur E vers le pole P, les rayons osculateurs HO iront aussi en augmentant ; puisque le rayon d'un cercle est d'autant plus grand que le degré ou la 360e partie de ce cercle a plus d'étendue. Donc la développée GOF sera toute entiere dans l'angle ECF. Or, par la propriété de la développée, voyez Développée, on a EGOF = FCP, & il est visible par les axiomes de Géometrie que EGOF est < EC + CF ; donc EC + CF > CP + CF ; donc EC > CP ; donc la Terre est applatie si les degrés vont en augmentant de l'équateur vers le pole. Ceux qui après M. Picard, mesurerent les premiers degrés du méridien en France pour savoir si la Terre étoit sphérique ou non, n'avoient pas tiré cette conclusion ; soit inattention, soit faute de connoissances géometriques suffisantes, ils avoient crû au contraire que si la Terre étoit applatie, les degrés devoient aller en diminuant de l'équateur vers le pole. Voici, selon toutes les apparences, le raisonnement qu'ils faisoient : soit tirée du centre une ligne qui fasse avec EC un angle d'un degré, & du même centre C soit tirée une ligne qui fasse avec PC un angle d'un degré, il est certain que EC étant supposé plus grand que PC, la partie de la Terre interceptée en E entre les deux lignes qui font un angle d'un degré, sera plus grande qu'en P ; donc (concluoient-ils peut-être) le degré près de l'équateur sera plus grand qu'au pole. Le paralogisme de ce raisonnement consiste en ce que le degré de la terre n'est pas déterminé par deux lignes qui vont au centre, & qui font un angle d'un degré ; mais par deux lignes qui sont perpendiculaires à la surface de la Terre, & qui font un angle d'un degré. C'est par rapport à ces perpendiculaires (déterminées par la situation du fil à plomb) qu'on mesure la distance des étoiles au zénith, & par conséquent leur hauteur ; or ces perpendiculaires ne passeront pas par le centre de la Terre, quand la Terre n'est pas sphérique. Voyez Développée, Osculateur, &c.
Quoi qu'il en soit de cette conjecture, ceux qui les premiers mesurerent les degrés dans l'étendue de la France, préoccupés peut-être de cette idée, que la Terre applatie donnoit les degrés vers le nord plus petits que ceux du midi, trouverent en effet que dans toute l'étendue de la France en latitude, les degrés alloient en diminuant vers le nord. Mais à peine eurent-ils fait part de ce résultat aux savans de l'Europe, qu'on leur démontra qu'en conséquence la Terre devoit être alongée. Il fallut en passer par-là ; car comment revenir sur des mesures qu'on assûroit très-exactes ? on demeura donc assez persuadé en France de l'alongement de la Terre, nonobstant les conséquences contraires tirées de la théorie.
Cette conclusion fut confirmée dans le livre de la grandeur & de la figure de la Terre, publié en 1718 par M. Cassini, que l'académie des Sciences de Paris vient de perdre. Dans cet ouvrage M. Cassini donna le résultat de toutes les opérations faites par lui & par M. Dominique Cassini son pere, pour déterminer la longueur des degrés. Il en concluoit que le degré moyen de France étoit de 57061 toises, à une toise près de celui de M. Picard ; & que les degrés alloient en diminuant dans toute l'étendue de la France du sud au nord, depuis Collioure jusqu'à Dunkerque. Voyez Degré. D'autres opérations faites depuis en 1733, 1734, 1736, confirmoient cette conclusion ; ainsi toutes les mesures s'accordoient, en dépit de la théorie, à faire la Terre alongée.
Mais les partisans de Newton, tant en Angleterre que dans le reste de l'Europe, & les principaux géometres de la France même, jugerent que ces mesures ne renversoient pas invinciblement la théorie ; ils oserent croire qu'elles n'étoient peut-être pas assez exactes. D'ailleurs en les supposant faites avec soin, il étoit possible, disoient-ils, que par les erreurs de l'observation, la différence entre des degrés immédiatement voisins, ou peu distans (différence très-petite par elle-même), ne fût pas susceptible d'une détermination bien sûre. On jugea donc à-propos de mesurer deux degrés très-éloignés, afin que leur différence fût assez grande pour ne pas être imputée à l'erreur de l'observation. On proposa de mesurer le premier degré du méridien sous l'équateur, & le degré le plus près du pole qu'on pourroit. MM. Godin, Bouguer, & de la Condamine, partirent pour le premier voyage en 1735 ; & en 1736 MM. de Maupertuis, Clairaut, Camus, & le Monnier, partirent pour la Lapponie. Ces derniers furent de retour en 1737. Ils avoient mesuré le degré de latitude qui passe par le cercle polaire, à environ 23d du pole, & l'avoient trouvé considérablement plus grand que le degré moyen de France ; d'où ils conclurent que la Terre étoit applatie.
Le degré de Lapponie, à 66d 20?, avoit été trouvé par ces savans observateurs, de 57438 toises, plus grand de 378 toises que le degré de 57060 toises de M. Picard, mesuré par 49d 23? ; mais avant que d'en conclure la figure de la Terre, ils jugerent à-propos de corriger le degré de M. Picard, en ayant égard à l'aberration des étoiles, que M. Picard ne connoissoit pas, comme aussi à la précession & à la réfraction, que cet astronome avoit négligées. Par ce moyen le degré de 57060 toises, déterminé par M. Picard, se réduisit à 56925 toises, plus court que celui de Lapponie de 513 toises.
En supposant que le méridien de la Terre soit une ellipse peu différente d'un cercle, on sait par la Géométrie que l'accroissement des degrés, en allant de l'équateur vers le pole, doit être sensiblement proportionnel aux quarrés des sinus de latitude. De plus la même Géométrie démontre que si on a dans un méridien elliptique la valeur de deux degrés à des latitudes connues, on aura le rapport des axes de la Terre par une formule très-simple. En effet, si on nomme E, F la longueur de deux degrés mesurés à des latitudes dont les sinus soient s & s, on aura pour la différence des axes . M. de Maupertuis a donné cette formule dans les mémoires de l'Académie de 1737, & dans son livre de la figure de la Terre déterminée, & il est très facile de la trouver par différentes méthodes. Si le degré F est sous l'équateur, on a s=0, & la formule devient plus simple, se réduisant à . MM. les académiciens du Nord appliquant à cette formule les mesures du degré en Lapponie & en France, trouverent que le rapport de l'axe de la Terre au diametre de l'équateur, étoit 173 à 174 ; ce qui ne s'éloignoit pas extrèmement du rapport de 229 à 230 donné par M. Newton, surtout en supposant des erreurs inévitables dans la mesure du degré. Il n'est pas inutile de remarquer que MM. les académiciens du Nord avoient négligé environ 1? pour la réfraction dans l'amplitude de leur arc céleste. Cette petite correction étant faite, le degré de Lapponie devoit être diminué de 16 toises, & se réduisoit à 57422 ; mais le rapport de l'axe au diametre de l'équateur demeuroit toûjours sensiblement le même, celui de 173 à 174. Suivant les mesures de M. Cassini, la Terre étoit un sphéroïde alongé, dont l'axe surpassoit le diametre de l'équateur d'environ . Le degré de Lapponie devoit être, dans cette hypothèse, d'environ 1000 toises plus petit que ne l'avoient trouvé les académiciens du Nord ; erreur dans laquelle on ne pouvoit les soupçonner d'être tombés.
Les partisans de l'alongement de la Terre firent d'abord toutes les objections qu'il étoit possible d'imaginer contre les opérations sur lesquelles étoit appuyée la mesure du Nord. On crut, dit un auteur moderne, qu'il y alloit de l'honneur de la nation à ne pas laisser donner à la Terre une figure étrangere, une figure imaginée par un Anglois & un Hollandois, à-peu-près comme on a crû long-tems l'honneur de la nation intéressé à défendre les tourbillons & la matiere subtile, & à proscrire la gravitation Newtonienne. Paris, & l'Académie même, se divisa entre les deux partis : enfin la mesure du Nord fut victorieuse ; & ses adversaires en furent si convaincus, qu'ils demanderent qu'on mesurât une seconde fois les degrés du méridien dans toute l'étendue de la France. L'opération fut faite plus exactement que la premiere fois, l'Astronomie s'étant perfectionnée beaucoup dans l'intervalle des deux mesures : on s'assûra en 1740 que les degrés alloient en augmentant du midi au nord, & par conséquent la Terre se retrouva applatie. C'est ce qu'on peut voir dans le livre qui a pour titre, la méridienne vérifiée dans toute l'étendue du royaume, &c. par M. Cassini de Thury, fils de M. Cassini, & aujourd'hui pensionnaire & astronome de l'académie des Sciences. Paris, 1744. Il faut pourtant remarquer, pour plus d'exactitude dans ce récit, que les degrés de France n'alloient pas tous & sans exception en diminuant du nord au sud, mais cela étoit vrai du plus grand nombre ; & dans les degrés qui s'écartoient de cette loi la différence étoit si excessivement petite, qu'on pouvoit & qu'on devoit l'attribuer toute entiere aux erreurs inévitables de l'observation.
Il est nécessaire d'ajouter que les académiciens du Nord de retour à Paris, crurent en 1739 qu'il étoit nécessaire de faire quelques corrections au degré de M. Picard, qu'ils avoient déjà réduit à 56925 toises. Voici quelle étoit leur raison. La mesure de ce degré en général dépend, comme on l'a déjà dit, de deux observations, celle de la différence entre les hauteurs d'une étoile observées aux deux extrémités du degré, & celle de la distance géographique entre les paralleles tracés aux deux extrémités du degré. On ne doutoit point que cette derniere distance n'eût été mesurée très-exactement par M. Picard ; mais on n'étoit pas aussi sûr de l'observation céleste : quelqu'exact que fût cet astronome, il ignoroit, ainsi qu'on l'a déjà remarqué, quelques mouvemens observés depuis dans les étoiles fixes ; il en avoit négligé quelques autres, ainsi que la réfraction : d'ailleurs les instrumens astronomiques modernes ont été portés à un degré de précision qu'ils n'avoient pas de son tems. On recommença donc l'observation de l'amplitude de l'arc céleste compris entre les deux extrémités du degré de Paris à Amiens ; & en conséquence au lieu de 57060 toises pour ce degré, on en trouva 57183 : ce degré nouveau, plus grand que M. Picard ne l'avoit trouvé, étoit toûjours beaucoup plus petit que celui du Nord, & l'applatissement de la Terre subsistoit : mais cet applatissement étoit un peu moindre que de 173 à 174 ; il étoit de 177 à 178, toûjours néanmoins dans l'hypothèse de la Terre elliptique.
En 1740, ceux qui avoient soûtenu d'abord l'alongement de la Terre, ayant eu occasion de vérifier la base qui avoit servi à la mesure de M. Picard, prétendirent que cette base étoit plus courte de près de six toises que M. Picard ne l'avoit trouvée ; & en conséquence admettant la correction faite à l'amplitude de l'arc de M. Picard par les académiciens du Nord, ils fixerent le degré de M. Picard à 57074 toises , à 14 toises près de la longueur que M. Picard lui avoit donnée ; ainsi les deux erreurs de M. Picard dans la mesure de la base & dans celle de l'arc céleste, formoient, selon eux, une espece de compensation.
Cependant plusieurs académiciens douterent encore que M. Picard se fût trompé sur sa base. M. de la Condamine nous paroît avoir très-bien traité cette matiere dans sa mesure des trois premiers degrés du méridien, art. xxjx. pag. 246. & suiv. Il ne croit point que l'erreur de M. Picard, si en effet il y en a une, vienne, comme le pense M. Bouguer, de ce que cet astronome avoit peut-être fait sa toise d'un trop courte : sa raison est que la longueur du pendule à Paris, déterminée par M. Picard, differe à peine de de ligne de celle que M. de Mairan a trouvée dans ces derniers tems. Cela posé, on ne sauroit douter que la toise des deux observateurs n'ait été exactement la même ; or la toise de M. de Mairan est aussi la même qui a servi à la mesure des degrés sous l'équateur & sous le cercle polaire, & la même qu'on a employée pour vérifier en 1740 la base de M. Picard. Mais d'un autre côté M. Cassini a vérifié cette base jusqu'à cinq fois, & en différens tems, & l'a toûjours trouvée plus courte de 6 toises que M. Picard. Plusieurs autres moyens directs & indirects, dont M. de la Condamine fait mention, ont été employés pour vérifier cette base, & on l'a toûjours trouvée plus courte de 6 toises. M. de la Condamine soupçonne que l'erreur de M. Picard ; s'il y en a une, peut venir, 1°. de la longueur des perches de bois qu'il employoit, & dans laquelle il a pû se glisser plusieurs erreurs sur lesquelles on étoit moins en garde alors qu'on ne l'est aujourd'hui ; 2°. de la maniere dont on les posoit sur le terrein. C'est un détail qu'il faut voir dans son livre, & auquel nous renvoyons, ne prenant point encore de parti sur l'erreur vraie ou fausse de M. Picard, jusqu'à ce que cette erreur soit constatée ou justifiée pleinement, comme elle le sera bientôt.
Cette incertitude sur la longueur du degré de M. Picard, rendoit nécessairement très-incertaine la quantité de l'applatissement de la Terre ; car en supposant la Terre un sphéroïde elliptique, on a vû qu'on pouvoit déterminer par la mesure de deux degrés de latitude, la quantité de son applatissement ; & l'on n'avoit alors que deux degrés de latitude, celui du Nord & celui de France, dont le dernier (chose très-singuliere) étoit beaucoup moins connu que le premier après 80 ans de travail, la différence entre les deux valeurs qu'on lui donnoit, étant de près de 110 toises.
Les académiciens du Pérou, à leur retour, rendirent la question encore plus difficile à résoudre. Ils avoient mesuré le premier degré de latitude, & l'avoient trouvé de 56753 toises, c'est-à-dire considérablement plus petit que le degré de France, soit qu'on mît ce dernier à 57074 toises, ou à 57183. Le comparaison des degrés de l'équateur & de Lapponie, donnoit, dans l'hypothèse elliptique, le rapport des axes de 214 à 215, fort près de celui de M. Newton : or dans cette hypothèse, & supposé cet applatissement, le degré de France devoit avoir nécessairement une certaine valeur ; cette valeur étoit assez conforme à la longueur de 57183 toises, assignée au degré de France par les académiciens du Nord, & nullement à celle de 57074 toises qu'on lui donnoit en dernier lieu. Il n'est pas inutile d'ajoûter qu'en 1740, lorsqu'on avoit trouvé la diminution des degrés de France du nord au midi, telle qu'elle doit être dans la Terre applatie, on avoit mesuré un degré de longitude, à la latitude de 43d 32? ; & ce degré de longitude s'accordoit aussi très-bien avec ce qu'il devoit être dans l'hypothèse de la Terre elliptique & de l'applatissement égal à .
Cependant M. Bouguer, sans égard aux quatre degrés qui s'accordoient dans l'hypothese elliptique, & qui donnoient l'applatissement de , crut devoir préférer le degré de France déterminé à 57074 toises, à ce même degré déterminé à 57183 : il ôta donc à la Terre la figure elliptique : il lui donna celle d'un sphéroïde, dans lequel les accroissemens des degrés suivroient la proportion, non des quarrés des sinus de latitude, mais des quatriemes puissances de ces sinus. Il trouva que le degré du Nord, celui du Pérou, celui de France suppose de 57074 toises, & le degré de longitude mesuré à 43d 32? de latitude, s'accordoient dans cette hypothèse. Il en conclut donc que la Terre étoit un sphéroïde non elliptique, dans lequel le rapport des axes étoit de 178 à 179, presqu'égal à celui de 177 à 178, trouvé en dernier lieu par les académiciens du Nord, mais à la vérité dans l'hypothèse elliptique ; ce qui donnoit deux sphéroïdes fort différens, quoiqu'à-peu-près également applatis. On verra dans un instant que les mesures faites depuis en d'autres endroits, ne sauroient subsister avec l'hypothèse de M. Bouguer, qui à la vérité ne la pouvoit prévoir alors, & qui croyoit tout faire pour le mieux, en ajustant à une même hypothèse les données qu'il avoit choisies.
Les choses en étoient là, lorsqu'en 1752 M. l'abbé de la Caille, un de ceux qui avoient eu le plus de part à la mesure des degrés de France en 1740, se trouvant au cap de Bonne-Espérance par 33d 18? de latitude, où il avoit été envoyé par l'académie pour y faire des observations astronomiques, principalement relatives à la parallaxe de la Lune, y mesura le degré du méridien, & le trouva de 57037 toises. Ce degré s'accordoit encore très-bien avec l'hypothèse elliptique & l'applatissement de , & ce qu'il faut bien remarquer, avec le degré de France supposé de 57183 toises ; mais il étoit presque égal au degré de France, supposé de 57074 toises ; & si cela étoit vrai, il en résulteroit que non-seulement le Terre ne seroit pas elliptique, mais que les deux hémispheres de la Terre ne seroient pas semblables, puisque les degrés seroient presque égaux à des latitudes aussi différentes que celle de France à 49d, & celle du cap à 33d. Il est visible au reste que le degré du cap ne s'accorderoit plus avec l'hypothèse de M. Bouguer, puisque le degré de France de 57074 toises, presque égal au degré du cap, quoiqu'à une latitude fort différente, étoit conforme à cette hypothèse.
Enfin la mesure du degré, récemment faite en Italie par les PP. Maire & Boscovich, à 43d 1? de latitude, produit de nouvelles difficultés. Ce degré s'est trouvé de 56979 toises ; ainsi non-seulement il differe beaucoup de ce qu'il doit être dans l'hypothèse de la Terre elliptique & de l'applatissement supposé , mais encore il s'est trouvé différer de plus de 70 toises d'un des degrés mesurés en France en 1740, presqu'à la même latitude que le degré d'Italie ; car le degré de latitude en France, à 43d 31?, a été déterminé de 57048 toises.
Si cette derniere différence étoit réelle, il s'ensuivroit que le méridien qui traverse l'Italie, ne seroit pas semblable au méridien qui traverse la France, & qu'ainsi les méridiens n'étant pas les mêmes, la Terre ne pourroit plus être regardée comme parfaitement ou même sensiblement circulaire dans le sens de l'équateur, comme on l'avoit toûjours supposé jusqu'ici. Il en résulteroit de plus d'autres conséquences très-fâcheuses, que l'on verra dans la suite de cet articie. On peut remarquer en même tems que le degré d'Italie quadre assez bien avec l'hypothèse de M. Pouguer, à laquelle celui du cap ne s'accorde pas ; ainsi de quelque côté qu'on se tourne, aucune hypothèse ne peut s'accorder avec la longueur de tous les degrés mesurés jusqu'ici. Il ne manque plus rien, comme l'on voit, pour rendre la figure de la Terre aussi incertaine que le pyrrhonisme peut le desirer.
Pour mettre en un coup-d'?il sous les yeux du lecteur les degrés mesurés jusqu'à présent, nous les rassemblerons dans cette table.
| Latitudes. | Degrés en toises. | ||||
| Degré du Nord | 66d | 20? | 57422 | ||
| Degrés de France | 49 | 56 | 57084 | ||
| 49 | 23 | 57074 | |||
| ou selon d'autres, | |||||
| 57183 | |||||
| 49 | 3 | 57069 | |||
| 47 | 58 | 57071 | |||
| 47 | 41 | 57057 | |||
| 46 | 51 | 57055 | |||
| 46 | 35 | 57049 | |||
| 45 | 45 | 57050 | |||
| 45 | 43 | 57040 | |||
| 44 | 53 | 57042 | |||
| 43 | 31 | 57048 | |||
| Degré d'Italie | 43 | 1 | 56979 | ||
| Degré sous l'équateur | 0 | 0 | 56753 | ||
| Degré du Cap à? de latitude mérid. |
33d | 18 | 57037 | ||
|
|
|||||
| Degré de longitude à? de latitude septentr. |
43d | 32? | 41618 | tois. | |
Cette table vérifie ce que nous avons remarqué plus haut, que tous les degrés mesurés en France ne vont pas exactement en diminuant du nord au sud ; mais le dernier degré de France vers le sud est de 36 toises plus petit que le dernier degré vers le nord ; & cela suffit pour qu'il soit certain que les degrés vont en diminuant du nord au sud dans l'étendue de la France.
A cette table j'ajoûterai la suivante que M. l'abbé de la Caille m'a communiquée.
Dans l'hypothèse de la longueur d'un degré du méridien sous l'équateur, de 56753 toises, comme il résulte des mesures faites sous l'équateur, & de celle de 57422 toises sous le parallele de 66d 19? selon la mesure du nord, après en avoir ôté 16 toises pour l'effet de la réfraction, ainsi que l'ont pratiqué tous ceux qui ont mesuré des degrés, on a le rapport des axes de 214 à 215 ou de 1, à 1, 00467, en supposant la Terre un sphéroïde elliptique régulier. Et en supposant que les accroissemens des degrés du méridien sont comme les quarrés des sinus des latitudes, on a les longueurs suivantes :
| Latitude. | Longueur du degré. |
Longueur mesurée. | |||
| 0d | 56753,0 | 56753,0 | sous l'équateur. | ||
| 5 | 56759,0 | ||||
| 10 | 56777,0 | ||||
| 15 | 56806,4 | ||||
| 20 | 56846,3 | ||||
| 25 | 56895,4 | ||||
| 30 | 56952,4 | ||||
| 33 | 569935 | 57037 | au Cap. | ||
| 35 | 57015,4 | ||||
| 40 | 57082,6 | ||||
| 41 | 57096,3 | ||||
| 42 | 57110,1 | ||||
| 43 | 57124,0 | ||||
| 43 | 30 | 57131,0 | 56979 | en Italie. | |
| 44 | 57137,9 | ||||
| 45 | 57151,8 | ||||
| 46 | 57165,7 | ||||
| 47 | 57179,6 | ||||
| 48 | 57193,5 | ||||
| 49 | 57207,3 | ||||
| 49 | 22 | 57212,3 | 57074,4 | en France. | |
| 50 | 57221,0 | 57183 | selon d'autres. | ||
| 55 | 57288,1 | ||||
| 60 | 57351,2 | ||||
| 65 | 57408,1 | ||||
| 66 | 57422,0 | 57422 | en Lapponie. | ||
| 70 | 57457,2 | ||||
| 75 | 57497,2 | ||||
| 80 | 57526,6 | ||||
| 85 | 57544,6 | ||||
| 90 | 57550,6 | ||||
On voit par cette table, que le degré du cap est moindre de 44 toises seulement que le degré mesuré ; que celui de France à 49d 22? est plus grand de 29 toises seulement que le degré de France supposé de 57183, mais plus grand de 138 toises que le degré supposé de 57074 ; enfin que le degré d'Italie est plus grand de 152 toises, que le degré mesuré. Ainsi il n'y a proprement que le degré d'Italie, & le degré de France supposé de 57074 toises (degré encore en litige), qui ne quadrent pas avec l'hypothèse elliptique & l'applatissement de ; car les différences des autres sont trop petites, pour ne pas être mises sur le compte de l'observation. Je ne parle point de la valeur des autres degrés de France ; elle est encore incertaine, jusqu'à ce qu'on ait vérifié la correction faite à la base de M. Picard. Il n'est pas inutile d'ajoûter que le degré de longitude mesuré à 43d 32?, & trouvé de 41618 toises, differe aussi de très-peu de toises de ce qu'il doit être dans l'hypothèse de la terre elliptique & de l'applatissement supposé à . En effet M. Bouguer a trouvé que ce degré ne différoit que de 11 toises de la longueur qu'il devroit avoir, en supposant l'applatissement de , qui differe peu de . De plus il n'est pas inutile de remarquer qu'en faisant de legeres corrections aux degrés qui quadrent avec ce dernier applatissement de , on retrouveroit exactement l'applatissement de , tel que Newton l'a donné. M. de la Condamine, comparant deux à deux dans l'hypothèse elliptique les quatre degrés suivans, celui du Pérou, celui de Lapponie, celui de France supposé de 57183 toises, & le même degré supposé de 57074, trouve que le rapport des axes varie depuis jusqu'à . Voyez son ouvrage, page 261. Enfin nous devons ajoûter que l'applatissement de la Terre a toûjours été trouvé beaucoup plus grand que celui de M. Huyghens, soit par la mesure des degrés, soit par l'observation du pendule ; d'où il semble qu'on peut conclure avec assez de fondement, que la pesanteur primitive n'est pas dirigée vers le centre de la Terre, ni même vers un seul centre, comme M. Huyghens le supposoit.
Avant que de porter notre jugement sur l'état présent de cette grande question de la figure de la Terre, & sur tout ce qui a été fait pour la résoudre, il est nécessaire que nous parlions des expériences sur l'alongement & l'accourcissement du pendule, observés aux différentes latitudes ; car ces expériences tiennent immédiatement à la question de la figure de la Terre. Il est certain en général, que si la Terre est applatie, la pesanteur doit être moindre à l'équateur qu'au pole, que par conséquent le pendule à secondes doit retarder en allant du pole vers l'équateur, & que par la même raison, le pendule qui bat les secondes à l'équateur, doit être alongé en allant de l'équateur vers le pole. De plus, si l'applatissement , donné par M. Newton, avoit lieu, il est démontré que la pesanteur à l'équateur seroit moindre de que la pesanteur au pole, & de plus, que l'accroissement de la pesanteur, de l'équateur au pole, doit suivre la raison des quarrés des sinus de latitude. Or, par la loi observée de l'alongement du pendule, en allant de l'équateur vers le pole, on connoît la loi de l'augmentation de la pesanteur dans le même sens, & cette augmentation qui est proportionnelle à l'alongement du pendule (voyez Pendule), se trouve, par les observations, assez exactement proportionelle aux quarrés des sinus de latitude.
| En effet les longueurs du pendule corrigées par le barometre, & réduites à celle d'un pendule qui oscilleroit dans un milieu non résistant, sont sous l'équateur | Lign. | Differenc. | ||
| 439,21 | ||||
| A Portobello à 9 degrés de latitude | 439,30 | 0,09 | ||
| Au petit Goave à 18 degrés de latitude | 439,47 | 0,26 | ||
| A Paris | 440,67 | 1,46 | ||
| A Pello | 441,27 | 2,06 |
Or, selon le calcul du P. Boscovich, les différences proportionnelles aux quarrés des sinus de latitude, ou, ce qui revient au même, à la moitié du sinus verse du double de la latitude (voyez Sinus), sont 7, 24, 138, 206, un peu plus petites à la vérité que celles de la table, comme je l'avois déjà remarqué dans mes Recherches sur le système du monde, II. part. pag. 288 & 289. en employant un calcul moins rigoureux que le précédent ; cependant comme le plus grand écart entre l'observation & la théorie est ici de de ligne, il semble qu'on peut regarder la proportion des quarrés des sinus de latitude comme assez exactement observée dans l'alongement du pendule. Il est à remarquer que dans la table précédente, on a augmenté de de ligne les longueurs du pendule observées à Paris & à Pello (ce que je n'avois pas fait dans l'endroit cité de mes Recherches sur le système du monde) ; parce que les longueurs observées 440, 57, & 441, 17, sont celles du pendule dans l'air, & que les longueurs 440, 67, 441, 27, sont celles du même pendule dans un milieu non résistant, ainsi que les trois autres qui les précedent.
Mais si d'un côté la loi de l'accourcissement du pendule est assez conforme à l'hypothese elliptique, de l'autre la quantité de l'accourcissement sous l'équateur ne se trouve pas telle qu'elle devroit être, si l'applatissement de la Terre étoit ; elle est plus grande que cette fraction. Ainsi les expériences du pendule semblent aussi donner quelque échec à la théorie Newtonienne de la figure de la Terre, dans laquelle on regarde cette planete comme fluide & homogene. Ceci nous conduit naturellement à parler de tout ce qui a été fait jusqu'à nos jours, pour étendre & perfectionner cette théorie.
M. Huyghens avoit déterminé la figure de la Terre dans l'hypothese, que la pesanteur primitive fût dirigée au centre, & que la pesanteur altérée par la force centrifuge fût perpendiculaire à la surface. M. Newton avoit supposé que la pesanteur primitive résultât de l'attraction de toutes les parties de la Terre, & que les colonnes centrales fussent en équilibre, sans égard à la perpendicularité à la surface. MM. Bouguer & de Maupertuis ont fait voir de plus dans les mémoires de l'académie des Sciences de 1734, que la Terre étant supposée fluide avec MM. Huyghens & Newton, il étoit nécessaire, pour qu'il y eût équilibre entre les parties, dans une hypothèse quelconque de pesanteur vers un ou plusieurs centres, que les deux principes hydrostatiques de M. Huyghens & de M. Newton s'accordassent entr'eux, c'est-à-dire que la direction de la pesanteur fût perpendiculaire à la surface, & que de plus les colonnes centrales fussent en équilibre. Ils ont démontré l'un & l'autre qu'il y a une infinité de cas où les colonnes centrales peuvent être en équilibre, sans que la pesanteur soit perpendiculaire à la surface, & réciproquement ; & qu'il n'y a point d'équilibre, à moins que l'observation de ces deux principes ne s'accorde à donner la même figure. Du reste ces deux habiles géometres ont principalement envisagé la question de la figure de la Terre, dans la supposition que la pesanteur primitive ait des directions données vers un ou plusieurs centres : l'hypothèse newtonienne de l'attraction des parties rendoit le problème beaucoup plus difficile.
Il l'étoit d'autant plus que la maniere dont il avoit été résolu par M. Newton pouvoit être regardée non seulement comme indirecte, mais encore comme insuffisante & imparfaite à certains égards : dans cette solution, M Newton supposoit d'abord que la Terre fût elliptique, & il déterminoit d'après cette hypothèse l'applatissement qu'elle devoit avoir : or quoique cette supposition de la Terre elliptique fût légitime dans l'hypothèse de la Terre homogene, cependant elle avoit besoin d'être démontrée ; sans cela c'étoit proprement supposer ce qui étoit en question. M. Stirling démontra le premier rigoureusement dans les Transactions philosoph. que la supposition de M. Newton étoit en effet légitime, en regardant la Terre comme un fluide homogene, & comme très-peu applatie. Bien-tôt après M. Clairaut, dans les mêmes Transactions, n°. 449. étendit cette théorie beaucoup plus loin. Il prouva que la Terre devoit être un sphéroïde elliptique, en supposant non-seulement qu'elle fût homogene, mais qu'elle fût composée de couches concentriques, dont chacune en particulier différât par sa densité des autres couches ; il est vrai qu'il regardoit alors les couches comme semblables ; or la similitude des couches, ainsi que nous le verrons plus bas, & que M. Clairaut s'en est assûré ensuite, ne peut subsister dans l'hypothese que ces couches soient fluides.
En 1740, M. Maclaurin, dans son excellente piece sur le flux & reflux de la mer, qui partagea le prix de l'académie des Sciences, démontra le premier cette belle proposition, que si la Terre est supposée un fluide homogene, dont les parties s'attirent, & soient attirées outre cela par le Soleil ou par la Lune, suivant les lois ordinaires de la gravitation, ce fluide tournant autour de son axe avec une vitesse quelconque, prendra nécessairement la forme d'un sphéroïde elliptique, quel que soit son applatissement, c'est-à-dire très-petit ou non. De plus M. Maclaurin faisoit voir que dans ce sphéroïde, non-seulement la pesanteur étoit perpendiculaire à la surface, & les colonnes centrales en équilibre, mais encore qu'un point quelconque pris à volonté au-dedans du sphéroïde, étoit également pressé en tout sens. Cette derniere condition n'étoit pas moins nécessaire que les deux autres, pour qu'il y eût équilibre ; cependant aucun de ceux qui jusqu'alors avoient traité de la figure de la Terre, n'y avoient pensé ; on se bornoit à la perpendicularité de la pesanteur à la surface, & à l'équilibre des colonnes centrales, & on ne songeoit pas que selon les lois de l'Hydrostatique (voyez Fluide & Hydrostatique), il faut qu'un point quelconque du fluide soit également pressé en tout sens, c'est-à-dire que les colonnes du fluide, dirigées à un point quelconque, & non pas seulement au centre, soient en équilibre entr'elles.
M. Clairaut ayant médité sur cette derniere condition, en a déduit des conséquences profondes & curieuses, qu'il a exposées en 1742 dans son traité intitulé, Théorie de la figure de la Terre, tirée des principes de l'Hydrostatique. Selon M. Clairaut, il faut pour qu'un fluide soit en équilibre, que les efforts de toutes les parties comprises dans un canal de figure quelconque qu'on imagine traverser la masse entiere, se détruisent mutuellement. Ce principe est en apparence plus général que celui de M. Maclaurin ; mais j'ai fait voir dans mon essai sur la résistance des fluides, 1752. art. 18. que l'équilibre des canaux curvilignes n'est qu'un corollaire du principe plus simple de l'équilibre des canaux rectilignes de M. Maclaurin ; ce qui, au reste, ne diminue rien du mérite de M. Clairaut, puisqu'il a déduit de ce principe un grand nombre de vérités importantes que M. Maclaurin n'en avoit pas tirées, & qu'il avoit même assez peu connues pour tomber dans quelques erreurs ; par exemple, dans celles de supposer semblables entr'elles les couches d'un sphéroïde fluide, comme on le peut voir dans son traité des fluxions, art. 670. & suiv.
M. Clairaut, dans l'ouvrage que nous venons de citer, prouve (ce que M. Maclaurin n'avoit pas fait directement) qu'il y a une infinité d'hypothéses, où le fluide ne seroit pas en équilibre, quoique les colonnes centrales se contre-balançassent, & que la pesanteur fût perpendiculaire à la surface. Il donne une méthode pour reconnoître les hypothèses de pesanteur, dans lesquelles une masse fluide peut être en équilibre, & pour en déterminer la figure ; il démontre de plus, que dans le système de l'attraction des parties, pourvû que la pesanteur soit perpendiculaire à la surface, tous les points du sphéroïde seront également pressés en tout sens, & qu'ainsi l'équilibre du sphéroïde dans l'hypothèse de l'attraction, se réduit à la simple loi de la perpendicularité à la surface. D'après ce principe, il cherche les lois de la figure de la Terre dans l'hypothèse que les parties s'attirent, & qu'elle soit composée de couches hétérogenes, soit solides, soit fluides ; il trouve que la Terre doit avoir dans tous ces cas une figure elliptique plus ou moins applatie, selon la disposition & la densité des couches : il prouve que les couches ne doivent pas être semblables, si elles sont fluides ; que les accroissemens de la pesanteur de l'équateur au pole, doivent être proportionnels au quarré des sinus de latitude, comme dans le sphéroide homogene ; proposition très remarquable & très-utile dans la théorie de la Terre : il prouve de plus que la Terre ne sauroit être plus applatie que dans le cas de l'homogénéité, savoir de ; mais cette proposition n'a lieu qu'en supposant que les couches de la Terre, si elle n'est pas homogene, vont en augmentant de densité de la circonférence vers le centre ; condition qui n'est pas absolument nécessaire, sur-tout si les couches intérieures sont supposées solides ; de plus, en supposant même que les couches les plus denses soient les plus proches du centre, l'applatissement peut être plus grand que , si la Terre a un noyau solide intérieur plus applati que . V. la III. part. de mes Recherches sur le système du monde, p. 187. Enfin M. Clairaut démontre, par un très-beau théoreme, que la diminution de la pesanteur de l'équateur au pole, est égale à deux fois (applatissement de la Terre homogene) moins l'applatissement réel de la Terre. Ce n'est là qu'une très-legere esquisse de ce qui se trouve d'excellent & de remarquable dans cet ouvrage, très-supérieur à tout ce qui avoit été fait jusque-là sur la même matiere. V. Hydrostatique, Tuyaux capillaires, &c.
Après avoir refléchi long-tems sur cet important objet & avoir lû avec attention toutes les recherches qu'il a produites, il m'a paru qu'on pouvoit les pousser encore beaucoup plus loin.
Jusqu'ici on avoit supposé que dans un fluide composé de couches de différentes densités, les couches devoient être toutes de niveau, c'est-à-dire que la pesanteur devoit être perpendiculaire à chacune de ces couches. Dans mes réflexions sur la cause des vents 1746, article 86. j'avois déjà prouvé que cette condition n'étoit point absolument nécessaire à l'équilibre, & depuis je l'ai démontré d'une maniere plus directe & plus générale, dans mon essai sur la résistance des fluides 1752, articles 167. & 168. Dans le même ouvrage, depuis l'art. 161. jusque & compris l'art. 166. j'ai prouvé que les couches concentriques & non semblables de ce même fluide, ne devoient pas non plus être nécessairement de la même densité dans toute leur étendue, pour que le fluide fût en équilibre ; & j'ai présenté, ce me semble, sous un point de vûe plus étendu qu'on ne l'avoit fait encore, & d'une maniere très-simple & très-directe, les équations qui expriment la loi de l'équilibre des fluides. (Voyez à l'article Hydrostatique un plus grand détail sur ces différens objets, & sur quelques autres qui ont rapport aux lois de l'équilibre des fluides, & à d'autres remarques que j'ai faites par rapport à ces lois). Enfin dans l'art. 169. du même ouvrage, j'ai déterminé l'équation des différentes couches du sphéroïde, non-seulement en supposant, comme on l'avoit fait avant moi, que ces couches soient fluides, qu'elles s'attirent, & qu'elles aillent en diminuant ou en augmentant de densité, suivant une loi quelconque, du centre à la circonférence, mais en supposant de plus, ce que personne n'avoit encore fait, que la pesanteur ne soit point perpendiculaire à ces couches, excepté à la couche supérieure ; je trouve dans cette hypothèse une équation générale, dont celles qui avoient été données avant moi, ne sont qu'un cas particulier ; il est à remarquer que dans tous les cas où ces équations limitées & particulieres peuvent être intégrées, les équations beaucoup plus générales que j'ai données, peuvent être intégrées aussi ; c'est ce qui résulte de quelques recherches particulieres sur le calcul intégral, que j'ai publiées dans les mém. de l'Acad. des Sciences de Prusse de 1750.
Néanmoins dans ces formules généralisées, j'avois toûjours supposé la Terre elliptique, ainsi que tous ceux qui m'avoient précédé, n'ayant trouvé jusqu'alors aucun moyen de déterminer l'attraction de la Terre dans d'autres hypothèses ; mais ayant fait de nouveaux efforts sur ce problème, j'ai enfin donné en 1754, à la fin de mes recherches sur le système du monde, une méthode que les Géometres desiroient, ce me semble, depuis long-tems, pour trouver l'attraction du sphéroïde terrestre dans une infinité d'autres suppositions que celle de la figure elliptique. J'ai donc imaginé que l'équation du sphéroïde fût représentée par celle-ci, , &c. r' étant le rayon de la Terre à un lieu quelconque, le demi-axe de la Terre, le sinus de la latitude, , &c. des coefficiens constans quelconques ; & j'ai trouvé l'attraction d'un pareil sphéroïde. Cette équation est infiniment plus générale que celle qu'on avoit supposée jusqu'alors ; car dans la Terre supposée elliptique, on a seulement .
J'ai tiré de la solution de cet important problème de très-grandes conséquences dans la troisieme partie de mes recherches sur le système du monde, qui est sous presse au moment que j'écris ceci (Mai 1756), & qui probablement aura paru avant la publication de ce sixieme volume de l'Encyclopédie. J'ai fait voir de plus que le problème ne seroit pas plus difficile, mais seulement d'un calcul plus long, dans l'hypothese de l'attraction proportionnelle non-seulement au quarré inverse de la distance, mais à une somme quelconque de puissances quelconques de cette distance ; ce qui peut être très-utile dans la recherche de la figure de la Terre, lorsqu'on a égard à l'action que le soleil & la lune exercent sur elle, ou (ce qui revient au même) dans la recherche de l'élévation des eaux de la mer par l'action de ces deux astres ; voyez Flux & Reflux : j'ai fait voir enfin qu'en supposant le sphéroïde fluide & hétérogene, & les couches de niveau ou non, il pourroit très-bien être en équilibre sans avoir la figure elliptique ; & j'ai donné l'équation qui exprime la figure de ses différentes couches.
Ce n'est pas tout. J'ai supposé que dans ce sphéroïde les méridiens ne fussent pas semblables, que non-seulement chaque couche y différât des autres en densité, mais que tous les points d'une même couche différassent en densité entr'eux ; & j'enseigne la méthode de trouver l'attraction des parties du sphéroïde dans cette hypothèse si générale ; méthode qui pourroit être fort utile dans la suite, si la Terre se trouvoit avoir en effet une figure irréguliere. Il ne nous reste plus qu'à examiner cette derniere opinion, & les raisons qu'on peut avoir pour la soûtenir ou pour la combattre.
M. de Buffon est le premier (que je sache) qui ait avancé que la Terre a vraissemblablement de grandes irrégularités dans sa figure, & que ses méridiens ne sont pas semblables. Voyez hist. nat. tom. I. p. 165 & suiv. M. de la Condamine ne s'est pas éloigné de cette idée dans l'ouvrage même où il rend compte de la mesure du degré à l'équateur, p. 262. M. de Maupertuis qui l'avoit d'abord combattue dans ses élémens de Géographie, semble depuis l'avoir adoptée dans ses Lettres sur le progrès des Sciences ; enfin le P. Boscovich, dans l'ouvrage qu'il a publié l'année derniere sur la mesure du degré en Italie, non-seulement penche à croire que les méridiens de la Terre ne sont pas semblables, mais en paroît même assez fortement convaincu, à cause de la différence qui se trouve entre le degré d'Italie & celui de France à la même latitude.
Il est certain premierement que les observations astronomiques ne prouvent point invinciblement la régularité de la Terre & la similitude de ses méridiens. On suppose à la vérité dans ces observations que la ligne du zénith ou du fil-à-plomb (ce qui est la même chose) passe par l'axe de la Terre ; qu'elle est perpendiculaire à l'horison ; & que le méridien, c'est-à-dire le plan où le Soleil se trouve à midi, & qui passe par la ligne du zénith, passe aussi par l'axe de la Terre ; mais j'ai prouvé dans la troisieme partie de mes recherches sur le système du monde (& je crois avoir fait le premier cette remarque), qu'aucune de ces suppositions n'est démontrée rigoureusement, qu'il est comme impossible de s'assûrer par l'observation de la vérité de la premiere & de la troisieme, & qu'il est au moins extrèmement difficile de s'assûrer de la vérité de la seconde. Cependant il faut avoüer en même tems que ces trois suppositions étant assez naturelles, la seule difficulté ou l'impossibilité même d'en constater rigoureusement la vérité, n'est pas une raison pour les proscrire, sur-tout si les observations n'y sont pas sensiblement contraires. La question se réduit donc à savoir si la mesure du degré faite récemment en Italie, est une preuve suffisante de la dissimilitude des méridiens. Cette dissimilitude une fois avoüée, la Terre ne seroit plus un solide de révolution ; & non-seulement il demeureroit très-incertain si la ligne du zénith passe par l'axe de la Terre, & si elle est perpendiculaire à l'horison, mais le contraire seroit même beaucoup plus probable. En ce cas la direction du fil-à-plomb n'indiqueroit plus celle de la perpendiculaire à la surface de la Terre, ni celle du plan du méridien ; l'observation de la distance des étoiles au zénith ne donneroit plus la vraie mesure du degré, & toutes les opérations faites jusqu'à présent pour déterminer la figure de la Terre & la longueur du degré à différentes latitudes, seroient en pure perte. Cette question, comme l'on voit, mérite un sérieux examen ; envisageons-la d'abord par le côté physique.
Si la Terre avoit été primitivement fluide & homogene, la gravitation mutuelle de ses parties, combinée avec la rotation autour de son axe, lui eût certainement donné la forme d'un sphéroïde applati, dont tous les méridiens eussent été semblables : si la Terre eût été originairement formée de fluides de différentes densités, ces fluides cherchant à se mettre en équilibre entr'eux, se seroient aussi disposés de la même maniere dans chacun des plans qui auroient passé par l'axe de rotation du sphéroïde, & par conséquent les méridiens eussent encore été semblables. Mais est-il bien prouvé, dira-t-on, que la Terre ait été originairement fluide ? & quand elle l'eût été, quand elle eût pris la figure que cette hypothèse demandoit, est-il bien certain qu'elle l'eût conservée ? Pour ne point dissimuler ni diminuer la force de cette objection, appuyons-la encore avant que d'en apprétier la valeur, par la réflexion suivante. La fluidité du sphéroïde demande une certaine régularité dans la disposition de ses parties, régularité que nous n'observons pas dans la Terre que nous habitons. La surface du sphéroïde fluide devroit être homogene ; celle de la Terre est composée de parties fluides & de parties solides, différentes par leur densité. Les boulversemens évidens que la surface de la Terre a essuyés, boulversemens qui ne sont cachés qu'à ceux qui ne veulent pas les voir (& dont nous n'avons qu'une foible, mais triste image, dans celui que viennent d'éprouver Quito, le Portugal & l'Afrique), le changement évident des terres en mers & des mers en-terres, l'affaissement du globe en certains lieux, son exhaussement en d'autres, tout cela n'a-t-il pas dû altérer considérablement la figure primitive ? (Voy. Géographie physique, Terre, Tremblement de Terre, &c. la Géographie de Varenius, & le premier volume de l'Histoire naturelle de M. de Buffon). Or la figure primitive de la Terre étant une fois altérée, & la plus grande partie de la Terre étant solide, qui nous assûrera qu'elle ait conservé aucune régularité dans la figure ni dans la distribution de ses parties ? Il seroit d'autant plus difficile de le croire, que cette distribution semble, pour ainsi dire, faite au hazard dans la partie que nous pouvons connoître de l'intérieur & de la surface de la Terre ? La circularité apparente de l'ombre de la Terre dans les éclipses de Lune, ne prouve autre chose sinon que les méridiens & l'équateur sont à-peu-près des cercles ; or il faut que l'équateur soit exactement un cercle, pour que les méridiens soient semblables. La circularité apparente de l'ombre ne prouve point que les méridiens soient des cercles exacts, puisque les mesures ont prouvé qu'ils n'en sont pas ; pourquoi prouveroit-elle la circularité parfaite de l'équateur ? Les mêmes hauteurs du pole observées, après avoir parcouru des distances égales sous différens méridiens, en partant de la même latitude, ne prouvent rien non plus, puisqu'il faudroit être certain qu'il n'y a point d'erreur commise ni dans la mesure terrestre, ni dans l'observation astronomique ; or l'on sait que les erreurs sont inévitables dans ces mesures & dans ces opérations. Enfin les regles de la navigation qui dirigent d'autant plus sûrement un vaisseau, qu'elles sont mieux pratiquées, prouvent seulement que la Terre est à-peu-près sphérique, & non que l'équateur est un cercle. Car la pratique la plus exacte de ces regles est elle-même sujette à beaucoup d'erreurs.
Voilà les raisons sur lesquelles on se fonde, pour douter de la régularité de la Terre que nous habitons, & même pour lui donner une figure irréguliere. Mais n'y auroit-il pas d'autres inconvéniens à admettre cette irrégularité ? La rotation uniforme & constante de la Terre autour de son axe, ne semble-t-elle pas prouver (comme l'ont déjà remarqué d'autres philosophes) que ses parties sont à-peu-près également distribuées autour de son centre ? Il est vrai que ce phénomene pourroit absolument avoir lieu dans l'hypothèse de la dissimilitude des méridiens, & de la densité irréguliere des parties de notre globe ; mais alors l'axe de la rotation de la Terre ne passeroit pas par son centre de figure, & le rapport entre la durée des jours & des nuits à chaque latitude, ne seroit pas tel que l'observation & le calcul le donne ; ou si on vouloit que l'axe de rotation passât par le centre de la Terre, comme les observations semblent le prouver, il faudroit supposer dans les parties irrégulieres du globe un arrangement particulier, dont la symmétrie seroit beaucoup plus singuliere & plus surprenante, que la similitude des méridiens ne pourroit l'être, sur-tout si cette similitude n'étoit que très-approchée, comme on le suppose dans les opérations astronomiques, & non absolument rigoureuse.
D'ailleurs les phénomenes de la précession des équinoxes, si bien d'accord avec l'hypothèse que les méridiens soient semblables, & que l'arrangement des parties de la Terre soit régulier, ne semblent-ils pas prouver qu'en effet cette hypothèse est légitime ? Ces phénomenes auroient-ils également lieu, si les parties extérieures de notre globe étoient disposées sans ordre & sans loi ? Car la précession des équinoxes venant uniquement de la non-sphéricité de la Terre, ces parties extérieures influeroient beaucoup sur la quantité & la loi de ce mouvement dont elles pourroient alors déranger l'uniformité. Enfin la surface de la Terre dans sa plus grande partie est fluide, & par conséquent homogene ; la matiere solide qui couvre le reste de cette surface, est presque par-tout peu différente en pesanteur de l'eau commune : n'est-il donc pas naturel de supposer que cette matiere solide fait à-peu-près le même effet qu'une matiere fluide, & que la Terre est à-peu-près dans le même état, que si sa surface étoit par-tout fluide & homogene ; qu'ainsi la direction de la pesanteur est sensiblement perpendiculaire à cette surface, & dans le plan de l'axe de la Terre, & que par conséquent tous les méridiens sont semblables sinon à la rigueur, au moins sensiblement ? Les inégalités de la surface de la Terre, les montagnes qui la couvrent, sont moins considérables par rapport au diametre du globe, que ne le seroient de petites éminences d'un dixieme de ligne de hauteur, répandues çà & là sur la surface d'un globe de deux piés de diametre. D'ailleurs le peu d'attraction que les montagnes exercent par rapport à leur masse (Voyez Attraction & Montagnes), semble prouver que cette masse est très-petite par rapport à leur volume. L'attraction des montagnes du Pérou élevées de plus d'une lieue, n'écarte le pendule de sa direction que de sept secondes : or une montagne hémisphérique d'une lieue de hauteur, devroit faire écarter le pendule d'environ la 3000e partie du sinus total, c'est-à-dire d'une minute 18 secondes : les montagnes paroissent donc avoir très-peu de matiere propre par rapport au reste du globe terrestre ; & cette conjecture est appuyée par d'autres observations, qui nous ont découvert d'immenses cavités dans plusieurs de ces montagnes. Ces inégalités qui nous paroissent si considérables, & qui le sont si peu, ont été produites par les boulversemens que la Terre a soufferts, & dont vraissemblablement l'effet ne s'est pas étendu fort au-delà de la surface & des premieres couches.
Ainsi de toutes les raisons qu'on apporte pour soûtenir que les méridiens sont dissemblables, la seule de quelque poids, est la différence du degré mesuré en Italie, & du degré mesuré en France, à une latitude pareille & sous un autre méridien. Mais cette différence qui n'est que de 70 toises, c'est-à-dire d'environ 35 pour chacun des deux degrés, est-elle assez considérable pour n'être pas attribuée aux observations, quelque exactes qu'on les suppose ? Deux secondes d'erreur dans la seule mesure de l'arc céleste, donnent 32 toises d'erreur sur le degré ; & quel observateur peut repondre de deux secondes ? Ceux qui sont tout-à-la-fois les plus exacts & les plus sinceres, oseroient-ils même répondre de 60 toises sur la mesure du degré, puisque 60 toises ne supposent pas une erreur de quatre secondes dans la mesure de l'arc céleste, & aucune dans les opérations géographiques ?
Rien ne nous oblige donc encore à croire les méridiens dissemblables ; il faudroit pour autoriser pleinement cette opinion, avoir mesuré deux ou plusieurs degrés à la même latitude, dans des lieux de la Terre très-éloignés, & y avoir trouvé trop de différence pour l'imputer aux observateurs : je dis dans des lieux très-éloignés, car quand le méridien d'Italie par exemple, & celui de France, seroient réellement différens, comme ces méridiens ne sont pas fort distans l'un de l'autre, on pourroit toûjours rejetter sur les erreurs de l'observation, la différence qu'on trouveroit entre les degrés correspondans de France & d'Italie à la même latitude.
Il y auroit un autre moyen d'examiner la vérité de l'opinion dont il s'agit ; ce seroit de faire l'observation du pendule à même latitude, & à des distances très-éloignées : car si en ayant égard aux erreurs inévitables de l'observation, la longueur du pendule se trouvoit différente dans ces deux endroits, on en pourroit conclure (au moins vraissemblablement) que les méridiens ne seroient pas semblables. Voilà donc deux opérations importantes qui sont encore à faire pour décider la question, la mesure du degré, & celle du pendule, sous la même latirude, à des longitudes extrèmement différentes. Il est à souhaiter que quelque observateur exact & intelligent veuille bien se charger de cette entreprise, digne d'être encouragée par les souverains, & surtout par le ministere de France, qui a déjà fait plus qu'aucun autre pour la détermination de la figure de la Terre.
Au reste, en attendant que l'observation directe du pendule, ou la mesure immédiate des degrés nous donne à cet égard les connoissances qui nous manquent ; l'analogie, quelquefois si utile en Physique, pourroit nous éclairer jusqu'à un certain point sur l'objet dont il s'agit, en y employant les observations de la figure de Jupiter. L'applatissement de cette planete observé dès l'an 1666 par M. Picard, avoit dejà fait soupçonner celui de la Terre long-tems avant qu'on s'en fût invinciblement assûré par la comparaison des degrés du Nord & de France. Des observations réitérées de cette même planete nous apprendroient aisément si son équateur est circulaire. Pour cela il suffiroit d'observer l'applatissement de Jupiter dans différens tems. Comme son axe est à-peu-près perpendiculaire à son orbite, & par conséquent à l'écliptique qui ne forme qu'un angle d'un degré avec l'orbite de Jupiter, il est évident que si l'équateur de Jupiter est un cercle, le méridien de cette planete, perpendiculaire au rayon visuel tiré de la Terre, doit toûjours être le même, & qu'ainsi Jupiter doit paroître toûjours également applati, dans quelque tems qu'on l'observe. Ce seroit le contraire, si les méridiens de Jupiter étoient dissemblables. Je sai que cette observation ne sera pas démonstrative par rapport à la similitude ou à la dissimilitude des méridiens de la Terre. Mais enfin si les méridiens de Jupiter se trouvoient semblables, comme j'ai lieu de le soupçonner par les questions que j'ai faites là-dessus à un très-habile astronome, on seroit, ce me semble, assez bien fondé à croire, au défaut de preuves plus rigoureuses, que la Terre auroit aussi ses méridiens semblables. Car les observations nous prouvent que la surface de Jupiter est sujette à des altérations sans comparaison plus considérables & plus fréquentes que celle de la Terre, voyez Bandes, &c. or si ces altérations n'influoient en rien sur la figure de l'équateur de Jupiter, pourquoi la figure de l'équateur de la Terre seroit-elle altérée par des mouvemens beaucoup moindres ?
Mais quand on s'assûreroit même par les moyens que nous venons d'indiquer, que les méridiens sont sensiblement semblables, il resteroit encore à examiner si ces méridiens ont la figure d'une ellipse. Jusqu'ici la théorie n'a point donné formellement l'exclusion aux autres figures ; elle s'est bornée à montrer que la figure elliptique de la Terre s'accordoit avec les lois de l'Hydrostatique : j'ai fait voir de plus, je le répete, dans la troisieme partie de mes recherches sur le système du monde, qu'il y a une infinité d'autres figures qui s'accordent avec ces lois, sur-tout si on ne suppose pas la Terre homogene. Ainsi en imaginant que le méridien de la Terre ne soit pas elliptique, j'ai donné dans cette même troisieme partie de mes recherches, une méthode aussi simple qu'on peut le desirer, pour déterminer géographiquement & astronomiquement sans aucune hypothèse, la figure de la Terre, par la mesure de tant de degrés qu'on voudra de latitude & de longitude. Cette méthode est d'autant plus nécessaire à pratiquer, que non-seulement la théorie, mais encore les mesures actuelles, ne nous forcent pas à donner à la Terre la figure d'un sphéroïde elliptique ; car les cinq degrés du nord, du Pérou, de France, d'Italie, & du Cap, ne s'accordent point avec cette figure : d'un autre côté les expériences du pendule s'accordent assez bien à donner à la Terre la figure elliptique, mais elles la donnent plus applatie que de : enfin ce dernier applatissement s'accorde assez bien avec les cinq degrés suivans, celui du Nord, celui du Pérou, celui du Cap, le degré de France supposé de 57183 toises, & le degré de longitude mesuré à 43d 22? de latitude ; mais le degré de France supposé de 57074 toises, comme on le veut aujourd'hui, & le degré d'Italie, dérangent tout.
M. le Monnier cherchant à lever une partie de ces doutes, a entrepris de vérifier de nouveau la base de M. Picard, pour proscrire ou pour rétablir irrévocablement le degré de France, fixé par les académiciens du Nord à 57183 toises.
Si ce degré est rétabli, alors ce seroit aux Astronomes à décider jusqu'à quel point l'hypothèse elliptique seroit ébranlée par le degré d'Italie, le seul qui s'éloigneroit alors de cette hypothese, & même de l'applatissement supposé de . (Ne pourroit-on pas croire que dans un pays aussi plein de hautes montagnes que l'Italie, l'attraction de ces montagnes doit influer sur la direction du fil-à-plomb, & que par conséquent la mesure du degré doit y être moins exacte & moins sûre ? c'est une conjecture legete que je ne fais que hasarder ici). Il faudroit examiner de plus jusqu'à quel point les observations du pendule s'écarteroient de ce même applatissement de , déduction faite des erreurs qu'on peut commettre dans les observations.
Mais si le degré de 57183 toises est proscrit, il faudra en ce cas discuter soigneusement les erreurs qu'on peut commettre dans les observations, tant du pendule que des degrés ; & si ces erreurs devoient être supposées trop grandes pour accommoder l'hypothèse elliptique aux observations, on seroit forcé d'abandonner cette hypothèse, & de faire usage des nouvelles méthodes que j'ai proposées, pour déterminer par la théorie & par les observations, la figure de la Terre.
L'observation de l'applatissement de Jupiter pourroit encore nous être utile ici jusqu'à un certain point. Il est aisé de trouver par la théorie quel doit être le rapport des axes de cette planete, en la regardant comme homogene. Si ce rapport étoit sensiblement égal au rapport observé, on pourroit en conclure avec assez de vraissemblance que la Terre seroit aussi dans le même cas, & que son applatissement seroit , le même que dans le cas de l'homogénéité ; mais si le rapport observé des axes de Jupiter est différent de celui que la théorie donne, alors on en pourra conclure par la même raison que la Terre n'est pas homogene, & peut-être même qu'elle n'a pas la figure elliptique. Cette derniere conclusion pourroit encore être confirmée ou infirmée par l'observation de la figure de Jupiter ; car il seroit aisé de déterminer si le méridien de cette planete est une ellipse, ou non. Pour cela il suffiroit de mesurer le parallele à l'équateur de Jupiter, qui en seroit éloigné de 60 degrés ; si ce parallele se trouvoit sensiblement égal ou inégal à la moitié de l'équateur, le méridien de Jupiter seroit elliptique, ou ne le seroit pas.
Je ne parle point de la méthode de déterminer la figure de la Terre par les parallaxes de la Lune : cette méthode imaginée d'abord par M. Manfredi, dans les mémoires de l'académie des Sciences de 1734, est sujette à trop d'erreurs pour pouvoir rien donner de certain. Il est indubitable que les parallaxes doivent être différentes sur une sphere & sur un sphéroïde ; mais la différence est si petite, que quelques secondes d'erreur dans l'observation emportent toute la précision qu'on peut desirer ici. Il est bien plus sûr de déterminer la différence des parallaxes par la figure de la Terre supposée connue, que la figure de la Terre par la différence des parallaxes ; & je me suis attaché par cette raison au premier de ces deux objets, dans la troisieme partie de mes recherches sur le système du monde déjà citées. Voyez Parallaxe.
Il ne nous reste plus qu'un mot à dire sur l'utilité de cette question de la figure de la Terre. On doit avoüer de bonne-foi, qu'eu égard à l'état présent de la navigation, & à l'imperfection des méthodes par lesquelles on peut mesurer en mer le chemin du vaisseau, & connoître en conséquence le point de la Terre où il se trouve, il nous est assez indifférent de savoir si la Terre est exactement sphérique ou non. Les erreurs des estimations nautiques sont beaucoup plus grandes, que celles qui peuvent résulter de la non-sphéricité de la Terre. Mais les méthodes de la navigation se perfectionneront peut-être un jour assez pour qu'il soit alors important au pilote de savoir sur quel sphéroïde il fait sa route. D'ailleurs n'est-ce pas une recherche bien digne de notre curiosité, que celle de la figure du globe que nous habitons ? & cette recherche, outre cela, n'est-elle pas fort importante pour la perfection des observations astronomiques ? Voyez Parallaxe, &c.
Quoi qu'il en soit, voilà l'histoire exacte des progrès qu'on a faits jusqu'ici sur la figure de la Terre. On voit combien la solution complete de cette grande question, demande encore de discussion, d'observations, & de recherches. Aidé du travail de mes prédécesseurs, j'ai tâché dans mon dernier ouvrage, de préparer les matériaux de ce qui reste à faire, & d'en faciliter les moyens. Quel parti prendre jusqu'à ce que le tems nous procure de nouvelles lumieres ? savoir attendre & douter.
Il est tems de finir cet article, dont je crains qu'on ne me reproche la longueur, quoique je l'aye abregé le plus qu'il m'a été possible : je crains encore plus qu'on ne fasse aux Savans une espece de reproche, quoique très-mal fondé, de l'incertitude où ils sont encore sur la figure de la Terre, après plus de 80 ans de travaux entrepris pour la déterminer. Ce qui doit néanmoins me rassûrer, c'est que j'ai principalement destine l'article qu'on vient de lire, à ceux qui s'intéressent vraiment au progrès des Sciences ; qui savent que le vrai moyen de le hâter est de bien démêler tout ce qui peut le suspendre ; qui connoissent enfin les bornes de notre esprit & de nos efforts, & les obstacles que la nature oppose à nos recherches : espece de lecteurs à laquelle seule les Savans doivent faire attention, & non à cette partie du public indifférente & curieuse, qui plus avide du nouveau que du vrai, use tout en se contentant de tout effleurer.
Ceux qui voudront s'instruire plus à fond, ou plus en détail, sur l'objet de cet article, doivent lire : la mesure du degré du méridien entre Paris & Amiens, par M. Picard, corrigée par MM. les académiciens du Nord, Paris, 1740 : le traité de la grandeur & de la figure de la Terre, par M. Cassini, Paris, 1718 : le discours de M. de Maupertuis sur la figure des astres, Paris, 1732 : la mesure du degré au cercle polaire, par les académiciens du Nord, 1738 : la théorie de la figure de la Terre, par M. Clairaut, 1742 : la méridienne de Paris vérifiée dans toute l'étendue de Franæ, par M. Cassini de Thury, 1744 : la figure de la Terre, par M. Bouguer, 1749 : la mesure des trois premiers degrés du méridien, par M. de la Condamine, 1751 : l'ouvrage des PP. Maire & Boscovich, qui a pour titre, de litterariâ expeditione per poutificiam ditionem, &c. Romæ, 1755 : mes réflexions sur la cause des vents, 1746 : la seconde & la troisieme partie de mes recherches sur le système du monde, 1754 & & 1756 ; & plusieurs savans mémoires de MM. Euler, Clairaut, Bouguer, de Maupertuis, &c. répandus dans les recueils des académies des Sciences de Paris, de Petersbourg, de Berlin, &c. (O)
Figure, en Astrologie, est une description ou représentation de l'état & de la disposition du ciel à une certaine heure, qui contient les lieux des planetes & des étoiles, marqués dans une figure de douze triangles appellés maisons. Voyez Maisons.
On la nomme aussi horoscope & thème. Voyez Horoscope, &c.
Figure, en Géomancie, s'applique aux extrémités des points, lignes ou nombres jettés au hasard, sur les combinaisons ou variations desquels ceux qui font profession de cet art, fondent leurs prédictions chimériques.
Figure, (Théolog.) est aussi un terme qui est en usage parmi les Théologiens, pour désigner les mysteres qui nous sont représentés & annoncés d'une maniere obscure sous de certains types ou de certains faits de l'ancien Testament. Voyez Type.
Ainsi la manne est regardée comme le type & la figure de l'Eucharistie : la mort d'Abel est une figure des souffrances de Jesus-Christ, &c.
Beaucoup de théologiens & de critiques soûtiennent que toutes les actions, les histoires, les cérémonies, &c. de l'ancien Testament, ne sont que des figures, des types & des prophéties de ce qui devoit arriver dans le nouveau. V. Mystique. Chambers.
M. l'abbé de la Chambre, dans son traité de la religion, tome IV. définit. jv. p. 270. donne plusieurs regles pour l'intelligence du sens figuré des Ecritures, que nous rapporterons ici, parce qu'il n'arrive que trop souvent qu'on se livre à cette opinion, que tout est figure, sur-tout dans l'ancien Testament, & qu'on en abuse pour y voir des choses qui n'y furent jamais.
Premiere regle. On doit donner à l'Ecriture un sens figuré & métaphorique, lorsque le sens littéral renferme une doctrine qui met sur le compte de Dieu quelqu'imperfection ou quelqu'impiété.
Seconde regle. On doit donner un sens figuré, spirituel & métaphorique aux propositions de l'Ecriture, lorsque leur sens littéral n'a aucun rapport naturel avec les objets dont elles veulent tracer l'image.
Troisieme regle. La simple force des expressions pompeuses de l'Ecriture n'établit point la nécessité de recourir au sens figuré. Lorsque les expressions de l'Ecriture sont trop magnifiques pour le sujet qu'elles semblent regarder, ce n'est pas une preuve générale & nécessaire qu'elles désignent un objet plus auguste.
Quatrieme regle. On ne doit admettre de figures & d'allégories dans l'Ecriture de l'ancien Testament, comme étant de l'intention du S. Esprit, que celles qui sont appuyées sur l'autorité de Jesus-Christ, sur celle des apôtres, ou sur celle d'une tradition constante & uniforme de tous les siecles.
Cinquieme regle. Il faut voir Jesus-Christ & les mysteres de la nouvelle alliance dans l'ancien Testament, par-tout où les apôtres les ont vûs ; mais il faut ne les y voir qu'en la maniere qu'ils les y ont vûs.
Sixieme regle. Quand un passage des Livres saints a un double sens, un littéral & un figuratif, il faut expliquer le passage en entier de la figure, aussi-bien que de la chose figurée : on doit conserver, autant qu'il est possible, le sens littéral dans tout le texte. Il est faux que la figure disparoisse quelquefois entierement, pour faire place à la chose figurée.
On peut voir les preuves solides qu'apporte de toutes ces regles le même auteur, qui les termine par ces deux observations importantes sur la nature des types & des figures.
1°. Les endroits de la bible les moins propres à figurer quelque chose qui ait rapport à la nouvelle alliance, ce sont ceux qui ne contiennent que des actions repréhensibles & criminelles. Ces sortes de figures ont quelque chose d'indécent & de très-peu naturel.
2°. Il est faux que les fautes des saints de l'ancien Testament cessent d'être fautes, parce qu'elles sont figuratives. La prérogative du type & de la figure n'est point de diviniser & de sanctifier les actions qui sont figuratives : ces actions demeurent telles qu'elles sont en elles-mêmes & par leur nature ; si elles sont bonnes, elles demeurent bonnes ; & si elles sont mauvaises, elles demeurent mauvaises. Une action ne change pas de nature parce qu'elle en figure une autre, la qualité de type ne lui donne aucune qualité morale ; sa bonté ou sa malice ne dépendent essentiellement que de sa conformité ou de son opposition avec la loi de Dieu. S. Augustin, qui est dans le principe que les fautes des patriarches sont figuratives, in peccatis magnorum virorum aliquando rerum figuras animadverti & indagari posse, ne croit pas qu'elles cessent d'être fautes par cet endroit. « L'action de Loth & de ses filles, dit-il, est une prophétie dans l'Ecriture qui la raconte ; mais dans la vie des personnes qui l'ont commise, c'est un crime » : aliquando res gesta in facto causa damnationis, in scripto prophetia virtutis. Lib. II. contr. Faust. c. xlij. (G)
A ces regles & à ces observations de M. l'abbé de la Chambre, nous ajoûterons quelques remarques sur la même matiere. Figure, en Théologie, a deux acceptions très-différentes : c'est dans deux sens divers qu'on dit que l'expression oculi Domini super justos est figurée, & qu'on dit que la narration du sacrifice d'Isaac dans la Genese est figurée. Dans le premier cas il y a une figure, au sens que les rhéteurs donnent à ce mot, une métaphore. Dans le second il y a une figure, c'est-à-dire un type, une représentation d'un évenement distingué de celui qu'on raconte.
La premiere des regles qu'on vient de lire, est relative aux figures de l'Ecriture prises dans le premier sens, aux expressions figurées ; & on peut dire en général que toutes les regles qu'on peut prescrire pour distinguer dans les écrits l'expression naturelle de l'expression figurée, peuvent s'appliquer à l'Ecriture.
Les cinq autres de M. l'abbé de la Chambre, ont pour objet les figures de l'Ecriture prises au second sens, c'est-à-dire les narrations typiques ; & c'est sur celles-ci que nous allons nous arrêter.
On peut voir au mot Ecriture, (Théol.) les définitions des différentes sortes de sens figurés qu'on trouve dans les Ecritures. Il nous suffira ici de les envisager sous un point de vûe très-simple, je veux dire par leur distinction du sens littéral. En effet le sens mystique ou spirituel, allégorique, tropologique, anagogique ; tous ces sens-là, dis-je, sont toûjours unis avec un sens littéral, sous l'écorce duquel ils sont, pour ainsi dire, cachés.
On a remarqué à l'article Ecriture-Sainte, les excès dans lesquels sont tombés ceux qui ont voulu voir des sens figurés dans toute l'Ecriture. Selon ces interpretes, il n'y a point de texte où Dieu n'ait voulu renfermer sous l'enveloppe du sens littéral, les vérités de la Morale, ou les évenemens de la religion chrétienne. Comme on a déjà combattu ce principe directement, nous allons nous arrêter ici à faire connoître 1°. les causes qui ont amené l'usage abusif des explications figurées ; 2°. les inconvéniens qu'a entraînés cette méthode d'expliquer l'Ecriture. Nous croyons que des détails & des exemples sur ces deux objets, seront de quelque utilité.
La premiere cause de l'abus des sens figurés dans l'interprétation de l'Ecriture, a été l'usage qu'en font les écrivains du nouveau Testament. Les premiers écrivains ecclésiastiques se sont crus en droit d'employer, comme les apôtres, ces sortes d'explications ; & il faut avoüer que quelques-unes des applications de l'ancien Testament faites par les évangélistes, sembleroient autoriser à expliquer toute l'Ecriture figurément, parce qu'elles semblent un peu détournées, & ne se présentent pas tout de suite : mais selon la quatrieme regle qu'on vient de lire, on ne devoit admettre de figures & d'allégories dans l'écriture de l'ancien Testament, comme étant d'institution divine, que celles qui sont appuyées sur l'autorité de J. C. des apôtres, ou de la tradition.
La seconde cause de l'emploi excessif des sens figurés, me semble avoir été pour les premiers écrivains ecclésiastiques, la coûtume des Juifs qui donnoient à l'Ecriture des explications spirituelles, & ce goût a duré chez eux jusqu'au viij. siecle.
Je trouve une troisieme cause de ces mêmes abus dans la méthode que les peres avoient d'instruire les fideles par des homélies, qui n'étoient que des commentaires suivis sur l'Ecriture ; car dans la nécessité de faire entrer dans ces commentaires les vérités de la Morale & de la religion, ils s'efforçoient de les trouver là-même où elles n'étoient pas, dans des récits purement historiques. Leur éloquence trouvoit son compte à s'écarter du sens littéral, & à secoüer le joug d'une rigoureuse précision. On peut se convaincre de la vérité de ce que nous disons, en ouvrant au hasard des homélies, & on verra que les explications figurées sont prodiguées dans cette espece d'ouvrages : d'ailleurs, comme ils travailloient tous leurs commentaires sur l'Ecriture, dans la vûe de les employer à l'instruction des fideles, plûtôt qu'à l'éclaircissement & à l'intelligence du texte, ils s'attachoient plus fortement à une maniere de l'expliquer, qui leur donnoit plus d'occasion de développer les vérités de la religion, surtout en matiere de Morale ; & c'est à quoi les explications figurées leur servoient merveilleusement.
Je donnerai ici un exemple de l'usage qu'ils en faisoient. Ce passage du Deuréronome : & erit vita tua pendens ante oculos tuos, & non credes vitæ tuæ, ch. xxviij. signifie que si les Israëlites ne sont pas fideles à observer la loi de Dieu, tant de maux les accableront, que leur vie sera suspendue à un filet, & qu'ils croiront la voir terminer à tous momens ; c'est ce que la suite démontre : timebis nocte & die, dit Moyse, & non credes vitæ tuæ ; manè dices quis mihi det vesperum, & vesperè quis mihi det manè.
Voilà le sens naturel du texte, c'est assûrément le seul que Moyse ait eu en vûe. S. Augustin l'a saisi sans doute ; mais quand on a donné ce sens si simple & si naturel, tout est dit ; cela ne fournit pas de certains détails dans une homélie. Sur cela S. Augustin laisse à côté ce premier sens, & se jettant dans une autre explication du passage en question, il y trouve la passion, le genre de mort de Jesus-Christ, sa qualité de redempteur, d'auteur de la vie, l'incrédulité des Juifs, &c. Et il dit là-dessus de fort belles choses, mais qui malheureusement ne sont point-du-tout relatives au texte.
Tous nos prédicateurs ont donné dans ces mêmes défauts ; & je trouve dans ceux qui joüissent de la plus grande réputation, des applications de l'Ecriture aussi fausses & aussi détournées que celle que je viens de rapporter.
Une quatrieme & une cinquieme cause de ces abus, sont, selon le judicieux M. Fleury (discours sur l'Hist. ecclés.), le mauvais goût qui faisoit mépriser ce qui étoit simple & naturel, & la difficulté d'entendre la lettre de l'Ecriture, faute de savoir les langues originales, je veux dire le grec & l'hébreu, & de connoître l'histoire & les m?urs de cette antiquité si reculée. C'étoit plûtôt fait de donner des sens mystérieux à ce que l'on n'entendoit pas ; & en effet, si l'on y prend garde, S. Augustin, S. Grégoire & la plus grande partie des peres qui ont travaillé sur l'Ecriture de cette façon, n'entendoient ni le grec ni l'hébreu. Au lieu que S. Jérôme qui connoissoit les sources, ne s'attache qu'au sens littéral.
Pour montrer que cette ignorance des langues originales a souvent influé dans la maniere dont les peres ont expliqué l'Ecriture, je citerai un exemple tiré encore de S. Augustin.
Au livre XIII. de la cité de Dieu, chap. xij. il explique ainsi la menace faite par Dieu au ch. ij. de la Genese. In quocumque die comederis ex eo, morte morieris : morte moriemini, dit-il, non tantum animæ mortis partem priorem ubi anima privatur Deo, nec tantùm posteriorem ubi corpus privatur animâ, nec solùm ipsam totam primam ubi anima & à Deo & à corpore separata punitur, sed quidquid mortis est usque ad novissimam quæ secunda dicitur, & quâ est nulla posterior comminatio illa amplexa est.
On voit bien que dans toute cette explication S. Augustin se fonde sur l'énergie & l'emphase qu'il prête à l'expression morte moriemini ; & c'est l'ignorance de la langue hébraïque qui le fait tomber dans cette erreur, selon la remarque du savant le Clerc, qui me fournit cet exemple, Artis crit. p. 11. sect. primâ, ch. jv. En hebreu on joint assez souvent l'infinitif au verbe, comme un nom, sans que ce redoublement donne aucune énergie à la phrase. Par exemple, au verset précédent on lit dans l'hébreu & dans les Septante, comedendo comedes, mis simplement pour comedes ; le même tour à-peu-près a lieu dans la dialecte attique. On trouve dans Homere concionem concionari ; les Latins mêmes disent vivere vitam, &c. & toutes ces expressions n'ont point l'emphase que S. Augustin a vûe ici.
Sixieme cause. L'opinion de l'inspiration rigoureuse de tous les mots, de toutes les syllabes de l'Ecriture & de tous les faits, c'est-à-dire de ceux-là mêmes dont les écrivains sacrés avoient été les témoins, & qu'ils pouvoient raconter d'après eux-mêmes. Car dans cette opinion on a regardé chaque mot de l'Ecriture, comme renfermant des mysteres cachés, & les circonstances les plus minutieuses des faits les plus simples, comme destinées par Dieu à nous fournir des connoissances très-relevées. Ce principe a été adopté par la plûpart des peres.
Je le trouve très-bien developpé par le jésuite Kirker, au liv. II. de son ouvrage de arcâ Noë. C'est au ch. viij. qu'il intitule de mystico-allegorico-tropologicâ arcæ expositione : il dit que puisque Dieu pouvoit d'un seul mot sauver du déluge Noë, ses enfans & les animaux, sans tout cet appareil d'arche, de provisions, &c. il est probable qu'il n'a fait construire ce grand bâtiment, & qu'il n'en a fait faire à l'historien sacré une description si exacte, que pour nous élever à la contemplation des choses invisibles par le moyen de ces choses visibles, & que cette arche cache & renferme de grands mysteres. Les bois durs & qui ne se corrompent point, sont les gens vertueux qui sont dans l'Eglise ; ces bois sont polis, pour marquer la douceur & l'humilité : les bois quarrés, sont les docteurs ; les trois étages de l'arche, sont les trois états qu'on voit dans l'Eglise, le séculier, l'ecclésiastique & le monastique. Il met les moines au troisieme étage, mais il n'assigne point aux deux autres ordres leurs places respectives, &c.
Voilà, je croi, les principales causes qui ont introduit les explications figurées. Je vais tâcher à présent de faire sentir les inconvéniens qu'a entraînés cette méthode d'interpreter l'Ecriture.
Premier inconvénient. Quoique les explications figurées puissent le plus souvent être rejettées, par cela seul qu'elles ne sont pas fondées, elles ne sont pas bien dangereuses tant qu'elles ne consistent qu'à chercher avec trop de subtilité dans les sens figurés de l'Ecriture, les dogmes établis d'ailleurs sur des passages pris dans leur sens propre & naturel. Mais le mal est qu'on ne s'est pas toûjours renfermé dans des bornes légitimes, & qu'on s'est efforcé d'ériger des sens figurés en dogmes. Ce nouvel usage, comme on voit, pouvoit s'introduire assez facilement ; en effet, lorsqu'on se servoit du sens figuré pour établir un dogme déjà reçû, on n'avoit garde de nier le sens figuré, ou de dire qu'il ne prouvoit rien, parce qu'on eût passé pour nier le dogme ; par-là le sens figuré acquit bien-tôt une autorité considérable, & on ne craignit pas de l'apporter en preuves d'opinions nouvelles. En voici un exemple frappant, & que tout le monde connoît : c'est l'usage qu'on a voulu faire de l'allégorie des deux glaives pour attribuer à l'Eglise une autorité sur les souverains, même dans le temporel ; & il est à remarquer que cette méthode d'expliquer l'Ecriture & l'autorité des allégories apportées en preuves des dogmes, étoit tellement établie dans le xj. siecle, que les défenseurs de l'empereur Henri IV. contre Grégoire VII. ne s'avisoient pas de dire que cette figure ne prouvoit rien.
Cet abus étoit monté au comble au tems dont nous parlons, & nous n'en sommes pas encore tout-à-fait corrigés ; Vivès au xvj. siecle s'en plaignoit amerement : quo magis miror, dit-il sur le ch. iij. du livre XVII. de civitate Dei, stultitiam, ne dicam an impudentiam, an utrumque eorum, qui ex allegoriis præcepta & leges vitæ, dogmata religionis, vincula quibus ligemur teneamurque, colligant atque innodant, & ea pro certissimis in vulgum efferunt, ac hæreticum clamant si quis dissentiat.
Mais même en supposant que le sens figuré soit employé par les Théologiens en preuve d'un dogme bien établi d'ailleurs, c'est toûjours un inconvénient considérable que d'employer une aussi mauvaise raison, & on doit bannir absolument de la Théologie, l'usage de ces sortes d'explications. Cependant les anciens théologiens (& les modernes ne sont pas tout-à-fait exempts de ce reproche) ont tombé fréquemment dans ce défaut. Il s'en présente à m
Trésor de la Langue Française informatisé
FIGURE, subst. fém.
Figure au Scrabble
Le mot figure vaut 10 points au Scrabble.
Informations sur le mot figure - 6 lettres, 3 voyelles, 3 consonnes, 6 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot figure au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
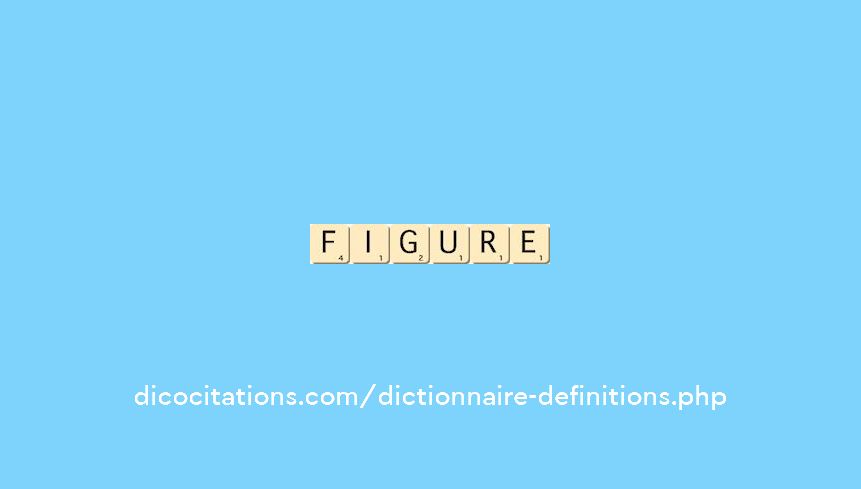
Les mots proches de Figure
Figé, ée Figement Figer Fignolage Figue Figuier Figulin Figuline Figurable Figurant, ante Figurant, ante Figuratif, ive Figuration Figure Figuré, ée Figurément Figurer Figurine Figuriste Figanières Figari Figari figaro Figarol figaros fige figé figé figea Figeac Figeac Figeac figeaient figeais figeait figeant figée figée figées figées figent figer figera figerai figeraient figerait figèrent figés figés figez fignard Fignévelle Fignières fignola fignolage fignolages fignolaient fignolait fignolant fignole fignolé fignolée fignolent fignoler fignolerai fignolerais fignolerait fignolés fignoleurMots du jour
Mondrain Combien Bleuir Parèdre Économiquement Motiver Tercet Filière Tuant, ante Portemanteau
Les citations avec le mot Figure
- Vous portez votre honneur comme on porte une armure, Stark. Vous vous figurez à l'abri, dedans, alors qu'il ne sert qu'à vous alourdir et à rendre pénible chacun de vos gestes.Auteur : George Raymond Richard Martin - Source : Le Trône de fer, L'Intégrale 1 (2008)
- Il existe des lois qui ont bonne mine lorsqu'elles sont exprimées dans un certain langage, mais qui ne souffrent pas d'être traduites; elles ne peuvent pas figurer parmi les lois de la nature.Auteur : Bertrand Russell - Source : ABC de la relativité
- La philosophie est écrite dans cet immense livre qui continuellement reste ouvert devant les yeux (je dis l'Univers), mais on ne peut le comprendre si, d'abord, on ne s'exerce pas à en connaître la langue et les caractères dans lesquels il est écrit. II est écrit dans une langue mathématique, et les caractères en sont les triangles, les cercles, et d'autres figures géométriques, sans lesquelles il est impossible humainement d'en saisir le moindre mot; sans ces moyens, on risque de s'égarer dans un labyrinthe obscur.Auteur : Galilée - Source : L'essayeur (1623)
- On ne peut se figurer combien les Parisiens sont ignorants et exclusifs; ils ne savent que ce qu'on leur apprend, quand ils veulent l'apprendre.Auteur : Honoré de Balzac - Source : Le Cousin Pons (1847)
- Figurez-vous que je m'étais bien acoquiné près du feu, pour vous écrire longuement ...Auteur : Honoré de Balzac - Source : Correspondance, 5 octobre 1833
- Le désespoir peut me tomber dessus, mais la félicité aussi, même si la mélancolie continue de défigurer la réalité. Le verre à moitié plein ? Souvent, je ne vois même pas le verreAuteur : Olivia de Lamberterie - Source : Avec toutes mes sympathies
- Les déclarations les plus belles ne figurent pas dans les manuels.Auteur : Bruno Nicolini, dit Bénabar - Source : Les Mots d'amour (2003)
- Charmantes petites figures en culs-de-lampe au-dessous de la tribune du Comte, représentant les Vertus assises.Auteur : Paul Claudel - Source : Journal, 28 mars 1920
- Nous connaissons en fait presque uniquement des gens défigurés par la nature et donc par leur malheur qui se sont résignés, et de très rares seulement dont nous pouvons dire que leur malheur les a conduits au triomphe, au triomphe de l'esprit...Auteur : Thomas Bernhard - Source : Les Mange-pas-cher (1980)
- Le 8 passa le premier, un garçon si trapu que bien qu'il montât debout sur les pédales, nous ne pensâmes pas au joli terme «monter en danseuse» qui désigne cette figure du style cycliste.Auteur : Roger Vailland - Source : 325 000 francs (1955)
- Avant une guerre, la science militaire fait figure de science, comme l'astronomie. Après une guerre, elle tient plus de l'astrologie.Auteur : Rebecca West - Source : In Talks, Volume 3, Les leçons de la guerre en Chine et en Espagne, Columbia Broadcasting System, Incorporated., 1938
- Que nous reste-t-il après l'agitation ? Pour les plus célèbres d'entre nous, figurer dans le dictionnaire avant d'être enfouis sous les strates du temps, oubliés.Auteur : Pierre Rabhi - Source : Graines de possibles, regards croisés sur l'écologie (2005)
- Moi, j'aime bien qu'il me coûte cher, mon plaisir ça me permet de me figurer que j'en ai vraiment envie.Auteur : Jean Anouilh - Source : L'Alouette (1953)
- Quant à Gauguin, à cause du bon temps qu'il avait pris avec des jeunes Polynésiennes de quatorze ans, elle le jugeait digne de figurer aujourd'hui parmi les pédophiles de haut vol plutôt qu'au programme des beaux-arts.Auteur : John Harvey - Source : Le Deuil et l'Oubli (2011)
- Après avoir voulu être un poète (rêvant de vivre comme une sorte de héros mythologique), je serai devenu l'auteur d'honnêtes essais autobiographiques qui feront peut-être figure de défense et illustration de ce genre littéraire.Auteur : Michel Leiris - Source : La Règle du Jeu III - Fibrilles (1966)
- Ne flattez pas le culte d'adjectifs tels que indescriptible, inénarrable, rutilant, incomparable, colossal, qui mentent sans vergogne aux substantifs qu'ils défigurent: ils sont poursuivis par la lubricité.Auteur : Isidore Ducasse, dit comte de Lautréamont - Source : Poésies
- Ces cartes particulières seront les différents articles de l'Encyclopédie, et l'arbre ou système figuré en sera la mappemonde.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Discours préliminaire à l'Encyclopédie (1751)
- Il parlait maintenant avec des intonations d'acteur, avec un jeu plaisant de figure qui divertissaient la jeune femme habituée aux manières et aux joyeusetés de la grande bohème des hommes de lettres.Auteur : Guy de Maupassant - Source : Bel-Ami (1885)
- Avec ce qui leur restait d'argent, ils s'étaient payé des dents en or, chacun une incisive, pour faire bonne figure en Allemagne.Auteur : Eugen Ruge - Source : Quand la lumière décline (2012)
- Il dépeignit l'ininterrompu défilé des lésés et des mécontents, leurs attitudes découragées, leurs figures navrées et navrantes.Auteur : Georges Courteline - Source : Messieurs les ronds-de-cuir (1893)
- Si je viens à te prendre en rêve, tu es mienne,
Car il n'est de plaisir qui ne soit figuré.Auteur : John Donne - Source : Le rêve - Il y a vraiment sur la terre de très beaux paysages ; mais les figures qui les peuplent sont toujours mauvaises ; aussi ne doit-on pas s'arrêter auprès d'elles.Auteur : Arthur Schopenhauer - Source : Essai sur les apparitions et opuscules divers (1912)
- Un chercheur est celui qui risque sa vérité et qui se casse la figure.Auteur : Michel Serres - Source : In Le bonheur possible, Éditions de l'Homme de Robert Blondin (1997)
- Défiez-vous de votre optimisme, et figurez-vous bien que nous sommes dans ce monde pour nous battre envers et contre tous.Auteur : Prosper Mérimée - Source : Sans référence
- Digne de figurer dans un musée ... Que garantissent sa survie les soins de générations de conservateurs.Auteur : Nathalie Sarraute - Source : Vous les entendez? (1972)
Les citations du Littré sur Figure
- La plupart des jeunes gens, les plus vifs et les moins pensants, qui ne voient que par les yeux du corps, saisissent cependant merveilleusement le ridicule des figuresAuteur : BUFF. - Source : Disc. nat. anim. Oeuv. t. V, p. 364
- Outre les quatre séries à signes variés qu'ils comprennent comme les jeux de cartes communes, les jeux de tarots en offrent une cinquième ... cette cinquième série est une suite de figures, généralement au nombre de vingt-deux ; vingt et une sont numérotées et prennent rang entre elles d'après le numéro dont elles sont marquées ; la moindre de ces figures l'emporte sur toutes les cartes des séries numérales, même sur les rois ; de là elles ont reçu le nom d'atouts et celui de triomphes ; c'est à ces atouts qu'appartient proprement le nom de tarots ; lesquelles séries de cartes numérales qui, avec les atouts, composent les jeux des tarots, ont chacune quatre figures : roi, reine, cavalier et valet, une figure de plus que les cartes communes ; ainsi les jeux de tarots ont au moins trente-huit figures, c'est-à-dire vingt-deux pour les atouts et seize pour les honneurs des quatre séries numérales ; ajoutons que, dans les pays qui ont conservé les anciens types, les signes distinctifs de ces quatre séries sont : les deniers, les coupes, les épées et les bâtonsAuteur : MERLIN - Source : Revue archéol. t. XVI, p. 283
- Le zodiaque, dont les figures ou catastérismes....Auteur : FR. LENORMANT - Source : Manuel d'hist. anc. t. II, p. 176, 4e édit.
- C'est de lui [Cadmus] que nous vient cet art ingénieux De peindre la parole et de parler aux yeux, Et par les traits divers des figures tracées Donner de la couleur et du corps aux penséesAuteur : BRÉBEUF - Source : Phars. III
- La quatrieme espece des fractures du crane est appellée incision ou marque. - Merque ou siege est toute incision du crane, retenant la figure du bastonAuteur : PARÉ - Source : VIII, 1
- Si nous entendons du Messie ce grand passage où Isaïe nous représente si vivement l'homme de douleurs frappé pour nos péchés et défiguré comme un lépreuxAuteur : BOSSUET - Source : Hist. II, 10
- Daniel.... vit par ordre, à diverses fois et sous des figures différentes, quatre monarchies sous lesquelles devaient vivre les IsraélitesAuteur : BOSSUET - Source : Hist. II, 4
- Figure d'un homme qui auroit une rupture [hernie] d'un seul costé, avec un brayerAuteur : PARÉ - Source : VI, 15
- J'aperçois le soleil, quelle en est la figure ? Ici-bas ce grand corps n'a que trois pieds de tour ; Mais, si je le voyais là-haut dans son séjour, Que serait-ce à mes yeux que l'oeil de la nature ?Auteur : Jean de La Fontaine - Source : Fabl. VII, 18
- Autre figure de tire-balle, nommée bec de lezard, pour tirer la balle lorsqu'elle sera applatieAuteur : PARÉ - Source : IX, 5
- Vous voilà tombé dans la possibilité ; dans cette possibilité, vous trouverez les choses de raison, les hircocerfs, les hippocentaures et mille autres figures bizarresAuteur : FÉN. - Source : t. XIX, p. 442
- J'ai toujours pensé que l'histoire demande le même art que la tragédie, une exposition, un noeud, un dénoûment, et qu'il est nécessaire de présenter tellement toutes les figures du tableau, qu'elles fassent valoir le principal personnage, sans affecter jamais l'envie de le faire valoirAuteur : Voltaire - Source : Lett. Schouvalof, 17 juill. 1758
- La même parure qui a autrefois embelli a jeunesse, défigure enfin sa personne, éclaire les défauts de sa vieillesseAuteur : LA BRUY. - Source : III
- La divisibilité, la figure, sont des qualités négatives et des limitationsAuteur : Voltaire - Source : Traité de métaph. ch. 2
- Sous la figure de la mort qui vous paraît si hideuse, il [Jésus-Christ] vous apporte sa grâce, son royaume, la félicité éternelleAuteur : BOSSUET - Source : Méd. sur l'Év. Dern. sem. du Sauveur, 86e jour
- Serpentaire : il y en a de deux sortes, l'une grande, l'autre petite ; ceste herbe a esté ainsi appellée à cause du serpent qu'elle represente en sa figure, le sommet de la plante semblant la teste d'un serpent, et son tige moucheté et tacheté de rouge et de jaune lui en marquant presque la couleurAuteur : O. DE SERRES - Source : 513
- Pour ung cachet d'or, auquel il y a deux figures de relief esmailléesAuteur : DE LABORDE - Source : Émaux, p. 181
- Quant aux courges, de trois principales sortes en avons-nous, distinguées par ces mots, courges, cougourdes, citrouilles. Les courges et cougourdes ne different qu'en figure, estans de couleur blanche et de semblable goust. Les courges sont longues, y en aiant attaindre jusqu'à cinq ou six pieds. Les cougourdes sont rondes, commodes à estre assechées pour en faire des bouteilles. Je ne doute pas qu'en plusieurs endroits, ces deux especes-ci ne se confondent en leurs appellationsAuteur : O. DE SERRES - Source : 547
- Dans ce mauvais tableau, il y a pourtant de la perspective, et les figures fuient bien du côté de la porte du fondAuteur : DIDER. - Source : Salon de 1767, t. IX, p. 42, éd. 1821
- Il ne faut pas juger des hommes comme d'un tableau ou d'une figure, sur une seule et première vue ; il y a un intérieur et un coeur qu'il faut approfondirAuteur : LA BRUY. - Source : XII
- Je présume qu'à une époque quelconque on détacha du groupe la figure de Mars, qu'alors le bras gauche fut cassé dans le descellement qu'on en fit, que la statue de Vénus [de Milo] resta mutilée jusqu'à ce que quelque circonstance ait donné lieu de la restaurerAuteur : QUATREMÈRE DE QUINCY - Source : dans l'Opin. nation. 25 juin 1875, 2e page, 4e col.
- Ils parcouraient donc mon hétéroclite figure ; et je pense qu'il n'y avait rien de si sot que moiAuteur : MARIVAUX - Source : Pays. parv. 5e part.
- À travers les obscurités et les défigurements du langageAuteur : VILLEMAIN - Source : Essai sur le génie de Pindare, p. 70
- Ils ont formé des figures dont le dessin se borne à des ronds, des carrés, des lignes droites, des moulinets et des chaînesAuteur : NOVERRE - Source : Lett. sur la danse, p. 130, dans POUGENS
- Ils cercheront le racord des figures de la damasquine, tellement qu'il semblera que toutes lesdites tables jointes ensemble ne sont qu'une mesme piece, à cause que le racord des figures empesche la cognoissance de l'assemblageAuteur : PALISSY - Source : 28
Les mots débutant par Fig Les mots débutant par Fi
Une suggestion ou précision pour la définition de Figure ? -
Mise à jour le mercredi 11 février 2026 à 02h16

- Facilite - Faible - Faiblesse - Faim - Faire - Fait - Famille - Fanatique - Fatalite - Fatigue - Faute - Faveur - Felicitations - Femme - Femme_homme - Ferocite - Fete - Fête des mamans - Fête des papas - Fête des mères - Fête des pères - Fidele - Fidèle - Fidelite - Fidélité - Fierte - Fille - Fils - Finalite - Finance - Flamme - Flatter - Flatterie - Fleur - Foi - Folie - Fonctionnaire - Foot - Football - Force - Fortune - Fou - Foule - Français - Française - France - Franchise - Fraternite - Frustation - Fuir - Futur
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur figure
Poèmes figure
Proverbes figure
La définition du mot Figure est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Figure sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Figure présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.























