La définition de Trop du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Trop
Nature : s. m.
Prononciation : tro ; le p se lie : il va tro-p avant ;
Etymologie : Patois des Fourgs, trou ; bourguig. trô ; génev. trop à bonne heure (dites de trop bonne heure) ; provenç. trop, troupeau, et trop, trop ; ital. troppo. C'est le mot trop, troupeau (voy. ) employé adverbialement pour signifier excès de quantité.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de trop de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec trop pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Trop ?
La définition de Trop
Ce qui est en excès.
Toutes les définitions de « trop »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
. Plus qu'il ne faut, avec excès. Trop vite. Trop avant. Trop loin. Trop tôt. Trop riche. Trop puissant. Trop fin. Trop bien. Cette viande est trop cuite. Il a trop travaillé. Il a bu trop de vin. Il en a trop, beaucoup trop, un peu trop. Il n'y a pas dans son discours un mot de trop. Il a trop de bon sens pour agir ainsi. Vous le traitez avec trop de rigueur. Cela n'est que trop vrai. C'en est trop, C'est aller trop loin, c'est dépasser la mesure. Je ne puis plus souffrir ses insolences, c'en est trop. Trop peu, Pas assez. Il n'en faut ni trop, ni trop peu. De trop, en trop, En excès. Vous m'avez donné cent francs de trop. Il faut retrancher ce qui est en trop. Fam., Vous n'êtes pas de trop se dit à une personne pour lui témoigner qu'elle peut rester, qu'on n'a rien à lui cacher de ce qu'on veut dire. On dit de même : Suis-je de trop? Fam., Par trop, Excessivement, d'une manière fatigante, importune, révoltante. Cet homme est aussi par trop ennuyeux, par trop complimenteur, par trop insolent. Ne... pas trop, Guère. Je ne voudrais pas trop m'y fier. Il ne se porte pas trop bien. Prov., Trop est trop, Rien de trop, Tout excès est condamnable. Prov. et fig., Qui trop embrasse mal étreint, Qui entreprend trop de choses à la fois ne réussit à rien.
TROP se dit encore, le plus souvent dans des phrases de politesse, pour Beaucoup, fort. Je suis trop heureux de vous voir. Vous êtes trop aimable.
TROP s'emploie aussi comme nom masculin et désigne l'Excès. Il a été victime de son trop de confiance.
Littré
(Trop est essentiellement un substantif.)
-
1Ce qui est en excès.
Le trop de confiance attire le danger
, Corneille, Cid, II, 7.Sa mère, que longtemps je voulus épargner? L'a de la sorte instruite?; et ce que je vois suivre Me punit bien du trop que je la laissai vivre
, Corneille, Héracl. I, 1.Le trop d'expédients peut gâter une affaire? N'en ayons qu'un, mais qu'il soit bon
, La Fontaine, Fabl. IX, 14.Il y en a beaucoup que le trop d'esprit gâte
, Molière, Critique, 6. -
2Mon trop de?, son trop de, etc., l'excès de mon, de son, etc.
Mais votre trop d'amour pour cet infâme époux Vous donnera bientôt à plaindre comme à nous
, Corneille, Hor. III, 6.Il s'en est peu fallu que, durant mon absence, On ne m'ait attrapé par son trop d'innocence
, Molière, Éc. des fem. III, 3.J'abuse, cher ami, de ton trop d'amitié
, Racine, Andr. III, 1. -
3Sans article, trop de, un excès de.
Je me suis accusé de trop de violence
, Corneille, Cid, III, 4.Voilà les pauvres gens Malheureux par trop de fortune
, La Fontaine, Fabl. VII, 6.Nos sens n'aperçoivent rien d'extrême?: trop de bruit nous assourdit, trop de lumière éblouit?
, Pascal, Pens. I, 1, éd. HAVET.Il nous sera toujours impossible de satisfaire pleinement les divers ordres de lecteurs?; le littérateur trouvera dans l'Encyclopédie trop d'érudition, le courtisan trop de morale, le théologien trop de mathématique, le mathématicien trop de théologie, l'un et l'autre trop de jurisprudence et de médecine
, D'Alembert, ?uv. i. I, p. 372.Trop de sang, trop de pleurs ont inondé la France
, Chénier M. J. la Promenade.C'est trop que ou de, il y a excès à.
Ah?! ma bonne, que je voudrais bien vous voir un peu, vous entendre? vous voir passer, si c'est trop que le reste?!
Sévigné, 18 févr. 1671.Si certains esprits vifs et décisifs étaient crus, ce serait encore trop que les termes pour exprimer les sentiments
, La Bruyère, I.C'est trop contre un mari d'être coquette et dévote?: une femme devrait opter
, La Bruyère, III.C'en est trop, c'est aller trop loin.
C'en est trop, madame, répliqua don Fadrigue?; je ne mérite pas que vous me regrettiez si longtemps
, Lesage, Diable boit. 15. -
4Trop, régime direct d'un verbe.
Non, je n'aurai pas trop de toute ma puissance Pour punir à mon gré mon odieux rival
, Fontenelle, Thét. et Pol. IV, 4.Et qui peut nous combler de honte et de dépit, Moi d'en avoir trop su, vous d'en avoir trop dit
, Voltaire, Indiscr. I, 3.Boileau restera un de nos bons auteurs classiques pour les vers?; on lui a peut-être trop accordé de son vivant?; peut-être lui refuse-t-on trop aujourd'hui
, Duclos, ?uv. t. x, p. 85. -
5Trop précédé d'une préposition.
De trop, qui est en excès.
Tout ce qu'on dit de trop est fade et rebutant
, Boileau, Art p. I.Ignorez-vous qu'une multitude de vos frères périt ou souffre du besoin de ce que vous avez de trop??
Rousseau, Inég. 2e part.Mademoiselle, votre approbation est de trop
, Diderot, Père de famille, III, 4.Vous n'êtes pas de trop, se dit pour engager à rester une personne qui craint que sa présence ne gêne.
Vous savez que votre présence ne gâte jamais rien, et que vous n'êtes point de trop, en quelque lieu que vous soyez
, Molière, Am. magn. I, 1.Un homme habile sent s'il convient, ou s'il ennuie?: il sait disparaître, le moment qui précède celui où il serait de trop quelque part
, La Bruyère, v.Oh?! ça, monsieur, voulez-vous que je vous parle franchement?? vous êtes de trop dans la maison
, Dancourt, 2e chap. Diable boit. sc. 1.Tu la gênes?; tu es ici de trop
, Boissy, Franç. à Lond. sc. 2.Par trop, à l'excès. Son style est par trop familier.
Tu m'obliges par trop avec cette nouvelle?: Va, je reconnaîtrai ce service fidèle
, Molière, l'Ét. III, 8. -
6Trop d'un, de deux, de la moitié, un, deux, moitié de trop.
Trop d'un Héraclius en mes mains est remis?; Je tiens mon ennemi, mais je n'ai plus de fils
, Corneille, Hér. IV, 4.C'est trop, me disait-il, c'est trop de la moitié, Je ne mérite pas de vous faire pitié
, Molière, Tart. I, 6.Nous sommes trois chez vous, c'est trop de deux, madame
, Hugo, Hernani, I, 3. -
7Adv. de quantité. Plus qu'il ne faut, avec excès.
C'est trop m'importuner en faveur d'un sujet
, Corneille, Nicom. III, 2.Ce secret, qui fut gardé entre dix-sept personnes, est un de ceux qui m'ont persuadé que parler trop n'est pas le défaut le plus commun des gens qui sont accoutumés aux grandes affaires
, Retz, Mém. t. II, liv. III, p. 137, dans POUGENS.Gens trop heureux font toujours quelque faute
, La Fontaine, Berceau.Il ne fallait pas faire faire cela par un écolier?; et vous n'étiez pas trop bon vous-même pour cette besogne-là
, Molière, Bourg. gentil. I, 2.Le trop riant espoir que vous leur présentez
, Molière, Mis, II, 1.Je reçois votre lettre du 16?; elle est trop aimable, et trop jolie, et trop plaisante
, Sévigné, 25 juill. 1689.Ils [les rois] ont trop fait sentir aux peuples que l'ancienne religion se pouvait changer
, Bossuet, Reine d'Angleterre.Trop faible pour expliquer avec force ce qu'il sentait, il empruntait la voix de son confesseur
, Bossuet, Louis de Bourbon.Vous le savez trop bien?: jamais, sans ses avis, Claude qu'il gouvernait n'eût adopté mon fils
, Racine, Brit. III, 3.Il [le péché] nous paraît moins hideux, parce qu'on n'est jamais trop effrayé de ce qui nous ressemble
, Massillon, Car. Pass.Je ne vous envoie jamais aucun des petits livrets peu orthodoxes qu'on imprime en Hollande et en Suisse?je n'ai été que trop calomnié
, Massillon, Lett. Richelieu, 8 nov. 1769.Terme de manége. Trop assis, se dit du cheval dont les extrémités postérieures se rapprochent trop de la ligne du centre de gravité, ou qui la devancent.
Trop ouvert, se dit lorsque les membres sont trop portés en dehors.
Trop serré, se dit lorsque les membres sont trop portés en dedans.
Pas trop, pas plus qu'il ne faut. Elle n'a pas trop dansé.
Médiocrement. Je ne m'y fierais pas trop.
M. de Vivonne est fort mal de sa blessure, M. de Marsillac pas trop bien de la sienne, et M. le Prince est quasi guéri
, Sévigné, 153.Muréna, de retour à Rome, reçut l'honneur du triomphe, qu'il n'avait pas trop mérité
, Rollin, Hist. anc. ?uv. t. x, p. 179, dans POUGENS. -
8Trop peu, pas assez. Vous en avez plus qu'il ne vous en faut, et il en a trop peu.
Trop peu d'honneur pour moi suivrait cette victoire
, Corneille, Cid, II, 2.Joignez tous vos efforts contre un espoir si doux?: Pour en venir à bout c'est trop peu que de vous?!
Corneille, Cid, v, 1.Les dieux t'ont laissé vivre assez pour ta mémoire, Trop peu pour l'univers
, Rousseau J.-B. Odes, II, 10. -
9Trop mieux, s'est dit pour beaucoup mieux.
Pardonnez-moi toutes ces redites, vous qui savez et qui possédez trop mieux tous les points que je range ici
, Saint-Simon, 300, 140.Trop mieux aimant suivre quelques dragons
, Gresset, Ver-vert.Bossuet a employé trop dans le sens archaïque de beaucoup.
Au premier avis que le hasard lui porta d'un siége important, il [Condé] traverse trop promptement tout un grand pays, et, d'une première vue, il découvre un passage assuré pour le secours?
, Bossuet, Louis de Bourbon. -
10Assez et trop longtemps, pendant un temps trop long.
Assez et trop longtemps ma lâche complaisance De vos jeux criminels a nourri l'insolence
, Boileau, Sat. IX.
PROVERBES
Trop est trop, rien de trop, tout excès est blâmable. Rien de trop est un point Dont on parle sans cesse, et qu'on n'observe point
, La Fontaine, Fabl. IX, 11.
Trop et trop peu n'est pas mesure.
À chacun le sien n'est pas trop.
Il y a deux sortes de trop, c'est-à-dire le trop et le trop peu.
Qui trop embrasse mal étreint, qui entreprend trop de choses à la fois ne réussit à rien.
REMARQUE
Trop de avec un nom au pluriel veut au pluriel le verbe dont il est sujet?: Trop de larmes ont été répandues.
HISTORIQUE
XIe s. Carles respunt?: trop avez tendre cuer
, Ch. de Rol. XXIII. Co dist li reis?: trop avez maltalant
, ib. XXIV.
XIIe s. Mais trop vient lent, dame, vostre secours
, Couci, VII. Car nus [nul] dons n'est courtois qu'on trop delaie
, ib. XVI. Certes, seigneur, dit-il, trop tost le saura-on
, Sax. XX.
XIIIe s. À tels croisés sera Diex trop soufrans, Se ne s'en venge à po de demourance
, Quesnes, Romancero, p. 97. Vertus corront et gaste par po [peu] et par trop, et si se conserve et maintient par la meenneté
, Latini, Trésor, p. 267. Vous en avez assez, et je en ai trop peu
, Berte, XXXII. Grant paour [elle] ot du vent, qui menoit trop grant bruit
, ib. XXXVI. Se li souget le conte li fesoient avoir trop grant salaire, quant li enfant seroient aagié, il aroient action de demander le trop à lor tuteur
, Beaumanoir, XVII, 8. Ha, pour Dieu, sire, lisies souvent ce livre?; car ce sont trop [très ] bones paroles
, Joinville, 260. En [on] se doit assemer [parer] en robes et en armes en tel maniere, que les preudes hommes de cest siecle ne dient que on en face trop, ne les joenes gens de cest siecle ne dient que on en face pou
, Joinville, 196.
XIVe s. Tel cas ne peut advenir fors trop [très ] peu souvent
, Oresme, Eth. 164.
XVe s. Un trop [très ] beau chemin et plain à chevaucher
, Froissart, II, III, 10. Il nous vaut trop mieux à mentir notre serment envers le duc d'Anjou que devers le roi d'Angleterre notre naturel seigneur
, Froissart, II, II, 8. Elle leur fit rendre l'estimation de leurs chevaux qu'ils voulurent laisser, si haut que chacun vouloit estimer les siens, sans dire ni trop ni peu et sans debat
, Froissart, I, I, 25. Laquelle jeune fille, pour ce que ledit Lechien mettoit trop [tardait trop] à l'espouser?
, J. de Troyes, Chron. 1465. Le vin n'est point de ces maulvais breuvaiges Qui, beus par trop, font faillir les couraiges
, Basselin, LIV. Sans nulle doubte le roy [Louis XI] en sens le passoit de trop [le duc de Bourgogne], et la fin l'a monstré par ses ?uvres
, Commines, III, 3.
XVIe s. Ilz sont en nombre trop plus dix foys que nous?: chocquerons nous sus eulx??
Rabelais, Garg. I, 43. J'ai reçu les lettres que m'avez escriptes, par lesquelles j'ay congneu que vous estes trop meilleur parent que le roy de Navarre n'est bon mary
, Marguerite de Navarre, Lett. 76. Il esclaireroit par trop la bestise des aultres [passages du livre]
, Montaigne, I, 156. Qu'il soit bien pourveu de choses, les paroles ne suyvront que trop
, Montaigne, I, 187. La regle de Rien trop, commandée par Chilon
, Montaigne, I, 202. La prudence enseigne le point du milieu, auquel consiste toute louable action entre deux vicieuses extremitez du peu et du trop
, Amyot, Préf. XI, 38. Assez et trop malgré nos a vescu Ce sang maudit par tant de fois vaincu
, Ronsard, 608. Partout, voire à estre bon et sage, il y peut avoir du trop
, Charron, Sagesse, II, 11. Assez n'y a, si trop n'y a
, Cotgrave ? Nul n'a trop pour soy De sens, d'argent, de foy
, Cotgrave ?
Wiktionnaire
Nom commun - ancien français
trop \Prononciation ?\ masculin
-
Variante de tros.
- Exemple d'utilisation manquant. (Ajouter)
Nom commun - français
trop \t?o\ masculin invariable
-
(Désuet) Excès.
- Par son trop de caquet il a ce qu'il lui faut. ? (Molière, L'École des femmes, 1662)
- Il a été victime de son trop de confiance.
Adverbe - français
trop \t?o\
- Plus qu'il ne faut ; avec excès.
- Le kébab doit être servi brûlant. Quand la bouche peut le tolérer, il est déjà trop froid. ? (Jane Dieulafoy, La Perse, la Chaldée et la Susiane: relation de voyage, Librairie Hachette, 1887, page 718)
- A 11 heures, nous devons descendre au ras de la mer ; une masse nuageuse nous barre la route ; elle est beaucoup trop élevée pour être survolée. ? (Jean Mermoz, Mes Vols, Flammarion, 1937, page 85)
- [?], j'étais venu à Tanger. Mais la ville des légations m'ayant encore parue trop européanisée, j'avais pris la résolution de venir me fixer à Casablanca. ? (Frédéric Weisgerber, Au seuil du Maroc Moderne, Institut des Hautes Études Marocaines, Rabat : Les éditions de la porte, 1947, page 12)
- Je pensai que j'avais été trop aimable ou familière avec Adam Johnson et je rédigeai un texte froid et distant: [?]. ? (Amélie Nothomb, Stupeur et tremblements, Éditions Albin Michel S.A., 1999, page 11)
- (Avec de) Un nombre ou une quantité avec excès.
- Il a trop de bon sens pour agir ainsi.
-
Si trop d'ardeur nous pousse à trop de liberté,
Ne t'en réjouis point dans ta malignité :
Nos passions du moins sont d'un ordre sublime ! ? (Leconte de Lisle, Hypatie et Cyrille, dans Poèmes antiques, 1852)
-
(Par extension) Très, extrêmement.
- Je suis trop heureux de vous voir.
- Vous êtes trop aimable.
- Toutes les autres me regardaient avec envie, en disant que j'avais trop de chance. ? (Colette Vivier, La maison des petits bonheurs, 1939, éditions Casterman Poche, page 201)
-
? Je suis trop heureuse !
? Jamais trop, Marie, jamais trop ! ai-je répondu en l'embrassant. ? (Colette Vivier, La maison des petits bonheurs, 1939, éditions Casterman Poche, page 267)
-
(Familier) Très, extrêmement.
- J'adore les frites, c'est trop bon.
-
? Je suis content? Et toi, Polyte, t'as plus mal au pied ?
? Ah ! non ! ? C'est trop bath ! ? (Léon Frapié, Le sou, dans Les contes de la maternelle, 1910, éditions Self, 1945, page 181)
Adverbe - ancien français
trop \Prononciation ?\
-
Trop, excessivement.
- cist cunseilz sereit trop hastis ? (Marie de France, Guigemar, édition de Warnke et Niemeyer (1900))
Trésor de la Langue Française informatisé
TROP, adv.
Trop au Scrabble
Le mot trop vaut 6 points au Scrabble.
Informations sur le mot trop - 4 lettres, 1 voyelles, 3 consonnes, 4 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot trop au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
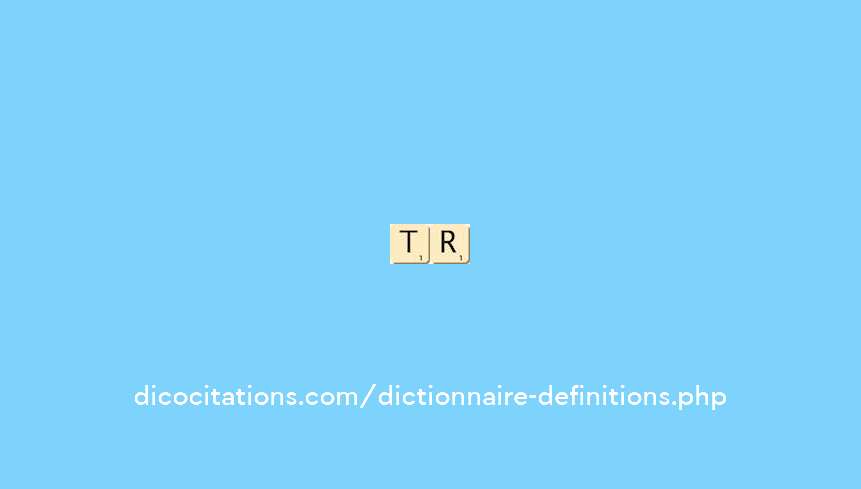
Les mots proches de Trop
Troc Trochanter Trochée Trochet Trochisque Trochoïde Trochure Troëne Trogne Trognon Trognonner Troïka Trois Troisième Trôle Trôler Trombe Trombone Trompe Trompé, ée Tromper Tromperie Trompeter Trompette Trompette Trompettiste Trompeur, euse Trompeusement Tronc Troncature Tronce ou tronche Tronchet Tronçon Tronçonné, ée Tronçonnement Tronçonner Trône Tronqué, ée Tronquement Tronquer Trop Trope Trophée Tropidogastre Tropique Tropiste Tropologie Tropologique Troquer Troqueur, euse Troarn trobriandais troc trocart trochaïque trochanter troche Troche trochée Trochères trochures trocs Trocy-en-Multien troène troènes Troësnes troglodyte troglodytes troglodytique troglodytiques trogne Trognée trognes trognon trognons Troguéry Trogues troïka troïkas trois Trois-Bassins trois-deux Trois-Domaines Trois-Fonds Trois-Fontaines-l'Abbaye trois-huit Trois-Îlets trois-mâts Trois-Monts Trois-Moutiers Trois-Palis Trois-Pierres trois-points Trois-Ponts Trois-Puits trois-quarts trois-quatre Trois-Rivières trois-six Trois-VèvresMots du jour
-
ondatra réglure fendillé tranchez écumeront méprises considérés abstiennent assouplissements dégueule
Les citations avec le mot Trop
- Un philosophe, hélas ! c'est un être qui souvent se fausse compagnie à lui-même, qui a souvent peur de soi, mais qui est trop curieux pour ne pas, chaque fois, revenir à lui-même.Auteur : Friedrich Wilhelm Nietzsche - Source : Par-delà le bien et le mal (1886)
- Toujours on sous-estime les gens qu'on aime trop, ou ceux qu'on aurait dû aimer encore bien davantageAuteur : Guy Boley - Source : Quand Dieu boxait en amateur
- Je crus pendant une seconde qu'elle était devenue folle, elle aussi. Et je hurlai de joie, semblable à un Indien qui se venge. Elle ne se troubla point. Elle était habituée à mon humeur fantasque. Elle me méprisait trop pour me craindre.Auteur : Renée Vivien - Source : La Dame à la louve (1904)
- Je suis trop vieux pour plaire aux femmes, mais je suis assez riche pour les payer.Auteur : Victor Hugo - Source : L'Homme qui rit (1869)
- Adieu, trop malheureux et trop parfait amant.Auteur : Pierre Corneille - Source : Polyeucte (1643), II, 2, Pauline
- Les grands transatlantiques lents, comme suspendus dans un temps qui ne finissait pas, furent remplacés par les latécoères jaillissants puis par les avions à réaction de plus en plus rapides et bondés : nous nous satisfaisions de nous y enfourner, pour la seule destination édénique : de la métropole.Auteur : Edouard Glissant - Source : La Case du Commandeur (1981)
- Lassé enfin d'un état si malheureux et si incertain, il résolut de tenter quelque voie d'éclaircir sa destinée. Que veux-je attendre, disait-il ? il y a longtemps que je sais que j'en suis aimé ; elle est libre, elle n'a plus de devoir à m'opposer ; pourquoi me réduire à la voir sans en être vu et sans lui parler ? Est-il possible que l'amour m'ait si absolument ôté la raison et la hardiesse, et qu'il m'ait rendu si différent de ce que j'ai été dans les autres passions de ma vie ? J'ai dû respecter la douleur de madame de Clèves ; mais je la respecte trop long-temps, et je lui donne le loisir d'éteindre l'inclination qu'elle a pour moi. Auteur : Madame de La Fayette - Source : La Princesse de Clèves (1678)
- Le Vice n'a que trop d'attraits:
Bien mieux que la Vertu sauvage,
Du vase il emmielle les bords;
Et dans le premier feu de l'âge,
Souvent nos malheurs et nos torts
Sont la faute de nos Mentors.Auteur : Pierre-Louis Ginguené - Source : Fables nouvelles (1810), Fable XXIV, Les jeunes Rats et le Chat - Contre l'inconvénient de se faire une trop haute idée d'autrui, il n'est pas meilleur antidote que d'avoir, au même moment, une excellente opinion de soi-même.Auteur : sir Walter Scott - Source : Waverley (1814)
- Il delibera d'aller combatre contre le roy de Perse pour sa propre personne, et luy mettre en compromis ses richesses et ses delices, dont il jouissoit trop à son aise en ses haults païs.Auteur : Jacques Amyot - Source : Agésilas, 23
- Dans toutes les existences, on note une date où bifurque la destinée, soit vers une catastrophe, soit vers le succès.Auteur : François de La Rochefoucauld - Source : Marie Leczinska
- Les choses étaient trop avancées pour qu'on voulût en avoir le démenti.Auteur : Jean-Jacques Rousseau - Source : Les Confessions (édition posthume 1782-1789)
- La modération est une chose fatale. «Assez» est mauvais comme un repas. «Trop» est bon comme un festin.Auteur : Oscar Wilde - Source : Sans référence
- Quelques exemples rapportés en peu de mots, et à leur place, donnent plus d'éclat, plus de poids, et plus d'autorité aux réflexions: mais trop d'exemples et trop de détails énervent toujours un discours.Auteur : Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargues - Source : Réflexions et Maximes (1746)
- Si je fume après avoir fait l'amour, c'est que je l'ai fait trop vite.Auteur : Woody Allen - Source : Sans référence
- ... plutôt ne pas en avoir, que d'avoir deux paroles dont une est de trop.Auteur : William Shakespeare - Source : Les deux gentilhommes de Vérone
- L'amour est une fleur trop délicate pour se relever quand on l'a foulée aux pieds.Auteur : George Sand - Source : Elle et Lui (1859)
- Il ne suffit pas d'avoir de l'esprit. Il faut en avoir encore assez pour s'abstenir d'en avoir trop.Auteur : André Maurois - Source : De la conversation
- Il faut bien trouver un responsable à la grippe de Phoenix déclara un jour Paul Temple. Nous sommes comme les flagellants au temps de la peste noire. Nous pratiquons l'autoflagellation. Notre société ne craint plus Dieu. Du coup, si ce n'est plus Lui qui nous châtie pour nos péchés, c'est forcément l'environnement qui nous punit en raison de nos voitures trop gourmandes en carburant.Auteur : Laura Kasischke - Source : En un monde parfait (2010)
- Au coeur de la nuit, face au mur qu'elle regardait autrefois, bousculée par le plaisir, le malheur du bas lui apparaît telle la revanche du destin sur les vies jugées trop simples. Auteur : Inès Bayard - Source : Le malheur du bas
- Lorsque ta vue veut pénétrer trop loin dans les ténèbres, il advient qu'en imaginant tu t'égares.Auteur : Dante - Source : La Divine Comédie, L'Enfer (1314), XXXI
- Vivons par toutes nos âmes, mais vivons en gens de bien, et, comme l'éphémère dans le rayon éternel, buvons le plus possible de chaleur et de lumière. En avions-nous donc trop, hélas! pour que l'on cherche à nous en ôter?Auteur : George Sand - Source : Nouvelles lettres d'un voyageur (1877)
- Le bonheur est comme la vérole: pris trop tôt, il peut gâter complètement la constitution.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Correspondance, à Louise Colet, 1853
- Le serpent se laissa doucement couler dans le sable, comme un jet d'eau qui meurt, et, sans trop se presser, se faufila entre les pierres avec un léger bruit de métal.Auteur : Antoine de Saint-Exupéry - Source : Le Petit Prince (1943)
- Aussitôt qu'un sujet s'est rendu trop puissant,
Encore qu'il soit sans crime, il n'est pas innocent :
On n'attend point alors qu'il s'ose tout permettre ;
C'est un crime d'état que d'en pouvoir commettre.Auteur : Pierre Corneille - Source : Nicomède (1651), II, 1, Araspe
Les citations du Littré sur Trop
- Car trop scet li traïstres d'agaiz et de cauteles Por les plus fors survaincreAuteur : J. DE MEUNG - Source : Test. 1825
- Peut-être un jour, s'il y a des millions d'habitants de trop en France, sera-t-il avantageux de peupler la Louisiane ; mais il est plus vraisemblable qu'il faudra l'abandonnerAuteur : Voltaire - Source : Moeurs, 151
- Une douleur au bras, que Le Dran, qui m'avait saigné, m'assura ne venir que d'une ligature trop serréeAuteur : SAINT-SIMON - Source : 130, 190
- On nous avait trop tôt mandé la prise de l'ouvrage à cornes ; il ne fut attaqué pour la première fois qu'avant-hier, encore fut-il abandonné un moment après par les grenadiers du régiment des gardes, qui s'épouvantèrent mal à propos et que leurs officiers ne purent retenir même en leur présentant l'épée nue, comme pour les percerAuteur : Jean Racine - Source : Lett. à Boileau, 3 avril 1691
- Je lui conseille de se faire tirer du sang, et lui promets de ne le lui échauffer jamais par mes façons de parler trop libresAuteur : Paul Scarron - Source : Lett. Oeuv. t. I, p. 256
- Elle a le coeur trop bas pour un si haut desseinAuteur : ROTR. - Source : Antig. IV, 4
- C'est une faute que j'ai laissée subsister trop longtempsAuteur : Voltaire - Source : Lett. au pr. roy de Prusse, 15 avr. 1739
- Car cueur, parlant soubz bouche desloyalle, N'est qu'arcenic dedans le miel logé ; Car trop desrogue à dignité royalleAuteur : J. MAROT - Source : V, 194
- Trop ai en mauvais lieu marchié ; Li dé m'ont pris et emparchié ; Je les claim quiteAuteur : RUTEB. - Source : 27
- Fille trop veue, robbe trop vestue n'est pas chere tenueAuteur : COTGRAVE - Source :
- Et vos soins trop prudents Les ont tous écartés [mes amis] ou séduits dès longtempsAuteur : Jean Racine - Source : Brit. III, 5
- Le chat court, mais trop tard, et bien loin de son compte, N'eut ni lard ni souris, n'eut que sa courte honteAuteur : LA MOTTE - Source : Fabl. IV, 8
- Il [Tertullien] s'abandonne souvent à sa vive et trop ardente imaginationAuteur : BOSSUET - Source : 6e avert. 95
- Ceulx qui se esjoissent et delettent superhabundamment et trop en melodies de vois humaines et de vois faites par instrumensAuteur : ORESME - Source : Eth. 92
- Ils [les hommes, s'ils n'avaient pas les affaires de la vie] se verraient, ils penseraient à ce qu'ils sont, d'où ils viennent, où ils vont ; et ainsi on ne peut trop les occuper et les détournerAuteur : Blaise Pascal - Source : Pens. IV, 1, éd. HAVET.
- L'amour n'est guère heureux lorsqu'il est trop timideAuteur : QUINAULT - Source : Atys, IV, 1
- Il [le chantre] saisit, en pleurant, ce rochet qu'autrefois Le prélat trop jaloux lui rogna de trois doigtsAuteur : BOILEAU - Source : Lutr. IV
- L'yeul regarde où le cueur aspire ; J'ay cecy par trop oeilladéAuteur : BASSELIN - Source : III
- Quant dedans fu [le dard], mon cueur vint esveiller Et tellement le print à catoillier Que je senty que trop rioit de joyeAuteur : CH. D'ORL. - Source : 1
- Trois années [durée moyenne qu'on a devant soi aux différents âges de la vieillesse] ne sont-elles pas une vie complète ? ne suffisent-elles pas à tous les projets d'un homme sage ? nous ne sommes donc jamais vieux, si notre moral n'est pas trop jeuneAuteur : BUFF. - Source : Suppl. à l'Hist. nat. Oeuv. t. XI, p. 144
- Protestants et premiers chrétiens étaient précisément dans les mêmes termes ; on ne peut trop le répéter ; ils étaient également innocents ou également coupablesAuteur : Voltaire - Source : Moeurs, rem. XVI
- L'inclination à la liberté, et à tant de belles fanfares qu'ils guignent de loin, que le monde leur jette en veue, ne leur fait venir que trop d'envie d'en sortir [du collége]Auteur : LANOUE - Source : 122
- Aucunes choses qui ne sont pas trop patentesAuteur : ORESME - Source : Eth. 136
- Le troisième morceau [de la Symphonie héroïque] est intitulé scherzo, suivant l'usage ; le mot italien signifie jeu, badinage ; on ne voit pas trop, au premier coup d'oeil, comment un pareil genre de musique peut figurer dans cette composition épique ; il faut l'entendre pour le concevoirAuteur : BERLIOZ - Source : ib. p. 22
- Vous méprisez trop Rome, et vous devriez faire Plus d'estime d'un roi qui vous tient lieu de pèreAuteur : Corneille - Source : Nicom. III, 1
Les mots débutant par Tro Les mots débutant par Tr
Une suggestion ou précision pour la définition de Trop ? -
Mise à jour le vendredi 6 février 2026 à 22h49
- Tabac - Tact - Talent - Tao - Tasse - Telephone - Telephone portable - Television - Temeraire - Temps - Tendresse - Tension - Tentation - Terre - Terrorisme - Theatre - Theme - Theologien - Therapie - Timidite - Timidité - Tissus - Titanic - Toilette - Tolerance - Tombe - Torture - Tourisme - Touriste - Tout l'amour - Tradition - Traduction - Trahison - Train - Traite - Transcendance - Transparence - Transport - Travail - Travailler - Trésor - Tricher - Triste - Tristesse - Tristesse - Tromper - Tuer - Tutoyer - Tyrannie
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur trop
Poèmes trop
Proverbes trop
La définition du mot Trop est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Trop sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Trop présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
