La définition de Chapiteau du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Chapiteau
Nature : s. m.
Prononciation : cha-pi-tô
Etymologie : Picard, capiteau ; provenç. et espagn. capitel ; ital. capitello ; du latin capitellum, diminutif de caput, tête (voy. ).
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de chapiteau de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec chapiteau pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Chapiteau ?
La définition de Chapiteau
Terme d'architecture. La partie du haut de la colonne qui pose sur le fût.
Toutes les définitions de « chapiteau »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
T. d'Architecture. Partie du haut de la colonne sur laquelle est posée la frise et qui repose sur le fût. Chapiteau corinthien. Chapiteau ionique. Il se dit, dans un sens plus général, de Quelques autres ornements d'architecture qui forment la partie supérieure, le couronnement de certaines choses. Chapiteau de pilastre. Chapiteau de balustre. Chapiteau de couronnement. Chapiteau de niche, etc. Par extension, il se dit des Corniches et autres couronnements qui se posent au-dessus des buffets, des armoires et d'autres ouvrages; de la Partie supérieure d'un alambic, dans laquelle se condensent les vapeurs qui s'élèvent de la cucurbite; d'un Morceau de carton en forme d'entonnoir, qui se met vers le haut d'une torche, pour recevoir ce qui en dégoutte de cire ou de poix; d'un Cornet placé au sommet d'une fusée volante, etc.
Littré
-
1 Terme d'architecture. La partie du haut de la colonne qui pose sur le fût.
Il faut que l'épaisseur de tout le chapiteau [de l'ordre ionique] soit partagée en sorte que, de neuf parties et demie qu'elle contient, la volute pende de la largeur de trois au-dessous de l'astragale du haut de la colonne, tout le reste étant employé à l'ove, au tailloir qui est mis dessus, et au canal
, Perrault, Vitruve, III, 3.Les proportions du chapiteau corinthien doivent être ainsi prises?: il faut que le chapiteau avec le tailloir ait autant de hauteur que le bas de la colonne a d'épaisseur?; que la largeur du tailloir soit telle que la diagonale qui est depuis un de ses angles jusqu'à l'autre ait deux fois la hauteur du chapiteau?; car de là on prendra la juste mesure des quatre côtés du tailloir?; la courbure de ces côtés en dedans sera de la neuvième partie du côté à prendre de l'extrémité d'un des angles à l'autre?; le bas du chapiteau sera de même largeur que le haut de la colonne, sans le congé et l'astragale
, Perrault, ib. IV, 1.Le diamètre des colonnes [doriques] doit être de deux modules?; la hauteur, compris le chapiteau, de quatorze?; la hauteur du chapiteau, d'un module?; la largeur, de deux modules et de la moitié d'un module?; le chapiteau doit être divisé selon sa hauteur en trois parties, dont l'une est pour le plinthe avec la cimaise, l'autre pour le quart de rond avec les annelets, la troisième pour la gorge du chapiteau
, Perrault, ib.En général, ornement de diverse forme qui surmonte et couronne certaines parties.
En menuiserie, corniches et autres couronnements des buffets, armoires, etc.
- 2La couverture mobile d'un moulin à vent.
- 3La partie supérieure de l'alambic où viennent se condenser les vapeurs. Chapiteau à bec. Chapiteau aveugle, sans bec.
-
4Le carton roulé en entonnoir qu'on met au haut d'une torche pour recevoir la cire ou la poix qui coule.
Terme d'artificier. Cornet placé au sommet d'une fusée volante.
Terme de botanique. Certaines parties des fleurs et des fruits.
Le dessus d'une presse à estampes.
-
5Petit couvercle fait de deux ais joints en angle dièdre, que l'on place sur la lumière d'un canon.
Couronnement du corps du fourreau de certaines armes blanches.
HISTORIQUE
XVe s. Et ces dorures Sur chapiteaux et pommeaux à pointures [peintures] D'or et d'azur?
, Christine de Pisan, Dit de Poissy.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
CHAPITEAU. - HIST. Ajoutez?: XIIe s. N'i ot bretesche ne danjont, Ne tors de marbre granz et lées, Forz, espesses, et bien ovrées, Tot de gros marbre à or listé?; Ne sé home de mere né Qui en ostast un des quarrials, Ne le menor des capitials
, Benoit de Sainte-Maure, Roman de Troie, V. 7648.
Encyclopédie, 1re édition
CHAPITEAU, s. m. terme d'Architecture, du Latin capitellum, est le sommet de quelque chose que ce soit. Il en est de cinq especes comme des colonnes, quoiqu'on en puisse composer à l'infini, selon la diversité des occasions qu'on a d'employer le talent de l'Architecte dans les pompes funebres, dans les fêtes publiques, & dans les décorations théatrales. Mais sans nous arrêter à ces dernieres, dont la composition par leurs différens symboles semble appartenir plûtôt à la Sculpture qu'à l'Architecture, nous traiterons en particulier des chapiteaux toscan, dorique, ionique, corinthien, & composite selon les Grecs, comme ceux qui ont été imités le plus universellement par les plus excellens Architectes, après avoir observé en général que le chapiteau est une des trois parties essentielles de la colonne (Voyez Colonne), & qu'il sert ordinairement à porter l'entablement. Voyez Entablement.
Le chapiteau toscan est composé de trois parties principales, non compris l'astragale ; savoir, le gorgerin, la cimaise, & le tailloir. Voyez ces mots. Toutes ses parties sont circulaires, à l'exception du tailloir qui est quarré, & peu chargées de moulures, à cause de la rusticité de l'ordre. Voyez Ordre.
Le chapiteau dorique est semblable au toscan, à l'exception de quelques moulures que le fust de la colonne moins rustique semble exiger : il a de hauteur, ainsi que le précédent, un module non compris l'astragale.
Le chapiteau ionique se fait de trois manieres : la premiere qu'on nomme antique, dont la forme principale consiste dans un tailloir quadrangulaire, au-dessous duquel sont deux volutes (Voyez Volute), entre lesquelles regne un membre d'Architecture nommé échigne ou quart de rond. Voyez Échigne. Ce chapiteau qui a été imité par les plus célebres Architectes François, au château de Maisons, aux Tuilleries, & dernierement à la fontaine de Grenelle, ne laisse pas cependant d'apporter quelques défauts de symmétrie lorsqu'il est vû sur l'angle, ses côtés étant dissemblables, c'est-à-dire le retour de ses faces étant orné d'un coussinet (Voyez Coussinet) ou balustre ; considération qui a porté nos Architectes François à imaginer le second chapiteau ionique nommé moderne, qui differe du précédent en ce que chacune de ses quatre faces sont ornées de deux volutes autorisées par les concavités de son tailloir, semblable en cela aux chapiteaux corinthien & composite.
Le troisieme chapiteau ionique differe des précédens en ce que, au-dessous des volutes, plusieurs Architectes, à l'imitation de Michel Ange, ont ajoûté une astragale (voyez Astragale) qui en donnant plus de hauteur à ce chapiteau, racourcit le fust de la colonne & la rend plus propre, quoique d'un genre moyen, à faire partie de la décoration d'un monument, où un ordre viril seroit hors de convenance, & où cependant un ordre ionique régulier ne pourroit convenir.
Le chapiteau corinthien est composé de deux rangs de feuilles, distribuées au nombre de seize autour de son tambour (voyez Tambour), & de seize volutes ou hélices, dont huit angulaires portent les carnes du tailloir, & les huit autres le bourrelet du tambour. Ces volutes ou hélices prennent naissance dans des culots soûtenus par des tigettes, Voy. Culots & Tigettes. Ce chapiteau, selon Vitruve, ne doit avoir que deux modules de hauteur. Voyez Module. Mais les Architectes modernes ayant reconnu que ce chapiteau réduit à deux modules, devenoit trop écrasé, lui ont donné deux modules un tiers : mais comme ce chapiteau pris aux dépens de la hauteur du fust le raccourcit considérablement, plusieurs d'entr'eux, tel que Perraut, ont donné à leur colonne corinthienne vingt-un modules de hauteur au lieu de vingt, ainsi qu'on peut le remarquer au peristil du Louvre. Ordinairement l'on met au chapiteau corinthien des feuilles d'olive, quelquefois l'on y préfere celles d'acanthe ou de persil ; mais comme ces dernieres sont d'un travail plus recherché, il n'en faut faire usage que lorsque le fust des colonnes est orné de cannelures à doubles listeaux, & enrichi de rudentures, d'ornemens, &c.
Vitruve donne à Callimachus, Sculpteur Grec, l'invention de ce chapiteau ; Villapande au contraire prétend qu'il avoit été exécuté bien avant Callimachus, au temple de Salomon. La seule différence qu'il nous rapporte, c'est que les feuilles étoient de palmier ; de sorte qu'il se pourroit bien que ces deux auteurs ayent raison, c'est-à-dine que le chapiteau corinthien ait pris son origine au temple de Salomon, & que Callimachus soit celui qui l'ait perfectionné : ce qui est certain, c'est que ce dernier a été si universellement approuvé, qu'aucun de nos Architectes de réputation n'a crû devoir lui apporter aucune altération, si ce n'est dans sa hauteur, ainsi que nous venons de l'observer. Voyez ce que Vitruve dit au sujet du chapiteau corinthien de Callimachus.
Le chapiteau composite a été inventé par les Romains d'après l'imitation des chapiteaux ionique & corinthien ; c'est-à-dire que les deux rangs de feuilles sont distribués autour de son tambour au nombre de seize, comme au précédent, & que son extrémité supérieure est terminée par les volutes & le tailloir du chapiteau ionique moderne, ce qui rend en général ce chapiteau moins leger que le corinthien ; aussi l'ordre composite ne devroit-il jamais être placé sur le corinthien, contre le système néanmoins & l'opinion de la plûpart de nos Architectes François. Ce chapiteau composite est suivi avec moins de sévérité dans l'Architecture que le corinthien, & est quelquefois susceptible d'attributs ou d'allégories relatives aux usages des bâtimens où il est employé : cependant il ne le faut pas confondre avec le chapiteau composé, ce dernier devenant arbitraire, pourvû toutefois qu'on ne tombe pas dans l'abus que la plûpart des Architectes Romains en ont fait, & singulierement les Architectes gothiques, qui non contens d'en avoir altéré les proportions, l'ont enrichi d'ornemens chimériques, peu convenables à l'Architecture réguliere & susceptible d'imitation.
Les cinq chapiteaux dont nous venons de parler ; sont également applicables aux colonnes comme aux pilastres, ne différant que dans la forme de leur plan. Voyez Pilastre ; voyez aussi les cinq desseins de ces chapiteaux dans les Planches d'Architecture. (P)
Chapiteau ; on appelle ainsi, dans l'Artillerie, deux petites planches de huit ou dix pouces de longueur sur cinq ou six de largeur, qui forment ensemble une espece de petit comble ou de dos d'âne ; on s'en sert pour couvrir la lumiere des pieces, & empêcher que le vent n'emporte l'amorce, ou qu'elle ne soit mouillée par la pluie. Voyez la figure du chapiteau, Pl. VI. de Fortification, fig. 6. (Q)
Chapiteau d'artifice, c'est une espece de cornet ou de couvercle conique, qu'on met sur le pot au sommet d'une fusée volante, non-seulement pour le couvrir, mais aussi pour percer plus aisément l'air en s'élevant en pointe.
Chapiteau, (Chimie.) le chapiteau est la piece supérieure de l'alembic des Chimistes modernes, qui est composé d'une cucurbite (Voyez Cucurbite) & de son chapiteau. Ce dernier instrument est un vaisseau le plus ordinairement de verre ou d'étain, dont la meilleure forme est la conique, ouvert par sa base & muni intérieurement d'une gouttiere circulaire, tournée vers le sommet du cone environ un ou deux pouces, selon la grandeur du vaisseau, au-dessus de la base du chapiteau. La gouttiere du chapiteau est le plus ordinairement continuée par un tuyau qui perce la paroi de ce vaisseau, & qui est destiné à verser au-dehors une liqueur ramassée dans cette gouttiere.
Le chapiteau pourvû de ce tuyau nommé bec du chapiteau, sert aux distillations proprement dites, ou distillations humides. Voyez Distillation.
Le chapiteau qui n'a point de bec, ou dont le bec est scellé hermétiquement, ou seulement exactement bouché, s'appelle chapiteau aveugle ou borgne ; celui-ci est employé dans les sublimations ou distillations seches. Voyez Sublimation.
Les Chimistes se servent dans plusieurs cas d'un chapiteau d'étain, enfermé dans un vaisseau destiné à contenir une masse considérable d'eau froide, par l'application de laquelle ils cherchent à rafraîchir ce chapiteau. Voyez Réfrigérent & Distillation.
On a long-tems employé le cuivre étamé à la construction de ces chapiteaux à réfrigérent, mais on ne les fait plus que de l'étain le plus pur, parce qu'on s'est apperçu que plusieurs des matieres qui s'élevoient dans les distillations faites dans cet appareil, se chargeoient de quelques particules de cuivre ; ce qui ne nuisoit pas moins à l'élégance de ces produits, qu'à leur salubrité. Voyez Cuivre.
Le chapiteau de verre muni d'un réfrigérent, est un vaisseau de pur apparat : le meilleur verre ne tient pas long-tems aux fréquentes alternatives de caléfaction & de refroidissement qu'il doit essuyer dans ce genre de distillation, où on employe le chapiteau à réfrigérent.
La tête de more est une espece de chapiteau presque rond & le plus souvent sans gouttiere, muni d'un bec à sa partie latérale, ou quelquefois même à son sommet. Ce vaisseau qui a le défaut essentiel de laisser retomber la plus grande partie des vapeurs qui se sont condensées contre sa voûte, n'est plus en usage que chez les distillateurs d'eau-de-vie : mais comme ces ouvriers ne rafraîchissent pas leur chapiteau, & que cette liqueur passe presque entierement sous la forme d'un torrent de vapeurs qui enfile le bec de la tête de more sans se condenser contre ses parois, dès qu'une fois elles sont échauffées, le manque de gouttiere n'est presque d'aucune importance dans cette opération.
La distillation à l'alembic recouvert d'un chapiteau sans gouttiere, répond exactement à la distillation par la cornue. Voyez Cornue. (b)
Chapiteau, (Papet.) couvercle de cylindres, du moulin à papier à cylindres. Voyez-en la description & l'usage à l'art. Moulin à papier à Cylindres, & la fig. Pl. II. de Papeterie.
Wiktionnaire
Nom commun - français
chapiteau \?a.pi.to\ masculin
-
(Architecture) Partie du haut de la colonne, sur laquelle est posée la frise, et qui repose sur le fût.
- Chapiteau corinthien. Chapiteau ionique.
- En face, sur le chapiteau d'un pilier, trois moines trapus, dodus et pansus, semble s'attrister du badigeon beurre frais qu'on leur a infligé. ? (Gustave Flaubert et Maxime Du Camp, Par les champs et les grèves (Voyage en Bretagne), 1886, Le Livre de poche, page 141, 2012)
- Quelques autres ornements d'architecture qui forment la partie supérieure, le couronnement de certaines choses.
- Chapiteau de pilastre. Chapiteau de balustre. Chapiteau de couronnement. Chapiteau de niche, etc.
- (Par extension) Corniches et autres couronnements qui se posent au-dessus des buffets, des armoires et d'autres ouvrages.
- (Par extension) Partie supérieure d'un alambic, dans laquelle se condensent les vapeurs qui s'élèvent de la cucurbite.
- (Par extension) Morceau de carton en forme d'entonnoir, qui se met vers le haut d'une torche, pour recevoir ce qui en dégoutte de cire ou de poix.
- (Par extension) (Histoire, Militaire) Deux ais joints qui couvrent la lumière d'un canon.
- (Par extension) (Alchimie) Vaisseau sur la cucurbite.
- (Par extension) Cornet placé au sommet d'une fusée volante.
-
Grande tente destinée à accueillir les spectacles, principalement ceux du cirque.
- Note : Il se compose, en général, de mâts, poteaux de tour, d'une grande toile confectionnée spécialement avec, éventuellement, des mâts intermédiaires appelés corniches. Cette architecture est maintenue par des pinces (de grands pieux en acier), plantées autour et amarrées par des sangles.
- Elle repense à ce comédien qui, pendant qu'elle ajustait son costume, lui contait avec force détails l'accouplement zoophilique auquel il avait assisté sous un chapiteau en compagnie d'une trentaine d'autres gringos. ? (Serge Brussolo, Cheval rouge, Le Masque, 2017, chap. 28)
- Quand les catcheuses regagnèrent les vestiaires, les spectateurs se retirèrent lentement du chapiteau. Les commentaires fusèrent. ? (Daniel Crozes, Un été d'herbes sèches, Éditions du Rouergue, 2016)
-
(En particulier) (Cirque) Tente de cirque.
- Peu d'années après sa création, le cirque fermé et couvert trouva le moyen de devenir nomade. La tente de toile ou « chapiteau » soutenue par un mât central, les gradins démontables, une enceinte formée de matériaux légers, ont permis au cirque de transporter son spectacle de ville en ville. ? (Gustave Fréjaville, « Cirques fixes et cirques voyageurs », dans Encyclopédie française, Tome XVI : Arts et littératures dans la société contemporaine, Paris, 1935, pages 16.76-16)
- Ils ont les mêmes grands mâts ? on définit un chapiteau comme un bateau par leur nombre ? et les mêmes mâts annexes, de charge ou de corniche. ? (Louis Merlin, C'était formidable !, Mémoires, Tome II, Julliard, Paris, 1966, chap. XI « Radio-Circus », p. 227)
- Les monteurs eux-mêmes se répartissaient en plusieurs groupes. Un des plus importants érigeait les mâts, plantait les pinces, tendait les haubans, fixait les corniches, bref hissait le chapiteau. ? (Achille Zavatta, Viva Zavatta, coll. "Vécu", Robert Laffont, Paris, 1976, chap. 8 « Le spectacle continue ! », p. 84)
- En contrebas, derrière les arbres,on distinguait la toile à rayures blanches et bleues d'un cirque. Des baltringues en maillots de corps, après avoir monté les chapiteaux, étaient venus se désensoiffer. ? (Jean-Michel Morel , Le prix du pardon, éd. Stock, 2006)
Trésor de la Langue Française informatisé
CHAPITEAU, subst. masc.
Chapiteau au Scrabble
Le mot chapiteau vaut 16 points au Scrabble.
Informations sur le mot chapiteau - 9 lettres, 5 voyelles, 4 consonnes, 8 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot chapiteau au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
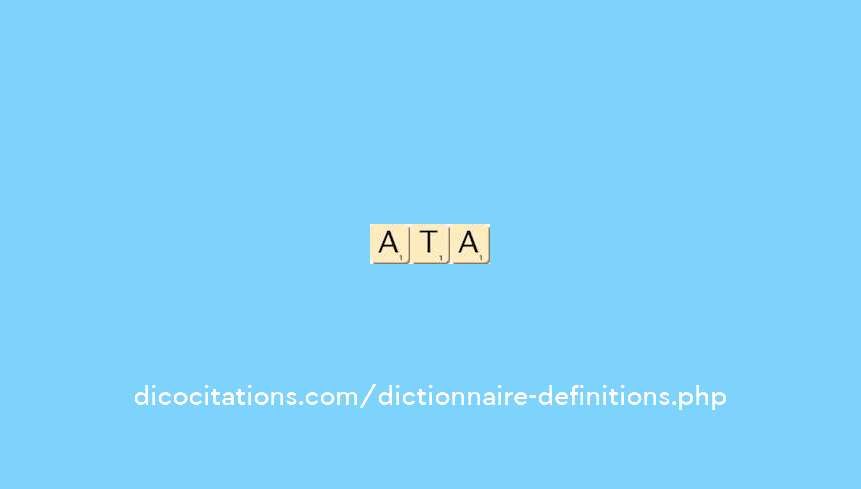
Les mots proches de Chapiteau
Chabichou Chablage Chableur Chablis Chabot Chabrol et chabrot Chacal Chaconne Chacun, chacune Chacunière Chafaud Chagrin Chagrin Chagrin, ine Chagrinant, ante Chagrinement Chagriner Chaillant Chaille Chailleux, euse Chaillot ou chaillou Chaîne Chaînette Chaînier ou chaîniste Chaînon Chaintre Chair Chair Chaire Chaise Chalaine Chaland, ande Chaland ou chalan Chalandise Chalcide Chalcidique Chaldaïque Chaldéen, enne Châle Chalet Chaleur Chaleureusement Chaleureux, euse Chalinoptère Châlit Chaloir Chalon Chalosse Chalot Chaloupe cha-cha-cha chabanais Chabanais Chabanne Chabestan Chabeuil chabichou chabler chablis Chablis chaboisseaux Châbons chabot chabots Chabottes Chabottonnes Chabournay Chabrac chabraque Chabreloche Chabrignac Chabrillan Chabris chabrot chacal chacals Chacé Chacenay chachlik chaconne Chacrise chacun chacune Chadeleuf Chadenac Chadenet Chadrac Chadron Chadurie chafaud chafauds Chaffal Chaffaut-Saint-Jurson Chaffois chafouin chafouin chafouine chafouins chafouins chagatteMots du jour
Fou Enfariner Bitumineux, euse Moucher Encens Simplesse Harmoniquement Courante Rééligibilité Nigaudement
Les citations avec le mot Chapiteau
- Dans le marbre blanc, veiné de gris, les motifs du bestiaire persan importés par les Arabes multiplient sur les chapiteaux et les portails les lions, les griffons, les bouquetins, les sirènes.Auteur : Jacques Laurent - Source : Les Bêtises (1971)
- Alain Madelin a annoncé sa candidature sous un petit chapiteau du Bois de Boulogne. - Quand on pense qu'on l'a connu à Bercy, ça prouve que c'est pas un job sûr, le métier des spectacles!Auteur : Laurent Ruquier - Source : Vu à la radio (2001)
- Dans la salle capitulaire de la cathédrale on peut regarder de tout près les chapiteaux qui en proviennent.Auteur : Simone de Beauvoir - Source : Tout compte fait (1972)
- Regardez cette colonnette. Autour de quel chapiteau avez-vous vu feuilles plus tendres et mieux caressées du ciseau?Auteur : Victor Hugo - Source : Notre-Dame de Paris (1831)
- Défigurement bizarre et triste, qui faisait conjecturer la fantastique juxtaposition d'une moitié de vieux visage à la cassure inférieure de quelque sublime chapiteau humain.Auteur : Léon Bloy - Source : Le Désespéré (1887)
Les citations du Littré sur Chapiteau
- Le diamètre des colonnes [doriques] doit être de deux modules ; la hauteur, compris le chapiteau, de quatorze ; la hauteur du chapiteau, d'un module ; la largeur, de deux modules et de la moitié d'un module ; le chapiteau doit être divisé selon sa hauteur en trois parties, dont l'une est pour le plinthe avec la cimaise, l'autre pour le quart de rond avec les annelets, la troisième pour la gorge du chapiteauAuteur : PERRAULT - Source : ib.
- Ceste sepulture est en figure carrée ; au lieu de colonnes ce sont les vertus approchantes à la moyenne proportion du colosse ; elles soutiennent le vase et taillouer du chapiteau dessus leurs testesAuteur : R. BELLEAU - Source : Bergeries, t. I, p. 20, dans LACURNE
- Il faut que l'épaisseur de tout le chapiteau [de l'ordre ionique] soit partagée en sorte que, de neuf parties et demie qu'elle contient, la volute pende de la largeur de trois au-dessous de l'astragale du haut de la colonne, tout le reste étant employé à l'ove, au tailloir qui est mis dessus, et au canalAuteur : PERRAULT - Source : Vitruve, III, 3
- Quoique le panier avec l'acanthe n'eussent aucun rapport avec le chapiteau d'une colonne et avec un bâtiment massif, il en imita la manière dans les colonnes qu'il fit depuis à Corinthe, établissant et réglant sur ce modèle les proportions et les ornements de l'ordre corinthienAuteur : ROLLIN - Source : Hist. anc. Oeuvres, t. XI, 1re part. p. 20, dans POUGENS.
- Deux vaisseaux qu'on nomme en un mot alembic : l'un d'iceux est appelé proprement cucurbite ou vaisseau contenant : l'autre est dit chapiteau ou chape, auquel sont amassées les vapeurs converties en eau, pour ce qu'il represente quelque certaine forme et figure de chef ou de testeAuteur : PARÉ - Source : XXVI, 5
- Que la vigne en rampant gagne ces colonnades, Monte à ces chapiteaux et pende à ces arcadesAuteur : DELILLE. - Source : Hom. des ch. Var. et add. ch. IV
- L'emploi de métal [dans les chapiteaux égyptiens] explique seul la sveltesse des colonnes et la longueur exagérée donnée aux architravesAuteur : MASPERO - Source : Rev. crit. 9 déc 1876, p. 375
- Les lignes du chapiteau de la cannelure des colonnes du Parthénon sont si déliées, qu'on serait tenté de croire que la colonne entière a passé au tourAuteur : Chateaubriand - Source : Itin. part. 1
- Pour distiller toutes sortes d'eaux, deux vaisseaux sont principalement necessaires, qu'on nomme en un mot alembic : l'un d'iceux est appelé proprement cucurbite ou vaisseau contenant ; l'autre est dit chapiteau ou chape, auquel sont amassées les vapeursAuteur : PARÉ - Source : XXVI, 5
- Chacun d'eux [végétaux] a sa grâce et son utilité ; Volutes, chapiteaux, fuseaux, navette, aiguilles, Quelles formes n'ont pas leurs nombreuses familles ! Partout le grand artiste a varié son planAuteur : DELILLE - Source : Trois règnes, VII
- Ornement composé de branches et de fruits, ou de feuilles d'acanthe disposées par enroulement, C'est du milieu de chaque colonne que prenait naissance le rinceau d'acanthe qui s'étendait jusqu'au chapiteauAuteur : QUATREMÈRE DE QUINCY - Source : Instit. Mém. hist. et litt. anc. t. IV, p. 361
- Les proportions du chapiteau corinthien doivent être ainsi prises : il faut que le chapiteau avec le tailloir ait autant de hauteur que le bas de la colonne a d'épaisseur ; que la largeur du tailloir soit telle que la diagonale qui est depuis un de ses angles jusqu'à l'autre ait deux fois la hauteur du chapiteau ; car de là on prendra la juste mesure des quatre côtés du tailloir ; la courbure de ces côtés en dedans sera de la neuvième partie du côté à prendre de l'extrémité d'un des angles à l'autre ; le bas du chapiteau sera de même largeur que le haut de la colonne, sans le congé et l'astragaleAuteur : PERRAULT - Source : ib. IV, 1
- Branche-ursine, en latin acanthus ; des anciens architectes est venue la coustume d'entailler les feuilles de branche-ursine es chapiteaux des colonnes corinthiennes, pour laquelle cause a esté communement appellée par les Romains marmolariaAuteur : O. DE SERRES - Source : 624
- Comme ils ne savaient pas bien quelle proportion il fallait donner aux colonnes qu'ils voulaient mettre à ce temple, ils cherchèrent le moyen de les faire assez fortes pour soutenir le faix de l'édifice et de les rendre agréables à la vue ; pour cela, ils prirent la mesure du pied d'un homme, qui est la sixième partie de sa hauteur, sur laquelle mesure ils fournirent leur colonne, en sorte qu'à proportion de cette mesure qu'ils donnèrent à la grosseur de la tige de la colonne, ils la firent six fois aussi haute en comprenant le chapiteau ; et ainsi la colonne dorique fut premièrement mise dans les édifices, ayant la proportion, la force et la beauté du corps de l'hommeAuteur : PERRAULT - Source : ib.
- Forme génératrice du chapiteau autour de laquelle se groupent les ornementsAuteur : VIOLLET-LE-DUC - Source :
- À chapiteaux d'albastre et frizes de crystalAuteur : DU BELLAY - Source : VI, 61, recto
- Au dessus des testes des chapiteaux des colonnes, il y aura un architrave, frise et corniche, qui regnera autour du dit cabinetAuteur : PALISSY - Source : 59
- Les frises, les festons, les corniches et les chapiteaux sont d'or, et portent pour finissement des vases de porcelaine, d'où sortent de gros bouquets de fleursAuteur : Corneille - Source : Toison d'or, décoration du 3e acte
- Et ces dorures Sur chapiteaux et pommeaux à pointures [peintures] D'or et d'azur....Auteur : CHRIST. DE PISAN - Source : Dit de Poissy.
Les mots débutant par Cha Les mots débutant par Ch
Une suggestion ou précision pour la définition de Chapiteau ? -
Mise à jour le dimanche 8 février 2026 à 02h35
Dictionnaire des citations en C +
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur chapiteau
Poèmes chapiteau
Proverbes chapiteau
La définition du mot Chapiteau est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Chapiteau sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Chapiteau présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
