La définition de Dame du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Dame
Nature : s. f.
Prononciation : da-m'
Etymologie : Bourguig. daime ; provenç. dama, et plus habituellement dompna, domna, dona et par abréviation na, et encore dons ; espagn. doña et dueña ; ital donna ; du latin domina. Le changement de l'o en a n'est pas très rare dans l'ancien français : en pour on, dam pour dom, etc. On trouve quelquefois dome : XIIIe s.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de dame de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec dame pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Dame ?
La définition de Dame
Titre qu'on donnait à la femme d'un seigneur, d'un châtelain, d'un chevalier, d'un gentilhomme, par opposition aux femmes mariées de la bourgeoisie qui ont porté pendant longtemps le nom de demoiselles.
Toutes les définitions de « dame »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Celle qui possédait une seigneurie avec autorité et commandement sur des vassaux. Haute et puissante dame. Notre-Dame, Nom donné par les chrétiens à la Sainte Vierge. On le donne par ellipse aux églises et aux fêtes qui lui sont consacrées. Notre-Dame de Paris. La Notre-Dame d'août. Il est aussi un Simple titre que l'on donnait par honneur aux femmes de qualité. Les dames de la cour. On dit ironiquement Elle fait la dame, elle fait la grande dame. Dame d'honneur, dame d'atour, dame du palais, Femmes de qualité qui remplissaient diverses fonctions auprès des reines ou des princesses Les dames de France, Les filles du roi. Voyez MADAME. Dame de compagnie. Voyez COMPAGNIE. C'était pareillement un Titre donné aux religieuses des abbayes et de certaines autres communautés, ainsi qu'aux chanoinesses. Les dames de Fontevrault. Les dames de Poissy. Les dames de Remiremont. On dit encore Les dames du Sacré-Cœur. Dames du chœur, Religieuses qui siègent dans les hautes stalles du chœur, à la différence des novices, qui sont dans les stalles basses, et des sœurs converses qui n'ont été reçues que pour le service de la maison. Dames de charité, se dit des Dames qui, dans l'étendue d'une paroisse, forment une association chargée de recueillir et de distribuer les aumônes. Il est également le Titre qu'on donne à toutes les femmes mariées. Une jeune dame. C'est une fort aimable dame. En termes de Procédure, La dame une telle. La dame veuve une telle. Ladite dame s'engage, etc. Il se prend aussi dans un sens plus général et s'étend à Toutes les femmes et à toutes les filles. Être aimé des dames. Plaire aux dames. Les dames de la ville. Il désignait particulièrement, dans le langage de la Chevalerie, la Femme à laquelle un chevalier consacrait ses soins et ses exploits. Il a rompu des lances pour sa dame. La dame de ses pensées. Porter une écharpe aux couleurs de sa dame. Les dames de la halle, Les marchandes de la halle, qui étaient admises sous ce titre chez le roi et chez les princes à certaines époques et à l'occasion de certains événements. En termes de Botanique, Dame d'onze heures, Plante liliacée à fleurs blanches qui ont l'extérieur des pétales vert. Il se dit figurément, en termes de jeu de Cartes, de Chacune des quatre cartes sur lesquelles est peinte la figure d'une dame. La dame de pique. La dame de cœur. La dame de trèfle. La dame de carreau. Avoir une tierce, une quatrième, une quinte à la dame. Il désigne, en termes de jeu d'Échecs, la Pièce du jeu la plus considérable après le roi. Dame blanche. Dame noire. On l'appelle aussi Reine. Il se dit aussi de Chacune des pièces rondes et plates avec lesquelles on joue sur un échiquier au jeu appelé, du nom de ces pièces, Jeu de dames, ou simplement Les dames. Jouer aux dames. Faire une partie de dames. Il se dit également des Pièces de même figure, mais ordinairement plus grandes, dont on se sert au jeu de Trictrac et à quelques autres jeux analogues. Poser une dame sur une flèche. Lever une dame. Battre une dame. Aller à dame, Pousser une pièce jusqu'aux dernières cases du côté de celui contre qui on joue, ce qui donne à cette pièce une marche particulière et plus avantageuse. En termes de Canotage, il se dit du Support de l'aviron, et, en termes de Ponts et Chaussées, de la Sorte de hie à deux anses qui sert au paveur à battre le sol ou à enfoncer les pavés. Dans ces deux acceptions, on dit aussi DEMOISELLE.
Littré
-
1Titre qu'on donnait à la femme d'un seigneur, d'un châtelain, d'un chevalier, d'un gentilhomme, par opposition aux femmes mariées de la bourgeoisie qui ont porté pendant longtemps le nom de demoiselles.
Fig.
Le hibou fut trop heureux de se cacher dans son trou et d'épouser la chouette qui fut une digne dame du lieu
, Fénelon, t. XIX, p. 45.Titre qu'on donnait à la femme qui possédait une seigneurie.
Celle qui a la seigneurie, l'autorité.
Surtout soyez de vous la maîtresse et la dame
, Régnier, Sat. XII.Brevet de dame, brevet par lequel le roi conférait à une fille de qualité, non mariée, le titre de dame.
Notre-Dame, nom donné par les chrétiens à la sainte Vierge.
-
2La femme noble à laquelle un chevalier consacrait ses soins. Combattre, mourir pour sa dame. La dame de ses pensées.
Ces hommes qui prêtaient foi et hommage à leur Dieu, leur dame et leur roi
, Chateaubriand, Génie, I, II, 2.Ah?! si ma dame me voyait, disait Fleuranges en montant le premier à l'assaut
, Saint-Foix, Ess. Paris, ?uvres, t. IV, p. 173, dans POUGENS.La femme à qui l'on rend d'assidus hommages. Être dévoué, fidèle à sa dame.
Quand on aime une dame sans égalité de condition?
, Pascal, Amour. -
3Aujourd'hui, titre donné à toute femme mariée qui n'est pas de la dernière classe. C'est une dame fort estimable.
Devenir dame, se marier.
-
4 Par civilité et politesse, dame se dit de toutes les femmes, qu'elles soient mariées ou non. Être poli avec les dames. Dans ce bal, les toilettes des dames étaient fort élégantes.
Rien ne pèse tant qu'un secret?; Le porter loin est difficile aux dames?; Et je sais même sur ce fait Bon nombre d'hommes qui sont femmes
, La Fontaine, Fabl. VIII, 6.Grande dame, dame appartenant à la haute société. C'est une grande dame. Faire la grande dame, affecter un luxe et des airs au-dessus de sa condition.
Dame galante, femme d'une conduite légère.
En courant la bague, en jouant à la paume, on disait que la première course, le premier coup étaient pour les dames, c'est-à-dire pour faire honneur aux dames, sans que le coup fût compté pour la course du prix ou pour le gain de la partie. Cela s'appelait à la paume Les dames, et à la dague La course pour les dames.
Ce mot s'est employé souvent quand on parle des femmes de l'antiquité. Les dames carthaginoises coupèrent leurs cheveux en une nécessité publique pour faire des cordages aux navires.
Répondez-moi, seigneur, comme dame romaine
, Corneille, Sertor. II, 2.? Qu'on l'honore ici, mais en dame romaine, C'est-à-dire un peu plus qu'on n'honore la reine
, Corneille, Pomp. III, 4.Étant fille de Scipion l'Africain et veuve de Tibérius Gracchus, qui avait été deux fois consul et censeur, elle rejeta ses offres, et crut qu'il était plus honorable pour elle d'être une des premières dames de Rome, que d'être reine de Libye avec Phycon
, Rollin, Hist. anc. ?uvres, t. IX, p. 296, dans POUGENS.Son avidité, par des lois inhumaines, Impose des tributs jusqu'aux dames romaines
, Voltaire, Triumv. IV, 2. - 5Titre d'honneur ou d'office donné à certaines femmes. Les dames de France, les filles du roi.
-
6Titre donné à certaines religieuses et aux chanoinesses. Les dames du Sacré-C?ur. Les dames de Longchamp. Les dames chanoinesses de Remiremont. Les dames du ch?ur, les mères qui siégent au ch?ur, par opposition aux s?urs converses et aux novices.
Dames de charité, dames qui, dans l'étendue d'une paroisse, d'un quartier, forment une association chargée de recueillir et de distribuer les aumônes.
Nos compliments à vos dames de la charité?; elles m'ont bien remercié de ce que vous avez fait pour elles
, Maintenon, Lett. d'Aubigné, 15 oct. 1682.Dame du lit, dame du palais, dame d'honneur, dame d'atour, dame de compagnie, femmes de qualité qui remplissent diverses fonctions auprès des reines et des princesses.
Fig.
Plus l'obstacle est puissant, plus on reçoit de gloire, Et les difficultés dont on est combattu, Sont les dames d'atour qui parent la vertu
, Molière, l'Étour. V, 11.Dame de compagnie, se dit aussi d'une dame qui demeure dans une maison pour y tenir compagnie à une autre dame ou pour faire les honneurs de la maison d'un homme âgé, et qui, bien que payée pour cela, est dans une sorte d'égalité avec les maîtres de la maison.
-
7On se servait, et on se sert encore, mais rarement, de ce mot par civilité en parlant aux femmes du petit peuple, et en y ajoutant leur nom propre?: Dame Barbe, faites-moi ce plaisir, je vous prie?; de là il est passé dans le langage familier et le style badin.
Car la dame Indignation Est une forte passion
, Régnier, Ép. III.Du palais d'un jeune lapin Dame belette, un beau matin, S'empara?: c'est une rusée
, La Fontaine, Fabl. VII, 16.Les dames de la halle, la corporation des marchandes de fruits, de légumes ou de poissons.
Terme de pratique. La dame une telle. La susdite dame.
- 8Dames blanches, êtres surnaturels dans les anciennes croyances des Écossais et des Allemands.
- 9Figure du jeu de cartes. La dame de c?ur. La dame de pique. Un brelan de dames.
-
10Aux échecs, la pièce la plus considérable après le roi, et qui réunit les deux marches du fou et de la tour, c'est-à-dire qu'elle peut parcourir tout l'échiquier, soit carrément, soit en diagonale, à moins qu'une autre pièce ne l'arrête. On dit également la reine.
Parbleu?! Dorval a perdu sa dame?; il joue son roi, je prends sa dame
, Goldoni, Bourru bienfais. I, 7.Aller à dame, se dit, aux échecs, d'un pion qui, poussé jusqu'au dernier rang des cases de l'adversaire, devient dame et remplace la dame qui avait été perdue auparavant dans le cours de la partie.
Chez les unes [nations], le roi [aux échecs] peut faire deux pas, chez d'autres il n'en fait qu'un?; ici on va à dame, là on n'y va pas
, Voltaire, Sing. 31. -
11Jeu de dames, jeu qui se joue sur l'échiquier avec 24 petites rondelles toutes semblables, les unes blanches, les autres noires. Chaque joueur en a douze. Le jeu de dames à la polonaise, beaucoup plus usité aujourd'hui, se joue sur un damier ou échiquier de 100 cases?; il y a alors 40 rondelles, et chaque joueur en a 20. Ces rondelles s'appellent en général des dames, mais plus exactement des pions. La dame est le pion mené sur une des cases de la rangée qui est du côté de l'adversaire?; on le couvre d'un autre pion d'entre ceux qui ont été déjà pris, et alors il peut parcourir tout le damier en diagonale comme la reine ou dame des échecs, au lieu de faire un pas seulement comme les pions ordinaires. Cette circonstance, empruntée au jeu des échecs, est probablement l'origine du nom de jeu de dames, jeu que l'on prétend avoir été inventé à Paris, vers l'époque de la régence, par un Polonais qui s'y trouvait alors.
Aller à dame, mener un pion à dame, conduire un de ses pions sur une des cases de la dernière rangée du côté de l'adversaire?; on dit alors que le pion devient dame damée, ou, simplement, dame. Prendre une dame. Battre une dame, la mettre en prise.
Aux échecs et aux dames, dame touchée, dame jouée, c'est-à-dire que, dès qu'on a touché une pièce, on est obligé de la jouer.
-
12Au jeu de trictrac, nom des rondelles avec lesquelles on joue. Dame découverte, dame placée seule sur une flèche. Dame surnuméraire. la 3e dame placée sur une case déjà faite. Dame passée, celle qui ne peut plus servir à faire le plein.
Dames rabattues, sorte de jeu différent du trictrac, mais qui se joue avec les mêmes pièces.
-
13Nom vulgaire de différents oiseaux?: le grèbe huppé, l'effraye, la hulotte, la mésange.
Belle-dame ou bonne-dame, nom d'un papillon.
-
14 Terme de botanique. Dame d'onze heures, plante liliacée à fleurs blanches qui ont l'extérieur des pétales vert.
Belle-dame ou bonne-dame, l'arroche des jardins.
-
15Masse dont se servent les paveurs et autres ouvriers pour battre et enfoncer. On dit plutôt demoiselle?; le nom propre est hie.
Pièce de fonte qui ferme la porte du creuset dans les grosses forges.
-
16 Terme de marine. Nom de deux chevilles de fer plantées sur l'arrière d'une embarcation de chaque côté d'un grelin pour le fixer.
Doubles tolets plats servant à retenir les avirons qui n'ont pas d'estropes.
- 17 Terme d'astrologie judiciaire. On dit d'une planète qui domine dans un thème céleste, qu'elle est dame de l'ascendant.
- 18En langage de matrones, chargées jadis de faire des rapports, dame signifiait la partie moyenne de la membrane hymen.
HISTORIQUE
XIe s. Pur sa bealté dames lui sont amies
, Ch. de Rol. LXXV.
XIIe s. Et tantes dames veuves de lor maris
, Ronc. p. 72. Mais à dame de valor Doit on penser nuit et jor
, Couci, I. Et se je truis [trouve] ma dame o le douz nom Pleine d'orgueil et dame sans guerdon
, ib. II. Bele dame me prie de chanter
, ib. X. Aussi comme en la mer est puissanz la baleine, Sur tous autres poissons est dame et chastelaine
, Sax. XX. Les gentix dame, chascune ot son sautier, Et si faisoient le dame Dieu mestier [le service du Seigneur Dieu]
, Raoul de Cambrai, 52.
XIIIe s. Dame, ce dist Pepins, on ne doit pas douter
, Berte, III. [La serve] En la chambre s'en va [à] Berte sa dame dire
, ib. XI. De tel geu, com l'en fait des mains, Estoit-ele dame et il mestre.
Lai de l'ombre. Et n'est de nulle riens certaine, Ains met les amans en grant paine, Et se fait d'aus [d'eux] dame et mestresse, Mains en deçoit par sa promesse
, la Rose, 4083. Se li empereres de Romme, Sous qui doivent estre tuit homme, Me daignoit voloir prendre à fame, Et faire moi du monde dame?
, ib. 8860. Se elle est dame, qu'ele y envoit chevalier, et s'ele est demoiselle, que elle y envoit escuier
, Beaumanoir, XXIX, 19. Et lor disoit que les autres bones viles s'estoient accordées privéement, qu'eles ne vcloient plus estre en obeissance du seigneur, et seroit cascune vile dame de soi
, Beaumanoir, XXX, 63. À vous toz faiz-je ma clamor D'ypocrisie, Cousine germaine Heresie, Qui bien à la terre saisie?; Tant est grant dame, Qu'ele en enfer metra mainte ame
, Rutebeuf, 203. Wide chambre fait fole dame
, Leroux de Lincy, Prov. t. I, p. 213. On sert le chien por le seignor?; Et por l'amor le chevalier Baise la dame l'escuier
, Herbers, Dolopathos, dans LEROUX DE LINCY, t. II, p. 489.
XVe s. Et [les Gantois à Dam] mirent femmes et enfants prisonniers dedans le moustier, et proprement ils firent entrer les dames chevaleresses
, Froissart, II, II, 232. Sa dame de mere lui acordoit tout ce qu'il disoit?
, Froissart, I, I, 100. ? Et obeiroient à li comme à leur dame, et à son fils comme à leur seigneur
, Froissart, I, I, 9. À ce propos raconte Valere de Scipion que il fit Rome dame de Carthage et du pays d'Afrique
, Bouciq. III, ch. 13.
XVIe s. Dame qui moult se mire peu file
, Leroux de Lincy, Prov. t. I, p. 213.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
1. DAME.REMARQUE
1. Une locution de mauvais usage est de dire sa dame pour sa femme?: Il est venu avec sa dame.
2. Dans les chemins de fer, aux arrêts, on lit?: Côté des dames, Côté des hommes. Il faudrait côté des femmes, ou, si l'on dit côté des dames, il faudrait dire côté des messieurs.
Encyclopédie, 1re édition
DAME, f. f. (Hist. nat.) Voyez Pie.
Dame, s. f. (Hist. mod.) titre autrefois très-distingué, très-honorable parmi nous, & qu'on n'accordoit qu'aux personnes du premier rang. Nos rois ne le donnoient dans leurs lettres qu'aux femmes des chevaliers ; celles des écuyers les plus qualifiés étoient simplement nommées mademoiselle : c'est pourquoi Françoise d'Anjou étant demeurée veuve avant que son mari eût été fait chevalier, n'est appellée que mademoiselle. Brantome ne donnoit encore que le titre de mademoiselle à la sénéchale de Poitou sa grand-mere. Il parleroit différemment aujourd'hui que la qualification de madame est devenue si multipliée, qu'elle n'a plus d'éclat, & s'accorde même à de simples femmes de bourgeois. Tous les mots qui désignent des titres, des dignités, des charges, des prééminences, n'ont d'autre valeur que celle des lieux & des tems, & il n'est pas inutile de se le rappeller dans les lectures historiques. Article de M. le Chevalier de Jaucourt.
Dame du Palais, (Hist. de France.) titre d'office chez la reine de France avec pension. François I. introduisit les femmes à la cour, & la reine Catherine de Médicis, les filles d'honneur qu'elle employa comme un moyen des plus propres à servir ses desseins, à amuser les grands, & à découvrir leurs secrets. Enfin en 1673 la triste aventure de mademoiselle de *****, une des filles d'honneur de la reine mere Anne d'Autriche, dont le malheur est connu par le sonnet de l'avorton, donna lieu à un nouvel établissement. « Les dangers attachés à l'état de fille dans une cour galante & voluptueuse », dit M. de Voltaire dans ses Anecdotes de Louis XIV. « déterminerent à substituer aux douze filles d'honneur qui embellissoient la cour de la reine, douze dames du palais ; & depuis, la maison des reines de France fut ainsi composée ». Article de M. le Chevalier de Jaucourt.
Dame, en Architecture : on appelle ainsi dans un canal qu'on creuse, les digues du terrein qu'on laisse d'espace en espace pour avoir de l'eau à discrétion, & empêcher qu'elle ne gagne les travailleurs.
On nomme aussi dames de petites langues de terre couvertes de leur gazon, qu'on pratique de distance en distance pour servir de témoins de la hauteur des terres qu'on a fouillées afin d'en toiser les cubes ; alors on les appelle témoins. (P)
Dame ou Demoiselle, (Fortification.) est une piece de bois ayant des bras, que l'on tient à deux mains, pour battre & refouler la terre ou le gazon qui se mettent dans le mortier. Voyez Mortier.
Les paveurs se servent du même instrument pour affermir les pavés des rues & des cours après qu'ils sont placés. Celui-ci est un gros bloc de bois dont l'extrémité est un peu allégie ; sa tête est ceinte d'une bande de fer, & armée en-dessous de gros clous de fer.
Dame est encore une partie de terre qui reste comme isolée entre les fourneaux des mines qui ont joüé. (Q)
Dame Jeanne, s. f. (Marine.) Les matelots appellent ainsi une grosse bouteille de verre couverte de nattes, qui sert à mesurer sur les vaisseaux marchands les rations de la boisson de l'équipage ; elle tient ordinairement la douzieme partie d'une barique, c'est-à-dire dix-sept à dix-huit pintes. (Z)
Dame Lopre, s. f. (Marine.) On donne ce nom en Hollande à une sorte de petit bâtiment dont on se sert dans ce pays pour naviguer sur les canaux & sur les autres eaux internes.
Cette sorte de bâtiment a ordinairement cinquante ou cinquante-cinq piés de long de l'étrave à l'étambord, sur une largeur de onze à douze piés. On lui donne quatre pieds de creux depuis les vaigres du fond jusqu'au bordage où les dalots sont percés, & cinq pieds derriere le côté du banc où le mât touche, qui regarde l'arriere.
A l'égard de la queste qu'on donne à ces sortes de bâtimens, le charpentier se regle à la vûe ; cependant le plus qu'on leur en peut donner est le meilleur.
On fait la quille d'une seule piece, d'un pié de large sur quatre à cinq pouces d'épais. (Z)
* Dame, s. f. (grosses forges.) c'est une piece d'environ un pié de hauteur, qui ferme la porte du creuset qui donne dans la chambre, à la réserve d'un espace d'environ sept à huit pouces, qu'on appelle la coulée & par lequel passe toute la fonte contenue dans le creuset.
* Dame (Jeu.) On donne ce nom à de petites tranches cylindriques de bois ou d'ivoire qui sont peu épaisses, qui ont à-peu-près pour diametre le côté d'un quarreau du damier, & dont on se sert pour joüer aux dames. Il y en a de deux couleurs ; un des joüeurs prend les dames d'une couleur, & l'autre joüeur les dames de l'autre couleur. Voyez Dames, (Jeu de) & Damier.
* Dames, (Jeu de) Le jeu de dames se joüe avec les dames. Voyez les art. Dame & Damier. Il y a deux sortes principales de jeu de dames ; on appelle l'un les dames françoises, & l'autre les dames polonoises. Aux dames françoises, chaque joüeur a douze dames ; aux dames polonoises, vingt. On commence le jeu par placer ses dames.
Aux dames françoises le joüeur A place ses douze dames sur les douze quarreaux ou cases a, b, c, d, &c. & le joüeur B, les douze siennes sur les douze cases 1, 2, 3, 4, 5, &c. fig. 1. Chaque joüeur joue alternativement. Lorsque le joüeur A a poussé une de ses dames, le joüeur B en pousse une des siennes. Les dames ne font qu'un pas ; elles vont de la case où elles sont, sur les cases vuides de même couleur qui leur sont immédiatement contigues par leurs angles, sur la bande qui est immédiatement au-dessus : d'où l'on voit qu'une dame quelconque ne peut jamais avoir que deux cases au plus à choisir. Au bout d'un certain nombre de coups, il arrive nécessairement à une des dames du joüeur A ou B, d'être immédiatement contigue à une des dames du joüeur B ou A. Si c'est au joüeur A à joüer, & que la dame M soit contigue à la dame N du joüeur B, ensorte que celle ci ait une case vuide par-derriere elle, la dame M se placera dans la case vuide, & la dame N sera enlevée de dessus le damier. S'il y a plusieurs dames de suite en avancant vers le fond du damier, placées de maniere qu'elles soient toutes séparées par une seule case vuide contigue, la même dame M les enlevera toutes, & se placera sur la derniere case vuide. Ainsi dans le cas qu'on voit ici, fig. 2. la dame M enlevera les dames 9, 7, 5, 3, & s'arrêtera sur la case ?. Quand une dame est arrivée sur la bande d'en-haut de l'adversaire, on dit qu'elle est arrivée à dame : pour la distinguer des autres on la couvre d'une autre dame, & elle s'appelle dame damée. La dame damée ne fait qu'un pas, non plus que les autres dames, mais les dames simples ne peuvent point reculer ; elles avancent toûjours ou s'arrêtent, & ne prennent qu'en avant : la dame damée au contraire avance, recule, prend en avant, en arriere, en tout sens, tout autant de dames qu'elle en rencontre séparées par des cases vuides, pourvu qu'elle puisse suivre l'ordre des cases sans interrompre sa marche. Que cet ordre soit ici en avançant, là en reculant, la dame damée prend toûjours ; au lieu que quand elle n'est pas damée, il faut que l'ordre des dames prises soit toûjours en avançant ; elles ne peuvent jamais faire un pas en arriere. Ainsi, fig. 3. la dame damée M prend les dames 1, 2, 3, 4, 5, &c. au lieu que la dame simple ne pourroit prendre que les dames 1, 2. Si on ne prend pas quand on a à prendre, & qu'on ne prenne pas tout ce qu'on avoit à prendre, on perd la dame avec laquelle on devoit prendre, soit simple, soit damée ; cela s'appelle souffler : votre adversaire vous souffle & joue, car souffler n'est pas joüer. Le jeu ne finit que quand l'un des joüeurs n'a plus de dame ; c'est celui à qui il en reste qui a gagné.
Les dames polonoises se joüent comme les dames françoises, mais sur un damier polonois, c'est-à-dire à cent cases, & chaque joüeur a vingt dames. Les dames polonoises simples avancent un pas seulement, comme les dames françoises simples ; mais elles prennent comme les dames damées françoises, & les dames damées polonoises marchent comme les fous aux échecs : elles prennent d'un bout d'une ligne à l'autre toutes les dames qui se trouvent séparées les unes des autres par une ou plusieurs cases vuides ; passent sans interrompre leur marche, d'un seul & même coup, sur toutes les lignes obliques, tant qu'elles rencontrent des dames à prendre, & ne s'arrêtent que quand elles n'en trouvent plus. On souffle aussi à ce jeu les dames simples & damées ; & on perd ou gagne, comme aux dames françoises, quand on manque de dames ou qu'on en garde le dernier.
Wiktionnaire
Nom commun 1 - français
dame \dam\ féminin
- Femme qui appartient à la noblesse.
- Haute et puissante dame.
-
(Chevalerie) Femme à laquelle un chevalier consacrait ses soins et ses exploits.
- Porter une écharpe aux couleurs de sa dame.
-
Titre donné aux religieuses des abbayes et ainsi qu'aux chanoinesses.
- Les dames de Remiremont.
- Les deux religieuses qui faisaient le service de l'infirmerie, dames lazaristes comme toutes les s?urs de charité, s'appelaient s?ur Perpétue et s?ur Simplice. ? (Victor Hugo, Les Misérables, I, 7, 1 ; 1862)
-
Titre que l'on donnait par honneur aux femmes.
- Dame d'honneur, dame d'atour, dame du palais, femmes qui remplissaient diverses fonctions auprès des reines ou des princesses.
-
dame Unetelle, titre utilisé avec le nom d'une femme dans des contextes très formels ou officiels (synonyme de Madame).
- Le C.S.J. est un club social... Sa dirigeante principale est dame Andrée Vincent. Le Club offre à ses membres le privilège de louer des salles pour des événements privés et à l'occasion va aider des organisations soutenues par ses membres. À ce propos, dame Deschambault est membre du C.S.J. ? (Juge Jean-Jude Chabot, Cour Supérieure du Québec, Lortie c. Club St-James de Montréal, 2013 QCCS 5834 (CanLII), 25 novembre 2013.)
-
Femme d'un rang social élevé.
- [?] ; mais il ne donnait pas à l'entretien une attention si soutenue qu'il ne se détournât parfois pour lancer un regard sur le groupe de dames au centre duquel resplendissait la reine de Navarre. ? (Alexandre Dumas, La Reine Margot, 1845, volume I, chapitre I)
- Pour emprunter des locutions vulgaires qui ont le mérite de dire avec un seul mot une idée qu'une page suffirait à peine à exprimer, madame Magloire avait l'air d'une paysanne et mademoiselle Baptistine d'une dame. ? (Victor Hugo, Les Misérables, I, 2, 2 ; 1862)
- Thackeray a dit quelque part qu'une dame anglaise bien élevée est la plus complète des ?uvres de Dieu sur la terre. ? (Jules Verne, Claudius Bombarnac, chapitre III, J. Hetzel et Cie, Paris, 1892)
- Terme courtois pour toute femme adulte.
- Un monsieur et une dame passent devant moi, interrompant leur conversation pour que je ne les entende pas, comme s'ils me refusaient l'aumône de ce qu'ils pensent. ? (Henri Barbusse, L'Enfer, Éditions Albin Michel, Paris, 1908)
- Je suis installé à côté d'une dame un peu maigre, [?]. C'est une actrice demi-célèbre, qui fut jadis maîtresse de plusieurs grands écrivains et qui débine avec frénésie. ? (Victor Méric, Les Compagnons de l'Escopette, Éditions de l'Épi, Paris, 1930, page 213)
- Un réconfort moral nous attendait pourtant là-bas puisque nous y avons retrouvé des Vouzinois, une dame accompagnée de sa fille et de son gendre. ? (Marie-Gabrielle Copin-Barrier, Robert-Espagne, une tragédie oubliée : une femme de gendarme raconte, L'Harmattan, 2009, page 42)
-
« Mais pourquoi toi d'abord ?
? Parce que je suis une dame. Voilà pourquoi. » ? (Les Aristochats, 1970)
-
(Populaire) Femme, épouse.
- Passez le bonjour à votre dame.
-
(Par extension) Toute femme.
- Au musée des Arts Anciens du Namurois, la dame du guichet fut instantanément conquise par notre petite fille. « Comme elle est mignonne ! Une vraie arsouille ! » roucoulait-elle. ? (Harry Pearson, Un géant au Plat Pays: Séjour chez les Belges, traduit de l'anglais par Sylvain Gilmont et Laure Harmegnies, Avin/Hannut : Editions Luce Wilquin, 2003)
- (Jeux) Pièce de nombreux jeux de pions ou de cartes. Note : on préfère dame au synonyme reine pour pouvoir abréger avec une lettre différente de roi.
-
(Jeu de dames) Pièce constituée par deux pions l'un sur l'autre pouvant se déplacer sur tout le damier.
- Il ne me reste qu'une dame et deux pions.
-
(Échecs) Reine, pièce du jeu d'échecs.
- Comme pièces, il ne me reste qu'une dame et un fou.
-
(Cartes à jouer) Reine, élément d'un jeu de cartes.
- Si deux joueurs abattent un brelan, celui de la valeur la plus haute l'emporte. Celui toutefois, qui a la chance d'obtenir un brelan de Valets, dénommé le favori, l'emporte sur tous les autres brelans, même ceux des As, des Rois ou des Dames. ? (Frans Gerver, Le guide Marabout de Tous les Jeux de Cartes, Verviers : Gérard & C°, 1966, page 89)
- Pièce du jacquet, de trictrac, de backgammon.
- Je bats ta dame à vrai et je remplis mon grand jan.
-
Allégorie d'une construction, d'une institution dont le substantif est au féminin.
- Il était donc urgent de ne plus fouiller mais aussi ? voire avant tout ? de restaurer et de protéger les ?uvres et les lieux, Pompéi cumulant les problèmes d'une cité antique, auguste dame âgée de deux millénaires, et ceux d'une ville touristique moderne. ? (Pierre Barthélémy, Pompéi, inépuisable trésor archéologique, Le Monde. Mis en ligne le 10 décembre 2019)
- Brodée il y a près de mille ans pour célébrer le débarquement victorieux de Guillaume le Conquérant en Angleterre en 1066, la vieille dame en lin souffre et nécessite des soins d'urgence. Exposée à la verticale depuis son installation en 1983 dans un bâtiment construit pour elle, en plein c?ur de la capitale du Bessin, la tapisserie de Bayeux « craque », malgré toutes les précautions prises pour assurer sa conservation. ? (Cédric Pietralunga, La restauration de la tapisserie de Bayeux crée des accrocs dans la diplomatie franco-britannique, Le Monde. Mis en ligne le 20 mars 2021)
- Dame Justice a pris un sérieux coup de vieux.
- Le design de cette moto demeure celui d'une grande dame de la route.
-
Outil de travaux publics, muni de deux anses, ou doté d'un manche, servant à tasser le sol ou à enfoncer des pavés.
- La terre a été battue à l'aide d'une dame en fonte.
- Il fit l'éloge de Paris qu'il avait habité six semaines. Comme il la comprenait ! Une fois le boulevard Raspail percé, on tombera directement sur le boulevard Saint-Germain, et l'on aura à deux cents mètres la Concorde, en face la Madeleine ; en face de la Madeleine, la Chambre, les Invalides ; en face des Invalides, le pont Alexandre-III. Et les chaussées pavées à la dame ! ? (Jean Giraudoux, Provinciales, Grasset, 1922, réédition Le Livre de Poche, page 144)
-
() Ellipse de « dame de nage ». (Par extension) Désigne un tolet à fourche.
- La dame de nage pivotante a été brevetée par Michael Davis en 1875.
- Il avait rossé en course plus d'un Anglais, jadis, à Joinville ; et il plaisanta sur le mot « dames », dont on désigne les deux montants qui retiennent les avirons, disant que les canotiers, et pour cause, ne sortaient jamais sans leurs dames. ? (Guy de Maupassant, Une partie de campagne, dans La maison Tellier, 1891, réédition Le Livre de Poche, page 191)
Nom commun 2 - ancien français
dame \dam?\ masculin
-
Variante de dan. Note : rare hors de Dame Deu, variante en deux mots de Damedeu.
- Por amor dame Deu ? (La Chanson des quatre fils Aymon, ligne 5582, édition de Castets)
- « Mere Deu » dame Isembart dist ? (Mort du Roi Gormond, ligne 635, édition de A. Scheler)
Nom commun 1 - ancien français
dame \dam?\
-
Dame.
-
C'uns chevaliers eut une dame amee. ? (poème de Conon de Béthune)
- Un chevalier aima une dame.
-
C'uns chevaliers eut une dame amee. ? (poème de Conon de Béthune)
Nom commun 2 - français
dame \dam\ féminin
-
Digue, ou pièce de maçonnerie, installée sur un cours d'eau pour permettre la construction d'un ouvrage.
- La réparation de l'écluse commencera dès la mise en place de la dame.
-
Ellipse de « dame de mine ». Mur de terre formé par l'explosion simultanée, autour de lui, d'explosifs.
- Il reste à effondrer la dame.
- Élément de fortification Vauban, construction cylindrique en pierre empêchant la progression d'un ennemi sur un batardeau (élément de fortification fermant le fossé d'une fortification pour en réguler le niveau de l'eau).
- Petit cône de terre laissé en place dans une fouille et qui servira de repère pour effectuer le métrage.
- (Métallurgie) Muret incliné situé à la partie basse du creuset et par dessus lequel les laitiers s'écoulent.
- (Métallurgie) Plaque en fonte sur laquelle s'écoulent les laitiers.
Trésor de la Langue Française informatisé
DAME1, DAM2, subst. fém. et interj.
DOMAINE DE LA PERSONNE ET/OU DE L'ACTIVITÉ HUMAINEDAME2, subst. fém.
[DOMAINES TECHNIQUES]Dame au Scrabble
Le mot dame vaut 6 points au Scrabble.
Informations sur le mot dame - 4 lettres, 2 voyelles, 2 consonnes, 4 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot dame au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
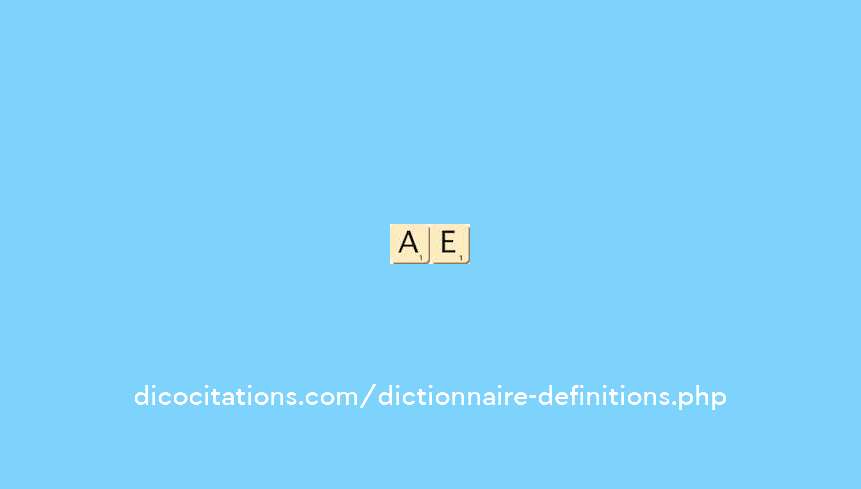
Les mots proches de Dame
Dam Damas Damasquin Damasquiné, ée Damasquiner Dame Dame Dame-jeanne Damer Dameret Damiéniste Damier Damnable Damnablement Damnation Damné, ée Damnement Damner Damoclès Damoiseau Damoiselle dam damage damas Damas-aux-Bois Damas-et-Bettegney damasquin damasquinage damasquiné damasquinée damasquinerie damasquinés damasquins damasquins damasquinure damassé damassée damassée damassées damassées damassés damassés Damazan Dambach Dambach-la-Ville Dambelin Dambenois Dambenoît-lès-Colombe Damblain Damblainville Dambron dame dame dame damé dame-jeanne Dame-Marie Dame-Marie Dame-Marie-les-Bois damée damées Damelevières dament damer Daméraucourt dameret Damerey dameriez Damery Damery damesMots du jour
Passe-passe Râpe Inquiété, ée Pet Obligatoire Fourrebuisson Équilibrer Prospère Charge Garde-feu
Les citations avec le mot Dame
- Un père en punissant, Madame, est toujours père: - Un supplice léger suffit à sa colère.Auteur : Jean Racine - Source : Phèdre (1677)
- Madame,
Je ne peus pas vous donée un certifica médical pour Sarah passque je nan ai pa mes elle était malade hier, mes elle ai solide et elle va pas au medessin pour sa et en plus j'ai pas d'argen. Que voulé vous que je vous dise dautre?Auteur : Patrice Romain - Source : Mots d'excuse - Les parents écrivent aux enseignants (2010), Les certificats médicaux - Notre-Dame est bien vieille: on la verra peut-être
Enterrer cependant Paris qu'elle a vu naître ;
Mais, dans quelque mille ans, le Temps fera broncher
Comme un loup fait un bœuf, cette carcasse lourde,
Tordra ses nerfs de fer, et puis d'une dent sourde
Rongera tristement ses vieux os de rocher !Auteur : Gérard de Nerval - Source : Poème Notre-Dame de Paris, Odelettes - Le fait fondamental pour la formation de la France a donc été la présence et le mélange sur son territoire d’une quantité remarquable d’éléments ethniques différents. Toutes les nations d’Europe sont composées, et il n’y a peut-être aucune d’elles dans laquelle une seule langue soit parlée. Mais il n’en est, je crois, aucune dont la formule ethnique et linguistique soit aussi riche que celle de la France.Auteur : Paul Valéry - Source : Regards sur le monde actuel (1931)
- Car, fondamentalement, c'était ça écrire : défier l'ordonnancement du monde. Conjurer par l'écriture ses imperfections et son absurdité. Auteur : Guillaume Musso - Source : La vie est un roman (2021)
- Nous ne nous abordâmes point de front; nous ne fîmes qu'exposer, moi, la nature de mes doutes, lui, le jugement qu'il devait en porter comme orthodoxe.Auteur : Ernest Renan - Source : Souvenirs d'enfance et de jeunesse (1883), II, Prière sur l'Acropole
- Le peuple a le droit de jouir de ses libertés fondamentales, même s'il commet des erreurs dans l'exercice de celles-ci.Auteur : Jean-Paul II - Source : Entretien avec le cardinal Angelo Sodano, 13 décembre 1996.
- Dans l'escalier régnait la fraîcheur. L'odeur de la pierre, aqueuse, métallique, n'avait probablement pas changé depuis le XIIe siècle, date de la construction de Notre-Dame.
Cette senteur de fleur morte, je l'ai sentie souvent dans les grottes karstiques où je bivouaquais au milieu des calanques de Cassis...
Je crois à la mémoire des pierres. Elles absorbent l'écho des conversations, des pensées. Elles incorporent l'odeur des hommes... Auteur : Sylvain Tesson - Source : Une très légère oscillation (2017)
- Il y avait trois dames de Paris assez laides à la Cour; on disait que c'étaient des ponts sans garde-fous, parce que personne ne voulait passez dessus.Auteur : Voltaire - Source : Le Sotisier
- Sur la vitre qui protège le guichet, un joli dessin montre une gentille dame qui dit Bonjour ! dans une bulle en souriant. Ce qui permet à l'employée, vingt centimètres plus bas, de continuer à faire la gueule en gagnant du temps sur les civilités.Auteur : Didier Van Cauwelaert - Source : L'éducation d'une fée (2000)
- Une action existe en tant qu'elle est un peuple. Un peuple monte en tant qu'il est nombreux, laborieux, ordonné. La puissance est la résultante de ce trinôme fondamental.Auteur : Benito Mussolini - Source : A l'Assemblée générale du régime, 10 mars 1929
- Si vous refusez, madame, ne le dites pas; si vous cédez, je me tairai.Auteur : Jean Dolent - Source : Amoureux d'art
- Et l'apôtre Saint Paul dit dans certain sermon :
«Dieu veut qu'à vos maris soyez soumises, femmes ;
Vous, Messieurs les maris, devez aimer ces dames ! »Auteur : Geoffrey Chaucer - Source : Contes de Canterbury, Conte du Curé - La lanterne, cette grosse dame hydropique qui ne sort que le soir.Auteur : Jules Renard - Source : Journal
- Cinquante grosses dames et un petit garçon sont venus me voir.Auteur : Tristan Bernard - Source : Sans référence
- Bon choix Madame, bon choix Monsieur.Auteur : Thierry Le Luron - Source : Sans référence
- Au lieu de se plaindre de l'obscurité, mieux vaut allumer la lumière, affirma madame Ming.Auteur : Eric-Emmanuel Schmitt - Source : Les dix enfants que Mme Ming n'a jamais eus (2012)
- Chacun de ces murs est tapissé d'espaliers et de vignes dont les fructifications grêles et poudreuses sont l'objet des craintes annuelles de madame Vauquer.Auteur : Honoré de Balzac - Source : Le Père Goriot (1835)
- Amis, qu'est-ce qu'une grande vie, sinon une pensée de la jeunesse exécutée par l'âge mûr ? La jeunesse regarde fixement l'avenir avec son oeil d'aigle, y trace un large plan, y jette une pierre fondamentale ; et tout ce que peut faire notre existence entière, c'est d'approcher de ce premier dessein. Ah ! quand pourraient naître les grands projets, sinon lorsque le coeur bat fortement dans la poitrine ? L'esprit n'y suffirait pas, il n'est rien qu'un instrument.Auteur : Alfred de Vigny - Source : Cinq-Mars (1826)
- Des galopins qui sentent encore le laitn'ont pas à se blottir dans les bras des dames qui sentent le scotch.Auteur : Françoise Sagan - Source : La Garde du coeur (1972)
- La marguerite, belle dame en robe blanche à longs plis, avec un petit canotier doré sur la tête.Auteur : Jules Renard - Source : Journal, 1er juin 1906
- Quand je suis déprimé, les raisons pour lesquelles je suis déprimé sont profondes, essentielles, fondamentales. Il m'arrive d'être heureux, bien sûr. Mais les raisons pour lesquelles je suis heureux sont si futiles, si ténues, que ça me déprime.Auteur : Jean-Jacques Sempé - Source : Sans référence
- La mort, surtout si elle est violente, exerce une drôle de fascination sur les vivants. Devant un cadavre, nous sommes tous curieux. La mort est une dame très séduisante.Auteur : Donato Carrisi - Source : Le Chuchoteur (2010)
- Les dames du palais sont dans une grande sujétion. Le Roi ... veut que la Reine en soit toujours entourée. Mme de Richelieu, quoiqu'elle ne serve plus à table, est toujours au dîner de la Reine, avec quatre dames, qui sont de garde tour à tour.Auteur : Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné - Source : Lettres (1646-1696), 5 janvier 1674
- Un optimiste est un monsieur qui croit qu'une dame a terminé sa conversation téléphonique parce qu'elle dit «au revoir».Auteur : Marcel Achard - Source : L'amour ne paie pas
Les citations du Littré sur Dame
- Il se trouverait peut-être quelques dames qui trouveraient ceci un peu romain, Et rendraient grâce aux dieux de n'être pas Romaines, Pour conserver encor quelque chose d'humainAuteur : Madame de Sévigné - Source : Lett. à Bussy, 26 juin 1655
- Ses amis, et nomméement une vieille dame sa parenteAuteur : MONT. - Source : I, 95
- Et l'aigreur de la dame à ces sortes d'outrages, Dont la plaint doucement le complaisant témoin, Est un champ à pousser les choses assez loinAuteur : Molière - Source : Éc. des mar. I, 6
- Je suis dans la chambre de madame de CoulangesAuteur : Madame de Sévigné - Source : 370
- Une infinité d'élogistes des dames illustresAuteur : BAYLE - Source : Lett. à la Monnoye, 8 juillet 1697
- La sûreté qu'on trouvait en Madame, que son esprit rendait si propre aux grandes affaires, lui faisait confier les plus importantesAuteur : BOSSUET - Source : Duch. d'Orl.
- Loing [elle] trova de son hospital Une femme qui aloit mal ; La bone dame fist la couche, Dedenz une granche l'acouche, L enfant receut et en fut bailleAuteur : RUTEB. - Source : II, 203
- Ombres et apparences du péché, madame la Dauphine vous poursuivait dans les plus secrets replis de son âmeAuteur : FLÉCH. - Source : Dauphine.
- Madame, le mariage en impromptu étonne l'innocence, mais ne l'afflige pasAuteur : MARIVAUX - Source : l'Épreuve, sc. 14
- Après les preuves touchantes, madame, que j'ai eues de votre amitié.... il y aurait à moi de l'ingratitude de n'y pas compter toujoursAuteur : Jean-Jacques Rousseau - Source : Lett. à Mme de Boufflers, 26 août 1764
- Madame, voyant la fille [d'Heemskerke] approcher son minois, se recula très brusquementAuteur : SAINT-SIMON - Source : 53, 130
- Un homme de la cour disait l'autre jour à Mme de Ludre : Madame, vous êtes, ma foi, plus belle que jamais. Tout de bon, dit-elle, j'en suis bien aise, c'est un ridicule de moins. J'ai trouvé cela plaisantAuteur : Madame de Sévigné - Source : 355
- Vous savez qu'une dame de vos amies vous obligea généreusement de le brûler [le portrait satirique de Mme de Sévigné]Auteur : Madame de Sévigné - Source : à Bussy, 26 juill. 1668
- Oh ! madame, M. le chevalier sait trop bien son vivreAuteur : DANCOURT - Source : le Chevalier à la mode, III, 6
- Il ne fallait pas un coeur moins hardi que le sien pour cette entreprise [présenter un hommage à une dame], et je ne sais encore comment elle lui réussiraAuteur : Vincent Voiture - Source : Lett. 4
- Cil Dame Diex qui le fist nestre Li doinst chevance, Et li envoit sa soustenance, Et me doinst encore alejance Qu'aidier li puisse....Auteur : RUTEB. - Source : 15
- Mais, madame, vous serez la seule à cette fête mise aussi simplementAuteur : GENLIS - Source : Veillées du château t. I, p. 394, dans POUGENS
- Je ne leu jamais tant de rigueur (je ne dirai cruauté) comme celle qui fut exercée contre cette dame [Marie Stuart], ny de constance comme celle qui se trouva en elleAuteur : PASQUIER - Source : Rech. liv. VI, p. 512, dans LACURNE
- Dame, soies raisonnable droit cy, et ne pren pas les choses en leur pire entendementAuteur : G. CHASTEL. - Source : Exposit. s. vérité.
- Mais par ma foi, madame, n'était que je lui ai déjà vu jouer mille fois le même rôle, je ne saurais qu'en direAuteur : BARON - Source : Homme à bonnes fort. III, 2
- Madame, c'est bientost commencé de tourmenter un serviteur et le lapiderAuteur : MARG. - Source : Nouv. X.
- Et cele, qui ot grant esmoi, Au miex que pot de ce s'excuse ; Mais la dame la fist concluse Par les resons qu'el li sot rendre, Si que plus ne se pot defendreAuteur : RUTEB. - Source : 268
- Je voudrais vous cacher une triste nouvelle, Madame ; mais il faut que je vous la révèleAuteur : Jean Racine - Source : Phèdre, I, 4
- De tous les deux, madame, il se faut assurerAuteur : Jean Racine - Source : Athal. II, 5
- Toutes les foiz que la royne s'escrioit, il disoit : dame, n'aiés garde [crainte], car je suis ciAuteur : JOINV. - Source : 252
Les mots débutant par Dam Les mots débutant par Da
Une suggestion ou précision pour la définition de Dame ? -
Mise à jour le mercredi 11 février 2026 à 01h39
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur dame
Poèmes dame
Proverbes dame
La définition du mot Dame est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Dame sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Dame présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
