Définition de « bachelier »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot bachelier de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur bachelier pour aider à enrichir la compréhension du mot Bachelier et répondre à la question quelle est la définition de bachelier ?
Une définition simple : (fr-accord-er|bacheli|ba.??.lj) bachelier
Approchant : bachelage, en ., bacheler, en ., bachelere, en ., bachelette, en ., bachelor, en .,,
Définitions de « bachelier »
Trésor de la Langue Française informatisé
BACHELIER, IÈRE, subst.
Wiktionnaire
Nom commun - ancien français
bachelier \Prononciation ?\ masculin
-
Batelier qui conduit un bachot.
- Exemple d'utilisation manquant. (Ajouter)
Adjectif - français
bachelier \ba.??.lje\
- Relatif à La Bachellerie, commune française située dans le département de la Dordogne.
- Exemple d'utilisation manquant. (Ajouter)
Nom commun - français
bachelier \ba.??.lje\ masculin (pour une femme, on dit : bachelière)
-
Personne diplômée au baccalauréat.
- Art. 5. Les élèves qui auront terminé leurs cours d'études pourront se présenter à l'examen de l'Université pour obtenir le grade de bachelier ès lettres. Ce grade leur sera conféré gratuitement. ? (Ordonnance du 5 octobre 1814, France)
- La réforme de 1891 apporte un coup très sérieux aux études scientifiques. En 1888-89, les diplômes de bachelier ès sciences délivrés s'élevèrent à 2 800, ceux de bachelier ès lettres à 4 000. ? (Revue internationale de l'enseignement, volume 37, Société de l'Enseignement Supérieur, 1899)
- « Il est toutefois possible que cette punition [le cachot] ne soit plus en usage : ce fait expliquerait la médiocrité des bacheliers d'aujourd'hui, comme la destruction de la Bastille explique l'anarchie dans laquelle nous vivons. » ? (Marcel Pagnol, Le temps des secrets, 1960, collection Le Livre de Poche, page 252)
- Ce jeune homme a été reçu bachelier.
- Le nombre des bachelières s'est accru depuis plusieurs années.
- (Belgique) (Éducation) Diplôme de l'enseignement supérieur universitaire sanctionnant la réussite d'un premier cycle.
-
(Féodalité) Jeune homme n'ayant pas reçu de fief ; gentilhomme qui n'était pas encore chevalier et qui était au service d'un autre pour apprendre le métier des armes.
- Le roi appelle celui qu'il veut faire bachelier par son nom, & après lui avoir commandé de se mettre à genoux devant lui, il lui touche légèrement l'épaule gauche avec une épée nue; après quoi il lui commande de se lever, en lui donnant le titre de Sir devant son nom de baptême. ? (Louis Moréri, Le Grand Dictionnaire historique, 1725, page 12)
-
(Vieilli) Jeune garçon.
- Exemple d'utilisation manquant. (Ajouter)
Nom commun - français
Bachelière \Prononciation ?\ féminin (pour un homme, on dit : Bachelier)
- Habitante de La Bachellerie, commune française située dans le département de la Dordogne.
Littré
-
1 En termes de féodalité, jeune gentilhomme qui, n'ayant pas moyen de lever la bannière, était contraint de marcher sous celle d'autrui, qui aspirait à être chevalier et tenait rang entre le chevalier et l'écuyer.
Les jeunes gens étaient bacheliers, ce qui voulait dire chevaliers, ou varlets et écuyers
, Voltaire, M?urs, 97.Pour un signe de deux beaux yeux, On sait qu'il n'est rien que ne fassent Les seigneurs et les bacheliers
, Hugo, Ball. 13. -
2Garçon.
Dans la Touraine, un jeune bachelier
, La Fontaine, Cloch. Vieux en ce sens. -
3Celui qui dans la faculté de droit canon, après trois ans d'étude, soutenait un acte dans les formes prescrites par la faculté.
Le bachelier, plongé dans les quatre premiers siècles, traite toute autre doctrine de science triste, vaine et inutile, pendant qu'il est peut-être méprisé du géomètre
, La Bruyère, 12.J'ai des forces, du feu, de l'esprit, de l'étude?; Et jamais sur les bancs on ne vit bachelier Qui sût plus à propos interrompre et crier
, L'Abbé de Villiers, Art de prêcher.Il vous faudra un jour réprimer les bacheliers en fourrure, ainsi que les gens en bonnet à trois cornes
, Voltaire, Lettr. la Chalotais, 9 juin 1763.Dans l'ancienne faculté de médecine, celui qui avait étudié deux ans et qui, ayant subi l'examen général, était revêtu de la fourrure pour entrer ensuite en licence.
- 4Aujourd'hui, dans l'Université, celui qui est promu au baccalauréat dans une faculté. Bachelier ès lettres, ès sciences, en droit.
HISTORIQUE
XIe s. Et escremissent [font des armes] cil baceler leger
, Ch. de Rol. VIII.
XIIe s. Tuit baceler et noble conquerant
, Ronc. p. 131. Breton, flaman, baceler parisant
, ib. p. 156. Blont [il] ot le poil, menu recercelé [à boucles menues], En nule terre n'ot si beau bacheler
, Romancero, p. 51. Sire, fait-il, laenz sunt quatre bacheler, Des chevaliers le rei
, Th. le mart. 139.
XIIIe s. Quant iere bachelers legiers, Volentiers gelines menjoie, En ces haies où ges [je les] trovoie
, Ren. 13100. Entre vous et ce bacheler Robichonet au vert chapel, Qui si tost vient à vostre apel, Avés-vous terres à partir??
la Rose, 8566. Un bacheler françois qui cuidoit que la coustume de France fust de sustance de mariage, une feme qu'il avoit prise segont la costume où il estoit, lessa et prist une autre
, Liv. de Just. 178. Quant je reving à ma nef, je mis en ma petite barge [barque] un escuier que je fiz chevalier, et deux moult vaillans bachelers
, Joinville, 214.
XVe s. Car c'est le metal [l'or et l'argent] par quoi on acquiert l'amour des gentils hommes et des povres bacheliers
, Froissart, I, I, 8. Sur ce la bonne dame [Isabelle d'Angleterre] avoit jà prié moult de chevaliers, bacheliers et aventuriers qui lui promettoient que très volontiers ils iroient
, Froissart, I, I, 19.
Encyclopédie, 1re édition
BACHELIER, s. m. (Hist. mod.) dans les écrivains du moyen âge, étoit un titre qui se donnoit, ou à ceux d'entre les chevaliers qui n'avoient pas assez de bien ou assez de vassaux pour faire porter devant eux leurs bannieres à une bataille, ou à ceux même de l'ordre des Bannerets, qui, n'ayant pas encore l'âge qu'il falloit pour déployer leur propre banniere, étoient obligés de marcher à la guerre sous la banniere d'un autre ; voyez Banneret. Camden & d'autres définissent le bachelier, une personne d'un rang moyen entre un chevalier & un écuyer, moins âgé & plus récent que celui-là, mais supérieur à celui-ci, voyez Chevalier, &c. D'autres veulent que le nom de bachelier ait été commun à tous les degrés compris entre le simple gentilhomme & le baron.
Quand l'amiral n'étoit ni comte, ni baron, il étoit nommé bachelier ; & « il est à noter que quand l'amiral va par le pays pour assembler vaisseaux de guerre, ou pour autre affaire du royaume, s'il est bachelier, il recevra par jour quatre chelins sterlins ; s'il est comte ou baron, ses gages seront à proportion de son état & rang ».
Le titre de bachelier se donnoit plus particulierement à tout jeune homme de condition qui faisoit sa premiere campagne, & qui recevoit en conséquence la ceinture militaire.
Bachelier, signifioit encore celui qui dans le premier tournois où il eut jamais combattu, avoit vaincu quelqu'un.
On disoit anciennement bacheliers au lieu de bas chevaliers, parce que les bacheliers formoient le plus bas ordre de chevaliers ; ils étoient au-dessus des bannerets, &c. Voyez Chevalier.
On appelle maintenant ceux-ci equites aurati, à cause des éperons qu'on leur met lors de leur réception.
D'abord cette dignité ne se donnoit qu'aux gens d'épée : mais dans la suite on la conféra aussi aux gens de robbe longue. La cérémonie en est extrèmement simple. L'aspirant s'étant mis à genoux, le roi le touche doucement d'une épée nue, & dit, sois chevalier au nom de Dieu ; & après, avance, chevalier. Voyez Chevalier & Noblesse.
Bachelier, est encore un terme dont on se sert dans les universités pour designer une personne qui a atteint le baccalauréat, ou le premier degré dans les Arts libéraux & dans les Sciences. Voyez Degré.
C'est dans le treizieme siecle que le degré de bachelier a commencé à être introduit par le pape Grégoire IX. mais il est encore inconnu en Italie. À Oxford, pour être reçu bachelier ès Arts, il faut y avoir étudié quatre ans, trois ans de plus pour devenir maitre ès Arts, & sept ans encore pour être bachelier en Théologie.
A Cambridge, il faut avoir étudié près de quatre ans pour être fait bachelier ès Arts, & plus de trois ans encore avant que d'être reçu maître, & encore sept ans de plus pour devenir bachelier en Théologie. Il ne faut avoir étudié que six ans en Droit pour être reçu bachelier de cette faculté.
A Paris, pour passer bachelier en Théologie, il faut avoir étudié deux ans en Philosophie, trois en Théologie, & avoir soûtenu deux examens, l'un sur la Philosophie, & l'autre sur la premiere partie de la somme de saint Thomas, qui comprend les traités de Dieu, & des divins attributs de la Trinité, & des anges. Ces deux examens doivent se faire à un mois l'un de l'autre, devant quatre docteurs de la faculté de Théologie, tirés au sort, avec droit de suffrage. Un seul mauvais billet ne laisse au candidat que la voie de l'examen public qu'il peut demander à la faculté. S'il se trouve deux suffrages defavorables, il est refusé sans retour. Lorsque les examinateurs sont unanimement contens de sa capacité, il choisit un président à qui il fait signer ses theses ; & quand le syndic les a visées, & lui a donné jour, il doit les soûtenir dans l'année à compter du jour de son second examen. Dans quelqu'une des écoles de la faculté, c'est-à-dire, des colleges ou des communautés qui sont de son corps, cette these roule sur les mêmes traités théologiques, qui ont servi de matiere à ce second examen, & on la nomme tentative. Le président, quatre bacheliers en licence, & deux bacheliers amis, y disputent contre le répondant ; dix docteurs qu'on nomme censeurs y assistent avec droit de suffrage ; les bacheliers de licence l'ont aussi, mais pour la forme, leurs voix n'étant comptées pour rien. Chaque censeur a deux billets, l'un qui porte sufficiens, & l'autre incapax. Un seul suffrage contraire suffit pour être refusé. Si le candidat répond d'une maniere satisfaisante, il va à l'assemblée du premier du mois, qu'on nomme prima mensis, se présenter à la faculté devant laquelle il prête serment. Ensuite le bedeau lui délivre ses lettres de baccalauréat, & il peut se preparer à la licence.
On distingue dans la faculté de Théologie de Paris deux sortes de bacheliers : savoir bacheliers du premier ordre, baccalaurei primi ordinis, ce sont ceux qui font leur cours de licence ; & ceux du second ordre, baccalaurei secundi ordinis, c'est-à-dire les simples bacheliers qui aspirent à faire leur licence, ou qui demeurent simplement bacheliers. L'habit des uns & des autres est la soutane, le manteau long, & la fourrure d'hermine doublée de soie noire.
Pour passer bachelier en Droit à Paris, il faut l'avoir étudié deux ans, & avoir soûtenu un acte dans les formes. Pour être bachelier en Medecine, il faut, après avoir été quatre ans maître ès Arts dans l'université, faire deux ans d'étude en Medecine & subir un examen, après quoi on est revêtu de la fourrure pour entrer en licence. Dans l'université de Paris, avant la fondation des chaires de Theologie, ceux qui avoient étudié six ans en Théologie, étoient admis à faire leurs cours, d'où ils étoient nommés baccalarii cursores : & comme il y avoit deux cours, le premier pour expliquer la bible pendant trois années consécutives ; le second, pour expliquer le maître des sentences pendant une année ; ceux qui faisoient leur cours de la bible étoient appellés baccalarii biblici ; & ceux qui étoient arrivés aux sentences, baccalarii sententiarii. Ceux enfin qui avoient achevé l'un & l'autre étoient qualifiés baccalarii formati ou bacheliers formés.
Il est fait mention encore de Bacheliers d'Église, baccalarii ecclesiæ, l'évêque avec ses chanoines & bacheliers, cum consilio & consensu omnium canonicorum suorum & baccalariorum. Il n'y a guere de mot dont l'origine soit plus disputée parmi les critiques que celui de bachelier, baccalarius ou baccalaureus : Martinius prétend qu'on a dit en latin baccalaureus, pour dire bacca laurea donatus, & cela par allusion à l'ancienne coûtume de couronner de laurier les poëtes, baccis lauri, comme le fut Petrarque à Rome en 1341. Alciat & Vivès sont encore de ce sentiment, Rhenanus aime mieux le tirer de baculus ou baccilus, un bâton, parce qu'à leur promotion, dit-il, on leur mettoit en main un bâton, pour marquer l'autorité qu'ils recevoient, qu'ils avoient achevé leurs études, & qu'ils étoient remis en liberté ; à peu près comme les anciens gladiateurs, à qui l'on mettoit à la main un bâton pour marque de leur congé ; c'est ce qu'Horace appelle rude donatus. Mais Spelman rejette cette opinion, d'autant qu'il n'y a point de preuve qu'on ait jamais pratiqué cette cérémonie de mettre un bâton à la main de ceux que l'on créoit bacheliers ; & d'ailleurs cette étymologie conviendroit plûtôt aux licentiés qu'aux bacheliers, qui sont moins censés avoir combattu qu'avoir fait un premier essai de leurs forces, comme l'insinue le nom de tentative que porte leur these.
Parmi ceux qui soûtiennent que les bacheliers militaires sont les plus anciens, on compte Cujas, qui les fait venir de buccellarii, sorte de cavalerie fort estimée autrefois ; du Cange, qui les tire de baccalaria, sorte de fiefs ou de fermes qui contenoient plusieurs pieces de terre de douze acres chacune, ou de ce que deux b?ufs pouvoient labourer. Selon lui les possesseurs de ces baccalaria étoient appelles bacheliers. Enfin Caseneuve & Hauteserre font venir bacheliers de baculus ou bacillus, un bâton, à cause que les jeunes cavaliers s'exerçoient au combat avec des bâtons, ainsi que les bacheliers dans les universités s'exercent par des disputes. De toutes ces étymologies la premiere est la plus vraissemblable, puisqu'il n'y a pas encore long-tems que dans l'université de Paris la these que les aspirans à la maîtrise ès Arts étoient obligés de soûtenir, s'appelloit l'acte pro laurea artium. Ainsi de bacca lauri, qui signifie proprement le fruit ou la graine de laurier, arbre consacré de tout tems à être le symbole des récompenses accordées aux savans, on a fait dans notre langue bachelier pour exprimer un étudiant qui a déjà merité d'être couronné. (G)
Bachelier, (Commerce.) c'est un nom qu'on donne dans quelques-uns des six corps de marchands de Paris, aux anciens & à ceux qui ont passé par les charges, & qui ont droit d'être appellés par les maîtres & gardes pour être présens avec eux & les assister en quelques-unes de leurs fonctions, particulierement en ce qui regarde le chef-d'?uvre des aspirans à la maîtrise. Ainsi dans le corps des marchands Pelletiers le chef-d'?uvre doit être fait en présence des gardes, qui sont obligés d'appeller avec eux quatre bacheliers dudit état.
Le terme de bachelier est aussi en usage dans le même sens, dans la plûpart des communautés des Arts & Métiers de la ville de Paris. Voyez Communauté. (G)
Étymologie de « bachelier »
Berry, bachelière, la jeune personne qui accompagne la mariée en qualité de fille d'honneur?; bas-lat. bacalarius, baquelarius (baccalaria, sorte de domaine, se trouve dans des textes du IXe siècle)?; provenç. bacalar, bachalier?; anc. catal. batxeller?; espagn. bachiller?; portug. bacharel?; angl. bachelor, homme célibataire. Mot très ancien dans les langues romanes, qui manque pourtant à la région italienne, et dont l'origine est inconnue. L'antiquité du mot suffit pour montrer que l'étymologie bas chevalier, qu'on a donnée, est sans la moindre apparence. Il va sans dire qu'il n'y a non plus à faire aucun compte de baccalaureus?; bachelier a eu, entre autres acceptions, celle de gradué dans une faculté, et, cherchant une étymologie au mot pris ainsi, on l'a décomposé, contre toutes les lois de l'analogie, en baccalaureus, comme s'il venait de bacca lauri, baie de laurier. Le sens primitif du bas-latin baccalarius était celui qui tient une baccalaria?; baccalaria voulait dire une espèce de bien rural que le bachelier avait à cens, et qui paraît avoir été formé d'une dizaine de manses. Il était donc compté parmi les gens de la campagne, quoique d'un rang plus élevé que ceux qui, tenant un manse, étaient assujettis aux ?uvres serviles, et on peut le définir un vassal d'un ordre inférieur. A côté de cette signification, il a encore celle de jeune guerrier qui n'est pas encore chevalier. Puis il y eut des bacheliers d'église, qui étaient des ecclésiastiques d'un degré inférieur. Il y eut, dans les corporations de métiers, des bacheliers qu'on nommait aussi juniores, et qui géraient les petites affaires de la corporation. Enfin, et par le même mouvement d'idées, naquirent les bacheliers, des facultés. De là aussi, par une autre extension, bachelier prit le sens d'homme jeune, non marié, et, en général, de célibataire, sens qui est resté celui du mot anglais bachelor. Dans l'ancien français, vassal a une double signification?: d'une part, il signifie celui qui est subordonné féodalement?; et, d'autre part, il veut dire courageux guerrier?; vasselage est constamment us té pour valeur et prouesse?: les chansons de gestes sont pleines de l'emploi de ce mot. Bachelier a exactement le même sens?; il signifie, comme l'autre, subordonné féodalement, et guerrier, jeune guerrier, vaillant guerrier. Le sens tendrait donc à rapprocher ces deux mots?; mais les lettres y opposent une difficulté que les exemples connus ne permettent pas de surmonter?: on ne peut expliquer comment les deux ss de vassal se seraient changées en c dur, à une époque aussi reculée que le IXe siècle. Cela conduit à reconnaître un radical bacal, bacel, bachel, qui a la double signification indiquée plus haut, et qui paraît collatéral de vassal. Le celtique a?: gaélique, bachall, irlandais, bacal, bâton, qui conviendraient très bien pour la forme du mot, et qui d'ailleurs ont pénétré dans les langues romanes?: en termes de marine, ancien italien, baccalaro, pièce de bois de pin ou d'orme?; ancien français, baccalat, même sens?; espagnol, vacalas, baccalas, bâtons fichés sur la couverture des galères. Dès lors ce n'est pas une conjecture dénuée de toute vraisemblance, de penser que le mot de bâton, de pièce de bois, ait passé à une bachelerie, sorte de domaine rural.
- (Date à préciser) Du latin baccalarius, en ancien français bacheler.
bachelier au Scrabble
Le mot bachelier vaut 16 points au Scrabble.
Informations sur le mot bachelier - 9 lettres, 4 voyelles, 5 consonnes, 8 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot bachelier au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
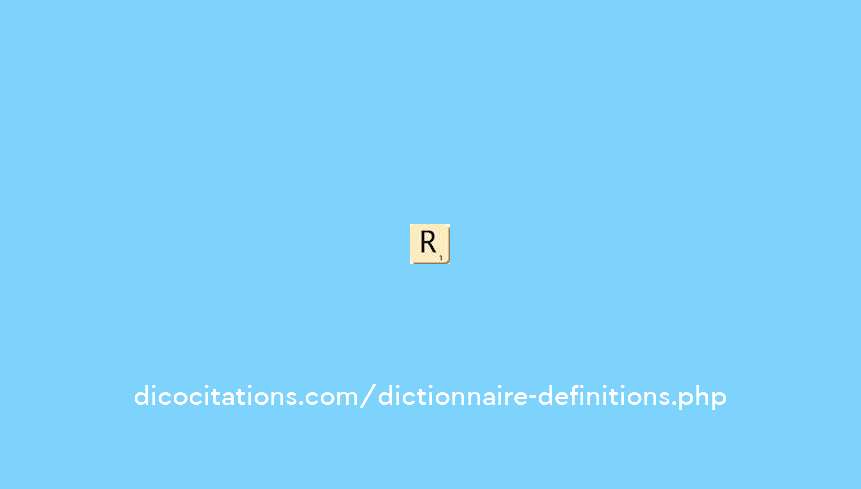
Les rimes de « bachelier »
On recherche une rime en JE .
Les rimes de bachelier peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en je
Rimes de traversier Rimes de congédiée Rimes de dédier Rimes de Rognée Rimes de excommuniez Rimes de intensifier Rimes de chassiez Rimes de mouillée Rimes de baumier Rimes de recroquevillai Rimes de papetier Rimes de hospitalier Rimes de laitiers Rimes de méprisiez Rimes de entaillés Rimes de sanctifiait Rimes de disgracié Rimes de enfourchiez Rimes de pionnier Rimes de festoyer Rimes de bonifié Rimes de souriais Rimes de souillés Rimes de pépier Rimes de glandouiller Rimes de méfiais Rimes de bâillaient Rimes de neutralisiez Rimes de féliciteriez Rimes de boulevardiers Rimes de choyés Rimes de réunifiées Rimes de trahiriez Rimes de ennuyées Rimes de nettoyés Rimes de papouillez Rimes de tapissiers Rimes de agenouillée Rimes de conveniez Rimes de rasseyais Rimes de déguisiez Rimes de mâchouillée Rimes de outillées Rimes de crucifiés Rimes de envoyés Rimes de criées Rimes de tiriez Rimes de choyée Rimes de nasillaient Rimes de tuméfiéeMots du jour
traversier congédiée dédier Rognée excommuniez intensifier chassiez mouillée baumier recroquevillai papetier hospitalier laitiers méprisiez entaillés sanctifiait disgracié enfourchiez pionnier festoyer bonifié souriais souillés pépier glandouiller méfiais bâillaient neutralisiez féliciteriez boulevardiers choyés réunifiées trahiriez ennuyées nettoyés papouillez tapissiers agenouillée conveniez rasseyais déguisiez mâchouillée outillées crucifiés envoyés criées tiriez choyée nasillaient tuméfiée
Les citations sur « bachelier »
- Le bachelier eut dans cette soupente ces doutes, ces tentations, ces triomphes et ces défaites, ces pleurs de rage et ces joies de la jeunesse que l'âge mur ignore ou dédaigne, et dont lui-même ne garda par la suite qu'un souvenir entaché d'oubli.Auteur : Marguerite Yourcenar - Source : L'Oeuvre au noir (1968)
- Un bachelier est un homme qui apprend, et un docteur un homme qui oublie.Auteur : Antoine Furetière - Source : Le Roman bourgeois (1666)
- Dans la vie, il faut choisir: être riche ou bachelier.Auteur : Frédéric Dard - Source : Sans référence
- On peut être las de tout sans rien connaître, fatigué de traîner sa casaque sans avoir lu Werther ni René, et il n'y a pas besoin d'être reçu bachelier pour se brûler la cervelle.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Par les champs et par les grèves
- Luniversité: école supérieure qui propose aux bacheliers des cours de distraction, de rêverie ou de changements d'humeur.Auteur : Alain Finkielkraut - Source : Le Petit Fictionnaire illustré (1981)
- (Shakespeare) avait été à l'école et savait autant de latin et de grec qu'en retiennent la plupart des bacheliers: c'est-à-dire rien, au point de vue pratique.Auteur : George Bernard Shaw - Source : Préface à Sainte Jeanne (1924).
Les mots proches de « bachelier »
Bac Bacchanal Bacchanale Bacchante Bacchus Bacha Bachelette Bachelier Bâcheur Bachique Bachlick ou bachelick Bâcler Bacologique BactériqueLes mots débutant par bac Les mots débutant par ba
bac baccalauréat baccara baccarat Baccarat bacchanal bacchanale bacchanales bacchante bacchantes Baccon Bach bachaghas Bachant Bachas bâche bâche bâché bâché bâchée bâchée bâchées bâchées bachelier bachelière bacheliers Bachellerie bâcher bâches bâchés bachi-bouzouk bachique bachiques Bachivillers Bachos bachot bachotage bachotaient bachotait bachotant bachoter bachots Bachte-Maria-Leerne Bachy bacillaires bacille bacilles Bacilly back back up
Les synonymes de « bachelier»
Aucun synonyme.Fréquence et usage du mot bachelier dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « bachelier » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot bachelier dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Bachelier ?
Citations bachelier Citation sur bachelier Poèmes bachelier Proverbes bachelier Rime avec bachelier Définition de bachelier
Définition de bachelier présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot bachelier sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot bachelier notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 9 lettres.
