Définition de « aigre »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot aigre de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur aigre pour aider à enrichir la compréhension du mot Aigre et répondre à la question quelle est la définition de aigre ?
Une définition simple : (fr-rég|???) aigre (mf)
Définitions de « aigre »
Trésor de la Langue Française informatisé
AIGRE, adj. et subst. inv.
Wiktionnaire
Nom commun - français
aigre \???\ masculin
-
Saveur piquante, amère et acide.
- Ce vin est en train de tourner à l'aigre.
-
(Figuré) S'emploie dans les expressions « tourner à l'aigre » et « virer à l'aigre » signifiant que quelque chose se dégrade en prenant un caractère violent, tendu.
- La conversation a viré à l'aigre.
- Avec ces lois liberticides, le climat tourne à l'aigre dans ce pays.
- En leur présence, et bien qu'il fût interdit de parler politique, dès le potage naissait le débat imbécile qui tournait vite à l'aigre. ? (François Mauriac, Thérèse Desqueyroux, Grasset, 1927)
Adjectif - français
aigre \???\ masculin et féminin identiques
- Qui a une saveur acide et amère provoquant un sentiment désagréable.
- La saveur aigre peut être liée aux acides lactique, acétique ou succinique.
-
(Figuré) Se dit d'un propos désagréable, acerbe.
- Elle a eu, envers lui, d'aigres paroles.
- Se dit également d'un caractère ou de la personne elle même.
- Votre adversaire est l'esprit le plus aigre que je connaisse.
-
(Par extension) Se dit aussi, d'autres sensations désagréables, perçantes.
- Toute la journée, un vent aigre a soufflé de l'Ouest ; le ciel est resté bas et triste, et j'ai vu passer des vols de corbeaux. ? (Octave Mirbeau, Lettres de ma chaumière : La Tête coupée, A. Laurent, 1886)
- Ce matin-là, dans le petit jour d'un hiver pluvieux, cinglé d'une bise aigre, à Chartres, Durtal, frissonnant, mal à l'aise, quitta la terrasse, se réfugia dans des allées mieux abritées. ? (Joris-Karl Huysmans, La Cathédrale, Plon-Nourrit, 1915)
- (Peinture) Désigne des couleurs qui ne sont pas liées par des passages qui les accordent.
-
(Désuet) (Métallurgie) Métaux qui ne sont pas ductiles et malléables, qui se désagrègent lorsqu'on les déforme.
- Ce fer est si aigre qu'on ne pourra pas le forger.
- (Gravure) Désigne des planches dures et qui se laissent difficilement tailler par les outils ; de même, les outils sont aigres quand ils sont trempés trop dur.
Nom commun - ancien français
aigre \Prononciation ?\ masculin
- (Agriculture) Sorte de houe.
Adjectif - ancien français
aigre \Prononciation ?\
- Ardent, impétueux.
- Vaillant.
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
. Qui est acide au goût. Le vin, le lait deviennent aigres quand ils se gâtent. Des fruits qui sont d'un goût aigre, qui ont un goût aigre, qui sont aigres au goût. Fig., L'air, le vent est aigre, Il n'est pas doux, il a quelque chose de piquant. Il se dit, par extension, de Quelques odeurs désagréables qui sortent de certaines substances altérées. Une odeur aigre qui fait mal au cœur. Il se dit figurément des Sons aigus et rudes en même temps, d'un bruit, d'un son trop aigu et perçant. Avoir la voix aigre, une voix aigre et désagréable. Une cloche qui rend un son aigre. Un son de voix aigre. En termes de Peinture, Couleurs aigres, Celles qui ne sont pas liées par des passages qui les accordent. Il se dit également, en termes d'Arts, des Métaux qui ne sont pas ductiles et malléables, dont les parties ne sont pas liées et se séparent facilement les unes des autres. Un fer extrêmement aigre. Du cuivre fort aigre. Ce fer est si aigre qu'on ne saurait le forger. En termes de Gravure, on dit que les planches sont aigres quand le métal en est dur et qu'il se laisse difficilement tailler par les outils. De même les outils sont aigres quand ils sont trempés trop dur. Il se dit figurément de l'Esprit, de l'humeur, etc., et signifie Qui est désagréable, fâcheux. Caractère aigre. Dire des paroles aigres. Il lui a écrit d'un style fort aigre. Il lui fit une réprimande aigre et sévère. Il lui parla d'un ton aigre. Il se dit aussi figurément des Personnes mêmes qui ont cette sorte d'esprit et d'humeur. C'est une personne bien aigre, une femme bien aigre. Votre adversaire est l'esprit le plus aigre que je connaisse. Il s'emploie comme nom masculin en parlant du Goût et de l'odeur aigre. Cela sent l'aigre, tire sur l'aigre. On dit de même Un goût, une odeur d'aigre. Fig., Il y a encore de l'aigre dans l'air, Le temps n'est pas encore tout à fait adouci.
Littré
- 1Qui a une acidité déplaisante. Vin aigre?; fruits aigres.
- 2Qui a l'odeur du vinaigre. Ce bouillon a une odeur aigre.
-
3Perçant, désagréable, en parlant des sons et de la voix. Cet instrument, cette cloche a un son aigre. Sa voix est aigre.
Tel un coursier qu'amour vient assaillir, Mort pour la gloire, entend sans tressaillir L'aigre clairon qui l'appelle aux alarmes
, Millevoye, Emma et Eginard. - 4 Fig. L'air, le vent est aigre, il n'est pas doux.
- 5 En termes de peinture, couleurs aigres, couleurs mal accordées?; tons aigres, tons qui ne sont pas fondus.
- 6Fer, cuivre aigre, fer, cuivre non ductile, non malléable.
-
7Au moral, fâcheux, désagréable. Rien de plus aigre que votre s?ur. Aigres réprimandes. Railleries aigres.
Ces supérieures brusques dans leurs manières, sèches dans leurs paroles, aigres dans leurs réprimandes, fâcheuses dans leurs humeurs
, Bourdaloue, Pensées, t. II, p. 471.Il n'y a guère de gens plus aigres que ceux qui sont doux par intérêt
, Vauvenargues, Max. 54.Ce qui rend mon mal plus aigre et plus cuisant
, Régnier, Plainte.Dans vos discours chagrins plus aigre et plus mordant Qu'une femme en furie ou Gauthier en plaidant
, Boileau, Sat. IX.Mais Evrard, en passant coudoyé par Boirude, Ne sait point contenir son aigre inquiétude
, Boileau, Lutr. V. - 8 S. m. Un goût, une odeur d'aigre. Cela sent l'aigre.
- 9 Fig. Il y a encore de l'aigre dans l'air, la température n'est pas encore adoucie.
- 10Aigre de cèdre, le jus de citrons ou de cédrats à demi mûrs, préparé aux environs de Gênes, non pour en faire des sorbets, mais pour l'usage des parfumeurs.
SYNONYME
AIGRE, ACIDE, ACERBE. Au propre, ces trois mots désignent une impression particulière du goût. Ils se distinguent nettement?; et, comme dit M. Lafaye, ce qui est aigre n'est plus doux, ce qui est acide n'est pas doux, ce qui est acerbe n'est pas encore doux. Aigre indique une saveur qui provient de quelque altération?: du lait aigre?; du vin aigre?; aussi est-elle toujours désagréable. Acide indique une saveur franche, spontanée?: la groseille est un fruit acide. Acerbe indique la saveur qui appartient aux fruits non mûrs?: la nèfle sur laquelle la gelée n'a pas passé est acerbe. Au moral acide n'est pas employé?; il ne reste que aigre et acerbe. La distinction qui existait au physique continue?: des paroles aigres sont dictées par le ressentiment, la mauvaise humeur?; des paroles acerbes le sont par l'âpreté naturelle de la personne qui parle. Des paroles aigres sont plus piquantes?; des paroles acerbes sont plus âpres et plus dures.
HISTORIQUE
XIIe s. Par plus aigre main de penitence
, Job, 460.
XIIIe s. Cil qui sont regratier de cervoises vendre, ne les vendent pas si bones ne si loiaus, come cil qui les font en leur hostieuz, et les vendent aigres et tournées, quar il ne les scevent point metre à point
, Liv. des Mét. 30. Tu es moult egres, si es fort Par menaces, mes petit vaut Tes povoirs à un poi d'asaut
, Ren. 16714.
XIVe s. Et le vicieux qui deffaut en ceste matiere est appelé aigre, agreste et dur
, Oresme, Eth. 138.
XVe s. En eulx avoit Dieu aigres et beaux champions, et le monde confort
, Chastelain, Chr. du duc Phil. Le roy retourna en santé? et lui exposa on bien les manieres qu'avoient tenu ses parens? et plusieurs autres choses les plus aigres que faire se pouvoient
, Juvénal Des Ursins, Charles VI, 1411. Le comte de Hainaut, qui trop durement avait pris cette guerre en c?ur, et qui estoit plus aigre que nul des autres
, Froissart, I, I, 138. Le seigneur de Jumont, qui moult estoit aigre chevalier et expert sur les ennemis
, Froissart, III, IV, 50.
XVIe s. Avoyt il mangé prunes aigres sans peler?? Avoyt il les dens esguassées??
Rabelais, Pant. IV, nouv. prol. Plus ne paistrez le trefle fleurissant, Ne l'aigre feuille au saule verdissant
, Marot, IV, 7. Ils penserent que cette sorte de vengeance debvoit estre plus aigre que la leur
, Montaigne, I, 240. Tout ainsi que l'ennemy se rend plus aigre à nostre fuitte
, Montaigne, I, 305. Ce bruit aigre et poignant que font les limes
, Montaigne, II, 367. Aigres sont choses qui se cassent aisement avec un marteau
, Palissy, 377. Lors le fer devenoit si aigre et si esclatant, que l'on ne pouvoit plus battre ne forger
, Amyot, Lyc. 13. Desguiser les viandes avec quelque saulse aigre et picquante
, Amyot, Anton. 29. L'abeille trouve naturellement es plus aigres fleurs et parmy les plus aspres espines le plus parfaict miel et le plus utile
, Amyot, Com. lire les poëtes, 49.
Encyclopédie, 1re édition
AIGRE, (Med.) ce mot exprime ce goût piquant accompagné d'astringence que l'on trouve dans les fruits qui ne sont pas encore mûrs ; c'est une bonne qualité dans ces fruits considérés comme remedes acides. Voyez Acide. (N)
Étymologie de « aigre »
Provenç. et catal. agre?; ital. agro?; du latin acer?; en grec ?????, pointu, de ????, pointe. Comp. acier (voy. aussi ÂCRE). Dans l'ancien français aigre a souvent le sens de actif, vaillant, comme acer en latin.
- (XIIe siècle) Du latin acer et du latin populaire acrus, de même sens, signifiant « pointu, pénétrant ».
aigre au Scrabble
Le mot aigre vaut 6 points au Scrabble.
Informations sur le mot aigre - 5 lettres, 3 voyelles, 2 consonnes, 5 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot aigre au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
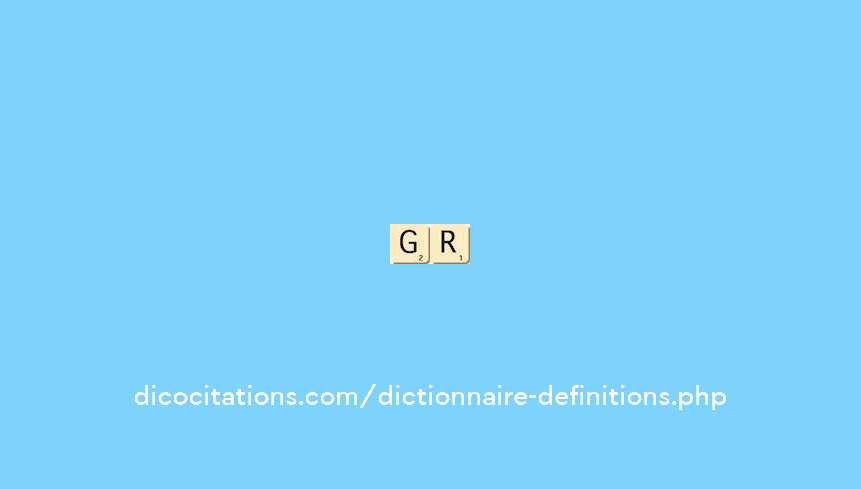
Les rimes de « aigre »
On recherche une rime en GR .
Les rimes de aigre peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en gR
Rimes de congre Rimes de nègre Rimes de pingres Rimes de nègres Rimes de chat-tigre Rimes de bougre Rimes de pingre Rimes de hongre Rimes de maigre Rimes de intègrent Rimes de migre Rimes de migrent Rimes de malingres Rimes de bigre Rimes de allègres Rimes de pellagre Rimes de allègre Rimes de nègre Rimes de tigres Rimes de pisse-vinaigre Rimes de pingre Rimes de désintègrent Rimes de migres Rimes de bigre Rimes de onagre Rimes de requin-tigre Rimes de ogre Rimes de pègre Rimes de réintègre Rimes de bougres Rimes de dénigres Rimes de dénigrent Rimes de pingres Rimes de hongres Rimes de transmigrent Rimes de mi-ogre Rimes de tête-de-nègre Rimes de aigres Rimes de émigre Rimes de maigre Rimes de tigre Rimes de hongre Rimes de intègres Rimes de vinaigre Rimes de ogres Rimes de aigre Rimes de nègres Rimes de malingre Rimes de petit-nègre Rimes de réintègrentMots du jour
congre nègre pingres nègres chat-tigre bougre pingre hongre maigre intègrent migre migrent malingres bigre allègres pellagre allègre nègre tigres pisse-vinaigre pingre désintègrent migres bigre onagre requin-tigre ogre pègre réintègre bougres dénigres dénigrent pingres hongres transmigrent mi-ogre tête-de-nègre aigres émigre maigre tigre hongre intègres vinaigre ogres aigre nègres malingre petit-nègre réintègrent
Les citations sur « aigre »
- Grasse cuisine, maigre testament.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe
- J'écoute les pas étouffés de l'aurore qui s'insinue par les fentes, fille maigre et perverse qui jette une lettre pleine d'insinuations et de calomnies.Auteur : Octavio Paz - Source : Liberté sur parole (1958)
- Les étouneaux sont maigres
Parce qu'ils vont en troupe.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe - Cette vie de si peu de joie, de si peu de tout, d'autant de maigres riens.Auteur : Jean Rouaud - Source : La Femme promise (2009)
- La gratitude, comme le lait, tourne à l'aigre, si le vase qui la contient n'est pas scrupuleusement propre.Auteur : Remy de Gourmont - Source : Dernières Pensées inédites
- Dans les maigres pâturages des îles de Bretagne, chaque brebis du troupeau, attachée à un pieu, ne peut brouter une herbe rare que l'étroit rayon de la corde qui la retient.Auteur : Ernest Renan - Source : Questions contemporaines (1868)
- Garde-toi du vinaigre de vin doux.Auteur : Proverbes italiens - Source : Proverbe
- Face de Ramadhan ? Plus il jeûnait, tombé dans la misère et la décrépitude, et plus il exultait. Il se parlait lui-même, il peuplait son chemin d'une autre multitude que celle des faux frères qui changeaient de trottoir devant sa barbe en pointe agitée de frissons, sa haute taille prise dans un costume de drap gris dont il était le seule à ne pas voir les trous, et qui révélait, sous de larges épaules, la maigreur d'un loup. Il se parlait lui-même. Auteur : Yacine Kateb - Source : Le polygone étoilé (1966)
- Les femmes sont plus aigres et plus choleres que les hommes.Auteur : Jacques Amyot - Source : Comment refréner la colère, 15
- Mieux vaut vivre maigrement dans la vertu, que brillamment dans le vice.Auteur : Ménandre - Source : Les Monostiques
- L'aigre est une variété de l'amer. ... L'aigreur est la supériorité du stérile.Auteur : Charles Dantzig - Source : Dictionnaire égoïste de la littérature française (2005)
- Que l'on meurt gros ou maigre, la différence, c'est pour les porteurs.Auteur : Peter Ustinov - Source : Sans référence
- Après plat doux, sauce aigre.Auteur : Proverbes anglais - Source : Proverbe
- Il se croit un moment le guide de jeunes âmes à pétrir et découvre vite ce que sont d'affreux gniards qui rient de sa maigreur squelettique.Auteur : Michel Déon - Source : Les Vingt Ans du jeune homme vert (1977)
- A la maigreur du caméléon, inutile de demander s'il est malade.Auteur : Ferdinand Oyono - Source : Le vieux nègre et la médaille (1956)
- Devoir! Ah, je ne puis souffrir ce vilain mot, cet odieux mot! Il est si pointu, si aigre, si froid. Devoir, devoir, devoir! On dirait des coups d'épingles.Auteur : Henrik Ibsen - Source : Solness le Constructeur
- L'été est comme un fruit, il point début juin, encore aigrelet, gonfle, mûrit à partir de juillet, jusqu'à faire craquer sa peau d'où ruisselle, fin août, un jus sucré, épais... Lequel sera perdu s'il n'y a personne pour le savourer.Auteur : Madeleine Chapsal - Source : Suzanne et la province (1993)
- De bien mal acquis, maigre profit.Auteur : Proverbes allemands - Source : Proverbe
- Mon jet de salive, c'est mon aigrette de diamants ...
Parle de la bonté de Madame. Elle, elle dit diam's.
Sa bonté! Ses diam's! C'est facile d'être bonne ... Quand on est belle et riche!Auteur : Jean Genet - Source : Les Bonnes (1947) - Les dures réalités de l’existence m’obligèrent à prendre de rapides résolutions. Les maigres ressources de la famille avaient été à peu près épuisées par la grave maladie de ma mère ; la pension d’orphelin qui m’était allouée ne me suffisait pas pour vivre et il me fallait, de quelque manière que ce fût, gagner moi-même mon pain.Auteur : Adolf Hitler - Source : Mein Kampf (1924), Adolf Hitler, éd. La Bibliothèque électronique du Québec, coll. « Polémique et propagande »
- Le plus maigre filet d'eau peut servir dans un incendie.Auteur : Proverbes anglais - Source : Proverbe
- On ne s'habille pas pour éblouir les autres femmes ou pour les embêter. Une robe n'a de sens que si un homme a envie de vous l'enlever, je dis bien l'enlever, pas l'arracher en hurlant d'horreur. Un homme ne vous aime pas pour une robe. Seulement, un jour, il vous réclamera aigrement "cette robe bleue, tu sais" (aux orties depuis deux ans), qu'il n'avait pas semblé voir. Les hommes se souviennent des robes, mais leur mémoire est sélective. Évitez les barboteuses...Auteur : Françoise Sagan - Source : La Petite Robe noire (2008)
- A 40 ans les uns se font aigres, les autres fades : d'autres tournent au porc, moi je me fais loup. Je dis non, je rôde, et je me maintiens inattaquable dans les grands bois enneigés.Auteur : Charles-Augustin Sainte-Beuve - Source : Correspondance
- Audra serra son portable avec aigreur. Si seulement elle arrivait à s'en débarrasser, à oublier les réseaux sociaux qui, au lieu de créer des liens, isolaient les individus dans des bulles.Auteur : Franck Thilliez - Source : Luca (2019)
- La France est devenu un pays de mauvaise grâce. Chacun peste dans son métier, dans ses occupations, contre les autres. Nous sommes devenus un peuple aigre qui mériterait qu'on le réduise en esclavage.Auteur : Charles Dantzig - Source : Encyclopédie capricieuse du tout et du rien (2009)
Les mots proches de « aigre »
Aigle Aiglon Aigre Aigre-doux, douce Aigrefin Aigrement Aigremoine Aigret, ette Aigrette Aigreur Aigri, ie Aigrir Aigrissement Aigu, uë Aiguadier Aiguail Aiguayer Aiguière Aiguiérée Aiguille Aiguillé, ée Aiguillée Aiguillette Aiguillier Aiguillon Aiguillonnement Aiguillonner Aiguillonnier Aiguisage Aiguisement Aiguiser Aiguiserie Aiguiseur AigûmentLes mots débutant par aig Les mots débutant par ai
Aigaliers aigle Aigle Aigle Aigle aiglefin Aiglemont Aiglepierre aigles Aigleville aiglon aiglons Aiglun Aiglun Aignan Aignay-le-Duc Aigne Aigné Aignerville Aignes Aignes-et-Puypéroux Aigneville Aigny Aigonnay aigre aigre Aigre aigre-douce aigre-doux Aigrefeuille Aigrefeuille-d'Aunis Aigrefeuille-sur-Maine aigrelet aigrelets aigrelette aigrelettes aigrement Aigremont Aigremont Aigremont Aigremont aigres aigres aigres-douces aigres-doux aigrette aigrette aigrettes aigrettes aigreur
Les synonymes de « aigre»
Les synonymes de aigre :- 1. acide
2. aigrelet
3. âcre
4. acidulé
5. piquant
6. sur
7. suret
8. tourné
9. acerbe
10. acrimonieux
11. âpre
12. irritant
13. mordant
14. acariâtre
15. fielleux
16. vert
17. aigu
18. pointu
19. cuisant
20. corrosif
21. corrodant
22. brûlant
23. caustique
24. virulent
25. venimeux
26. ginglard
27. ginglet
28. ginguet
29. reginglard
30. ginglette
31. aigrelette
32. suret
synonymes de aigre
Fréquence et usage du mot aigre dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « aigre » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot aigre dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Aigre ?
Citations aigre Citation sur aigre Poèmes aigre Proverbes aigre Rime avec aigre Définition de aigre
Définition de aigre présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot aigre sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot aigre notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 5 lettres.
