Définition de « noté »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot note de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur noté pour aider à enrichir la compréhension du mot Noté et répondre à la question quelle est la définition de note ?
Une définition simple : (fr-verbe-flexion|pp=oui)
Définitions de « note »
Trésor de la Langue Française informatisé
NOTE, subst. fém.
Wiktionnaire
Nom commun - français
note \n?t\ féminin
- Marque que l'on inscrit en quelque endroit d'un livre, d'un écrit.
- J'ai mis une note sur mon exemplaire, pour retrouver ce passage.
- Je veux revoir quelques articles de ce compte, j'ai mis des notes en marge.
-
Remarque, indication, sorte d'explication, de commentaire sur quelque passage d'un écrit, d'un livre.
- On a imprimé ce poème avec des notes.
- Notes marginales.
- Notes de bas de page.
- Notes en fin de volume.
- Une édition sans notes.
- Une édition avec notes bibliographiques, historiques, grammaticales, etc.
-
Extrait sommaire ; exposé succinct.
- Pourtant j'aurais voulu examiner le paysage, mollement éclairé par la lune, et crayonner quelques notes au passage. ? (Jules Verne, Claudius Bombarnac, chapitre II, J. Hetzel et Cie, Paris, 1892)
- Mme Surville n'a laissé sur son frère que quelques pages insignifiantes, une apologie froide, banale, où nous n'avons pas une seule note à prendre, pas un seul document à retenir. ? (Octave Mirbeau La Mort de Balzac, 1907)
- J'ai pris note de ce que j'ai à payer et à recevoir à la fin du mois.
- Bab?uf avait, du fond d'une de ses retraites, fait parvenir au représentant Drouet, son complice, une note énergique qui devait lui servir de texte à un discours à prononcer devant le Conseil des Anciens pour la conservation des Sociétés populaires. ? (Édouard Fleury, Baboeuf et le Socialisme en 1796, Pars ; chez Didier, 1851, p. 182)
- Prendre des notes au cours d'un professeur, en lisant un ouvrage.
- Ce conférencier consulte ses notes à tout moment.
-
Facture.
- Vivement elle fit sa malle, paya la note, prit dans la cour un cabriolet ? (Gustave Flaubert, Madame Bovary, Michel Lévy frères, Paris, 1857)
- L'office H.L.M. mena l'opération en deux coups de cuillère à pot. Du béton si mince que les gens grelottaient l'hiver tout en payant des notes de chauffage faramineuses. ? (Jean-Pierre Perrin-Martin, Urbanisme, minimum d'insertion : les Salmones, Éditions L'Harmattan, 1989, p. 15)
-
(Diplomatie) Communication officielle, contresignée par écrit.
- Note confidentielle.
- Échange de notes.
- Note verbale : Note qui se réfère à un entretien et qui a pour objet de préciser par écrit la portée de cet entretien.
-
(Éducation) Appréciation de la valeur d'un devoir fait par un élève, que le professeur exprime par un nombre.
- Il a obtenu la note 15 sur 20 pour sa composition française.
- Cet élève a mérité toute l'année des notes excellentes.
-
(Administration) Appréciation, faite par son chef, du mérite d'un subordonné.
- Cet officier, ce fonctionnaire a de bonnes notes.
-
(Par extension) Désignation favorable ou défavorable d'une personne à l'opinion.
- Cette mésaventure sera une mauvaise note qui te poursuivra pendant toute sa vie.
- Il n'oublie pas ceux qui l'ont aidé : c'est une bonne note à son actif.
- Note d'infamie, ou note infamante, : Note imprimée juridiquement pour quelque cause grave.
- Le blâme en justice était une note infamante.
-
(Musique) Caractères qui figurent la hauteur et la durée d'un son.
- Savoir lire ses notes.
- Il écrit les dernières notes de sa sonate.
- Les sept notes de la gamme.
- Ré est la seconde note de la gamme d'ut.
- Quelle est cette note ? C'est un sol.
- Quelle est la valeur de cette note ? C'est une blanche : elle vaut deux noires.
- Savoir ses notes.
-
(Par extension) Le son lui-même.
- Et, pour égayer le voyage, les chansons bientôt fusèrent d'elles-mêmes. Les notes joyeuses retentissaient au loin sur la terre nue [?] ? (Out-el-Kouloub, « Zariffa », dans Trois Contes de l'Amour et de la Mort, 1940)
- Note tonique : La Note principale ou fondamentale d'un ton.
- Note sensible : La septième note de la gamme dans un ton donné.
- Notes de goût, notes d'agrément : Ornements que peut recevoir une note principale.
- Bien attaquer la note : Faire une intonation juste et nette.
- Fausse note.
- Ceci est bien dans la note qui convient, vous restez dans la note : Ceci est bien dans le ton, vous gardez le ton qui convient.
- Ne savoir qu'une note, chanter toujours sur la même note : (Figuré) Dire toujours la même chose, proposer toujours le même expédient.
- Changer de note, chanter sur une autre note : (Figuré) Changer de façon d'agir ou de parler.
- Forcer la note : (Figuré) Exagérer.
-
(Par extension) La tonalité générale d'un ouvrage.
-
Mais sois prudent? Je ne connais pas ton livre? J'espère qu'il est dans la note. Tu comprends ce que je veux dire ?
? Il n'est dans aucune note, dit Suzanne avec un grand rire clair. ? (Henri Troyat, Le mort saisit le vif, 1942, réédition Le Livre de Poche, page 53)
-
Mais sois prudent? Je ne connais pas ton livre? J'espère qu'il est dans la note. Tu comprends ce que je veux dire ?
-
(Figuré) Aspect, touche.
- Des azalées, des rhododendrons aux dimensions sénégaliennes donnent une note gaie à ce triste parc où les couleurs éclatantes étonnent, où leur taille gigantesque semble lutter de force avec les vieux remparts toujours solides. ? (Gustave Fraipont; Les Vosges, 1895)
- Toutes ces vieilles coutumes ajoutent une note pittoresque à la vie de Santa-Cruz; mais elles finiront probablement bientôt par disparaître, emportées par le modernisme niveleur. ? (Frédéric Weisgerber, Huit jours à Ténériffe, dans la Revue générale des sciences pures et appliquées, Paris : Doin, 1905, vol.16, pp. 1039)
- Quelques luzernières; le Sainfoin jette de-ci de-là, au printemps, une note gaie dans la monotonie des verts. ? (Josias Braun-Blanquet & J. Susplugas, Reconnaissance phytogéographique dans les Corbières, Station internationale de Géobotanique Méditerranéenne et Alpine, Montpellier, communication n°61, 1937)
Littré
-
1Marque qu'on fait en quelque endroit d'un livre, d'un écrit, etc. pour s'en souvenir. Mettre des notes à la marge d'un compte.
Je chargerai de notes mon exemplaire [de la Félicité publique, par Chastellux'?; et c'est ce que je ne fais que quand le livre me charme et m'instruit
, Voltaire, Lett. Chastellux, 7 déc. 1772.Fig. Homme de note, un homme au-dessus du commun, soit par sa naissance, soit par le rang ou par les qualités personnelles.
-
2Observation, commentaire sur quelque endroit d'un écrit, etc.
Vos notes sur Racine sont si judicieuses, si pleines de goût, de finesse?
, Voltaire, Lett. la Harpe, 22 janv. 1773.C'est contre ces Lois [les Lois de Minos, tragédie de Voltaire] qu'il y aura une belle cabale, et je m'en moque?; j'ai fait cette pièce pour avoir occasion d'y mettre des notes qui vous réjouiront
, Voltaire, Lett. Marmontel, 23 oct. 1772.Il est certain que, dans une de ses notes sur Longin, Despréaux semble préférer assez ouvertement Racine à Corneille
, D'Alembert, Éloges, Segrais.Les notes de Voltaire sur les tragédies de Corneille sont les oracles du bon goût et les plus précieuses leçons de l'art pour les poëtes dramatiques
, Marmontel, Élém. litt. ?uv. t. IX, p. 435, dans POUGENS.Observation qu'on fait sur un mot, sur une phrase. Ce mot porte dans le dictionnaire la note?: Il est du langage technique.
-
3Eclaircissement que dans un livre on met au bas des pages, ou en marge, ou à la fin du volume, en un caractère différent de celui du reste de l'ouvrage. Mettre une chose en note. Les notes sont renvoyées à la fin de l'ouvrage. Notes marginales.
Fig.
D'après l'athée, la nature est un livre où la vérité se trouve toujours dans la note et jamais dans le texte
, Chateaubriand, Génie, I, VI, 4.Notes à l'usage des classes, notes en latin ou en français mises au bas des pages des éditions d'auteurs expliqués ou appris dans les classes, pour expliquer des difficultés de sens ou d'histoire, etc.
-
4Extrait sommaire, exposé succinct. Remettez-moi une note de votre affaire, afin que je ne l'oublie pas. J'ai pris note de ce qu'il y avait à faire.
Prendre des notes, relever sommairement ce qui se dit, ce qui se fait.
Quand sur son règne [de l'usurpateur] on prend des notes
, Béranger, Requête.Prendre des notes à un cours, inscrire très sommairement, à fur et à mesure de l'exposition, ce qui est essentiel dans le cours.
Au plur. Indications plus ou moins succinctes dont se servent les avocats, les orateurs, les professeurs. Il parla sans notes. Il consultait incessamment ses notes.
-
5Mémoire à solder. La note d'un marchand.
Payer sur note, payer sur le vu d'une note contenant en détail les travaux faits ou les avances fournies.
-
6En diplomatie, communication entre des agents diplomatiques. Échanger des notes. La France et l'Italie échangèrent des notes.
Alors se rompirent nos liens avec la Russie?; aussitôt Napoléon s'adresse au prince de Suède [Bernadotte]?; ses notes furent d'un suzerain qui croit parler dans l'intérêt de son vassal, qui sent ses droits à sa reconnaissance ou à sa soumission, et qui y compte
, Ségur, Histoire de Napoléon, I, 4.Se dit de certaines déclarations officielles ou semi-officielles que le gouvernement fait insérer au Moniteur.
-
7Observations d'un professeur sur la conduite et le travail des élèves. Ce jeune homme a de bonnes notes, de mauvaises notes. Notes hebdomadaires. Notes de quinzaine. Notes trimestrielles.
Renseignements transmis à un chef concernant des subordonnés.
Notes d'un fonctionnaire, appréciation qu'un supérieur fait de ce fonctionnaire. Cet officier, ce professeur a de bonnes notes.
-
8Ce qui fait une marque déshonorante. Sa conduite déloyale en cette occasion est une note dans sa vie. C'est une note qu'il portera toujours.
Même dans les confréries qui sont formées par pure élection, le pouvoir de retrancher les confrères n'appartient qu'aux magistrats, parce qu'il y a de l'honneur dans l'admission et de la note dans la destitution
, Furetière, Factums, t. I, p. 202.Chose étrange?! on ose attribuer à Jésus-Christ même toutes ces notes flétrissantes [les caractères de nouveauté et de schisme]
, Bossuet, 2e instruct. past. 42.Note d'infamie, ou note infamante, note imprimée juridiquement pour quelque cause grave. Le blâme en justice était une note infamante.
-
9Signe qui, en musique, représente à la fois la durée et l'intonation d'un son?; la durée par sa forme ou figure?; l'intonation, par sa position sur la portée.
On s'est servi des caractères inventés par les anciens pour écrire les chants musicaux, jusque dans le onzième siècle, que Gui d'Arezzo trouva l'invention de les écrire, comme on fait aujourd'hui, avec des notes placées sur différentes lignes
, Rollin, Hist. anc. ?uv. t. XI, 1re part. p. 252, dans POUGENS.Ces notes ne furent d'abord que des points où il n'y avait rien qui en marquât la durée?; mais Jean de Meurs, né à Paris, et qui vivait sous le règne du roi Jean, trouva le moyen de donner à ces points une valeur inégale par les différentes figures de rondes, de doubles croches et autres qu'il inventa, et qui ont été adoptées par les musiciens de toute l'Europe
, Rollin, ib.Le premier monument incontestable de l'impression des notes musicales avec des types mobiles est sorti des presses d'Erhard Oeglin (Ocellus), imprimeur à Augsbourg, ?
, Camus, Instit. Mém. litt. et beaux-arts, t. V, p. 299.Vous verrez, me dit-il à l'oreille, qu'il ne sait pas une note de musique
, Rousseau, Confess. III.Notes accidentées, notes accompagnées d'un des signes que l'on nomme accidents.
Chanter la note, solfier.
Ce musicien chante la note, il chante juste mais sans expression.
-
10 Par extension, l'intonation même du son représenté par le signe. Les sept notes de la gamme.
Fig.
La nature a deux chants, de bonheur, de tristesse, Qu'elle rend tour à tour ainsi que notre c?ur?; De l'une à l'autre note elle passe sans cesse?; Homme, l'une est ta joie, et l'autre ta douleur
, Lamartine, Harm. II, 6.Note fausse, fausse note, voy. FAUX 1.
Note tonique, la note principale ou fondamentale d'un ton ou d'un mode.
Note sensible, la note qui est d'un demi-ton au-dessous de la tonique.
Notes de goût, celles qui, appartenant à la mélodie et non à l'harmonie, entrent dans la mesure et n'entrent pas dans l'accord.
Notes d'agrément, ou petites notes, notes qui n'entrent ni dans la mélodie ni dans l'harmonie, et dont la durée très rapide se prend sur la note qui précède ou sur celle qui suit.
Notes surabondantes, nom que quelques auteurs donnent aux triolets, aux sextolets et aux notes marquées 5 pour 4, 7 pour 4, 9 pour 8, etc.
Bien attaquer la note, faire une intonation juste et nette.
Suivre la note, chanter un morceau de musique avec d'autres personnes.
D'un gai refrain, à ce lutrin, Pour qu'on suive la note, De main en main, Jusqu'à demain, Passons-nous la marotte
, Béranger, Marotte.Fig. Donner la note, indiquer quel ton il faut prendre, quel langage il faut tenir.
Fig. Apprendre une note, apprendre une chose que l'on ignorait.
À s?ur Agnès? Il fit apprendre une semblable note
, La Fontaine, Mazet.Fig. Ne savoir qu'une note, chanter toujours sur la même note, dire toujours la même chose.
C'est toujours même note et pareil entretien
, La Fontaine, Fabl. VI, 21.Il ne sait qu'une note, Il n'aura qu'un double, se dit d'une personne qui ne sait qu'une chose et qui sera payée en conséquence.
Fig. Changer de note, quitter un discours pour en commencer un autre, parler d'autre chose.
Puis rechangeant de note, il montre?
, Régnier, Sat. VIII.Changer de note, chanter sur une autre note, changer de façon d'agir ou de parler.
La peste du bourreau?! je te ferai changer de note, chien de philosophe enragé
, Molière, Mariage forcé, 8.Ils [les écrivains de Port-Royal] ne changent pas d'avis, pour changer de note
, Sévigné, 25 mai 1680.Fig. Cela change la note, cela change l'état des choses.
À basse note, en basse note, sans élever la voix. Prier Dieu à basse note. Dire à quelqu'un des injures à basse note.
Hier vendredi il nous donna à dîner en poisson? on fit briller le vin de Saint-Laurens?; et en basse note, entre M. et Mme de Chaulnes, l'évêque de Vannes et moi, votre santé fut bue
, Sévigné, 569.Voilà M. de la Rochefoucauld à s'exclamer?; M. de Bouillon, le duc de Tresmes à répéter à basse note
, Saint-Simon, 195, 100.Mlle Clairon va jouer à basse note Aménaïde et Électre sur mon petit théâtre de Ferney? c'est contre les ordres exprès de Tronchin
, Voltaire, Lett. d'Argental, 12 août 1765. - 11Notes tironiennes, voy. TIRONIEN.
- 12Note s'est dit des minutes et des actes. Ce sens du mot ne se trouve plus que dans l'expression garde-note.
SYNONYME
NOTE, REMARQUE. La note a un sens plus général que la remarque. Une remarque est toujours une note?; mais une note n'est pas toujours une remarque.
HISTORIQUE
XIIe s. Si sot [il sut] de toute chanterie, Moult sot de lais, moult sot de note
, Brut, f° 28, dans LACURNE.
XIIIe s. Amis, riens ne m'i vaut, sons, note ne estive [instrument de musique]?; Quant [je] ne vous puis veoir, [je] n'ai talent que plus vive
, Audefroi le Bastard, Romancero, p. 11. Le gouvernement de sa terre fut tel, que touz les jours il ooit [entendait] à note [musique] ses heures, et une messe de requiem sans note
, Joinville, 198. Compains, entendés ceste note, Que je vous amoneste et note
, la Rose, 8285.
XVe s. Les notes, prothocolles, briefs ou registres que iceulx tabellions ont faites et enregistrées
, Ord. des rois, t. v, p. 352. Là les maudissoient les povres gens? et leur chantoient une note entre leurs dents tout bas
, Froissart, II, III, 44. En intention qu'il n'eust la note et le reproche, qu'à luy eust tenu le rapaisement du royaume
, De la Marche, Mém. liv. I, p. 122, dans LACURNE. Et comme chose convenable, Chanta ainsi à haulte notte?: Il faut payer son hoste
, Villon, La repue franche du souffreteux.
XVIe s. Ses filles et sa race eussent à jamais porté cette note
, Marguerite de Navarre, Nouv. XXXVI. Notes d'infamie
, Amyot, Agés. 49. Un prieur est dict conventuel, quand il a avecques luy trois ou quatre freres qui chantent toutes les heures à note, comme grand messe, matines
, Grand coust. de France, livre III, ch. I, p. 289. Il y faisoit beau voir monsieur le lieutenant? prendre Mantes par le guichet, et dire aux habitants en note basse et courte haleine?: " Mes amis, sauvez-moi et mes gens?; tout est perdu, mais le Biarnois est mort, "
, Sat. Mén. édit. LABITTE, p. 28.
Encyclopédie, 1re édition
NOTE, s. f. (Gramm.) observations placées au bas des pages sur les endroits difficiles d'un ouvrage quel qu'il soit.
Il n'y a presque pas un ancien auteur qui n'ait été publié avec des notes, & qui n'en eût besoin.
Le mot note a encore d'autres acceptions. Voyez les articles suivans.
Note d'abréviation, (Littérat.) écriture abrégée ; les notes d'abbréviation en grec ??????, étoient des figures qui n'avoient aucun rapport à l'écriture ordinaire, & dont chacune exprimoit ou une syllabe, ou un mot tout entier, à-peu-près comme l'écriture chinoise. Ces abrégés avoient été inventés par Ennius ; ils furent ensuite perfectionnés & augmentés par Tiron, & depuis par un affranchi de Mécénas : enfin, Séneque, ou quelqu'un de ses affranchis les rassembla tous. Non-seulement le Bembe mandoit autrefois au pape Jules II. qu'il avoit vû l'Astronomie composée en vers par Hippinus écrite de cette façon, mais Joseph Scaliger parle aussi d'un pseautier écrit de la même maniere.
Il paroît par un passage de la vie de Xenophon, dans Diogene Laerce, que cette façon d'écrire abrégée étoit en usage chez les Grecs long tems avant qu'elle eût passé chez les Romains. Il est vraissemblable que le mot de notaire vient originairement de cette sorte d'écriture, du moins notarius est expliqué dans un ancien glossaire par ????????????.
Du tems de Cicéron, cette maniere d'écrire servoit principalement pour copier les plaidoyers, & les discours qui se prononçoient dans le sénat, car les actes judiciaires s'ecrivoient en notes, c'est-à-dire en notes abrégées, afin que le scribe pût suivre la prononciation du juge, & ne rien perdre de ses paroles. Ces abréviations n'étoient point un mystere de chicane imaginé pour tourmenter les plaideurs, & multiplier les procès ; les Romains ignoroient cet indigne artifice qui n'est que le fruit de l'intérêt, & l'ouvrage de la barbarie ; chaque citoyen entendoit une partie de ces sortes d'abréviations ; c'étoit d'ailleurs le style ordinaire des inscriptions publiques : les Jurisconsultes les employoient communément dans leurs ouvrages, aussi-bien que les Philosophes & les Rhéteurs dans leurs écoles.
A ces notes abrégées de jurisprudence & de jurisdictions, des particuliers en ajouterent depuis des nouvelles pour leur propre utilité, & qui n'étoient point d'usage au barreau, comme l'assure Valerius Probus : chaque caractere signifioit un mot, & cet usage se perfectionna en se portant à toutes sortes de matieres. Quintilien, Manile, Ausone, Martial, Prudence & Eusebe, S. Jerome, & S. Fulgence parlent de ces caracteres d'abréviations. Plusieurs modernes ont écrit pareillement sur cette matiere, mais Orsati (Sertorio) s'est distingué sur tous les autres par son commentaire sur les notes des Romains ; ouvrage plein d'industrie, de travail, & d'exactitude. Voyez aussi Thachéographie. (D. J.)
Notes, s. f. en Musique, sont genéralement tous les caracteres dont on se sert pour l'écrire ou pour la noter : mais ce terme s'applique plus précisément à ceux de ces caracteres qui désignent immédiatement les sons, leurs divers degrés du grave à l'aigu, & leurs différentes durées.
Les Grecs se servoient des lettres de leur alphabeth pour noter leur musique. Or, comme ils avoient vingt-quatre lettres, & que leur plus grand système, qui, dans un même mode, n'étoit que de deux octaves, n'excedoit pas le nombre de seize sons ; il sembleroit que l'alphabeth devoit être plus que suffisant pour les exprimer. Mais il faut remarquer en premier lieu, que les deux mêmes sons étant tantôt à l'extrémité, & tantôt au milieu du troisieme tétracorde, selon le lieu où se faisoit la disjonction, Voyez Systeme, Tétracorde ; on leur donnoit à chacun des noms qui marquoient ces diverses circonstances : secondement, que ces seize sons n'étoient pas tous les mêmes dans chacun des trois genres, qu'il y en avoit de communs, & qu'il y en avoit de différens ; il falloit par conséquent des notes particulieres pour exprimer ces différences : troisiemement, que la musique instrumentale se notoit d'une autre maniere que la musique vocale ; il falloit donc encore ici des distinctions de caracteres ? enfin, que les anciens ayant au moins quinze modes, selon le dénombrement d'Alypius, il fallut approprier des caracteres à ces modes-là, comme on le voit dans les tables du même auteur. Toutes ces diverses modifications exigeoient une multitude de signes nécessaires, à laquelle les vingt-quatre lettres étoient bien éloignées de suffire. De là la nécessité d'employer les mêmes lettres pour plusieurs sortes de notes, ce qui obligea de donner à ces lettres différentes situations, & de les mutiler en divers sens. Par exemple, la lettre pi écrite de toutes les manieres ?, ?, ?, ?, ? exprimoit cinq différentes notes. En combinant toutes les modifications qu'exigeoient ces diverses circonstances, on trouve 1620 notes en tout ; nombre prodigieux, qui devoit rendre l'étude de la musique grecque de la derniere difficulté ! aussi l'étoit-elle, selon le témoignage de Platon, qui veut que les jeunes gens se contentent de donner deux ou trois ans à la musique pour en apprendre les rudimens. Cependant les Grecs n'avoient pas un si grand nombre de caracteres différens, mais la même note avoit differentes significations, selon les occasions. Ainsi, cette lettre ? est dans le genre diatonique le lichanos hypaton du mode lydien & l'hypate-meson du mode phygien, &c.
Les Latins qui, à l'imitation des Grecs, noterent aussi la musique avec les lettres de leur alphabet, retrancherent beaucoup de cette quantité de notes. Il paroît que Boëce établit l'usage de quinze lettres seulement, & même le pape Grégoire, considérant que les proportions de sons sont les mêmes d'une octave à l'autre, réduisit encore ces quinze notes aux sept premieres lettres de l'alphabet, que l'on répétoit en différentes formes, d'une octave à l'autre.
Enfin, dans l'onzieme siecle, un bénédictin d'Arezzo, nommé Guy, substitua à ces lettres les syllabes dont nous nous servons aujourd'hui avec des points posés sur différentes lignes paralleles : dans la suite, on grossit ces points, & on s'avisa d'en distribuer aussi dans les espaces compris entre ces lignes.
Des sept noms des notes de notre musique les six premiers seulement, ut, ré, mi, fa, sol, la, sont de l'invention de Guy. On dit qu'il les inventa en 1024, à Pompose, dans le duché de Ferrare, & qu'il les tira de l'hymne de S. Jean.
Ut queant laxis resonare fibris
Mira gestorum famuli tuorum ;
Solve polluti labii reatum
Sancte Johannes.
En prenant la premiere syllabe de chaque hemistiche ou demi-vers : ce qu'Angelo Berardi a renfermé dans les vers suivant.
Ut relevet miserûm fata sollicitosque labores.
La septieme, savoir le si, a été ajoutée, selon quelques uns, par Jean de Muris ; selon d'autres, par Vander Putten ; & par un nommé le Maire, selon Brossard. Voyez Si. Vossius ne veut pas même accorder aux mordernes l'invention des six autres notes, mais il avance que les Egyptiens en faisoient usage long-tems auparavant, en quoi il prétend s'appuyer du témoignage obscur de quelques anciens. Voyez les articles Clé, Degrés, Gamme, Intervalles, Portée.
Les notes, à ce qu'on croit, n'eurent long-tems d'autre usage que de marquer les degrés & les différences des tons. Elles étoient toutes, quant au tems, d'égale valeur, & ne recevoient à cet égard d'autres différences que celles des syllabes longues & breves sur lesquelles on les chantoit : c'est dans cet état qu'est demeuré le plein-chant. Voyez . On prétend même que cela dura pour la musique jusqu'en 1330, où, selon la commune opinion, Jean de Meurs ou de Muris, docteur & chanoine de Paris, leur donna différentes figures pour marquer les rapports de durée qu'elles devoient avoir entre elles : plusieurs de ces figures ne subsistent plus ; on leur en a substitué d'autres. Voyez Mesure, Tems, Valeur des Notes.
Pour déterminer le sens des notes, & en rendre exactement l'expression, il y a huit choses essentielles à considerer ; savoir, 1. la clef & sa position ; 2. les dièses ou bémols qui peuvent l'accompagner ; 3. le lieu ou la position de la note ; 4. son intervalle ; c'est-à-dire, son rapport à celle qui la précede, ou la tonique ; 5. sa figure ; 6. le tems où elle se trouve, & la place qu'elle y occupe ; 7. le dièse, ou bémol, ou béquarre accidentel qui peut la précéder ; 8. l'espece de la mesure & le caractere du mouvement. Une seule de ces observations manquée doit faire chanter faux ou hors de mesure.
Tous ceux qui ont examiné avec attention la méchanique des caracteres de notre musique, y ont apperçu des défauts considérables, qui ne sont que des suites nécessaires de la maniere dont ces caracteres se sont établis. La musique a eu le sort des arts qui ne se perfectionnent que lentement & successivement ; les inventeurs des notes n'ont songé qu'à l'état où elle se trouvoit de leur tems, sans prévoir celui où elle pouvoit parvenir dans la suite ; aussi leur système s'est-il bien-tôttrouvé défectueux ; & d'autant plus défectueux que l'art s'est plus perfectionné. A mesure qu'on avançoit, on établissoit de nouvelles regles pour remédier aux inconvéniens présens : en multipliant les expressions, on a multiplié les difficultés, & à force d'additions & de chevilles, on a tiré d'un principe assez simple, un système fort embrouillé & fort mal assorti.
Plusieurs de ces défauts sautent aux yeux. En général, on peut les réduire à trois classes principales. La premiere est la multitude des signes & de leur combinaisons, qui surchargent inutilement l'esprit & la mémoire des commençans. De façon que l'oreille étant formée, & les organes ayant acquis toute la facilité nécessaire long-tems avant qu'on soit en état de chanter à livre ouvert ; il s'ensuit que la difficulté est toute dans l'observation des regles, & nullement dans l'exécution du chant. La seconde est le défaut d'évidence dans le genre des intervalles exprimés sur la même ou sur différentes clefs, défaut d'une si grande étendue, que non-seulement il est la principale cause de la lenteur du progrès des écoliers, mais encore qu'il n'est point de musicien forme qui n'en soit incommodé dans l'exécution. La troisieme enfin est l'extrème diffusion des caracteres & le trop grand volume qu'ils occupent ; ce qui, joint à ces lignes, & à ces portées si ennuyeuses à tracer, devient une source d'embarras de plus d'une espece. Si le premier mérite des signes d'institution est d'être clair, le second est d'être concis : quel jugement doit-on porter des notes de notre musique à qui l'un & l'autre manque ?
Les Musiciens, il est vrai, ne voient point tout cela. Faut-il s'en étonner ? La musique pour eux n'est pas la science des sons ; c'est celle des noires, des blanches, des doubles croches, &c. Dès que ces figures cesseroient d'affecter leurs yeux, ils ne croiroient jamais voir de la musique. D'ailleurs, ce qu'ils ont appris difficilement, pourquoi le rendroient-ils facile à d'autres ? Ce n'est donc pas eux qu'il faut consulter sur ce point.
Mais les défauts des caracteres de la musique sont plus aisés à connoître que les remedes à trouver. Plusieurs jusqu'ici l'ont tenté sans succès.
Tous les systèmes qui n'ont pas eu pour premier principe l'évidence des intervalles, ne nous paroissent pas valoir la peine d'être relevés. Nous ne nous arêterons donc point à celui de M. Sauveur, qu'on peut voir dans les mémoires de l'académie des Sciences, année 1721, ni à celui de M. Demaux, donné quelques années après. Des queues tournées à droite, à gauche, en haut, en bas, & des biais en tout sens, pour représenter des ut, des ré, &c. sont les notes inventées par celui-ci. Celles de M. Sauveur sont des têtes & des queues différemment situées pour répondre aux dénominations, pa, ra, ga, so, bo, lo, do, &c. substituées par le même auteur à celle de l'Arétin. On sent d'abord que tout cela ne dit rien aux yeux, & n'a nul rapport à ce qu'il doit signifier. Plus récemment encore on a proposé un nouveau système dans un petit ouvrage intitulé dissertation sur la musique moderne, & publié en 1743 ; la simplicité de ce système nous invite à en rendre compte dans cet article.
Les caracteres de la musique ont un double objet ; savoir, de représenter les sons 1°. selon leurs divers intervalles du grave à l'aigu, ce qui constitue l'harmonie & le chant ; 2°. & selon leurs durées relatives du vîte au lent, ce qui détermine le tems & la mesure.
Pour le premier point, de quelque maniere qu'on retourne la musique, on n'y trouvera jamais que des combinaisons des sept sons de la gamme portés à diverses octaves, ou transposés sur différens degrés, selon le ton & le mode qu'on aura choisi. L'auteur de de la dissertation exprime ces sept sons par les sept premiers chiffres de l'arithmétique, de sorte que le chiffre 1 forme la note ut ; 2, la note ré ; 3, la note mi, &c. & il les traverse d'une ligne horisontale dans l'ordre marqué. Voyez les Pl. de Musique.
Il écrit au-dessus de la ligne les notes qui, continuant de monter, se trouveroient dans l'octave supérieure ; ainsi, l'ut qui suivroit immédiatement le si, en montant d'un sémiton, doit être au-dessus de la ligne de cette maniere ?, & de même les notes qui appartiennent à l'octave aiguë, dont cet ut est le commencement, doivent toutes être au-dessus de la même ligne. Si l'on entroit dans une troisieme octave à l'aigu, il ne faudroit que traverser les notes par une seconde ligne accidentelle au-dessus de la premiere. Voulez-vous, au contraire, descendre dans les octaves inférieures à celle de la ligne principale, écrivez immédiatement au-dessous de cette ligne les notes de l'octave qui la suit en descendant ; si vous descendez encore d'une octave, ajoutez une ligne au-dessous, &c. au moyen de trois lignes seulement vous pouvez parcourir l'étendue de cinq octaves ; ce qu'on ne sauroit faire dans la musique ordinaire à moins de dix-huit lignes.
On peut même se passer de tirer aucune ligne. On place toutes les notes horisontalement sur le même rang : on met un point au dessus de chaque note qui passe, en montant, le si de son octave, c'est-à-dire, qui entre dans l'octave supérieure ; ce point suffit pour toutes les notes suivantes qui sont dans la même octave. Que si l'on redescend d'une octave à l'autre, c'est l'affaire d'un autre point sous la note par laquelle on y rentre, &c.
La premiere maniere de noter avec des lignes convient pour les musiques fort travaillées & fort difficiles, pour les grandes partitions, &c. La seconde avec des points est propre aux musiques plus simples & aux petits airs ; mais rien n'empêche qu'on ne puisse à sa volonté l'employer toujours à la place de l'autre, & l'auteur s'en est servi pour la fameuse ariette, l'objet qui regne dans mon ame, qu'on trouve ainsi notée fort exactement par ses chiffres, en partition avec la basse & la symphonie, à la fin de son ouvrage.
Par cette méthode, tous les intervalles deviennent d'une évidence dont rien n'approche ; les octaves portent toujours le même chiffre ; les intervalles simples se reconnoissent toujours dans leurs doubles ou composées : on connoît d'abord dans la dixieme +3 ou 13, que c'est l'octave de la tierce majeure 13. Les intervalles majeurs ne peuvent jamais se confondre avec les mineurs ; le 24 sera éternellement une tierce mineure, 46 éternellement une tierce majeure, la position ne fait rien à cela.
Après avoir ainsi réduit toute l'étendue du clavier sous un beaucoup moindre volume avec des signes beaucoup plus évidens, on passe aux transpositions.
Il n'y a dans notre musique, qu'un mode majeur & un mode mineur. Qu'est-ce que chanter ou jouer en ré majeur ? C'est transporter la gamme ou l'échelle d'ut, un ton plus haut, & la placer sur le ré, comme tonique ou fondamentale : tous les rapports qui appartenoient à l'ut deviennent propres au ré par cette transposition. C'est pour exprimer cela qu'il a tant fallu imaginer d'altération, de dièses ou de bémols à la clé. L'auteur du nouveau système supprime tout d'un coup tous ces embarras ; le seul mot ré mis à la marge, avertit que la piece est en ré majeur, & comme alors ré est revétu de toutes les propriétés de l'ut, aussi l'appelle-t-il ut, & le marque-t-il avec le chiffre 1, & toute son octave avec les chiffres, 2, 3, 4, &c. comme ci-devant. Ce ré de la marge, il l'appelle clé ; c'est la touche ré ou D du clavier naturel ; mais ce même ré devenu tonique, il l'appelle ut dans le chant : c'est la fondamentale du mode.
Il faut remarquer que cette fondamentale, qui est tonique dans les tons majeurs, devient médiante dans les tons mineurs ; la tonique qui prend le nom de la ; se trouvant alors une tierce mineure, au-dessous de cette fondamentale ; c'est ce qui se distingue par une petite ligne horisontale qui se tire sous la clé. Ré désigne le mode majeur de ré ; mais ré désigne le mode mineur de si, dont ce ré est médiante. Distinction qui n'est que pour la connoissance assurée du ton, & dont on peut se passer dans les chiffres du nouveau système, aussi-bien que dans les notes ordinaires ; au lieu des noms mêmes des notes, on pourroit se servir pour clés des lettres majuscules de la gamme qui leur répondent, C pour ut, D pour ré, &c. Voyez Gamme.
Les Musiciens ont beaucoup de mépris pour la méthode des transpositions ; l'auteur fait voir que ce mépris n'a nul bon fondement ; que c'est leur méthode qu'il faut mépriser, puisqu'elle est difficile en pure perte, & que les transpositions, dont il montre les avantages, sont même sans qu'ils s'en apperçoivent, la véritable regle que suivent tous les grands musiciens & les habiles compositeurs. Voyez Gamme.
Il ne suffit pas de faire connoître toutes les notes d'une octave, ni le passage d'une octave à l'autre par des signes clairs & certains ; il faut encore indiquer de même le lieu du clavier qu'occupent ces octaves. Si j'ai un sol à entonner, ce sol doit être déterminé ; car il y en a cinq dans le clavier, les uns hauts, les autres moyens, les autres bas, selon les différentes octaves. Ces octaves sont indiquées dans le nouveau système par de petites lettres qui sont au commencement de chaque ligne, qui répondent à autant d'octaves & déterminent le lieu du clavier où l'on se trouve en commençant cette ligne. Il faut voir la figure qui est à la fin du livre, & l'explication qu'en donne l'auteur pour se mettre au fait de cette partie de sa méthode qui est des plus simples.
Il reste pour l'expression de tous les sons possibles à rendre les altérations accidentelles amenées par la modulation, ce qui se fait sans embarras. Le dièse se forme en traversant la notte d'une petite barre montant de gauche à droite, ainsi ?, ? ; le bémol par une semblable barre, descendant dans le même sens ?, ?. A l'égard du béquarre, l'auteur le supprime, comme un signe tout-à-fait inutile dans son système.
Cette partie ainsi remplie, il faut venir au tems ou à la mesure.
D'abord, l'auteur fait main-basse sur cette foule de différentes mesures, dont on a si inutilement chargé la musique. Il n'en reconnoît que deux, mesure à deux tems & mesure à trois : les tems de chacune de ces mesures peuvent à leur tour être divisés en deux, ou en trois parties égales. De ces deux regles combinées, il tire des expressions exactes pour tous les mouvemens possibles.
On rapporte dans la musique ordinaire les diverses valeurs des notes, à celle d'une note particuliere qui est la ronde, ce qui fait que la durée de cette ronde variant continuellement, les notes qu'on lui compare n'ont point de valeur fixe. M. Rousseau s'y prend autrement : il ne détermine les valeurs des notes que sur l'espece de la mesure dans laquelle elles sont employées, & sur le tems qu'elles y occupent : une note entre deux barres remplit seule toute une mesure : dans la mesure à deux tems, deux notes au lieu d'une remplissant la mesure, forment chacune un tems. Trois notes font la même chose dans la mesure à trois tems. S'il y a quatre notes dans une mesure à deux tems ou six dans une mesure à trois, c'est que chaque tems est subdivisé en deux parties égales ; on passe donc deux notes pour un tems. On en passe trois, quand il y a six notes dans l'une ou neuf dans l'autre. En un mot, quand il n'y a aucun signe d'inégalité, le nombre des notes contenues dans une mesure, se distribue également en deux ou trois tems, selon l'espece de la mesure, & pour rendre cette distribution plus aisée, on sépare si l'on veut les tems par des virgules ; ensorte qu'en lisant la musique, on voit clairement la valeur des notes sans qu'il leur faille donner pour cela aucune figure particuliere. Voyez les Planches de Musique.
Les divisions inégales ne sont gueres plus difficiles à noter. Ces inégalités ne sont jamais que des subdivisions, qu'on ramene à l'égalité par un trait dont on couvre deux ou plusieurs notes. Par exemple, si un tems contient une croche & deux doubles croches, un trait au-dessus ou au-dessous des deux doubles croches, montrera qu'elles ne font ensemble que la valeur de la croche : ainsi un tel tems se trouve divisé en deux parties égales ; savoir la note seule & le trait qui en comprend deux. Il y a encore des subdivisions d'inégalité qui peuvent exiger des traits, comme si une croche pointée étoit suivie de deux triples croches, il faudroit d'abord un trait sur les deux notes qui exprimeroient les triples croches, ce qui les rendroit ensemble égales au point ; puis un second trait, qui couvrant les deux triples croches & le point, les rendroit ensemble égaux à la croche ; mais quelque vitesse que puissent avoir les notes, ces traits ne sont jamais nécessaires que quand les valeurs sont inégales, & quelque inégalité qu'il puisse y avoir, on n'aura jamais besoin de passer deux traits, sur-tout en séparant les tems par des virgules. Voyez les fig.
L'Auteur du nouveau système y employe le point, mais c'est autrement que dans la musique ordinaire ; dans celle-ci le point vaut toujours la moitié de la note qui le précéde ; dans la sienne le point qui marque toujours le prolongement de la note précédente, n'a point d'autre valeur que celle de la place qu'il occupe : si le point remplit un tems, il vaut un tems ; s'il remplit une mesure, il vaut une mesure ; s'il se trouve dans un tems avec une autre note, le point vaut la moitié de ce tems. En un mot, le point se compte pour une note, s'évalue comme les notes mêmes, & il y a tel cas où l'on peut employer plusieurs points de suite de valeurs égales ou inégales, pour marquer des tems ou des syncopes.
Tous les silences n'ont besoin que d'un seul caractere ; c'est le zéro. Le zéro s'emploie comme les notes & comme le point ; il vaut le tems ou la durée dont il occupe la place, & le point se place après un zéro pour prolonger un silence, comme après une note pour prolonger un son.
Tel est à-peu-près le fond du système de M. Rousseau : nous ne le suivrons point dans le détail des régles, ni dans la comparaison qu'il fait des caracteres en usage avec les siens : on s'artend bien qu'il met tout l'avantage de son côté, mais ce préjugé ne détournera jamais un homme impartial d'examiner les raisons de cet auteur dans son ouvrage même. Voyez dans nos Pl. de Musiq. un air noté par ces nouveaux caracteres. (S)
Note sensible, en Musique, est celle qui est une tierce majeure au dessus de la dominante, ou un semi-ton au-dessous de la tonique. Le si est note sensible dans le ton d'ut, le sol diese dans le ton mineur de la.
On l'appelle note sensible, parce qu'elle fait sentir le ton & la tonique, sur laquelle, après l'accord dominant, elle est même obligée de monter, ce qui fait que quelques-uns traitent cette note sensible de dissonance majeure.
Je n'ai point dit que la note sensible est la septieme note du ton, parce qu'en mode mineur cette septieme note n'est note sensible qu'en montant ; car en descendant, elle est à un ton de la tonique, & à une tierce mineure de la dominante. Voyez Mode, Tonique, Tonique, &c. (S)
Nous avions promis de donner ici, d'après M. Rameau, la raison pourquoi la note sensible est un demi-ton au-dessous de la tonique. La raison qu'il en donne est que cette note sensible est la tierce majeure de la dominante, qui résonne dans la dominante, & que le repos ou cadence parfaite dans la basse étant la cadence ou chûte de la dominante à la tonique, le repos le plus parfait dans l'échelle diatonique doit par conséquent consister à monter la note sensible à cette tonique. Voyez mes élémens de Musique, article 77, premiere édition. (O)
Note, signifie, dans le Commerce, un petit extrait ou mémorial qu'on fait de quelque chose pour s'en mieux souvenir.
Les agens de change prennent la note des lettres & billets de change que les marchands ou banquiers ont à négocier ; quelquefois les marchands les leur confient sur une simple note signée d'eux. Pour plus d'exactitude, l'agent doit faire toûjours la note double ; l'une pour le banquier à qui appartiennent les lettres & billets, l'autre pour soi-même. Dictionnaire de Commerce.
Note, veut dire aussi un mémoire, un état. Donnez-moi une note, c'est-à-dire, un état de ce que je vous dois. Id. ibid.
Étymologie de « note »
Provenç. nota, noda?; esp. et ital. nota?; du lat. nota.
- Du latin nota (« marque (faite sur un manuscrit ou ailleurs - naturelle sur le visage - qu'on imprimait avec un fer chaud aux esclaves fugitifs d'où « stigmate »), signe, indice, indication, inscription, étiquette (qu'on mettait sur les amphores), signes de ponctuation, flétrissure, condamnation (infligée par le censeur) » mais aussi « distinction honorable ».
- Nota en latin est dérivé du supin, notum du verbe nosco (« apprendre, connaître »).
noté au Scrabble
Le mot noté vaut 4 points au Scrabble.
Informations sur le mot note - 4 lettres, 2 voyelles, 2 consonnes, 4 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot noté au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
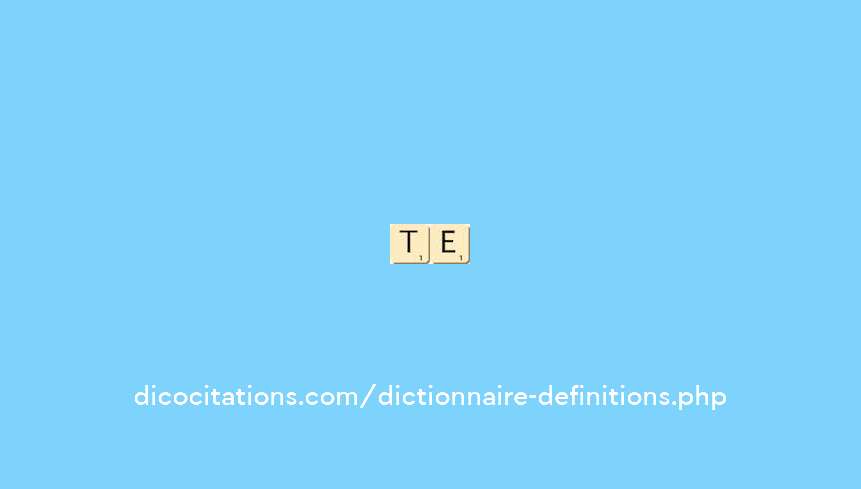
Les rimes de « noté »
On recherche une rime en TE .
Les rimes de noté peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en te
Rimes de connectés Rimes de argentées Rimes de amputer Rimes de rechanté Rimes de commentait Rimes de frisottés Rimes de exorbités Rimes de indenté Rimes de nervosités Rimes de portées Rimes de confronter Rimes de permanentée Rimes de exclusivités Rimes de réhydrater Rimes de occultée Rimes de pivotait Rimes de facilité Rimes de emberlificotées Rimes de causalité Rimes de majestés Rimes de piémontais Rimes de arrêtée Rimes de stabilité Rimes de virginité Rimes de citais Rimes de contrariété Rimes de énormité Rimes de mouvementée Rimes de cérébralité Rimes de sportivité Rimes de cureter Rimes de phagocyter Rimes de déguster Rimes de charcutés Rimes de affrontais Rimes de anti-cité Rimes de solidarités Rimes de ajouté Rimes de refoutez Rimes de gigotez Rimes de zieutez Rimes de existé Rimes de loyauté Rimes de scrutais Rimes de massicoter Rimes de traficoté Rimes de émettait Rimes de rachetait Rimes de méditées Rimes de alertéMots du jour
connectés argentées amputer rechanté commentait frisottés exorbités indenté nervosités portées confronter permanentée exclusivités réhydrater occultée pivotait facilité emberlificotées causalité majestés piémontais arrêtée stabilité virginité citais contrariété énormité mouvementée cérébralité sportivité cureter phagocyter déguster charcutés affrontais anti-cité solidarités ajouté refoutez gigotez zieutez existé loyauté scrutais massicoter traficoté émettait rachetait méditées alerté
Les citations sur « noté »
- La décadence de l'amour! Les termites! Ces insectes qui bouffent les poutres et les charpentes. On ne les voit pas, on ne les entend pas, ils grignotent jusqu'à ce qu'un jour la maison s'écroule.Auteur : Eric-Emmanuel Schmitt - Source : Petits crimes conjugaux (2003)
- Nous serons des notes dans cette grande symphonie dont la cadence allant de cercle en cercle forme le rythme de toutes les sphères, le coeur de l'Univers entier, battant de vie, ne fera qu'un avec notre coeur.Auteur : Oscar Wilde - Source : Panthéa
- J'ignorais l'existence de ce son, de cette note à l'intérieur de moi. Je me sens comme un instrument de musique qui posséderait une touche en plus. Un défaut de fabrication salutaire.
Est-ce que c'est ça, la jeunesse ? Est-ce possible de faire connaissance avec elle à bientôt cinquante ans ? Auteur : Valérie Perrin - Source : Changer l'eau des fleurs (2019)
- Au piano, le «doigté» ne désigne nullement une valeur d'élégance et de délicatesse (ce qui, alors, se dit: «toucher»), mais seulement une façon de numéroter les doigts qui ont à jouer telle ou telle note ...Auteur : Roland Barthes - Source : Roland Barthes par Roland Barthes (1975)
- Avez-vous noté l'impact des promenades nocturnes en automobile sur le fonctionnement du cerveau ? C'est mieux que le caisson extrasensoriel ou le haschisch. On se détend, les idées affluent comme des vagues régulières.Auteur : Dominique Sylvain - Source : Soeurs de sang (1997)
- Que celuy qui est studieux d'eloquence y note diligemment ce qu'il y a d'escrit purement et artificiellement (avec art).Auteur : Jacques Amyot - Source : Comment il faut lire les poëtes, 43
- Décomposer les idées, noter leurs dépendances, former leur chaîne de telle façon qu'aucun anneau ne manque et que la chaîne entière soit accrochée à quelque axiome incontestable ou à un groupe d'expériences familières.Auteur : Hippolyte Taine - Source : Philosophie de l'art (1865)
- Je refuse de signé une note aussi mauvaise. Thomas ma dit qui devrait avoir la moyenne. Merci de bien vouloir corrigée la note pour que je la signe.Auteur : Patrice Romain - Source : Mots d'excuse - Les parents écrivent aux enseignants (2010), Les contestations de notes
- Notez bien, le malheur c'est comme le mariage. On croit qu'on choisit et puis on est choisi.Auteur : Albert Camus - Source : Caligula (1944)
- Pourquoi les mots que la musique accompagne se gravent-ils plus profondément dans la mémoire que les mots nus, les mots seuls? Les notes ont-elles des crochets qui se cramponnent aux régions de la tête où s'entreposent les souvenirs.Auteur : Erik Orsenna - Source : L'Entreprise des Indes (2010)
- Je n'avais jamais noté combien l'âge nous rend libres. A vingt ans, nous sommes le produit de notre éducation, mais à quarante ans, enfin, le résultat de nos choix - si nous en avons fait.Auteur : Eric-Emmanuel Schmitt - Source : Concerto à la mémoire d'un ange (2010)
- Je ne suis même pas sûr de savoir encore comment ça marche de faire sortir des notes de musique de mon corps, maintenant que j'ai un trou dedans.Auteur : Mathias Malzieu - Source : Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi (2005)
- L'univers de la drogue ressemble à une pyramide dont chaque étage grignoterait celui d'en dessous […], et ainsi de suite jusqu'au sommet – ou plutôt : aux sommets, car il existe de nombreuses pyramides de cames qui écrasent des milliers de gens de par le monde, et elles sont toutes fondées sur les principes de base du monopole :
1° Ne jamais rien donner gratis ;
2° Ne jamais donner plus que le strict minimum […],
3° Ne jamais hésiter à tout reprendre si l'occasion se présente.Auteur : William S. Burroughs - Source : Le Festin nu (1959) - Le mot liberté ne peut pas être chanté sur la même note par tout le monde.Auteur : André Mathieu - Source : Complot (1979)
- Quand je serai vieille, je m'allongerai sur mon lit ou me calerai les reins dans un fauteuil et j'écouterai la musique que j'écoute aujourd'hui, celle qui passe à la radio ou dans les boîtes de nuit. Je fermerai les yeux pour retrouver la sensation de mon corps en train de danser. Mon corps délié, souple, obéissant, mon corps au milieu des autres corps, mon corps affranchi de tout regard, quand je danse seule au milieu de mon salon. Quand je serai vieille, je passerai des heures ainsi, attentive à chaque son, à chaque note, à chaque impulsion. Oui, je fermerai les yeux et je me projetterai mentalement dans la danse, dans la transe, je retrouverai un à un les mouvements, les ruptures, et mon corps épousera de nouveau le rythme, la mesure, au plus près de sa pulsation.
Quand je serai vieille, si je le suis un jour, il me restera ça. Le souvenir de la danse, les basses qui cognent dans le ventre, et l'ondulation de mes hanchesAuteur : Delphine de Vigan - Source : Les gratitudes
- On ne sait pas encore si le portable est cancérigène, mais on peut quand même noter que comme les cigarettes, on nous en vend déjà des lights et même des ultra-lights.Auteur : Laurent Ruquier - Source : Vu à la radio (2001)
- En cas de mouvement d'humeur, regarder l'heure et la noter. Regarder la petite aiguille des secondes. Cela travaille tout seul contre le mal et le bien.Auteur : Paul Valéry - Source : Mélange (1939)
- Je me suis éveillé de la Maladie, à l'âge de quarante-cinq ans, sain d'esprit et relativement de corps, si j'excepte un foie affaibli et ce masque de chair d'emprunt que portent tous ceux qui ont survécu au Mal... La plupart des survivants ne se souviennent pas du délire dans tous ses détails. Il semble que j'aie enregistré mes impressions sur ce mal et son délire, mais je n'ai guère souvenir d' avoir rédigé les notes que l'on a publiées en langue anglaise sous le titre « Naked lunch » (Le festin nu). C'est Jack Kerouac qui m'a suggéré ce titre, et je n'en ai compris la signification que très récemment, après ma guérison. Il a exactement le sens de ses termes : le Festin Nu cet instant pétrifié et glacé où chacun peut voir ce qui est piqué au bout de chaque fourchette. Auteur : William S. Burroughs - Source : Le Festin nu (1959)
- L'heure que j'avais attendue,
Le bonheur que j'avais rêvé.
A fui de mon âme éperdue,
Comme une note suspendue,
Comme un sourire inachevé !Auteur : Alexis-Félix Arvers - Source : Mes heures perdues (1900), A mon ami *** - Choisir, noter ce qui fut marquant, garder l'insolite, éliminer le banal, ce n'est pas mon affaire, puisque la plupart du temps, c'est l'ordinaire qui me pique et me vivifie.Auteur : Sidonie Gabrielle Colette - Source : Le Fanal bleu (1949)
- Vous n'avez pas besoin de mourir pour renaître. Elle avait noté ces mots quand elle était rentrée chez elle. Ces mots ensuite avaient fait leur chemin.Auteur : Delphine de Vigan - Source : Jours sans faim (2001) (sous le pseudonyme de Lou Delvig)
- Le péché est, du reste, la seule note de couleur vive qui subsiste dans la vie moderne.Auteur : Oscar Wilde - Source : Le Portrait de Dorian Gray (1891)
- Comme cet homme savait rire ! A chaque note qui fusait de sa gorge, c'était un verrou qui sautait de mon coeur.Auteur : Marise Liliane Appoline Bocoulon, dite Maryse Condé - Source : Moi, Tituba sorcière... (1986)
- Je commençais à comprendre pourquoi il y a des gens qui ne peuvent supporter le bruit de la mer. Elle a parfois une note désolée et sa persistance même, ces éternels roulements, fracas et glissements, portent sur les nerfs. Auteur : Daphne du Maurier - Source : Rebecca (1938)
- La terreur offre d'étonnantes perspectives de carrière pour les jeunes aujourd'hui. Promotions assurées, voyages autour du monde, notes de frais, retraite à quarante ans. J'aurai un fils, je lui conseillerai soit le droit, soit le terrorisme. Auteur : Hugh Laurie - Source : Tout est sous contrôle (2009)
Les mots proches de « note »
Nota ou nota benè Notabilité Notable Notablement Notaire Notamment Notaresse Notarial, ale Notarié, ée Notation Note Noté, ée Noter Notice Notification Notifier Notion Notocordal, ale Notoire Notoirement Notoriété Notre Nôtre Notre-dameLes mots débutant par not Les mots débutant par no
not nota nota nota bene notabilité notabilités notable notable notablement notables notables notai notaient notaire notaires notais notait notamment notant notarial notariale notariat notariaux notarié notarié notariée notariées notariés notariés notation notations note note noté noté notée notée notées notées notent noter notera noterai noterais noterait noteras notèrent noterez noterons noteront
Les synonymes de « note»
Les synonymes de noté :- 1. couac
- 1. annotation
2. commentaire
3. renvoi
4. remarque
5. réflexion
6. mention
7. observation
8. glose
9. apostille
10. explication
11. post
- 1. facturé
2. compté
synonymes de noté
Fréquence et usage du mot noté dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « note » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot noté dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Noté ?
Citations noté Citation sur noté Poèmes noté Proverbes noté Rime avec noté Définition de noté
Définition de noté présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot noté sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot noté notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 4 lettres.
