Définition de « opium »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot opium de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur opium pour aider à enrichir la compréhension du mot Opium et répondre à la question quelle est la définition de opium ?
Une définition simple : (fr-rég|?.pj?m) opium (m)
Approchant : codeine, methadon, morphine, heroine
Définitions de « opium »
Trésor de la Langue Française informatisé
OPIUM, subst. masc.
Suc épaissi obtenu par incision, avant la maturité du fruit, des capsules d'un pavot (papaver somniferum) qui contient notamment des alcaloïdes. Fumeur, mangeur d'opium; effet, ivresse, usage de l'opium; plateau, table à opium; dose, fumerie, grain, pipe d'opium. Là je vivais heureux, demeurant de longues journées couché sur mes nattes, aspirant la douce fumée d'un opium odorant et rêvant à une jeune fille (Du Camp,Mém. suic., 1853, p.110).L'opium rétrécit les pupilles, les réduit à un point, même dans l'ombre; c'est un des symptômes à quoi on reconnaît le fumeur encore sous l'effet de la drogue (Vailland,Drôle de jeu, 1945, p.192):Wiktionnaire
Nom commun - français
opium \?.pj?m\ masculin
-
Suc de plusieurs espèces de pavots, notamment le pavot blanc (Papaver somniferum) qui a des propriétés narcotiques.
- Comme tous les grands voluptueux, il est amoureux de l'impossible ; il voudrait s'élancer, dans les régions idéales, à la recherche de la beauté sans défaut ; l'ivresse ne lui suffit pas, il lui faut l'extase ; à l'aide de l'opium, il tâche de dénouer les liens qui enchaînent l'âme au corps ; il demande à l'hallucination ce que la réalité lui refuse. ? (Théophile Gautier, La Péri, 1845, dans Théâtre. Mystère. Comédies et ballets, G. Charpentier, 1882, page 295)
- Pour préparer sa pipe, le fumeur saisit quelques gouttes d'opium liquide ou plutôt sirupeux au bout d'une aiguille qu'il roule ensuite au-dessus de la flamme de sa petite lampe jusqu'à ce que l'opium ait pris une consistance molle de la grosseur d'un pois. Il l'enfonce alors dans un petit trou percé au centre du fourneau de la pipe, aspire trois ou quatre fois, baisse doucement les paupières pour concentrer son bonheur... et c'est tout. ? (Camille Paris, Voyage d'exploration de Hué en Cochinchine, E. Leroux, 1889, page 20)
- Il [Pierre Carle Édouard Potain] est un des très rares médecins qui aient su administrer la digitale et la quinine, de même que l'Anglais Sydenham fut presque le seul à savoir jouer de son opium. ? (Léon Daudet, Souvenirs littéraires ? Devant la douleur, Grasset, 1915, réédition Le Livre de Poche, page 131)
- « Sydenham connaissait l'opium, profondément inconnu, et comme déchaîné depuis sa mort. J'enrage de voir tourner au mal, faute d'un maître cuisinier, une aussi merveilleuse puissance, un pareil ennemi de la douleur ». Son avis était que l'opium, engourdissant toute souffrance, physique ou morale, fait pencher d'abord l'esprit vers la joie ? d'où l'euphorie au début de l'intoxication ? puis, à la longue, engourdit la joie à son tour et amène en nous les ténèbres. Il fallait donc, non se passer de lui, mais en quelque sorte le domestiquer, l'humaniser : « C'est ce qu'avait compris Sydenham. C'est ce qu'il n'a pas complètement réalisé, car le laudanum n'est qu'un commencement d'apprivoisement de l'opium ». ? (Léon Daudet, ?'Souvenirs des milieux littéraires, politiques, artistiques et médicaux/Salons et Journaux'', Grasset, 1917, réédition Le Livre de Poche, page 315)
-
? As-tu de nouveaux ennuis ? Qu'est-ce que tu veux, si tu ne peux pas te passer de drogue, prends-en. Fume un peu, ça te calmera.
? J'ai horreur de l'opium, la drogue des concierges. ? (Pierre Drieu La Rochelle, Le Feu follet (1931)) - Quand les temps sont durs et que la souffrance risque de dépasser ses forces de résistance, le paysan ira rendre visite au génie protecteur du village, petit monstre hilare ou grimaçant et barbouillera prudemment ses lèvres gourmandes des restes d'un pot d'opium ? [?]. ? (Albert Gervais, Æsculape dans la Chine en révolte, Gallimard, 1953, page 20)
- En songeant que le liquide s'était éventé, bien qu'enfermé dans une boîte métallique, il fut ressaisi par le doute qui le tenaillait : quarante ans et des broquilles s'étaient écoulés depuis qu'on avait transformé l'opium de l'Empire des Indes en morphine dans les labos de Sa Gracieuse Majesté. ? (Thierry Marignac, Morphine Monojet: ou Les fils perdus, Éditions du Rocher, 2016)
-
(Figuré) Ce qui engourdit l'esprit, substitue le rêve à la réalité.
- La dévotion, prétend-il, est un opium pour l'âme ; elle égaye, anime et soutient quand on en prend peu ; une trop forte dose endort, ou rend furieux, ou tue. ? (Jean-Jacques Rousseau, Julie ou la Nouvelle Héloïse, 1761, sixième partie, Lettre VIII de Madame de Wolmar)
- Est-ce moi qui glorifierai la corruption, cet infâme moyen de gouvernement, véritable poison, véritable opium qu'on jette dans les veines du corps social, et qui aggrave le mal qu'il semble assoupir ? ? (Alphonse de Lamartine, discours du 10 janvier 1836, cite par Gustave de Molinari dans Biographie politique de M. A. de Lamartine, 1843, page 87)
- La religion est le soupir de la créature accablée par le malheur, l'âme d'un monde sans c?ur, de même qu'elle est l'esprit d'une époque sans esprit. C'est l'opium du peuple. ? (Karl Marx, Contribution à la critique de la Philosophie du droit de Hegel, 1843, traduction de Jules Molitor, Éditions Allia, 1989, p. 8)
- Lisez et ne rêvez pas. Plongez-vous dans de longues études ; il n'y a de continuellement bon que l'habitude d'un travail entêté. Il s'en dégage un opium qui engourdit l'âme. ? (Gustave Flaubert, Correspondance, lettre à Louise Colet, 26 juillet 1851)
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Extrait des capsules de pavot blanc, qui a des propriétés narcotiques. Les Asiatiques font un grand usage d'opium. L'usage de l'opium devient facilement mortel. Une fumerie, un fumeur d'opium.
Littré
-
1Suc épaissi des capsules de diverses espèces du genre pavot et surtout du pavot somnifère (papaver somniferum, L.), qui nous vient de la Turquie et de la Perse en morceaux arrondis ou aplatis. L'opium est une substance narcotique, très vénéneuse à haute dose, calmante et soporifique à dose médicale.
Après que l'opium a été recueilli, on l'humecte et on le pétrit avec de l'eau ou du miel, jusqu'à ce qu'il ait acquis la consistance, la viscosité et l'éclat de la poix bien préparée?; on le réduit en petits pains
, Raynal, Hist. phil. III, 30.Le pavot blanc se cultive en grande quantité dans l'Inde et l'Orient?; après la floraison, on fait des incisions longitudinales aux capsules?; il en découle un suc laiteux qui se concrète facilement?; ce suc, ainsi devenu concret, constitue l'opium
, Thenard, Traité de chimie, t. III, p. 365, dans POUGENS.Fig.
L'armée était au Saussay, dans une tranquillité profonde, dont l'opium avait gagné jusqu'à M. le duc de Bourgogne
, Saint-Simon, 213, 125.La dévotion est un opium pour l'âme
, Rousseau, Hél. VI, 8. -
2L'opium est employé aussi comme un excitant du système nerveux, qui procure un sentiment momentané de bien-être. Les fumeurs d'opium.
Ce qu'il y a de certain, c'est qu'aujourd'hui même, les preneurs d'opium ou de haschisch se procurent, sous les haillons de la pauvreté et sans sortir d'une misérable taverne, un bonheur et des jouissances auxquels il ne manque que la réalité
, Silvestre de Sacy, Instit. Mém. hist. et litt. anc. t. IV, p. 61.Fig.
Ils [les poëtes] versent? Cet opium divin que dans sa soif d'extase Le rêveur Orient puise en vain dans son vase
, Lamartine, Joc. VI, 234.
REMARQUE
On a longtemps écrit et prononcé opion, témoin ces vers de Voltaire?: L'opium peut servir un sage?; Mais, suivant mon opinion, Il lui faut, au lieu d'opion, Un pistolet et du courage?; et ces vers de Senecé?: Lit-on du mal, c'est jubilation?; Lit-on du bien, des mains tombe le livre, Qui vous endort comme bel opion.
HISTORIQUE
XVIe s. L'odeur fascheuse du suc de pavot noir, qu'on appelle opion, fait qu'il est malaisé à mesler parmy le boire?
, Paré, XXIII, 44.
Encyclopédie, 1re édition
OPIUM, s. m. (Hist. nat. des drog.) C'est un suc concret, résineux & gommeux, pesant, compact, pliant, inflammable, d'un roux noir, d'une odeur narcotique, d'un goût acre & amer. Il nous vient en gâteaux arrondis, applatis, de la grosseur d'un pouce, qui pesent une demi livre ou une livre, & sont enveloppés dans des feuilles de pavots. On l'apporte de l'Anatolie, de l'Egypte & des Indes.
Les Arabes & les Droguistes recommandent l'opium de Thèbes ou celui que l'on recueilloit en Egypte auprès de Thèbes, mais on ne fait plus à présent cette distinction. De quelqu'endroit que vienne l'opium, on estime celui qui est naturel, un peu mou, qui obéit sous les doigts, qui est inflammable, d'une couleur brune ou noirâtre, d'une odeur forte, puante, & assoupissante. On rejette celui qui est sec, friable, brûlé, mêlé de terre, de sable ou d'autres ordures.
Les anciens distinguoient deux sortes de suc de pavot ; l'un étoit une larme qui découloit de l'incision que l'on faisoit à la tête des pavots : elle s'appelloit ??????? ????, & chez les médecins ????? par autonomasie. L'autre s'appelloit ????????? ou ???????? ; c'étoit le suc épaissi que l'on retiroit de toute la plante. Ils disoient que le méconium étoit bien moins actif que l'opium.
Présentement on ne nous en fournit que d'une sorte sous le nom d'opium : savoir, un suc qui découle de l'incision des têtes de pavots blancs ; on n'en trouve aucune autre espece parmi les Turcs & à Constantinople, que celui que l'on apporte en gâteaux. Cependant, chez les Perses on distingue les larmes qui découlent des têtes auxquelles on fait des incisions, & ils recueillent avec grand soin celles qui coulent les premieres, qu'ils estiment beaucoup comme ayant plus de vertu.
La plante dont on retire le suc, s'appelle papaver hortense, se nine albo, sativum, Dioscorid. album, Plinii, Cés. Bauhin, p. 170. Sa racine est environ de la grosseur du doigt, rempli comme le reste de la plante d'un lait amer. Sa tige a deux coudées ; elle est branchue, ordinairement lisse, quelquefois un peu velue. Sur cette tige naissent des feuilles semblables à celles de la laitue, oblongues, découpées, crêpues, de couleur de verd de mer. Ses fleurs sont en rose, plus souvent à quatre pétales blancs, placés en rond, & qui tombent bientôt. Le calice est composé de deux feuillets ; il en sort un pistil ou une petite tête, entourée d'un grand nombre d'étamines. Cette tête se change en une coque, de la figure d'un ?uf, qui n'a qu'une seule loge, garnie d'un chapiteau : elle est ridée, étoilée, munie intérieurement de plusieurs lames minces qui tiennent à ses parois ; à ces lames adherent, comme à des placenta, grand nombre de graines très-petites, arrondies, blanches, d'un goût doux & huileux.
Dans plusieurs provinces de l'Asie mineure, on seme les champs de pavots blancs, comme nous semons le froment ; aussi-tôt que les têtes paroissent, on y fait une legere incision ; & il en decoule quelques gouttes de liqueur laiteuse, qu'on laisse figer, & que l'on recueille ensuite. M. Tournefort rapporte que la plus grande quantité d'opium se tire par la contusion & l'expression de ces mêmes têtes : mais Belon n'en dit rien, non plus que K?mpfer qui a fait une dissertation sur l'opium persique. Ces deux derniers auteurs distinguent trois sortes d'opium, mais tirés seulement par incision.
Dans la Perse on recueille l'opium au commencement de l'été. On fait des plaies en sautoir à la superficie des têtes qui sont prêtes d'être mûres. Le couteau qui sert à cette opération a cinq pointes ; & d'un seul coup il fait cinq ouvertures longues & paralleles. Le lendemain on ramasse avec des spatules le suc qui découle de ces petites plaies, & on le renferme dans un petit vase attaché à la ceinture.
Ensuite on fait l'opération de l'autre côté des têtes, pour en tirer le suc de la même maniere. La larme que l'on recueille la premiere, s'appelle gobaar ; elle passe pour la meilleure ; sa couleur est blanchâtre ou d'un jaune pâle ; mais elle devient brune, lorsqu'elle est exposée long-tems au soleil, ou qu'elle est trop séchée. La seconde larme que l'on recueille, n'a pas tant d'efficace, & elle n'est pas si chere. Sa couleur est le plus souvent obscure, ou d'un goût noirâtre. Il y en a qui font une troisieme opération, par laquelle on retire une larme très-noire & de peu de vertu.
Après que l'on a recueilli l'opium, on en fait une préparation, en l'humectant avec un peu d'eau ou de miel, en le remuant continuellement & fortement avec une espece de spatule dans une assiette de bois plate, jusqu'à ce qu'il ait acquis la consistance, la viscosité, & l'éclat de la poix bien préparée ; ensuite on le remanie dans la main ; & enfin on en fait de petits cylindres ronds que l'on met en vente : Lorsque les marchands n'en veulent que de petits morceaux, on les coupe avec des ciseaux.
L'opium ainsi préparé s'appelle chez les Perses theriaack-malideh, c'est-à-dire, thériaque préparée par le broyement, ou bien theriaack affinum, c'est-à-dire, thériaque opiée, pour la distinguer de la thériaque d'Andromaque, qu'ils nomment theriaack-farnuk ; car ces peuples regardent l'opium comme le remede vanté par les Poëtes, qui donne la tranquillité, la joie & la sérénité.
Cette maniere de préparer l'opium, est le travail perpétuel des revendeurs qui sont dans les carrefours, & qui exercent fortement leurs bras à ce travail. Ce n'est pas là cependant la seule façon de préparer ce suc : très-souvent on broie l'opium, non pas avec de l'eau, mais avec une si grande quantité de miel, que non-seulement il l'empêche de se sécher, mais encore il tempere son amertume.
La préparation la plus remarquable est celle qui se fait, en mêlant exactement avec l'opium, la noix muscade, le cardamome, la canelle, & le macis réduits en poudre très-fine. On croit que cette préparation est très-utile pour le c?ur & le cerveau : elle s'appelle pholonia, c'est le philonium de Perse ; d'autres n'emploient point les aromates dont nous venons de parler ; mais ils mettent beaucoup de saffran & d'ambre dans la masse de l'opium. Plusieurs font la préparation chez eux à leur fantaisie.
Outre ces préparations dont on ne fait usage qu'en pillules, Koempfer fait mention d'une certaine liqueur célebre chez les Perses, que l'on appelle cocomar, dont on boit abondamment par intervalles.
Les uns préparent cette liqueur avec les feuilles de pavots qu'ils font bouillir peu de tems dans l'eau simple. D'autres la font avec les têtes pilées & macérées dans l'eau ; ou bien ils en mettent sur un tamis, versent dessus sept à huit fois la même eau ; en y mêlant quelque chose qui y donne de l'agrément selon le goût de chacun.
K?mpfer ajoute une troisieme sorte d'opium, qu'il qualifie d'électuaire, qui réjouit & qui cause une agréable ivresse. Les parfumeurs & les médecins préparent différemment cet électuaire, dont la base est l'opium ; on le destine par les différentes drogues que l'on y mêle, à fortifier & à récréer les esprits : c'est pourquoi on en trouve différentes descriptions, dont la plus célebre est celle qu'a trouvée Hasjem-Begi. L'on dit qu'elle excite une joie surprenante dans l'esprit de celui qui en avale, & qu'elle charme le cerveau par des idées, & des plaisirs enchantés. (D. J.)
Opium cyrenaïque, (Mat. médic.) nom donné par quelques écrivains du moyen âge à l'assa-f?tida, parce que de leur tems on tiroit principalement cette drogue de Cyrene, ou comme dit Avicene, du Kirvan, ce qui est le même pays.
Étymologie de « opium »
- Emprunté au latin opium (« suc de pavot »), du grec ancien ?????.
- Emprunté au latin opium (« suc de pavot »), du grec ancien ?????.
?????, diminutif de ????, suc?: proprement petit suc. ???? est de même radical que le latin sapa (voy. SÈVE), et l'allem. Saft, suc.
opium au Scrabble
Le mot opium vaut 8 points au Scrabble.
Informations sur le mot opium - 5 lettres, 3 voyelles, 2 consonnes, 5 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot opium au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
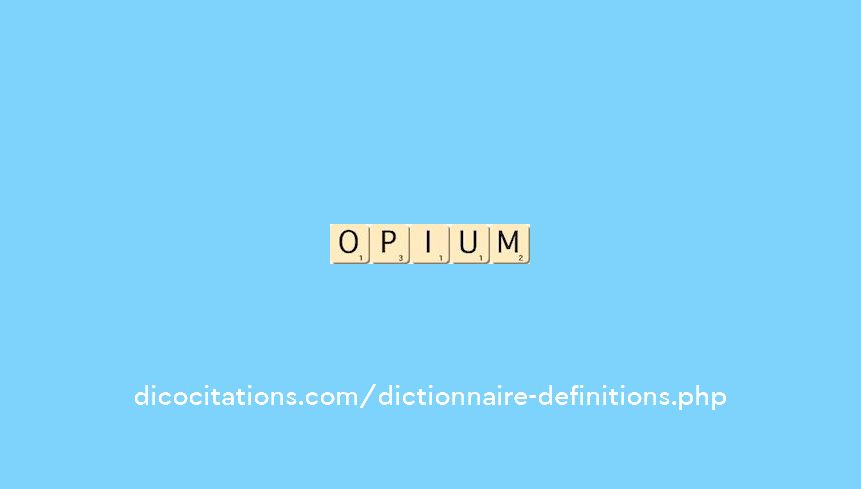
Les rimes de « opium »
On recherche une rime en OM .
Les rimes de opium peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en om
Rimes de paume Rimes de baumes Rimes de radôme Rimes de caesium Rimes de embaument Rimes de gommes Rimes de nomme Rimes de années-homme Rimes de calcium Rimes de gastronome Rimes de surhomme Rimes de réticulum Rimes de suivez-moi-jeune-homme Rimes de Betekom Rimes de forums Rimes de bonhommes Rimes de trivium Rimes de rogommes Rimes de hématome Rimes de diplôme Rimes de gastronomes Rimes de hélium Rimes de binômes Rimes de ex-homme Rimes de bégum Rimes de atome Rimes de adénocarcinome Rimes de forum Rimes de ribosomes Rimes de heaumes Rimes de mercurochrome Rimes de pogrome Rimes de économe Rimes de métronome Rimes de hématomes Rimes de medium Rimes de méningiome Rimes de bonhomme Rimes de homes Rimes de grossiums Rimes de ad infinitum Rimes de psaume Rimes de factums Rimes de vivarium Rimes de caecum Rimes de custom Rimes de prodrome Rimes de majordomes Rimes de slaloms Rimes de anthonomeMots du jour
paume baumes radôme caesium embaument gommes nomme années-homme calcium gastronome surhomme réticulum suivez-moi-jeune-homme Betekom forums bonhommes trivium rogommes hématome diplôme gastronomes hélium binômes ex-homme bégum atome adénocarcinome forum ribosomes heaumes mercurochrome pogrome économe métronome hématomes medium méningiome bonhomme homes grossiums ad infinitum psaume factums vivarium caecum custom prodrome majordomes slaloms anthonome
Les citations sur « opium »
- L'opium dégage l'esprit. Jamais il ne rend spirituel. Il éploie l'esprit. Il ne le met pas en pointe.Auteur : Jean Cocteau - Source : Opium (1930)
- L'homme qui, s'étant livré longtemps à l'opium ou au hachisch, a pu trouver, affaibli comme il l'était par l'habitude de son servage, l'énergie nécessaire pour se délivrer, m'apparaît comme un prisonnier évadé.Auteur : Charles Baudelaire - Source : Les Paradis artificiels (1860)
- La religion est le soupir de la créature accablée, le coeur d'un monde sans coeur, comme elle est l'esprit d'une époque sans esprit. Elle est l'opium du peuple.Auteur : Karl Marx - Source : Contribution de la critique de "la Philosophie du droit" de Hegel (1841)
- On peut se demander aujourd'hui si Marx ne s'est pas trompé, et si ce n'est pas plutôt l'opium qui est devenu la religion du peuple.Auteur : André Frossard - Source : Sans référence
- L'érudition est dans beaucoup de cas une forme mal déguisée de la paresse spirituelle, ou un opium pour endormir les inquiétudes intimes de l'esprit.Auteur : Miguel de Unamuno - Source : Essais
- Je préfère au constance, à l'opium, au nuits,
L'élixir de ta bouche où l'amour se pavane;
Quand vers toi mes désirs partent en caravane,
Tes yeux sont la citerne où boivent mes ennuis.Auteur : Charles Baudelaire - Source : Les Fleurs du Mal (1857), XXVI - Sed non satiata - L'optimiste est l'opium du genre humain! L'esprit saint pue la connerie.Auteur : Milan Kundera - Source : La Plaisanterie (1975)
- Les Européens qui fument de l'opium me font penser aux Chinois qui portent des chapeaux melon.Auteur : Sacha Guitry - Source : L'Esprit
- La culture tend à prendre la place qui fut naguère celle de la religion. C'est en son nom maintenant qu'on mobilise, qu'on prêche les croisades. A elle le rôle de l'opium du peuple.Auteur : Jean Dubuffet - Source : Asphyxiante culture (1968)
- ... la philosophie se convertit volontiers et souvent en une sorte de proxénétisme, spirituel si l'on veut. D'autres fois, en opium pour endormir les chagrins.Auteur : Miguel de Unamuno - Source : Du sentiment tragique de la vie (1913)
- Nous sommes deux fumeurs d'opium chacun dans son nuage, sans rien voir au-dehors, seuls, sans nous comprendre jamais nous fumons, visages agonisants dans un miroir, nous sommes une image glacée à laquelle le temps donne l'illusion du mouvement, un cristal de neige glissant sur une pelote de givre dont personne ne perçoit la complexité des enchevêtrementsAuteur : Mathias Enard - Source : Boussole (2015)
- Plongez-vous dans de longues études; il n'y a de continuellement bon que l'habitude d'un travail entêté. Il s'en dégage un opium qui engourdit l'âme.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Correspondance, 26 juillet 1851
- La vie est un opium dont on ne se lasse jamais.Auteur : Maxence Fermine - Source : Opium (2002)
- Langage: Camouflage d'idée, ou opium de l'intelligence.Auteur : Georges Elgozy - Source : L'Esprit des mots, ou l'Antidictionnaire (1981)
- L'intériorité n'est plus chez elle. Le monde l'a envahie et la surpeuplée. Autrefois, je n'arrivais à me concentrer que chez moi, dans la solitude et le silence. C'est exactement ce que je dois fuir désormais, si je veux espérer employer efficacement les heures d'une journée : sinon, j'explore sur l'internet toutes les choses qui me passent par la tête, les brèves distractions mentales qui ponctuent normalement un travail soutenu prennent des proportions démesurées, le temps file entre mes doigts et je me regarde le perdre en continuant de tirer des bouffées de cet opium. C'est dans l'étendue physique - beaucoup moins foisonnante, en définitive - que je me réfugie pour retrouver la faculté de me concentrer. Auteur : Maël Renouard - Source : Fragments d'une mémoire infinie (2016)
- On peut donc voyager non pour se fuir, chose impossible, mais pour se trouver. Le voyage devient alors un moyen, comme les Jésuites emploient les exercices corporels, les bouddhistes l'opium et les peintres l'alcool.Auteur : Jean Grenier - Source : Les Iles (1933)
- Il est terrible de penser que les seuls moyens découverts jusqu'à présent par l'homme pour apaiser la souffrance, le chloroforme, l'opium, la morphine, l'hypnotisme, ne sont, en réalité, que des approximatifs de la mort.Auteur : Louis Dumur - Source : Petits aphorismes sur la souffrance (1892)
- Le travail est l'opium du peuple... Je ne veux pas mourir drogué!Auteur : Boris Vian - Source : Sans référence
- La Révolution est une purge ; une extase que seule prolonge la tyrannie. Les opiums sont pour avant et après.Auteur : Ernest Hemingway - Source : Paradis perdu (1949)
- Le marxisme est le soupir de la créature accablée, l'âme d'un monde sans âme, de même qu'il est l'esprit d'un monde sans esprit. Il est l'opium du peuple.Auteur : Bernard-Henri Lévy - Source : La Barbarie à visage humain (1977)
- Le sport est un opium décérébrant le peuple.Auteur : Mathieu Riboulet - Source : Entre les deux il n'y a rien (2015)
- Le livre est l'opium de l'Occident.Auteur : Anatole France - Source : La Vie littéraire (1888)
- La faveur est comme l'opium:
Un peu, fait dormir; et beaucoup, fait mourir.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe - La religion est l'opium du peuple.Auteur : Karl Marx - Source : Contribution de la critique de "la Philosophie du droit" de Hegel (1841)
- Ce sont les bourgeois qui ont fait de la religion l'opium du peuple. Ils l'ont dénaturée à leur profit. Auteur : Béatrix Beck - Source : Léon Morin, prêtre (1952)
Les mots proches de « opium »
Opiat Opilation Opiler Opimes Opinant Opiner Opineur Opiniâtre Opiniâtrément Opiniâtrer Opiniâtreté Opinion Opisthodome Opisthotonos OpiumLes mots débutant par opi Les mots débutant par op
opiacé opiacé opiacé opiacées opiacées opiacés opiacés opiat opiats opimes opina opinai opinaient opinais opinait opinant opine opiné opinel opinels opiner opinèrent opines opiniâtra opiniâtre opiniâtre opiniâtrement opiniâtres opiniâtreté opiniâtrez opinion opinions opinions Opio opiomane opiomane Opitter opium
Les synonymes de « opium»
Aucun synonyme.Fréquence et usage du mot opium dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « opium » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot opium dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Opium ?
Citations opium Citation sur opium Poèmes opium Proverbes opium Rime avec opium Définition de opium
Définition de opium présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot opium sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot opium notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 5 lettres.
