La définition de Nous du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Nous
Nature :
Prononciation : noû ; l's se lie : noû-z avons
Etymologie : Bourguig. no ; picard, nos ; wallon, noisez ; provenç. nos ; espagn. et portug. nos ; ital. noi ; du latin nos ; grec au duel, sanscr. nas.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de nous de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec nous pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Nous ?
La définition de Nous
Nous sujet se place avant le verbe, excepté dans les phrases interrogatives. Nous partirons demain.
Toutes les définitions de « nous »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
, de la première personne du pluriel. Il s'emploie comme sujet, comme attribut et comme complément avec ou sans préposition. Nous, sujet, se place avant le verbe, sauf dans les phrases interrogatives où il le suit. Nous partons. Où allons-nous? Nous peut être attribut : C'est nous. Nous, complément direct ou complément indirect sans préposition, se place avant le verbe. Il nous regarde. Il nous parle. Nous regarde-t-il? Nous parle-t-il? Ne nous regardez pas. Ne nous parlez pas. Toutefois, dans les phrases impératives sans négation, il se place après le verbe. Regardez-nous. Parlez-nous. Nous, complément précédé d'une préposition, se met toujours après le verbe, l'adjectif ou l'adverbe auquel il se rapporte. Il parle de nous. Il est contre nous. On est content de nous. Il n'a rien dit relativement à nous. Je vous l'avouerai entre nous. Mais on dit familièrement, dans le sens de cette dernière phrase, Entre nous soit dit. Nous se répète lorsqu'on veut insister sur la personne, donner plus d'énergie à la phrase. Nous, nous n'oserions pas faire cela. Nous prétendons, nous, ne pas le faire. On nous a insultés, nous! On nous a fait cela, à nous! Il se place par répétition après deux ou plusieurs pronoms sujets du verbe et dont l'un est à la première personne. Vous et moi, nous sommes dans le même cas. Toi, lui et moi, nous avons été heureux de nous rencontrer à cette occasion. Nous se dit souvent pour désigner une Collectivité dont fait partie la personne qui parle, qu'il s'agisse de l'humanité, d'un pays, d'une province, d'une famille, ou encore de gens ayant en commun des idées, des croyances, une formation, des habitudes, etc. La Grèce et Rome nous ont apporté la civilisation. L'administration que l'Europe nous envie. Chez nous, À la maison, dans notre province, dans notre pays. Fam., Nous autres, Nous, de notre côté, Nous, tant que nous sommes de personnes du même côté, du même avis, du même rang. Vous allez jouer, nous autres nous allons à la promenade. Vous désirez une grande opulence, nous autres nous sommes contents d'avoir le nécessaire. Nous-mêmes. Voyez MÊME. Nous s'employait, au lieu du singulier Je ou Moi, par le roi dans les lois, dans les ordonnances, etc. : Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit. Il s'emploie encore par les évêques dans leurs mandements, et en général par les personnes qui ont caractère et autorité : Nous N., certifions. Nous N., déclarons. Un auteur, un orateur le dit quelquefois en parlant de lui-même. Dans cet emploi de Nous, l'adjectif ou le participe qui s'y rapporte se met au singulier. Il s'emploie aussi quelquefois, dans le style familier, au lieu du pronom personnel Il ou Elle. On l'a fait apercevoir plusieurs fois de sa faute, mais nous sommes opiniâtre, nous ne voulons pas nous corriger.
Littré
-
1Nous sujet se place avant le verbe, excepté dans les phrases interrogatives. Nous partirons demain.
Partirons-nous demain?? Soit que nous nous élevions, pour parler métaphoriquement, jusque dans les cieux?; soit que nous descendions dans les abîmes, nous ne sortons point de nous-mêmes?; et ce n'est jamais que notre propre pensée que nous apercevons
, Condillac, Conn. hum. I, 1.Le singe, ayant des bras et des mains, s'en sert comme nous, mais sans songer à nous
, Buffon, Quadrup. t. VII, p. 54. - 2Quelquefois, par une répétition qui donne de l'énergie à la phrase, on place nous, sujet, avant et après le verbe. Nous voulons, nous, que telle chose se fasse.
-
3Nous, régime direct ou indirect, se place avant le verbe. Il nous conduit. Il nous a conduits. Il nous parlera. Il nous a parlé. Ne nous parlez pas. Ne nous reconduisez pas.
Tout est en feu jusque sur les bords de la rivière de l'Oise?; nous pouvons voir de nos faubourgs [de Paris] la fumée des villages qu'ils [les ennemis] nous brûlent
, Voltaire, Lett. 74.Il faut en excepter les phrases impératives sans négation. Parlez-nous. Regardez-nous.
-
4Quand le verbe est réfléchi, nous régime se met avant le verbe. Nous nous convenions. Nous ne nous convenons pas. Ne nous fatiguons pas.
Il faut excepter les phrases impératives sans négation. Aimons-nous.
-
5Nous est aussi régime des prépositions. On est injuste envers nous. Une averse est tombée sur nous. Tout tourne contre nous. Entre nous soit dit.
Nous plaignons le sort de l'enfance, et c'est le nôtre qu'il faudrait plaindre, nos plus grands maux nous viennent de nous
, Rousseau, Émile, I. -
6Nous se dit collectivement pour exprimer nos compatriotes dans le présent et dans le passé.
Plus d'un écrivain? ne fait point de difficulté de dire nous, nos aïeux, nos pères, quand il parle des Francs qui vinrent des marais delà le Rhin et la Meuse piller les Gaules et s'en emparer?; l'abbé Vély dit nous?; hé?! mon ami, est-il bien sûr que tu descendes d'un Franc?? pourquoi ne serais-tu pas d'une pauvre famille gauloise??
Voltaire, Pol. et législ. Comm. Espr. des lois, XXXIX.Rome autrefois nous [les habitants de la Gaule] trompa, nous désunit, nous massacra, nous enchaîna
, Voltaire, Dict. phil. César. -
7 Familièrement. Nous autres, ce que nous sommes de personnes du même côté, du même avis, du même rang. Vous allez jouer?; nous autres nous allons à la promenade.
Nous deux, vous et moi, lui et moi.
De nous deux à l'instant que le coupable expire
, Voltaire, Mahomet, V, 4. -
8Il s'emploie par répétition, avec deux pronoms dont l'un est de la première personne et l'autre de la deuxième ou de la troisième personne ou un substantif. Vous et moi nous partirons ensemble. Lui et moi nous parlerons pour vous. Mon ami et moi nous restons à la campagne. Il nous cherche vous et moi.
Ma gloire loin d'ici vous et moi nous appelle
, Racine, Mithr. II, 4.Songez-vous quel serment vous et moi nous engage??
Racine, Iphig. V, 2. - 9Lorsque nous, employé comme sujet ou comme régime, est joint à un autre nom qui concourt avec ce pronom à former le sujet ou le régime, il faut d'abord mettre nous avant le verbe, puis le répéter après ce verbe, sans préposition s'il est sujet ou régime direct, avec une préposition s'il est régime indirect, afin de le lier avec le nom qui concourt à former le sujet ou le régime. Nous partirons demain, nous et nos domestiques. Il nous a bien traités, nous et nos amis. Il nous a donné de l'argent, à nous et à nos compagnons.
-
10Quand nous est suivi de qui, on accorde avec nous le verbe dont qui est le sujet.
Quand nous, qui vivons sous des lois civiles, sommes contraints à faire quelque contrat que la loi n'exige pas, nous pouvons, à la faveur de la loi, revenir contre la violence
, Montesquieu, Espr. XXVI, 20. -
11Il se prend dans un sens indéterminé.
Il faut laisser ici des gens honnêtes, doux, Par nous-même choisis, qui dépendent de nous, Qui soient à nous, de nous qui lui parlent sans cesse
, Collin D'Harleville, Vieux célib. II, 6.Dans ce sens, il peut se construire avec on.
Au moins en pareil cas est-ce un bonheur bien doux, Quand on sait qu'on n'a point d'avantage sur nous
, Molière, le Dép. II, 4.Et qu'on s'aille former un monstre plein d'effroi De l'affront que nous fait son manquement de foi
, Molière, Éc. des f. IV, 8. -
12 Familièrement. Ce que c'est que de nous?! c'est-à-dire voyez quelle est la chétive condition de l'humanité.
Il [un cheval] s'est jeté comme un furieux par-dessus les barres, et s'est crevé le c?ur?; j'ai dit en le voyant mort, comme M. de Montbazon?: voyez ce que c'est de nous
, Sévigné, 460.Ce que c'est que de nous?! moi, cela me confond
, Regnard, le Légat. V, 7.Avez-vous vu comme il parlait tout seul?? ce que c'est que de nous?!
Beaumarchais, Barb. de Sév. III, 12. -
13Il s'emploie au lieu de je ou moi par les personnes qui ont caractère et autorité. Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit.
Dire nous, quoiqu'on ne soit qu'un, lorsque celui qui parle est un souverain ou une personne constituée en dignité, et qu'elle fait un acte solennel de sa volonté ou de son autorité?: usage qui, je crois, prit naissance chez les empereurs romains, lorsqu'ils faisaient semblant de prendre conseil du sénat, et d'exprimer dans leurs édits une volonté collective
, Marmontel, Élém. litt. ?uv. t. X, p. 365, dans POUGENS.Alors l'adjectif ou le participe qui y a rapport se met au singulier?: Nous, juge de paix soussigné, sommes convaincu, etc.
Il se dit aussi pour je ou moi par une sorte d'emphase, et sans qu'il s'y attache aucune idée d'autorité.
De notre grandeur seule ayons des c?urs jaloux, Ne vivons que pour nous, et ne pensons qu'à nous
, Corneille, Oth. II, 4.?Taisez-vous?; Je vous apprendrai bien s'il faut sortir sans nous
, Molière, Éc. des mar. I, 2.Pyrrhus revient à nous?; eh bien, chère Cléone, Conçois-tu les transports de l'heureuse Hermione??
Racine, Andr. III, 3.C'est vous qu'on demande. - Eh bien, que nous veut-on??
Montfleury, Femme juge et part. III, 8.Je demande pourquoi, dans un écrit qui est l'ouvrage d'un seul homme, l'auteur, en parlant de lui-même, se croit obligé de dire nous
, Marmontel, Élém. litt. ?uv. t. X, p. 371. - 14 Familièrement, il s'emploie au lieu de il ou elle. On l'a fait apercevoir de sa faute, mais nous ne voulons pas nous corriger, nous sommes opiniâtre.
-
15 Interrogativement, il se dit pour consulter la ou les personnes avec qui l'on est.
Célimène?: Voulons-nous nous asseoir?? - Arsinoé?: Il n'est pas nécessaire
, Molière, Misanthr. III, 4. -
16Nous-mêmes, voy. MÊME.
Substantivement, d'autres nous-mêmes, voy. MÊME.
-
17Dans les phrases où se trouvent en ou y, nous se met avant ces particules et le verbe. Il nous en donnera. Il nous y a conduits. Ne nous en donnez pas. Ne nous y conduisez pas.
Si la phrase est impérative sans négation, nous se met après le verbe. Menez-nous-y. Donnez-nous-y une place. Donnez-nous-en.
-
18Chez nous, dans notre maison, dans notre société, dans notre pays.
Il est vrai, notre ami?; peut-être que chez vous Vous trouvez des sujets de craindre pour chez nous
, Molière, Éc. des femmes, I, 1.Mon cher philosophe militaire, vous m'aviez mandé, il y a deux mois, que vous passeriez chez nous, et je vous attendais
, Voltaire, Lett. d'Argence, 3 août 1770. -
19 S. m. Le nous.
Calliope?: Tu devrais l'obliger, pour l'honneur de ton temple, D'aimer ainsi que nous - Uranie?: Les Muses n'aiment pas. - Calliope?: Et qui les en soupçonne?? Ce nous n'est pas pour nous?; je parle, en la personne Du sexe en général, des dévotes d'amour
, La Fontaine, Climène, comédie.Ils commençaient à dire nous?; ah?! qu'il est touchant ce nous prononcé par l'amour?!
Staël, Corinne, IV, 1.Nous s'emploie quelquefois dans le même sens que l'on dit le moi.
Cet être appelé nous est formé de deux principes de différente nature, tellement unis, qu'il règne entre les mouvements et les affections de l'un et de l'autre une correspondance que nous ne saurions ni surprendre ni altérer, et qui les tient dans un assujétissement réciproque
, D'Alembert, Disc. prélim. Encycl. ?uv. t. I, p. 192, dans POUGENS.
REMARQUE
Nous se joint par un trait d'union au verbe et aux particules en et y dans les phrases impératives.
HISTORIQUE
Xe s. Tut oram [prions tous] que por nos [elle] degnet preier
, Eulalie.
XIe s. Seignor, que faites?? ço dist li apostolie [le pape], Que valt cist crit, cist dol [deuil] en ceste noise?? Chi chi se doilet, à nos otros [à nous autres] est il goie [joie]
, St Alexis, CI. Nus [à nous] ne semble pas raison que?
, Lois de Guill. 44.
XVIe s. Les reproches que nous faisons les uns aux aultres
, Montaigne, IV, 45. Voilà la huguenotaille à gronder, chacun à part, sans pouvoir dire nous
, D'Aubigné, Conf. II, 111.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
NOUS. - REM. Ajoutez?:Wiktionnaire
Pronom personnel - ancien français
nous \Prononciation ?\
- Variante tardive de nos.
Nom commun - français
nous \nu\ masculin singulier
-
(Rare) Collectivité, souvent nationale, vue par ses propres membres, par opposition à un ou plusieurs groupes perçus comme extérieurs ou étrangers.
- Dans tout cela, une véritable réflexion sur le nous québécois, sur le nous qu'on est ou qu'on croit être devenu, est absente [?]. ? (Sébastien Mussi, Le nous absent, Liber, Montréal, 2018, page 50)
Pronom personnel - français
nous \nu\ masculin et féminin identiques pluriel
- Pronom de la première personne du pluriel, incluant le locuteur ainsi que d'autres personnes au nom de qui il parle, utilisable en sujet, en complément d'objet, ou en tant que pronom tonique pour marquer l'insistance sur la personne.
- Nous sommes contents. (masculin ou mixte)
- Nous sommes heureuses. (féminin)
- Vous et moi, nous sommes dans le même cas.
- Toi, lui et moi, nous avons été heureux de nous rencontrer à cette occasion.
- Ils nous aiment. (complément d'objet direct)
- Il nous l'a dit. (complément d'objet indirect)
- Il parle de nous.
- Il est contre nous.
- La victoire est à nous.
- Nous, nous n'oserions pas faire cela.
- Nous prétendons, nous, ne pas le faire.
- Se dit souvent pour désigner une collectivité dont fait partie la personne qui parle, qu'il s'agisse de l'humanité, d'un pays, d'une province, d'une famille, ou encore de gens ayant en commun des idées, des croyances, une formation, des habitudes, etc.
- La Grèce et Rome nous ont apporté la civilisation.
- L'administration que l'Europe nous envie.
- Il s'emploie aussi quelquefois, dans le registre familier, au lieu du pronom personnel il ou elle.
- On lui a fait remarquer plusieurs fois sa faute, mais nous sommes opiniâtre, nous ne voulons pas nous corriger.
- À l'époque des rois, remplaçait le singulier je ou moi dans les lois, dans les ordonnances, etc. Note : Il s'emploie encore par les évêques dans leurs mandements, et en général par les personnes qui ont caractère et autorité (voir nous de majesté).
- Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit.
- (Par plaisanterie) Alors comme ça, nous ne voulons pas ranger notre chambre ?
- Dans les romans, essais, travaux universitaires, remplace les pronoms je, me, moi pour désigner l'auteur du texte (voir nous de modestie).
- En écrivant ces passages dont nous sommes presque effrayé, nous n'avons pu échapper à une sorte de serrement de c?ur... ? (Eugène Sue, Les Mystères de Paris, Première partie, chap. I, 1842.)
- Pendant que les scènes que nous venons de décrire se passaient dans l'autre partie du château, la juive Rébecca attendait son sort dans une tourelle éloignée et isolée. ? (Walter Scott, Ivanhoé, ch. XXIV, traduit de l'anglais par Alexandre Dumas, 1820)
Trésor de la Langue Française informatisé
NOUS, pron. pers.
Nous au Scrabble
Le mot nous vaut 4 points au Scrabble.
Informations sur le mot nous - 4 lettres, 2 voyelles, 2 consonnes, 4 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot nous au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
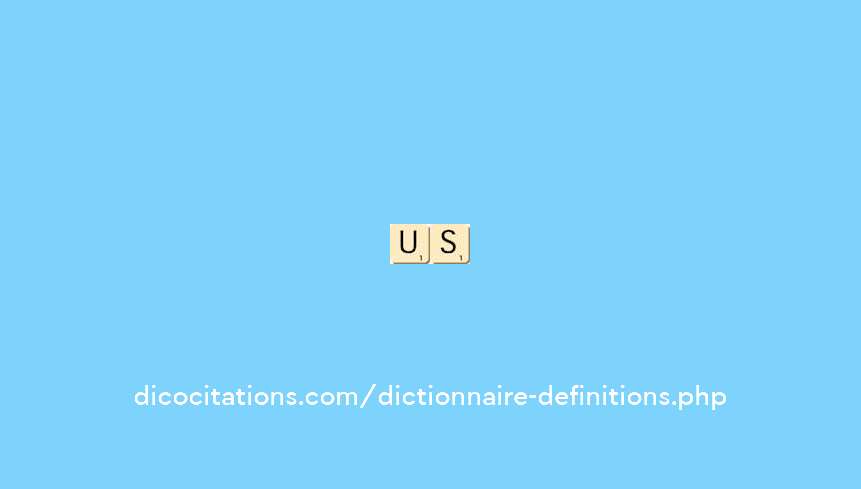
Les mots proches de Nous
Noue Noue Noué, ée Nouement Nouer Nouet Noueur Noueux, euse Nourrain Nourri, ie Nourrice Nourricerie Nourricier, ère Nourrir Nourrissable Nourrissage Nourrissant, ante Nourrissement Nourrisseur Nourrisson Nourriture Nous Nouveau ou, devant une voyelle Nouveauté Nouvelle Nouvellement Nouvelleté Nouvelliste noua nouage nouai nouaient Nouaille Nouaillé-Maupertuis Nouainville nouais nouait Nouan-le-Fuzelier Nouan-sur-Loire Nouans Nouans-les-Fontaines nouant Nouart nouas Nouâtre Nouaye nouba noubas noue noue noué noué Noue nouée nouée nouées nouées Noueilles nouent nouer nouera nouerais nouerait nouèrent nouerez noueront noués noués noueuse noueuses noueux nouez Nougaroulet nougat nougatine nougatines nougats NouhantMots du jour
-
kawa abondant roidissait grison évaderaient décimée linceuls télégraphiez habillerais divertissements
Les citations avec le mot Nous
- Bercé par l'amour-propre, chacun de nous s'endort tout éveillé et , dans un rêve glorieux, plane sur les humbles réalités de sa destinée.Auteur : Jean Antoine Petit, dit John Petit-Senn - Source : Bluettes et boutades (1846)
- Un jour, beau jeune homme, votre chevelure blanchira, et les rides viendront défigurer vos traits. Formez-vous donc de bonne heure un esprit solide, et faites-en l'auxiliaire de la beauté : c'est le seul compagnon qui nous reste fidèle jusqu'au tombeau.Auteur : Ovide - Source : L'art d'aimer
- C'est amusant de voir les monstres au cinéma. Mais l'idée qu'ils existent effectivement et qu'ils rôdent autour de nous, ça c'est pas drôle du tout.Auteur : Stephen King - Source : Salem (1975)
- On court bien loin pour chercher le bonheur;
A sa poursuite en vain l'on se tourmente:
C'est près de nous, dans notre propre coeur,
Que le plaça la nature prudente.Auteur : Jean-Pierre Claris de Florian - Source : Le Cheval d'Espagne - Bien loin de tout ramener à soi, comme fait l'hédonisme, l'amour nous fait au contraire imaginer d'en sortir.Auteur : Nicolas Grimaldi - Source : Proust, les horreurs de l'amour (2008)
- On nous dit: «Il ne faut pas frapper un ennemi à terre.» Bon. Mais alors, quand?... On nous dit: «Il ne faut pas dormir avec la femme de ses amis.» Bon. Mais alors, avec qui?Auteur : Lucien Guitry - Source : Sans référence
- Nous marchons à grands pas vers la formation de cinq ou six grands empires. Ces empires une fois formés, rien ne remuera plus, d'autant moins même que, tôt ou tard, ils devront se faire la guerre.Auteur : Pierre Joseph Proudhon - Source : Correspondance, 3 mai 1860
- On aimerait tant pouvoir inventer le dragon qui fera de nous des princes charmants. Auteur : Bernard Arcand - Source : De nouveaux lieux communs (1994)
- Mais si nous ne sommes pas guidés par l'espoir, qu'adviendra-t-il de nous !Auteur : Douglas Kennedy - Source : Cinq jours (2013)
- Le salut de l'humanité réside en chacun de nous, non pas dans un système, une croyance, ou à l'intérieur d'une frontière donnée. L'ennemi n'est pas au-dehors, mais en dedans. Auteur : William Golding - Source : Sa Majesté des mouches (1954)
- Mme Cottard prononçait rarement un nom propre et se contentait de dire «des amis à nous», «une de mes amies».Auteur : Marcel Proust - Source : A la recherche du temps perdu, Du côté de chez Swann (1913)
- Devant la mort nous serons comme à notre naissance, radicalement privés de toute puissance.Auteur : Christian Bobin - Source : Ressusciter (2001)
- Ni Juifs, ni chiens, ni niggers...Est-ce ma faute si la formule, ces mots féroces que j’ai entendus répéter jusqu’à New York même et par d’honnêtes gens, m’obsède ? Est-ce que nous sommes des punaises pour ces honnêtes Américains ? Est-ce que nous avons marché sur l’eau pour venir chez eux ? Est-il honorable à l’heure actuelle, dites-moi, qu’en Amérique – dans des villes des U.S.A. qui se flattent d’être à l’avant-garde pour tout le progrès -, à partir d’une certaine heure, le soir, les Juifs et les nègres ne puissent sortir de leurs maisons, qu’ils y soient relégués, comme des pestiférés, sous peine de représailles plus ou moins couvertes par des lois honteuses d’elles-mêmes ? Je suis du côté des « niggers ». Je n’en ai ni gloire ni humiliation. Je n’ai pas choisi.Auteur : Joséphine Baker - Source : « Les mémoires » de Joséphine Baker, recueillis par Marcel Sauvage (1949)
- L'explication semblait impossible à fournir, surtout lorsque la conversation tournait, fût-ce de manière indirecte, autour des rapports père-fils. Peut-être la seule chose que j'avais retenue de lui était la conscience de la difficulté à saisir si la tyrannie était bien réelle, ou façonnée par nous. de même que la soumission. Et si, en fin de compte, en un certain sens, on pouvait être l'esclave d'un tyran autant que lui était le nôtre. Auteur : Ismaïl Kadaré - Source : La Poupée (2015)
- Il nous faut écouter l'oiseau au fond des bois, le murmure de l'été, le sang qui monte en soi...Auteur : Jacques Brel - Source : Sans référence
- A ton bûcher, Phénix, j'ajouterai ma bûche - C'est pour nous que tu meurs et renais de ta mort - Bruxelles! douce main de la France qui dort. - Et je vois sur ta place au centre de la ruche - La reine Elisabeth comme une abeille d'or.Auteur : Jean Cocteau - Source : Sans référence
- Février avec neige nous garantit un bel été.Auteur : Dictons - Source : Dicton
- Le délibéré ne fut pas long; mais notre impatience nous fit entrer dans le parquet des huissiers.Auteur : Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon - Source : Mémoires (1829)
- Ce n'est pas le succès qui fait de nous un crétin ou un fils de pute. Mais il peut faire sortir le fils de pute ou le crétin qu'on porte en soi.Auteur : Javier Cercas - Source : A la vitesse de la lumière (2006)
- Avez-vous constaté comme à certains moments nous mourrons d'envie de marquer notre reconnaissance à autrui, à cause d'une joie qui nous fait le coeur léger comme une bulle ?Auteur : Mohammed Dib - Source : Au café (1955)
- Nous sommes des sourds-muets qui rêvons du plus beau langage alors qu'un seul mot nous ne savons le reconnaître. La vie d'un homme est un misérable balbutiement dans le désert...Auteur : Jean-Paul Baron, dit Frédérick Tristan - Source : Le Dieu des mouches (1959)
- Nous sommes d'une école: nous vivons dans la mode.Auteur : Stéphane Mallarmé - Source : Correspondance 1864 (1871)
- Nous ne sommes rien jusqu'à ce que quelqu'un nous aime. C'est une des petites vérités que certains films ou certaines oeuvres nous offrent et que l'on devrait chaque jour garder sous les yeux pour comprendre ce monde et surmonter ce qu'il nous impose.Auteur : Gilles Legardinier - Source : Et soudain tout change (2013)
- L'Amour d'un sexe pour l'autre nous donne, pour ainsi dire, un autre amour de nous-mêmes; il transporte notre amour-propre dans les autres.Auteur : Etienne Pivert de Senancour - Source : De l'amour considéré dans les lois réelles et dans les formes sociales de l'union des sexes (1806)
- En donnant la liberté aux esclaves nous assurons celle des hommes libres. Ce que nous offrons est aussi honorable pour nous que ce que nous préservons.Auteur : Abraham Lincoln - Source : Second message annuel au Congrès, 1862.
Les citations du Littré sur Nous
- Vous, taisez-vous, guimbarde ; Il vous appartient bien de dire vos raisons, Et de mettre le nez dans ce que nous disonsAuteur : BOURSAULT - Source : Mots à la mode, sc. 12
- Ce ne sommes pas nous qui avons rien faitAuteur : CALVIN - Source : 296
- Le dessein de ceux qui poursuivent ces nouvelles protestations qu'on nous demande n'est autre que de renverser finement les maximes fondamentales de cet ÉtatAuteur : Blaise Pascal - Source : Prov. XIX.
- Tout cela agité, approfondi, discuté et disputé entre nous deux [le duc d'Orléans et moi] nous laissa chacun dans sa persuasionAuteur : SAINT-SIMON - Source : 521, 172
- Nos peres estoient francs ; nous qui sommes si braves, Nous lairrons des enfants qui seront nez esclavesAuteur : D'AUBIGNÉ - Source : ib. Princes.
- Lorsque nous vous rapprochons ces anciens modèles...Auteur : MASS. - Source : Carême, Immutab.
- Nous avons vu des porcs-épics vivants, et jamais nous ne les avons vus, quoique violemment excités, darder leurs piquants ; on ne peut donc trop s'étonner que les auteurs les plus graves, tant anciens que modernes, que les voyageurs les plus sensés soient tous d'accord sur un fait aussi fauxAuteur : BUFF. - Source : Quadrup. t. VI, p. 4
- Nous ne devons rien avoir de séparé ; bien et mal, tout est partageable entre nousAuteur : MALH. - Source : Lexique, éd. L. Lalanne.
- Et de là nous pouvons tirer des conséquences, Qu'on n'acquiert point leurs coeurs sans de grandes avancesAuteur : Molière - Source : Mis. III, 5
- Il nous convint descendre en la terre de nos ennemis pour fere feu et cuire viande, pour les enfants repestre et alaitierAuteur : JOINV. - Source : 282
- Ah ! ma bonne, c'est dommage que nous n'y sommes [ensemble] quelquefois au moins, par quelque espèce de magie, en attendant le printemps qui vientAuteur : Madame de Sévigné - Source : 8 juill. 1671
- La conscience qui nous tourmente de plusieurs imaginations peniblesAuteur : MONT. - Source : II, 45
- Si les dignités municipales étaient si recherchées à Pompéï, ce n'est pas pour les profits qu'on en retirait ; aucun des magistrats ne recevait de traitement ; au contraire ils payaient pour être élus ; la différence entre ces magistrats et les nôtres, à ce sujet, est bien marquée nettement par le sens qu'avait alors le mot d'honoraires et celui qu'il a pris chez nous ; il signifie aujourd'hui le salaire dont on paye le travail d'un fonctionnaire public ; c'était alors la somme d'argent qu'il devait donner pour reconnaître l'honneur qu'on lui faisait en le nommant, honoraria summaAuteur : G. BOISSIER - Source : La vie de province sous l'Empire, dans la Revue des Deux-Mondes, 1er avril 1866, page 380
- Notre profond silence abusant leurs esprits, Ils n'osent plus douter de nous avoir surprisAuteur : Corneille - Source : Cid, IV, 3
- Vous nous éclaircissez de votre trahisonAuteur : MAIRET - Source : M. d'Asdrubal, IV, 4
- Voici donc, mes frères, la seule peine que nous prononçons en plein synode contre....Auteur : MASS. - Source : Disc. synod. Contre certains abus
- Nous débarquâmes à l'orée d'une plaine circulaireAuteur : CHATEAUBR. - Source : Voy. Amér. 416
- Le monde me dédaigne, il me rejette, nous ne changerons pas le mondeAuteur : MARIVAUX - Source : Marianne, 7e part.
- Justes, ne craignez point le vain pouvoir des hommes ; Quelque élevés qu'ils soient, ils sont ce que nous sommesAuteur : J. B. ROUSS. - Source : Odes, I, 3
- Or, pour reprendre la harangue Dont nous avons rompu le filAuteur : Paul Scarron - Source : Virg. IV
- Puis le coeur s'aperçoit qu'il est devenu vieux, Et l'effet qui s'en va nous découvre les causesAuteur : A. DE MUSSET - Source : Poésies nouv. Sonnet à M. V. H.
- Adieu, quelque autre fois nous suivrons ce discoursAuteur : Corneille - Source : Tite et Bérén. III, 3
- La coustume establit en nous, peu à peu, le pied de son autoritéAuteur : MONT. - Source : I, 105
- Il me semble que l'esprit de politesse est une certaine attention à faire que, par nos paroles et nos manières, les autres soient contents de nous et d'eux-mêmesAuteur : LA BRUY. - Source : ib.
- Se nous avions un non qui compresist toutes teles chosesAuteur : ORESME - Source : Eth. 144
Les mots débutant par Nou Les mots débutant par No
Une suggestion ou précision pour la définition de Nous ? -
Mise à jour le samedi 14 février 2026 à 17h03

- Nain - Naissance - Naitre - Naître - Naivete - Nation - Nature - Necessite - Neutre - Noblesse - Noël - Noir - Normalisation - Normalite - Nostalgie - Nourriture - Nouveau - Nouvel_an - Nuit
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur nous
Poèmes nous
Proverbes nous
La définition du mot Nous est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Nous sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Nous présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
