La définition de Pis du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Pis
Nature : s. m.
Prononciation : pî
Etymologie : Wallon, pé ; bourg. pei, sein de femme ; genev. pètre, peitre, gésier, estomac ; prov. peich, peit, piech, pieit, pit, pege ; espagn. pecho ; port. peito ; ital. petto ; du lat. pectus, poitrine.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de pis de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec pis pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Pis ?
La définition de Pis
Poitrine (ce qui est l'ancienne signification, aujourd'hui hors d'usage).
Toutes les définitions de « pis »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Comparatif de Mal. Plus mal, plus désavantageusement; d'une manière plus fâcheuse, Ils sont pis que jamais ensemble. Il se portait un peu mieux, mais il est pis que jamais. Tant pis. Voyez TANT. Il s'emploie aussi comme adjectif. Il n'y a rien de pis que cela. C'est bien pis. Il en a dit pis que pendre. Qui pis est, Ce qui est plus mauvais, plus fâcheux. Il est sot et qui pis est méchant. Il s'emploie encore substantivement et signifie Ce qu'il y a de pire. Le pis qui puisse arriver. Le pis de l'affaire, le pis de l'aventure. Prendre, mettre les choses au pis, Les envisager dans le pire état où elles puissent être et en supposant tout ce qui peut arriver de plus fâcheux. En mettant tout au pis, il lui restera encore de quoi vivre.
AU PIS ALLER, loc. adv. En supposant les choses au pire état où elles puissent être. Au pis aller, nous y vivrons de ce que nous y trouverons. On dit aussi Au pis. Pis aller s'emploie aussi substantivement. C'est votre pis aller, C'est le pis qui puisse vous arriver. J'ai accepté cela comme un pis aller, Je l'ai accepté faute de mieux. Être le pis aller de quelqu'un, Être la personne à qui il s'adresse pour quelque chose que ce soit, lorsqu'il n'a pas trouvé une autre personne de qui il pût l'obtenir. Je ne veux pas être son pis aller. Je serai votre pis aller.
DE MAL EN PIS, DE PIS EN PIS, loc. adv. De mal ou de plus mal en plus mal. Ses affaires vont de mal en pis, de pis en pis.
Littré
-
1Comparatif de l'adverbe mal?: plus mal, d'une manière plus mauvaise. Ils sont pis que jamais ensemble. Il se portait mieux?; mais aujourd'hui il est pis que jamais.
Il ne m'en sera jamais ni pis ni mieux
, La Bruyère, VI.S. m. Pis aller, ce qui peut arriver de plus fâcheux.
Hélas?! je suis perdu. -Pourquoi?? ton pis aller n'est que d'être pendu
, Th. Corneille, Feint astrol. IV, 12.Au pis aller, loc. adv. En mettant les choses au pis.
Au pis aller, on se justifie en accusant la fortune
, Guez de Balzac, 5e disc. de la cour.Au pis aller, l'argent le fera taire
, La Fontaine, Mandr.Ce qui sert à défaut de mieux.
Cela posé, disent-ils, jouissons des créatures?; c'est le pis aller
, Pascal, Caract. de la vr. relig. 7, édit. FAUGÈRE.La vertu n'est pas un pis aller
, Massillon, Petit carême, Vices et vertus.Certains amis dont on peut faire son pis aller
, Lesage, Turc. I, 1.Pour être un pis aller je ne fus jamais faite
, Destouches, Phil. marié, IV, 8.Être le pis aller de quelqu'un, être la personne à qui il s'adresse pour quelque chose que ce soit, lorsqu'il n'a pas trouvé une autre personne de qui il pût l'obtenir.
Mon jaloux après tout sera mon pis aller
, Corneille, Ment. III, 3.Cette opinion le fit rechercher et fêter dans le grand monde, et par là l'éloigna de moi, qui jamais n'avais été pour lui qu'un pis aller
, Rousseau, Confess. VIII. -
2Pis se prend quelquefois adjectivement (d'autant plus facilement que pejus n'est que le neutre de pejor)?; il signifie plus mauvais.
Que m'offrirait de pis la fortune ennemie??
Corneille, Pomp. III, 2.Que pourrais-je avoir pis, si j'étais le parjure, Si j'avais violé les droits de la nature??
Rotrou, Antig II, 4.Je n'ai fait que penser à votre état, à transir pour l'avenir, à craindre qu'il ne devienne pis
, Sévigné, 14 juin 1677.Il [Jurieu] avoue qu'on peut croire? non pas qu'il survient à Dieu des accidents comme à nous, et de nouvelles pensées?; mais, ce qui est beaucoup pis, qu'il change dans la substance?
, Bossuet, 1er avert. 11.Ce qu'il y a de pis pour la sagesse est d'être savant à demi
, Rousseau, Ém. IV.Cette aversion sourde pour les lumières, triste preuve de médiocrité ou de quelque chose de pis dans les monarques qui ouvrent leur âme à un sentiment si méprisable
, D'Alembert, Éloges, Vaux de St-Cyr. -
3 S. m. Le pis (avec l'article défini), ce qu'il y a de plus mauvais.
Quelque plume y périt, et le pis du destin Fut qu'un certain vautour à la serre cruelle Vit notre malheureux [pigeon]?
, La Fontaine, Fabl. IX, 2.Ce fut là le pis de l'aventure
, La Fontaine, Or.Tout le pis, tout ce qu'il y a de plus mauvais.
Je suis du nombre des méchantes langues, et je crois tout le pis
, Sévigné, 48.Il [Séguier] disait toujours tout le pis contre notre pauvre ami [Fouquet]
, Sévigné, 27 nov. 1664.Il fit tout du pis qu'il put?
, Staal, Mém. t. I, p. 293.On dit dans le même sens?: le pis du pis.
Une députation, sur laquelle le pis du pis était de faire connaître une bonne intention sans effet
, Retz, IV, 210.Faire du pis qu'on peut, faire le plus de mal qu'on peut.
Et quoique jusqu'ici la fortune contraire Nous ait fait tout du pis qu'elle nous pouvait faire
, Mairet, Sophon. I, 3.Pharasmanes faisait du pis qu'il pouvait aux Arméniens
, Perrot D'Ablancourt, Tac. 412.Mettre quelqu'un au pis, se dit par manière de défi pour marquer à un homme qu'on ne le craint point, quelque mauvaise volonté qu'il ait.
Et nous verrons bientôt, s'il me veut mettre au pis, Lequel l'emportera de la femme ou du fils
, Tristan, M. de Chrispe, III, 6.Les mettre au pis et leur ôter tout prétexte
, Bossuet, Lett. quiét. 230.Mettre les choses au pis, supposer tout ce qui peut arriver de plus fâcheux.
À présent on met tout au pis, on s'attend à tout, on compte là-dessus
, Dancourt, Fêtes du cours, SC. 19.En mettant tout au pis dans l'avenir, il se soulage et se tranquillise
, Rousseau, 2e dialogue.Prendre les choses au pis, les envisager dans le pire état où elles puissent être.
Pour prendre les choses au pis, quand même il serait véritable que Jansénius aurait tenu ces propositions
, Pascal, Prov. XVIII. -
4Pis (sans article), chose plus mauvaise.
Encore pis que cela ne nous rendrait pas l'affaire douteuse
, Guez de Balzac, Disc. à la rég.C'est à qui pis fera, à qui pis dira
, Sévigné, 597.Vous dites bien pis que tout ce qui m'a tant déplu, et qu'on avait la cruauté de me dire quand vous partîtes
, Sévigné, 11 août 1677.Vous avez bien fait pis aux Français que de répandre leur sang?; vous avez corrompu le fond de leurs m?urs
, Fénelon, Dial des morts mod.Richelieu, Mazarin Quitter l'armée par paresse ou par pis
, Saint-Simon, 102, 89.Dire à quelqu'un pis que son nom, l'injurier.
Je pensai l'appeler guenon, Et lui dire pis que son nom
, Scarron, Virg. II.Mettre à faire pis ou à pis faire, défier de faire plus de mal ou de faire plus mal.
Je mets à faire pis, en l'état où nous sommes, Le sort et les démons, et les dieux et les hommes
, Corneille, Hor. II, 3.Ils me feront plaisir?: je les mets à pis faire
, Racine, Plaid. II, 3.Qui pis est, ce qu'il y a de plus fâcheux et de plus désagréable.
Qui pis est, il pleuvait d'une telle manière?
, Régnier, Sat. x.Bacchus le déclare hérétique Et janséniste, qui pis est
, Boileau, Poésies div. VI. -
5De mal en pis, de pis en pis, loc. adv. De plus mal en plus mal.
?Les gens n'ont point de honte De faire aller le mal toujours de pis en pis
, La Fontaine, Fabl. III, 8.Les affaires de ce roi, mon ancien disciple et mon ancien persécuteur, vont de mal en pis
, Voltaire, Lett. d'Argental, 12 sept. 1757. - 6Tant pis, voy. TANT.
REMARQUE
1. On dit bien?: il a fait pis, comme on dit?: il a fait mieux que vous?; mais, si l'on prend un verbe qui ne reçoive pas de complément, comme agir, parler, etc. on dira bien?: il a agi mieux que vous?; mais on ne dira pas?: il a agi pis que vous, JULLIEN., En effet l'usage (l'usage seul, car il n'y a pas de raison pour ne pas employer pis comme mieux, ainsi qu'on faisait anciennement) ne prend pis adverbialement qu'avec le verbe être et dans la locution pis aller.
2. Molière a dit?: La prose est pis encore que les vers, Impromptu
, Molière, sc. 1. Cette phrase a un sens particulier, où pire ne conviendrait pas. Molière s'adresse à des comédiens, et leur dit que, s'ils ne savent pas tout à fait leurs rôles, ils pourront y suppléer, puisque c'est de la prose. À quoi l'un d'eux lui répond?: " La prose est pis encore que les vers, " c'est-à-dire est chose plus difficile à apprendre, est, pour apprendre, quelque chose de pis que les vers. Si Molière eût écrit pire, il n'eût pas exprimé sa pensée, puisque cela voudrait dire que la prose est plus mauvaise que les vers, qu'elle est au-dessous, GIRAULT-DUVIV.
3. Pis, qui est un adjectif en certains emplois particuliers, ne se joint jamais avec un substantif?; l'on dit?; il n'est pire eau que l'eau qui dort?; et jamais?: il n'est pis eau?
4. C'est une faute populaire de dire tant pire au lieu de tant pis.
HISTORIQUE
XIIe s. Li destriers Pinabel, ce jour, en ot le pis
, Ronc. p. 194. Et se je sui de vostre amour espris, Douce dame, ne m'en doit estre pis
, Couci, XVII.
XIIIe s. Li mundz s'en va de mal en pis, Edouard le confesseur, V. 3401. Se vos à lui tenés, vous ferés ce que vous devés?; ou se non, sachiés certainement que nous vos ferons du pis que nous porrons
, Villehardouin, LXVIII. Ne sai [ce] que puissons faire, or va la chose au pis
, Berte, LXXV. Maintenant lui [à la malade] est pis, je ne sai que cle a
, ib. LXXVIII. Vous savez que le conte de Bretaingne a pis fait au roy que nul home qui vive
, Joinville, 203.
XIVe s. Qui? font de pis en pis Pour aller en enfer avec les anemis [diables]
, Guesclin. 7660.
XVe s. Car Dangier l'a desrobé de plaisir, Et, que pis est, a de lui eslongnée Celle qui plus le povoit enrichir
, Orléans, Ball. 23. Il fut crié sur peine de la hart, que nul ne nulle ne fust si ozé ne si hardy de leur dire pis de leur nom
, Journ. de Paris sous Ch. VI et VII, p. 176, dans LACURNE. Ou à tout le moins et au pis aller une bien glorieuse fin
, Commines, II, 12.
XVIe s. Et qui pis est
, Montaigne, I, 404. Je prends toutes choses au pis, et ce pis là, je me resoulds à le porter
, Montaigne, III, 46. Il les admonestoit qu'ilz ne se muassent point en pis
, Amyot, Caton, 16. Le juge dit qu'ilz avoient tous respondu, l'un pis que l'autre
, Amyot, Alex. 107. Ils pensent qu'on n'ose les irriter, ny les mettre à pis faire, Sat. Mén p. 188. Villes mal garnies de gens de guerre, et encores pis fortifiées
, Du Bellay, M. 402. Celuy qui porte au menton Le plus crespelu coton? Je suis son pis et son mieux?; Il me courtize en tous lieux
, Pasquier, ?uvres meslées, p. 485, dans LACURNE.
Encyclopédie, 1re édition
PIS, s. m. (Gram.) mamelle de la vache, de la chevre, de la brebis, de la jument, &c.
Pis, (Boucherie.) c'est la poitrine du b?uf, ce qui comprend la piece tremblante ou le grumeau, les morceaux du tendron, les morceaux du milieu, ou les morceaux du flanchet.
Pis, adv. (Gram.) degré comparatif de mal adv. On disoit qu'il s'amendoit, mais je vois que c'est pis que jamais.
Wiktionnaire
Adverbe 2 - français
pis \pi\
-
(Populaire) Variante de puis.
- « Et pis toé, mon p'tit gars, tu sais pu c'que tu vas faire », chantent Mes Aïeux. ? (L'actualité, 5 fév. 2010)
- Pis, êtes-vous contents que trois paliers de gouvernement et la Caisse de dépôt aient payé 2,2 millions de dollars de subventions pour qu'un groupe sélect puisse bénéficier des pépites de discernement de l'actrice-militante ? ? (Sophie Durocher, 2,2 millions de dollars de perles de sagesse, Le Journal de Montréal, 23 octobre 2020)
- Pis faut dire qu'on avait pas le temps de mater autre chose que les bombes atomiques en bikini, dit Cédric avec un sourire coquin. ? (Sandra Noël, Gigot bitume mortel, 2020, page 63)
- Et pis c'est tout !
Adverbe 1 - français
pis \pi\
-
(Vieilli) Comparatif de mal : Plus mal, plus désavantageusement, d'une manière plus fâcheuse. ? Note : Aujourd'hui, l'on utilise généralement pire ou plus mal sauf dans quelques expressions.
- L'institution, à Montcy-Saint-Pierre, est en pauvre état; et c'est encore pis dans la commune d'Étion. ? (Paul Lorain, Tableau de l'instruction primaire en France, d'après des documents authentiques, Paris : Hachette, 1837, page 189)
- La vedette placée par les insurgés dans la rue Mondétour, n'avait point à donner le signal d'alarme pour un garde national seul. Elle l'avait laissé s'engager dans la rue en se disant : c'est un renfort probablement, et au pis aller un prisonnier. ? (Victor Hugo, Les Misérables, V, 1, 4 ; 1862)
- Il est, de nos jours, très mal vu d'avouer qu'on a été un bon élève. Encore pis de s'en vanter. ? (François Cavanna, Lune de miel, Gallimard, 2011, collection Folio, page 91)
- Je vis la dernière journée dans l'angoisse d'être refusée à la table de communion. Elle vient s'ajouter à la peur panique de rompre par inadvertance le jeûne matinal en chipant une fraise dans le saladier du dessert ; pis, de laisser tomber l'hostie ou de la mordre avec les dents, catastrophes dont on nous a longuement entretenues, avec leurs conséquences funestes pour ceux qui auraient commis ce sacrilège, fût-il involontaire. ? (Mona Ozouf, Composition française, Gallimard, 2009, collection Folio, page 149)
Nom commun 2 - français
pis \pi\ masculin, singulier et pluriel identiques
- Le pire.
- Lorsqu'il m'arrivait une bonne chance, on s'étonnait de me voir sombre. C'était que tout d'un coup, l'idée de mon néant avait traversé ma joie. Le terrible : « À quoi bon ? » sonnait comme un glas à mes oreilles. Mais le pis de ce tourment, c'est qu'on l'endure dans une honte secrète. On n'ose dire son mal à personne. ? (Émile Zola, La Mort d'Olivier Bécaille, G. Charpentier, 1884)
Nom commun 1 - français
pis \pi\ masculin, singulier et pluriel identiques
-
(Anatomie) Mamelle de bête laitière (vache, brebis, etc.).
- La vache possède deux paires de mamelles, qui sont inguinales, et dont l'ensemble très volumineux constitue le pis (Uber). ? (Barone, R., Anatomie comparée des mammifères domestiques. Tome 3e. Splanchnologie, fascicule II, page 475, 1978, Laboratoire d'Anatomie, École Nationale Vétérinaire Lyon)
- Les vaches, habituées aux ventouses happeuses des trayeuses, ruent des quatre sabots, envoyant balader dans les pailles noires les casseroles à lait parce que les doigts n'ont plus le tact, la manière, la caresse adéquate aux sollicitations du pis. ? (Marius Noguès, Terre des Hêtres, en Gascogne, Éditions Cheminements, 2002, page 264)
- Au Salon de l'agriculture, le lait sorti du pis n'est pas buvable ? (L'Express, 25 février 2013)
-
(Probablement par plaisanterie) Sein de la femme.
- La vertu d'une Catherine de Suède ou d'un Robert de la Chaise Dieu qui, à peine nés, [?] ne voulaient sucer que des pis pieux. ? (Joris-Karl Huysmans, La Cathédrale, 1898, p. 113.)
-
(Élevage) Trayon.
- La Julie, lui tournant le dos, était en train de traire et, du pis qu'elle pressait en cadence, le lait tombait dans le chaudron de fer battu avec un roulement semi-argentin de tambour. ? (Louis Pergaud, La Vengeance du père Jourgeot, dans Les Rustiques, nouvelles villageoises, 1921.)
- (Boucherie) Pièce de viande bovine correspondant à la poitrine avec le paleron.
Nom commun - ancien français
pis \Prononciation ?\ masculin
-
Poitrine.
-
De sun espé l'ad al piz feru ? (La Chanson de Guillaume, f. 23r., au milieu de la 1re colonne, manuscrit de la British Library)
-
Le pis gros et les costés ? (Roman d'Eneas, ms. 60 français de la BnF, f. 150v. b.)
-
De sun espé l'ad al piz feru ? (La Chanson de Guillaume, f. 23r., au milieu de la 1re colonne, manuscrit de la British Library)
Trésor de la Langue Française informatisé
PIS1, adv., adj. et subst.
PIS2, subst. masc.
Pis au Scrabble
Le mot pis vaut 5 points au Scrabble.
Informations sur le mot pis - 3 lettres, 1 voyelles, 2 consonnes, 3 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot pis au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
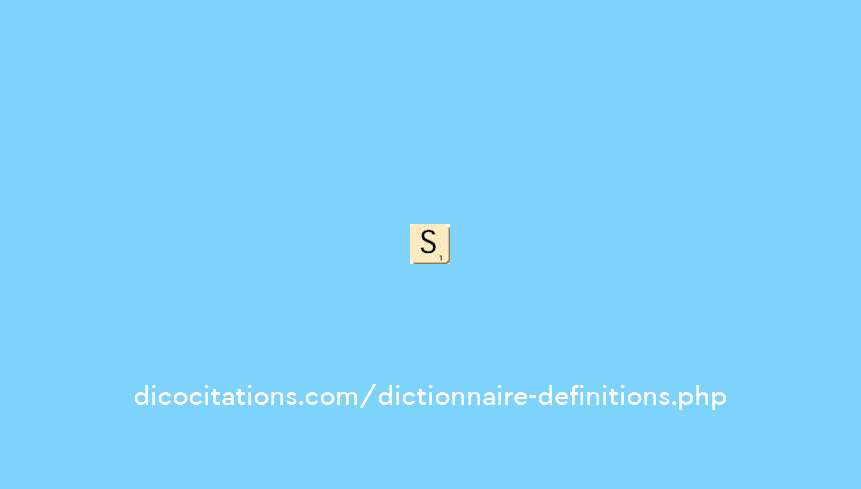
Les mots proches de Pis
Pis Pis Pisang Piscicole Piscicultural, ale Piscine Pisé Pissasphalte Pissasphaltique Pissat Pisse-chien Pisse-froid Pissenlit Pisser Pisse-sang Pisseur, euse Pisseux, euse Pissode Pissoir Pissoter Pistache Piste Pistil Pistolade Pistole Pistoler Pistolet Pistolier Piston pis pis pis Pis pis-aller pisa pisan pisans pisans Pisany piscicole piscicoles pisciculteur pisciculture pisciforme piscine piscines Piscop Piscop pisé Piseux Pisieu pisiforme pissa pissaient pissais pissait pissaladière pissant pissat pissât pisse pisse pissé pisse-copie pisse-copies pisse-froid pisse-vinaigre pissée Pisseleu Pisseleux Pisseloup pissenlit pissenlits pissent pisser pissera pisserai pisseraient pisseraisMots du jour
Ambidextre Participable Consternation Azel Bredouillage Chemineau Major Pleurement Désinfectoire Magnificat
Les citations avec le mot Pis
- La parfaite stupidité de ce jouisseur toujours en érection se manifeste par des yeux de vache ahurie ou de chien qui pisse.Auteur : Léon Bloy - Source : Parlant de Guy de Maupassant.
- Le pis que je trouve en notre état, c'est l'instabilité, et que nos lois, non plus que nos vêtements, ne peuvent prendre aucune forme arrêtée.Auteur : Michel de Montaigne - Source : Essais, II, 17
- Pluie de mars, - Tant vaut pisse de renard.Auteur : Dictons - Source : Dicton
- Nager dans le bonheur, c'est faire des brasses dans sa propre piscine.Auteur : Michèle Bernier - Source : Le petit livre de Michèle Bernier (2003)
- Je suis dans un de ces moments où je vois si nette la piste de ce gibier qui s'appelle le bonheur.Auteur : Jean Giraudoux - Source : Electre (1937)
- Peut-être qu'il n'y aura pas d'autre fois. Peut-être que dans la vie on a une seule chance, tant pis si on ne sait pas la saisir, ça ne revient pas.Auteur : Delphine de Vigan - Source : No et moi (2007)
- Très tôt, elle avait appris à endiguer ce radar fiévreux qui posait trop de questions, devinait trop de secrets, disait trop de bêtises, importunait les grands. Valait mieux se taire. Et tant pis pour la spontanéité qui l'émerveillait chez les autres.Auteur : Louise Auger - Source : Ev Anckert, une passion parisienne
- Oui, j'entendais, avec la finesse d'une ouïe tendue par la batteuse lointaine dans la campagne, gonfler et s'alourdir non point l'orge dans les épis, non point la pomme du Nord, mais le monde, le monde capitaliste gonfler pour tomber ! Auteur : Ossip Emilievitch Mandelstam - Source : Le Bruit du temps
- Voici l'Eden, et c'est une Fleur. Voici l'Eden. Le Pistil se penche sur les pétales et les baise un à un - chaque fleur pour un baiser, chaque baiser pour une fleur.Auteur : Malcolm de Chazal - Source : Petrusmok (1951)
- Chez nous, les repas familiaux ressemblaient à une punition, un grand verre de pisse qu'on devait boire quotidiennement. Chaque soirée se déroulait selon un rituel qui confinait au sacréAuteur : Adeline Dieudonné - Source : La vraie vie
- J'aime l'Italie, j'aime les villes italiennes avec un sérieux penchant pour Pise.Auteur : Philippe Geluck - Source : Le tour du chat en 365 jours (2006)
- Je suis allé à la piscine pour me nettoyer le yeux avec le chlore comme chaque fois que je ne vois plus rien. J'ai enfilé mon maillot noir, le bonnet argenté qui me donne un air de spermatozoïde de l'espace et j'ai plongé pour chercher de l'air au fond du grand bassin. Auteur : Nicolas Delesalle - Source : Un parfum d'herbe coupée (2013)
- Le vent couchait la pluie presque horizontalement, comme des épis de blé.Auteur : Jules Renard - Source : Journal, 27 octobre 1887
- Je pense qu'une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais sauté d'un pont à l'élastique, c'est que j'ai peur de pisser de trouille, et d'être à l'envers à ce moment-là.Auteur : Hervé Le Tellier - Source : Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable (1998)
- La liberté, c'est le droit au soupir. La liberté de l'esprit, voilà le principal ; si elle manque, tant pis. On a toujours bonne conscience. Chacun s'embrouille dans sa bonne conscience.Auteur : Jacques Chardonne - Source : Demi-jour - suite et fin du Ciel dans la fenêtre (1964)
- Je défie la calomnie, et je la mets à pis faire.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Lettre à Voltaire, 26 octobre 1762
- On finit par s'habituer aux gens intelligents. - Vous, peut-être. D'ailleurs, il est pis que cela : c'est un génie. Une super-nature. Personne ne peut suivre sa conversation sophistiquée. Comme les génies, il est toujours en retard, mal habillé.Auteur : Paul Morand - Source : Rien que la Terre (1926)
- Piscine chauffée: Piscine dont il est possible de diminuer la température en y jetant des phoquesAuteur : Marc Escayrol - Source : Mots et Grumots (2003)
- Les événements ne sont jamais absolus, leurs résultats dépendent entièrement des individus : le malheur est un marchepied pour le génie, une piscine pour le chrétien, un trésor pour l'homme habile, pour les faibles un abîme.Auteur : Honoré de Balzac - Source : La Comédie humaine (1842-1852)
- Un loft rupin dans un entrepôt rénové, du côté des Halles, une piaule vaste comme un hangar d'avions et haute comme une cathédrale, murs crépis vieux rose, meubles laqués blanc, verrière dépolie et structure métallique à gros rivets ronds.Auteur : Daniel Pennac - Source : La fée carabine (1987)
- On ne peut pas balayer les souvenirs d'un simple coup de balai. Ils restent en nous, tapis dans l'ombre, guettant le moment où l'on baissera la garde pour ressurgir avec une force décuplée.Auteur : Guillaume Musso - Source : Demain (2013)
- Si le prince Ernst August de Hanovre pisse le long d'un mur en Allemagne, c'est parce qu'il ne peut pas le faire à Monaco, ça déclencherait toutes les alarmes...Auteur : Laurent Ruquier - Source : Vu à la radio (2001)
- C'est difficile d'imaginer comment ça sera arrangé ici dans 900 milliards d'années, déjà qu'en dix ans la plupart des bougnats ont disparu, t'as plus que des grandes brasseries. Au pis, ça existera plus, ça sera des bureaux hyper modernes...Auteur : Jean-Marie Gourio - Source : Brèves de comptoir, 1988
- Il n'y a pas de justice. Tout est loterie. La naissance, la mort, le talent. Et c'est tant pis pour nous.Auteur : Eric-Emmanuel Schmitt - Source : La Part de l'autre (2001)
- Le tapis de l'escalier, mauve très clair, n'était usé que toutes les trois marches : en effet, Colin descendait quatre à quatre. Il se prit les pieds dans une tringle nickelée et se mélangea à la rampe. - Ca m'apprendra à dire des conneries.Auteur : Boris Vian - Source : L' Ecume des jours (1947)
Les citations du Littré sur Pis
- Donner loy au pis faireAuteur : MONT. - Source : I, 25
- Marton : C'est le garçon de France le plus désintéressé. - Le comte : Tant pis, ces genslà ne sont bons à rienAuteur : MARIVAUX - Source : Fausses confid. II, 4
- Ces champisses contenances de nos laquais y estoient aussi [chez les Romains]Auteur : MONT. - Source : I, 374
- Ils ne cavaient d'abord que trois ou quatre pistolesAuteur : HAMILT. - Source : Gram. 3
- C'était [Fabroni] un bourgeois de Pistoie, venu à Rome avec de l'esprit, de la scolastique, du feuAuteur : SAINT-SIMON - Source : 345, 29
- Et les soleils d'avril peignant une prairie En leur tapis de fleurs n'ont jamais égalé Son teint renouveléAuteur : MALHERBE - Source : V, 24
- Quand l'âme se trouve dans les pesanteurs et dans les assoupissementsAuteur : BALZ. - Source : Socrate chrétien, VI
- La pistolle ne fait quasi nul effect, si elle n'est tirée de trois pasAuteur : LANOUE - Source : 312
- Le but du concours, le siége de Pise par les Florentins, la consécration d'un des fastes de l'histoire de FlorenceAuteur : H. HOUSSAYE - Source : Rev. des Deux-Mondes, 15 fév. 1876, p. 866
- C'estoient tapisseries que l'on avoit tendues pour les secherAuteur : AMYOT - Source : Thém. 54
- Et qui pis estAuteur : MONT. - Source : I, 404
- Puis Pise et Florence avaient esté trois cens ans ennemies, avant que Florentins la conquissentAuteur : COMM. - Source : VIII, 3
- L'homme depuis son péché porte un fonds malheureux de concupiscenceAuteur : Blaise Pascal - Source : Prov. 18
- Ainsi qu'on voit, sous cent mains diligentes, Choir les épis des moissons jaunissantesAuteur : Voltaire - Source : dans GIRAULT-DUVIVIER
- La parolle de eschauffaison et de felonie luy faillit, mais non pas la voulenté de pis direAuteur : AL. CHARTIER - Source : l'Esp. ou consol. des trois vertus.
- Pisistrates adjousta ces deux vers, pour gratifier [être agréable] aux AtheniensAuteur : AMYOT - Source : Thésée, 24
- Quand la douce haleine du printemps a tapissé les forêts de verdureAuteur : BUFF. - Source : Morceaux choisis, p. 293
- Madame a besoin de ces dix pistoles pour payer cet ingénieur qui a pratiqué cette trappe dans son alcôveAuteur : DANCOURT - Source : la Femme d'intrigue, v, 1
- Un homme accumulait ; on sait que cette erreur Va souvent jusqu'à la fureur ; Celui-ci ne songeait que ducats et pistolesAuteur : Jean de La Fontaine - Source : Fabl. XII, 3
- Comme seroit concupiscence et mauvais desirs surmontés et vaincus par abstinenceAuteur : ORESME - Source : Eth. 5
- Le pistil est toujours disposé de manière à recevoir la poussière des étaminesAuteur : BONNET - Source : Contempl. nat. VI, 7
- La crainte n'a pas Dieu pour son objet immédiat ; son motif essentiel, qui est la peine éternelle, ne fait qu'ôter les empêchements, et rabattre la concupiscence par une terreur salutaireAuteur : BOSSUET - Source : 2e écrit sur les Max. des saints, 10
- La tyrannie des Pisistratides est entièrement éteinteAuteur : BOSSUET - Source : Hist. I, 8
- Un autre reproche qu'on peut faire à Marivaux dans ses romans, c'est de s'y être permis de trop longs épisodes ; celui de la religieuse, dans Marianne, occupe lui seul plus d'un volumeAuteur : D'ALEMB. - Source : Éloges, Marivaux.
- Passant par où quelqu'un des leurs a pissé, ils [les chiens] s'arrêtent tout court pour faire le mêmeAuteur : LA MOTHE LE VAYER - Source : Dial. d'Orat. Tubero, t. I, p. 287, dans POUGENS
Les mots débutant par Pis Les mots débutant par Pi
Une suggestion ou précision pour la définition de Pis ? -
Mise à jour le samedi 7 février 2026 à 02h31
- Paix - Papa - Paradis - Paradoxe - Paraître - Pardon - Pardonner - Parent - Paresse - Parler - Parole - Parole chanson - Partage - Partir - Pas - Passé - Passé - Passion - Passoire - Patience - Patient - Patrie - Patriotisme - Pauvre - Pauvrete - Pauvreté - Payer - Pays - Paysan - Péché - Peche - Pédagogie - Pédanterie - Peine - Peinture - Pensée - Pensées - Penser - Perception - Père - Père noel - Père fils - Amour Papa - Enfants Père - Amour Père - Aime Père - Aime Papa - Père coeur - Père enfant - Père Mère - Père Fille - Père Fils - Fête des Pères - Bonne fête des pères - Perfection - Perfidie - Permanence - Perséverance - Personnage - Personnalité - Personne - Persuader - Pessimisme - Peuple - Peur - Philosophie - Phrases - Physiologie - Physique - Piano - Piege - Piston - Pitie - Pitié - Plagiat - Plaindre - Plaire - Plaisir - Plannification - Pleonasme - Pleur - Pleurer - Poésie - Poesie - Poète - Poete - Pognon - Police - Politesse - Politicien - Politique - Ponctualite - Populaire - Popularité - Pornographie - Porte - Posologie - Posséder - Postérité - Pouvoir - Prédiction - Préférence - Préjugé - Prendre - Présent - Président - Pret - Prétention - Prévoir - Prier - Principes - Prison - Privilege - Prix - Probabilite - Probleme - Producteur - Profit - Progres - Proletariat - Promenade - Promesse - Promettre - Prononciation - Proposer - Propriété - Prose - Prostituée - Prouver - Proverbe - Prudence - Psychanalyse - Psychologie - Psychose - Publicité - Pucelage - Pudeur - Punition - Pureté
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur pis
Poèmes pis
Proverbes pis
La définition du mot Pis est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Pis sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Pis présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
