La définition de Rimer du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Rimer
Nature : v. n.
Prononciation : ri-mé
Etymologie : Rime ; provenç. espagn. et portug. rimar ; ital. rimare. L'ancienne langue disait aussi rimoier.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de rimer de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec rimer pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Rimer ?
La définition de Rimer
Avoir le même son, en parlant des finales des mots.
Toutes les définitions de « rimer »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Il se dit des Mots dont les dernières syllabes ont la même terminaison et forment le même son. Ces deux mots riment bien, ces deux autres ne riment pas, riment mal. Ce mot ne rime pas avec celui-là. On ne peut faire rimer Paume avec Pomme, le simple avec le composé. Ces deux mots riment à la fois pour l'œil et pour l'oreille, Les syllabes qui les terminent ont le même son et sont orthographiées de même. Fig. et fam., Ces deux choses ne riment pas ensemble, Elles n'ont aucun rapport entre elles. Cela ne rime à rien, Cela ne signifie rien; cela est dépourvu de sens, de raison.
RIMER se dit aussi du Poète, du versificateur et signifie Accoupler des rimes. Ce poète rime bien, rime mal, rime richement. Il se contente de rimer pour l'oreille. Il signifie, par extension, Faire des vers. Il emploie tout son temps à rimer. Son plus grand plaisir est de rimer. Il se dit alors avec quelque sorte d'ironie.
RIMER s'emploie encore comme verbe transitif et signifie Mettre en vers. Il a rimé ce conte. Je veux rimer cette anecdote. Bouts-rimés. Voyez ce mot à son rang alphabétique.
Littré
-
1Avoir le même son, en parlant des finales des mots.
C'est par l'honneur qu'il [Trissotin] a de rimer à latin, Qu'il a sur son rival emporté l'avantage
, Molière, Femm. sav. IV, 7.Quand je veux d'un galant dépeindre la figure, Ma plume pour rimer trouve l'abbé de Pure
, Boileau, Sat. II.Une brève, à la rigueur, ne doit rimer qu'avec une brève, ni une longue qu'avec une longue
, D'Olivet, Prosodie franç. V, I.Rimer à l'oreille, aux oreilles, se dit de deux finales dont le son est le même.
Rimer aux yeux, se dit de deux finales qui ont même orthographe et non même son. Monsieur et seigneur riment aux yeux, et non à l'oreille.
Fig. et familièrement. Ces deux choses ne riment pas ensemble, elles n'ont aucun rapport.
Il se trouve aujourd'hui que leur c?ur et leur convention ne riment pas ensemble, et qu'on est fort embarrassé de savoir ce qu'on fera de vous
, Marivaux, Serm. indiscr. IV, 3.Cela ne rime à rien, ne signifie rien, est dépourvu de sens.
-
2Il se dit aussi en parlant du poëte occupé à faire rimer les mots. Ce poëte rime bien, rime mal.
C'est des Arabes, à mon avis, que nous tenons l'art de rimer?; et je vois assez d'apparence que les vers léonins ont été faits à l'exemple des leurs
, Huet, De l'origine des romans, p. 19, dans POUGENS.Il faut que ceux qui ne sauraient pas que le poëte a été obligé de rimer ne s'en aperçoivent pas?; et que ceux qui le savent soient surpris de ne pas s'en apercevoir
, Fontenelle, Réfl. poét. ?uv. t. III, p. 203, dans POUGENS.Autrefois, quand je faisais des vers, je ne rimais pas trop pour les yeux, mais j'avais grand soin de l'oreille
, Voltaire, Lett. de Boissy, 7 déc. 1770.Rimer en Dieu, jurer, blasphémer.
C'est là que l'on rime très richement en Dieu
, Scarron, Rom. com. I, 3. -
3Faire des vers.
Et, lorsque d'en mieux faire [des vers] on n'a pas le bonheur, On ne doit de rimer avoir aucune envie, Qu'on n'y soit condamné sur peine de la vie
, Molière, Mis. IV, 1.Il est vrai, s'il [Chapelain] m'eût cru, qu'il n'eût point fait de vers?; Il se tue à rimer?; que n'écrit-il en prose??
Boileau, Sat. IX.Tout n'en irait que mieux, Quand de ces médisants [les satiriques] l'engeance tout entière Irait, la tête en bas, rimer dans la rivière
, Boileau, ib.Persuadé que l'harmonie Ne verse ses heureux présents Que sur le matin de la vie, Et que, sans un peu de folie, On ne rime plus à trente ans
, Gresset, Chartr.Et Despréaux rima contre les plats rimeurs
, Delille, Trois règ. VII. -
4 V. a. Faire rimer.
S'ils font quelque chose, C'est proser de la rime, et rimer de la prose
, Régnier, Sat. IX.Mais je ne puis souffrir qu'un esprit de travers Qui, pour rimer des mots, pense faire des vers?
, Boileau, Disc. au roi. -
5Mettre en vers.
Puis dessus le papier mes caprices je rime
, Régnier, Sat. XI.Certain conte, Que j'ai rimé comme vous allez voir
, La Fontaine, Mazet.Muse, c'est donc en vain que la main vous démange?; S'il faut rimer ici, rimons quelque louange
, Boileau, Sat. VII.Et pour rimer ici ma pensée en deux mots
, Boileau, ib. IV.Marot bientôt après fit fleurir les ballades, Tourna des triolets, rima des mascarades
, Boileau, Art p. I.Seul en un coin, pensif et consterné, Rimant une ode et n'ayant point dîné
, Voltaire, Le pauvre diable.
HISTORIQUE
XIIIe s. Qui bien voudra rimer, il li convient conter totes les syllabes de ses diz, en tel maniere que li vers soient acordables en nombre, et que li uns n'ait plus que li autres?; après ce convient il amesurer les deux derraines sillabes dou vers en tel maniere que totes les letres de la derraine sillabe soient semblables, et au mains [moins] la vocal syllabe qui va devant la derraine?; après ce li convient il contre-poser l'accent et la voix, si que les rimes s'accordent à ses accens?; car jà soit ce que tu accordes les letres et les sillabes, certes la rime n'iert [ne sera] droite se li accens se descorde
, Latini, Trésor, p. 481. Ceste sentence ci rimée Troveras escripte en Thimée De Platon qui ne fu pas nices
, la Rose, 7135.
XIVe s. Une chanson d'amours? Que Blance li avoit apris nouviellement?; Un clerc l'avoit rimée tant grasieusement
, Baud de Seb. V, 394.
XVe s. Si empris-je assez hardiment, moi issu de l'escole, à rimer et à dicter les guerres dessus dites
, Froissart, Prol.
XVIe s. En m'esba tant je fais rondeaux en rithme?; Et en rithmant bien souvent je m'enrime
, Marot, II, 32. Quoy, dist Grandgousier, as-tu pris au pot, veu que tu rimes desjà [calembour sur rimer, qui, en patois saintongeois, se dit des viandes qui prennent au pot]?? - Oui dea, respondit Gargantua, mon roy, je rime tant et plus, et en rimant souvent m'enrime [m'enrhume]
, Rabelais, I, 13. Cela se peult bien rismer, mais il ne s'accorde pas
, Palsgrave, p. 691.
Wiktionnaire
Verbe - français
rimer \?i.me\ intransitif 1er groupe (voir la conjugaison)
- Faire une rime (le sujet est une personne).
- Ce poète rime bien, rime mal, rime richement.
- Il se contente de rimer pour l'oreille.
-
(Par extension) Faire des vers, de la poésie.
- Quand je pense que j'ai usé la meilleure portion de ma vie à rimer dix ou douze mille vers, à écrire six ou sept pauvres volumes in-8° et trois ou quatre cents mauvais articles de journaux, et que je me trouve fatigué, j'ai honte de moi-même et de mon époque, où il faut tant d'efforts pour produire si peu de chose. ? (Théophile Gautier, Voyage en Espagne, Charpentier, 1859)
- Alors, ne pouvant pas rimer, ne voulant pas sortir, il se mit à écrire à Jacques. ? (Alphonse Daudet, Le Petit Chose, 1868, page 265)
- Se dit des mots dont les dernières syllabes ont la même terminaison et forment le même son.
- Ces deux mots riment bien, ces deux autres ne riment pas, riment mal.
- Ce mot ne rime pas avec celui-là.
- On ne peut faire rimer « paume » avec « pomme », le simple avec le composé.
- Ces deux mots riment à la fois pour l'?il et pour l'oreille : Les syllabes qui les terminent ont le même son et sont orthographiées de même.
-
(Figuré) Correspondre.
- Ces deux choses ne riment pas ensemble, Elles n'ont aucun rapport entre elles.
- Cela ne rime à rien : Cela ne signifie rien; cela est dépourvu de sens, de raison.
-
(Figuré) (Par extension) Signifier.
- Si Hostrup faisait marche arrière aujourd'hui, toutes les mésaventures qu'il avait subies pour faire plier Mørk n'auraient plus aucun sens et rimeraient tout au plus avec fiasco. Hostrup ne pouvait plus faire marche arrière. ? (Anders Bodelsen, Mauvais Calcul, traduit du danois par Anne Renon, éd. Autrement, 2014)
- Démocratie illibérale ? A première vue, l'expression a un petit air de paradoxe, voire d'oxymore, tant la démocratie a toujours, en Occident, rimé avec le libéralisme constitutionnel. ? (Anne Chemin, Pologne, Hongrie... ces démocraties « illibérales » qui remettent en cause l'Etat de droit, Le Monde. Mis en ligne le 7 juin 2018)
rimer transitif
-
Mettre en vers, versifier.
- Il a rimé ce conte.
- Je veux rimer cette anecdote.
- Bouts-rimés.
-
Y d'vint l'idôle de la jeunesse
Car il savait se faire aimer
Surtout des gars de Garges-Les-Gonesses
Qu'étaient là que pour faire rimer. ? (Renaud, extrait de la chanson Jojo le démago)
Trésor de la Langue Française informatisé
RIMER, verbe
Rimer au Scrabble
Le mot rimer vaut 6 points au Scrabble.
Informations sur le mot rimer - 5 lettres, 2 voyelles, 3 consonnes, 4 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot rimer au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
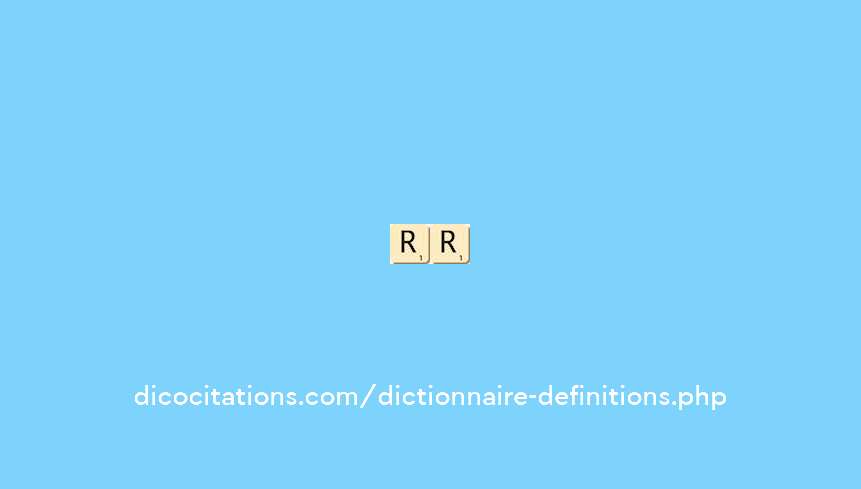
Les mots proches de Rimer
Rimaille Rimailler Rimaillerie Rimailleur Rimasser Rimasseur Rimbombo Rime Rimer Rimeur rima rimaient rimaillerie rimailles rimailleur rimailleurs rimait rimante Rimaucourt rimaye Rimbach-près-Guebwiller Rimbach-près-Masevaux Rimbachzell rimbaldien Rimbez-et-Baudiets Rimboval rime rime rimé rimée Rimeize riment rimer rimes rimes rîmes rimés rimeur rimeurs rimeuse rimez rimions Rimling rimmel Rimogne Rimon-et-Savel Rimondeix Rimons Rimont Rimou Rimplas RimsdorfMots du jour
Oignonet Érugineux, euse Débâcleur Étoiler Harfang Résiduaire Grison, onne Cuvier Pérégrination Rayonnant, ante
Les citations avec le mot Rimer
- Par l'oeuvre d'art, l'homme qui en est l'auteur cherche à exprimer la conscience qu'il a de lui-même.Auteur : Georg Wilhelm Friedrich Hegel - Source : Esthétique (1832)
- A quoi rimerait un Hamlet privé du château d'Elseneur, d'Ophélie, de toutes les situations concrètes qu'il traverse, du texte de son rôle ? Qu'en resterait-il hormis je ne sais quelle essence muette et illusoire ?Auteur : Milan Kundera - Source : La Plaisanterie (1975)
- Le sang répandu cimente l'opinion qu'on veut comprimer.Auteur : Louis Philippe, comte de Ségur - Source : Pensées, maximes, réflexions extraites de ses ouvrages - Alexis Eymery - Publié en 1823
- Le défaut capital du roman d'idées, c'est qu'on est obligé de mettre en scène des gens ayant des idées à exprimer - ce qui exclut à peu près la totalité de la race humaine - à part quelque chose comme 0,01 pour 100.Auteur : Aldous Huxley - Source : Contrepoint (1928), Philip Quarles
- Il vient parfois à l'esprit des pensées informulables parce que les mots sont insuffisants ou même n'existent pas, qui pourraient les exprimer.Auteur : Julien Green - Source : Journal, Vers l'invisible, 27 janvier 1960
- Il n'enjolivait pas les choses, il les trouvait belles, il trouvait la beauté là où les autres la déformaient ou la méconnaissaient, et prenait les attributs que les autres employaient pour exprimer leur admiration afin d'exprimer la sienne. Auteur : Bernhard Schlink - Source : Amours en fuite (2001)
- Agir, c'est être vivant. C'est prendre le risque de sortir de votre coquille et d'exprimer votre rêve. Ce n'est pas la même chose que d'imposer son rêve à autrui, car chacun a le droit d'exprimer son rêve.Auteur : Miguel Ángel Ruiz - Source : Les quatre accords toltèques (1999)
- Je ne crois pas que quoi que ce soit d'important puisse s'exprimer en mots de plus de quatre syllabes.Auteur : Roger Caillois - Source : Approches de l'imaginaire (1974)
- L'imprimerie a été la cause de toutes les révolutions qui ont eu lieu depuis et des résultats qu'elles ont eu.Auteur : Adam Jerzy Czartoryski - Source : Essai sur la diplomatie (1830)
- Je sais bien mauvais gré à l'auteur du Système de la nature du prétendu pacte qu'il imagine que les rois ont fait avec les prêtres pour opprimer les peuples.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Lettre au roi de Prusse, 10 juillet 1775
- L'apparent relâchement de la rigueur peut n'exprimer qu'une rigueur plus grande à laquelle il fallait répondre en premier lieu.Auteur : Georges Bataille - Source : Méthode de méditation
- Si l'on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant: «Parce que c'était lui, parce que c'était moi.»Auteur : Michel de Montaigne - Source : Essais
- Ce sont de purs hommes parce qu'à n'importe quel moment la bêtise humaine peut les tuer, les soumettre à la violence en s'abritant sous un des nombreux masques dévoyés qu'elle utilise pour s'exprimer: culture, religion, pouvoir, richesse, gloire... Les homosexuels sont solidaires de l'humanité parce que l'humanité peut les tuer ou les exclure. On l'oublie trop souvent, ou on ne veut pas s'en souvenir: nous sommes liés à la violence, liés par elle les uns aux autres, capables à chaque instant de la commettre, à chaque instant de la subir.Auteur : Mohamed Mbougar Sarr - Source : De purs hommes (2021)
- Le monde est notre cahier d'écolier, sur ses pages nous faisons nos exercices. Il n'est pas réalité, quoique tu puisses y exprimer de la réalité si tu le désires. Tu es également libre d'écrire des inepties, ou des mensonges, ou de déchirer les pages.Auteur : Richard Bach - Source : Illusions ou le messie récalcitrant (1977)
- La SNCF est en grève en raison du passage des horaires d'hiver aux horaires d'été. - Faudra penser à dire aux syndicats qu'on n'a pas encore réussi à supprimer l'été.Auteur : Laurent Ruquier - Source : Vu à la radio (2001)
- Etouffer un sentiment pénible, c'est comprimer la vapeur: mieux vaut une fissure qu'une explosion; mieux vaut une soupape qu'une fissure.Auteur : Henri-Frédéric Amiel - Source : Grains de mil (1854)
- Il existe une façon pratique d'éviter la contagion des maladies: c'est de supprimer les malades.Auteur : Jean Paulhan - Source : Les Fleurs de Tarbes ou La terreur dans les Lettres (1936-1941)
- Ce qui a répandu le plus de lumière dans le monde, c'est une couleur noire: l'encre d'imprimerie.Auteur : Paul Masson - Source : Les Pensées d'un Yoghi (1896)
- L'invention de l'imprimerie est le plus grand évènement de l'histoire.Auteur : Victor Hugo - Source : Notre-Dame de Paris (1831)
- Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne peut s'exprimer qu'en répondant: «Parce que c'était lui, parce que c'était moi.»Auteur : Michel de Montaigne - Source : Essais, I, 28
- Je doute que toute la philosophie du monde parvienne à supprimer l'esclavage : on en changera tout au plus le nom. Auteur : Marguerite Yourcenar - Source : Alexis ou le Traité du vain combat (1929)
- Tout ce qui ne va pas dans le sens de l'adhésion au réel n'est que remâchonnement de théories usées, abstraction, décollement. Il y a mille façons d'exprimer ce qui est, mais il n'y a qu'une raison de ne pas fuir.Auteur : J. M. G. Le Clézio - Source : L'Extase matérielle (1967)
- Aucun artiste n'est jamais morbide. L'artiste peut tout exprimer.Auteur : Oscar Wilde - Source : Sans référence
- Cette lecture succédait à une autre qui avait été très brillante; semée de traits vifs et saillants, et à la suite desquels toute la métaphysique de Marivaux ne parut, si on peut s'exprimer de la sorte, qu'une vapeur imperceptible.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Eloges, Marivaux
- On sait que le hasard n'est rien. Nous avons inventé ce mot pour exprimer l'effet connu de toute cause inconnue.Auteur : Voltaire - Source : Le Philosophe ignorant (1766)
Les citations du Littré sur Rimer
- Elles se saulpoudroient de quelque pouldre pour reprimer les sueursAuteur : MONT. - Source : I, 374
- Admettez l'innocence à réprimer l'outrageAuteur : ROTROU - Source : Bélis. V, 5
- Qui pourrait exprimer par quels faits incroyables Son bras se signalant pour la dernière fois....Auteur : Jean Racine - Source : Mithr. V, 4
- Que ne puis-je t'exprimer ce que je sens si bien ! et comment sens-je si bien ce que je ne puis t'exprimer ?Auteur : Montesquieu - Source : Lett. pers. 7
- Je sçais bien, quand j'ois quelqu'un qui s'arreste au langage des Essais, que j'aimerois mieulx qu'il s'en teust : ce n'est pas tant eslever les mots, comme desprimer le sens, d'autant plus picquamment que plus obliquementAuteur : MONT. - Source : I, 290
- [Le milan] va tout droit imprimer sa griffe Sur le nez de Sa Majesté ! - Quoi ! sur le nez du roi ! - Du roi même en personne. - Il n'avait donc alors ni sceptre ni couronne ? - Quand il en aurait eu, ç'aurait été tout unAuteur : Jean de La Fontaine - Source : Fabl. XII, 12
- Et toi, malheureux Jurieu, fugitif de ton village, tu voulus opprimer le fugitif Bayle dans son asile et dans le tienAuteur : Voltaire - Source : Petit comm. sur l'éloge du dauphin
- .... Un libelle scandaleux contre Louis XIV et contre le ministère de Louis XV ; M. de Montpérou le fit supprimer par les scolarques [à Genève]Auteur : Voltaire - Source : Philos. Remontrances, III
- J'en oy qui s'excusent de ne se pouvoir exprimerAuteur : MONT. - Source : I, 188
- Moi, que j'ose opprimer et noircir l'innocence !Auteur : Jean Racine - Source : Phèdre, III, 3
- C'est dans ce doute qui doute de soi et dans cette ignorance qui s'ignore, et qu'il [Montaigne] appelle sa maîtresse forme, qu'est l'essence de son opinion, qu'il n'a pu exprimer par aucun terme positifAuteur : Blaise Pascal - Source : Entretien avec M. de Saci.
- Vous aurez bientôt une lettre ostensible, sur les Sirven, qui peut-être sera imprimable, supposé qu'il soit permis d'imprimer des choses utilesAuteur : Voltaire - Source : Lett. Damilaville, 27 mars 1767
- On vient d'imprimer .... une Réponse de M. de Cambrai.... ses amis répandent partout que c'est un livre victorieux, et qu'il y remporte sur moi de grands avantagesAuteur : BOSSUET - Source : Avertiss. sur les écrits.... 4
- Vous rendez un grand service à la raison, en faisant réimprimer le livre de feu M. HelvétiusAuteur : Voltaire - Source : Lett. Gallitzin, 19 juin 1773
- Ils font entre eux une danse ornée de toutes les attitudes que peuvent exprimer des gens qui étudient leurs forcesAuteur : Molière - Source : Am. magn. V, intermède 6
- Les premiers verbes n'ont été imaginés que pour exprimer l'état de l'âme quand elle agit ou pâtitAuteur : CONDIL. - Source : Conn. hum. II, I, 9
- Mais je ne puis souffrir qu'un esprit de travers Qui, pour rimer des mots, pense faire des vers, Se donne en te louant une gêne inutileAuteur : BOILEAU - Source : Disc. au roi.
- Federico Zerenghi, chirurgien de Narni en Italie, fit imprimer à Naples l'histoire de deux hippopotames qu'il avait pris vivants et tués lui-même en Égypte, dans une grande fosse qu'il avait fait creuser aux environs du NilAuteur : BUFF. - Source : Quadrup. t. V, p. 189
- Tout n'en irait que mieux, Quand de ces médisants [les satiriques] l'engeance tout entière Irait, la tête en bas, rimer dans la rivièreAuteur : BOILEAU - Source : ib.
- Un honnête libraire, nommé G***, s'avisa d'imprimer une histoire générale qu'il assurait être de moi, et il me le soutenait à moi-mêmeAuteur : Voltaire - Source : Mél. litt. à l'auteur du Mercure, 1761
- Je veux exprimer ma pensée, les paroles convenables me sortent aussitôt de la bouche, sans que je sache aucun des mouvements que doivent faire, pour les former, la langue ou les lèvres, encore moins ceux du cerveau, du poumon et de la trachée-artère ; puisque je ne sais pas même naturellement si j'ai de telles parties et que j'ai eu besoin de m'étudier moi-même pour le savoirAuteur : BOSSUET - Source : Connaiss. III, 12
- Pour les primeraines couvées seront les cabinets les plus chauds et ensuite les autres par ordreAuteur : O. DE SERRES - Source : ib.
- Mais, pour un vain bonheur qui vous a fait rimer, Gardez qu'un sot orgueil ne vous vienne enfumerAuteur : BOILEAU - Source : Art p. II
- s'il m'était permis de me supprimer moi-même, il y a longtemps que] je me serais empoisonnéAuteur : Paul Scarron - Source : Lett .Oeuv. t. I, p. 202, dans POUGENS
- Je ne vois rien qui m'oblige à supprimer des événements remarquables qui se rencontrent dans mon sujet, et qui peuvent servir d'instruction et de préjugé en des occasions pareillesAuteur : PELLISSON - Source : Hist. de l'Acad. IV
Les mots débutant par Rim Les mots débutant par Ri
Une suggestion ou précision pour la définition de Rimer ? -
Mise à jour le lundi 9 février 2026 à 23h28

- Racine - Racisme - Raillerie - Raison - Raisonnement - Rancune - Realisme - Realite - Rebelle - Reception - Recevoir - Recherche - Recolter - Recompense - Reconnaissance - Reconnaître - Record - Reddition - Reflechir - Regard - Regime - Regle - Regret - Reincarnation - Reine - Religion - Remède - Remords - Rencontre - Rengaine - Renoncement - Repartie - Repas - Repentir - Repos - Reproduction - Reputation - Resilience - Respect - Respecter - Responsabilite - Restaurant - Retraite - Retrospective - Réussite - Reussite - Reve - Rêve - Reveil - Revolte - Revolution - Riche - Richesse - Ridicule - Rire - Roman - Romantique - Rumination - Rupture - Rythme
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur rimer
Poèmes rimer
Proverbes rimer
La définition du mot Rimer est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Rimer sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Rimer présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
