Définition de « relique »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot relique de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur relique pour aider à enrichir la compréhension du mot Relique et répondre à la question quelle est la définition de relique ?
Une définition simple : relique (f)
Définitions de « relique »
Trésor de la Langue Française informatisé
RELIQUE, subst. fém.
Wiktionnaire
Nom commun - ancien français
relique \Prononciation ?\ féminin
-
(Religion) Relique (de saints).
-
Pur reliques en grant cherté ? (Marie de France, Livre de l'espurgatoire, ms. 25407 de la BnF, f. 104v. a.)
-
Pur reliques en grant cherté ? (Marie de France, Livre de l'espurgatoire, ms. 25407 de la BnF, f. 104v. a.)
Nom commun - français
relique \??.lik\ féminin
-
(Sens étymologique) Les restes de quelque chose.
- Les reliques de sa fortune. ? Les reliques d'une ancienne splendeur.
- Ce qui reste d'une personne après sa mort, soit le corps entier, soit une partie du corps, soit même ce qui lui a appartenu, qui a été à son usage, et qui est gardé en souvenir.
- C'est une collection de reliques, non pas de saints, mais de rois. En effet, chaque papier enveloppait un os, des cheveux ou de la barbe. ? Il y avait une rotule de Charles IX, le pouce de François Ier, un fragment du crâne de Louis XIV, une côte de Henri II, une vertèbre de Louis XV, de la barbe de Henri IV et des cheveux de Louis XIII. ? (Alexandre Dumas, Les Mille et Un Fantômes,)
- Pour arracher l'espèce entière à l'animalité il ne fallait que deux conditions : que l'on conservât dans des locaux surveillés les reliques ? toiles, livres, statues ? des clercs morts ; qu'il restât au moins un clerc vivant pour continuer la besogne et fabriquer les reliques futures. ? (Jean-Paul Sartre, Les mots, 1964, collection Folio, page 151.)
-
(Courant) (Religion) Ce qui reste d'un saint, d'un martyr, voire de Jésus-Christ lui-même, après sa mort.
- Le vol des choses consacrées à Dieu était un sacrilège, parce que ce vol renfermait une profanation de choses saintes : tel était le vol des calices, ciboires, reliques, images et même des troncs d'église. ? (Adolphe Chauveau & ?Faustin Hélie, Théorie du Code pénal, Bruxelles : Imprimerie typographique belge, 1844, vol.3, page 40)
- C'était un plastron en flanelle rouge, l'un de ces talismans quasi hygiéniques qui, avec les pilules et les spécialités pharmaceutiques, remplacent, chez les peuples protestants de la chrétienté, les images et les reliques miraculeuses. ? (H. G. Wells, La Guerre dans les airs, 1908, traduction d'Henry-D. Davray et B. Kozakiewicz, Mercure de France, Paris, 1910, page 102 de l'édition de 1921)
- L'histoire du culte de saint Bond à Sens, à Paris et dans le diocèse de Soissons, de même que l'histoire de ses reliques, ont fait l'objet d'un long développement en 1867 de la part des bollandistes, travail nécessitant une actualisation. ? (Pierre Glaizal & Étienne Dodet, L'ermitage Saint-Bond à Paron; la légende et l'histoire, société archéologique de Sens, 2006, page 40)
-
(Par extension) Quelque chose de précieux que l'on garde en souvenir.
- Les reliques du passé. - Les reliques du c?ur.
-
(Figuré) Définition manquante ou à compléter. (Ajouter)?
- Le passe vaccinal, relique de la double vague Delta-Omicron de décembre, est devenu au fil des semaines un objet encombrant pour le gouvernement, dont l'utilité fait débat à l'heure de la décrue et qu'il faudra de surcroît débrancher à quelques encablures du premier tour de l'élection présidentielle.? (Vincent Glad, Covid-19 : le passe vaccinal a-t-il encore un sens ?, Journal du dimanche, 11 février 2022)
-
(Biologie) Définition manquante ou à compléter. (Ajouter)?
- Les arbres cauliflores tels l'arbre de Judée ou le caroubier, ou encore des herbacées reviviscentes comme Haberlea et Ramonda peuvent aussi être considérés comme des reliques de cette époque. ? (Georg Grabherr (trad. Pierre Bertrand), Guide des Écosystèmes de la Terre [« Farbatlas Ökosysteme der Erde »], Paris, Eugen Ulmer, 1999 p. 185)
- Ces petits ARN qui infectent les plantes pourraient être les reliques d'un « monde ARN » ancestral.? (Marie-Neige Cordonnier, Les viroïdes, précurseurs de la vie ?, Pour la Science, 28 mars 2011)
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Ce qui reste d'un saint après sa mort, soit le corps entier, soit une partie du corps, soit même ce qui lui a appartenu, qui a été à son usage; il se dit de Tout ce qui reste des instruments de la passion de Notre-Seigneur, de celle des martyrs, aussi bien que des vêtements des saints, de leurs ornements sacerdotaux, etc. Précieuse relique. Les reliques de la Passion. Les reliques des saints. Exposer les reliques des martyrs. Vénérer des reliques. Baiser des reliques. Porter des reliques en procession. Le culte des reliques. Il a des reliques de tel saint. Enchâsser des reliques. Fig., Garder une chose comme une relique, La garder soigneusement, Elle garde cette lettre comme une relique.
RELIQUE désigne aussi, sans y attacher le sens religieux, Quelque chose de précieux que l'on garde en souvenir. Les reliques du passé. Les reliques du cœur. Il désigne encore les Restes de quelque chose de grand. Les reliques de sa fortune. Les reliques d'une ancienne splendeur.
Littré
-
1Ce qui reste de Jésus-Christ, des saints et des martyrs, soit parties du corps, soit objets à leur usage, soit instruments de leur supplice.
Un baudet chargé de reliques S'imagina qu'on l'adorait?; Dans ce penser il se carrait, Recevant comme siens l'encens et les cantiques
, La Fontaine, Fabl. V, 14.Les corps saints sont habités par le Saint-Esprit jusqu'à la résurrection? c'est pour cette raison que nous honorons les reliques des morts
, Pascal, Lett. sur la mort de son père.Nous ne pouvons pas appeler ces précieux restes les reliques de son corps?; mais nous ne nous éloignerons pas de la raison, quand nous les nommerons les reliques de la sainteté
, Bossuet, Panég. St Gorgon, préambule.J'ai eu le courage de revoir [après la mort de Louis XIV] les reliques que le roi portait sur lui
, Maintenon, Lett. à Mme de Caylus, 15 déc. 1715.On vit des généraux lever un siége et perdre une ville pour avoir une relique
, Montesquieu, Rom. 22.Les serments les plus ordinaires des anciens Français se faisaient sur les reliques des saints
, Voltaire, Dict. phil. Reliques.Le catéchisme du concile de Trente approuve la coutume de jurer par les reliques
, Voltaire, ib.Les saints supposés, les faux miracles, les fausses reliques commencèrent à être décriés
, Voltaire, Louis XIV, 35.Ce pèlerin espagnol, tout glorieux d'avoir visité plus de reliques qu'aucun de ses pareils
, D'Alembert, Éloges, St-Aulaire.Ce sont les femmes qui ont dû inventer le culte des reliques, par le même sentiment qui leur fait attacher tant de prix à un chiffre, à un n?ud de ruban, ou à une boucle de cheveux qui leur vient d'un objet aimé
, Genlis, V?ux téméraires, t. II, p. 38, dans POUGENS.Garder une chose comme une relique, la garder soigneusement.
Il en fait une relique, des reliques, se dit d'un homme qui fait grand état de quelque chose.
Familièrement. Je n'en veux pas faire des reliques, se dit d'une chose dont on veut se servir, dont on permet de se servir.
Fig. et familièrement. Je n'ai pas grande foi à ses reliques, je ne prendrai pas de ses reliques, il ne m'inspire aucune confiance.
-
2
Reliques d'affection, se disait d'objets que la piété filiale traitait comme des reliques?; c'étaient des souvenirs de famille légués par affection de génération en génération
, De Laborde, Ém. p. 478. -
3 Au plur. Dans le style élevé. Débris, restes de quelque chose de grand (mot qui vieillit, mais qui est défendu par l'autorité de Racine, et que A. de Musset a heureusement rajeuni).
Il ne faut pas que tu penses Trouver de l'éternité En ces pompeuses dépenses Qu'invente la vanité?; Tous ces chef-d'?uvres antiques Ont à peine leurs reliques?
, Malherbe, II, 2.Il rentra dans Babylone avec les tristes reliques de l'armée
, Vaugelas, Q. C. IV, 16.Je les blâme de condamner reliques, qui sans doute est meilleur et beaucoup plus noble que restes dans la majesté du style de l'histoire
, Vaugelas, Nouv. rem. obs, de M*** p. 118, dans POUGENS.Voyons sous un tombeau ces muettes reliques
, Rotrou, Herc. mour. IV, 3.Sur un vaisseau dans le port préparé, Chargeant de mon débris les reliques plus chères
, Racine, Baj. III, 2.Ils s'arrêtent non loin de ces tombeaux antiques, Où des rois ses aïeux sont les froides reliques
, Racine, Phèd. V, 6.Fig.
Les morts dorment en paix dans le sein de la terre?; Ainsi doivent dormir nos sentiments éteints?; Ces reliques du c?ur ont aussi leur poussière?; Sur leurs restes sacrés ne portons pas les mains
, Musset, Poésies nouv. Nuit d'octobre.
HISTORIQUE
XIe s. Sur les reliques de s'espée jura
, Ch. de Rol. XLV.
XIIIe s. Mais or sai bien ke reliques n'a mie En molt de lieus où li saint sont cuidié
, Maetzner, p. 37. Des saintuaires ne des hautes reliques qui i estoient ne covient-il mie parler
, Villehardouin, LXXXVII.
XIVe s. Ne passe tant d'oneur les termes, Que dedans ta chambre t'enfermes Pour homme qui veingne à ta court? On diroit?: c'est une relique Qu'on ne voit qu'une fois l'année?; Pis en vauroit ta renommée
, Machaut, p. 116. À Jehan du Vivier orfevre et varlet de chambre du roy, pour avoir fait et forgié un petit reliquaire d'or pendant à une chayenne d'or, ouquel a de la vraye croix de Rodes et de plusieurs autres reliques, pour mettre et porter au col dudit seigneur
, De Laborde, Émaux, p. 478. Et à ce que Grisilidis n'apportast avecques soy aucunes reliques de la vile fortune de povreté?
, Ménagier, I, 6.
XVe s. Compains, compains, ce ne poet estre, Que nullement voiiés le prestre Qui jà jour ses reliques blasme
, Froissart, Poésies mss. p. 390, dans LACURNE. Et de très grans capitaines comme? dont je m'en tais?; car ce n'est point de mon temps, combien que j'en ay veu des reliques
, Commines, I, 3.
XVIe s. C'est tout ce que j'ay peu recouvrer de ses reliques [deux livres de La Boétie]
, Montaigne, I, 206. S'il [l'envahisseur] venoit à la perte d'une battaille, [qu'il n'aurait] aulcun moyen de sauver les reliques de son armée
, Montaigne, I, 357. Il se trouveroit alors plus de douze cens gentils-hommes, qui auroyent moyen, sans solde, de l'accompagner [le roi], qui sont encores de bonnes reliques de la France ruinée, et qui feroyent autant de miracles que celles de S. Mathurin de Larchant
, Lanoue, 95. Chascun chapelain loue ses reliques
, Génin, Récréat. t. II, p. 236. Brutus et Cassius, qui, se tuans, avec le temps et l'occasion perdirent les reliques de la liberté romiane, de laquelle ils estoient protecteurs
, Charron, Sagesse, p. 382, dans LACURNE.
Encyclopédie, 1re édition
RELIQUE, s. f. (Hist. ecclés. & prof.) ce mot tiré du latin reliquiæ, indique que c'est ce qui nous reste d'un saint ; os, cendres, vêtemens, & qu'on garde respectueusement pour honorer sa mémoire ; cependant si l'on faisoit la revision des reliques avec une exactitude un peu rigoureuse, dit un savant bénédictin, il se trouveroit qu'on a proposé à la piété des fideles un grand nombre de fausses reliques à révérer, & qu'on a consacré des ossemens, qui loin d'être d'un bienheureux, n'étoient peut-être pas même d'un chrétien.
On pensa, dans le iv. siecle, d'avoir des reliques des martyrs, sous les autels dans toutes les églises. On imagina bien-tôt cette pratique comme si essentielle, que S. Ambroise, malgré les instances du peuple, ne voulut pas consacrer une église, parce, disoit-il, qu'il n'y avoit point de reliques. Une opinion si ridicule prit néanmoins tant de faveur, que le concile de Constantinople in Trullo, ordonna de démolir tous les autels sous lesquels il ne se trouveroit point de reliques.
L'origine de cette coutume, c'est que les fideles s'assembloient souvent dans les cimetieres où reposoient les corps des martyrs ; le jour anniversaire de leur mort, on y faisoit le service divin, on y célébroit l'Eucharistie. L'opinion de l'intercession des saints, les miracles attribués à leurs reliques, favoriserent les translations de leurs corps dans les temples ; enfin le passage figuré de l'Apocalypse, ch. vj. v. 9. « Je vis sous les autels les ames de ceux qui avoient été tués pour la parole de Dieu », autorisa l'usage d'avoir toujours des reliques sous l'autel. Scaliger a prouvé tous ces faits dans son ouvrage sur la chronique d'Eusebe.
Avant que d'aller plus loin, considérons un moment l'importance qu'il y a d'arrêter de bonne heure des pratiques humaines qui se rapportent à la religion, quelqu'innocentes qu'elles paroissent dans leur source. Les reliques sont venues d'une coutume qui pouvoit avoir son bon usage réduit à ses justes bornes. On voulut honorer la mémoire des martyrs, & pour cet effet l'on conserva autant qu'il étoit possible, ce qui restoit de leurs corps ; on célébra le jour de leur mort, qu'on appelloit leur jour natal, & l'on s'assembla dans les lieux que ces pieux restes étoient enterrés. C'est tout l'honneur qu'on leur rendit pendant les trois premiers siecles : on ne pensoit point alors qu'avec le tems les Chrétiens dussent faire des cendres des os des martyrs l'objet d'un culte religieux ; leur elever des temples ; mettre ces reliques sur l'autel ; séparer les restes d'un seul corps ; les transporter d'un lieu dans un autre ; en prendre l'un un morceau, l'autre un autre morceau ; les montrer dans des châsses ; & finalement en faire un trafic qui excita l'avarice à remplir le monde de reliques supposées. Cependant dès le iv. siecle, l'abus se glissa si ouvertement, & avec tant d'étendue, qu'il produisit toutes sortes de mauvais effets.
Vigilance fut scandalisé avec raison du culte superstitieux que le vulgaire rendoit aux reliques des martyrs. « Quelle nécessité, dit-il, d'honorer si fort ce je ne sais quoi, ce je ne sais quelles cendres qu'on porte de tous côtés dans un petit vase ? Pourquoi adorer, en la baisant, une poudre mise dans un linge ? » Nous voyons par-là la coutume du paganisme presque introduite, sous prétexte de religion. Vigilance appelle les reliques qu'on adoroit, un je ne sais quoi, un je ne sais quelles cendres, pour donner à entendre que l'on faisoit déjà passer de fausses reliques pour les cendres des martyrs ; & qu'ainsi ceux qui adoroient les reliques, couroient risque d'adorer toute autre chose que ce qu'ils s'imaginoient. Ces fraudes, dirai je, pieuses ou impies, si multipliées dans les siecles suivans, étoient déja communes.
S. Jérôme nous en fournit lui-même un exemple remarquable, qui suffiroit pour justifier Vigilance, qu'il a si maltraité à ce sujet. Peut-on croire, sans un aveuglement étrange, que plus de quatorze cens ans après la mort de Samuel, & après tant de révolutions arrivées dans la Palestine, on fût encore où étoit le tombeau de ce prophete, enseveli à Rama ? Samuel, xxvj. Cependant on nous dit que l'empereur Accadius fit transporter de Judée à Constantinople, les os de Samuel, que des évêques portoient environnés d'une étoffe de soie, dans un vase d'or, suivis d'un cortege de peuple de toutes les églises, qui ravis de joie, comme s'ils voyoient le prophete plein de vie, allerent au-devant des ses reliques, & les accompagnerent depuis la Palestine jusqu'à Chalcédoine, en chantant les louanges de Jesus-Christ. Il n'en faut pas davantage pour montrer jusqu'où la fourberie & la crédulité avoient déjà été portées, & combien Vigilance avoit raison de dire, qu'en adorant les reliques, on adoroit je ne sais quoi. Cette raison seule devoit bien réprimer l'empressement de ceux qui couroient après les reliques, dans la crainte d'être les dupes de l'avarice des ecclésiastiques, qui userent de ce moyen pour s'attirer des offrandes. Vigilance vouloit donc qu'on fît un juste discernement des vraies reliques d'avec les fausses ; & qu'à l'égard même des vraies, on modérât les honneurs qu'on leur rendoit.
On eût très-bien fait sans doute de suivre le conseil de Vigilance, au sujet des reliques ; car il arriva que la superstition fut soutenue & encouragée par l'intérêt. Le peuple est superstitieux, & c'est par la superstition qu'on l'enchaîne. Les miracles forgés au sujet des reliques, devinrent un aimant qui attiroit de toutes parts des richesses dans les églises où se faisoient ces miracles. Si S. Jérôme se fût bien conduit, il se seroit opposé vigoureusement à une superstition qui n'étoit déjà que trop difficile à déraciner ; il auroit au moins su bon gré à Vigilance de sa résolution courageuse ; & loin de le rendre l'objet de la haine publique, il auroit dû seconder ses efforts.
En effet, dès l'année 386, l'empereur Théodose le grand fut obligé de faire une loi, par laquelle il défendoit de transporter d'un lieu dans un autre, les corps ensevelis, de séparer les reliques de chaque martyr, & d'en trafiquer. Quinze ans après, le 5e. concile de Carthage ordonna aux évêques de faire abattre les autels qu'on voyoit élever par-tout dans les champs & sur les grands chemins, en l'honneur des martyrs, dont on enterroit çà & là de fausses reliques, sur des songes & de vaines révélations de toutes sortes de gens.
S. Augustin reconnoit lui-même les impostures que faisoient en ce genre quantité de moines, & les faux miracles qu'ils débitoient. Le concile de Carthage dont nous venons de parler, craignoit les tumultes, parce que cette superstition s'étoit emparée de l'esprit du peuple. Les évêques usoient de connivence ; & l'auteur de la cité de Dieu déclare naïvement qu'il n'ose parler librement sur plusieurs semblables abus, pour ne pas donner occasion de scandale à des personnes pieuses, ou à des brouillons. L'amour des reliques étoit venu au point qu'on ne vouloit point d'églises ni d'autels sans reliques : il falloit donc bien en trouver à quelque prix que ce fût, de sorte qu'au défaut des véritables, on en forgea de fausses.
Voilà quelle fut l'occasion de tant de sortes d'impostures, dit M. l'abbé Fleuri, 3. discours ; car pour s'assurer des vraies reliques, il eût fallu les suivre exactement depuis leur origine, & connoître toutes les mains par lesquelles elles avoient passé ; or après plusieurs siecles il fut bien aisé d'en imposer non seulement au peuple, mais aux évêques devenus moins éclairés & moins attentifs ; & depuis qu'on eut établi la regle de ne point consacrer d'églises ni d'autels sans reliques, la nécessité d'en avoir fut une grande tentation de ne les pas examiner de si près. L'intérêt d'attirer des offrandes fut encore une nouvelle tentation plus difficile à vaincre.
Après cela, il ne faut pas s'étonner du mérite qu'acquirent les reliques dans l'esprit des peuples & des rois. Nous lisons que les sermens les plus ordinaires des anciens françois se faisoient sur les reliques des saints. C'est ainsi que les rois Gontran, Sigebert & Chilpéric partagerent les états de Clotaire, & convinrent de jouir de Paris en commun. Ils en firent le serment sur les reliques de S. Polieucte, de S. Hilaire & de S. Martin. Cependant Chilpéric se jetta dans la place, & prit seulement la précaution d'avoir la châsse de quantité de reliques, qu'il fit porter comme une sauve garde à la tête de ses troupes, dans l'espérance que la protection de ces nouveaux patrons le mettroit à l'abri des peines dûes à son parjure ; sur quoi il est bon d'observer que nos rois de la premiere & de la seconde race gardoient dans leur palais un grand nombre de reliques, surtout la chappe & le manteau de S. Martin, & qu'ils les faisoient porter à leur suite, & jusque dans les armées. On envoyoit les reliques du palais dans les provinces, lorsqu'il étoit question de prêter serment de fidélité au roi, ou de conclure quelque traité.
Je ne me propose pas de donner au lecteur un recueil des excès où la superstition & l'imposture ont été portées dans les siecles suivans en matiere de reliques ; mais je ne crois pas devoir lui laisser ignorer ce que raconte Grégoire de Tours, hist. l. IX. c. vj. que dans la châsse d'un saint, on trouva des racines, des dents de taupe, des os de rats, & des ongles de renard.
A propos de Tours, Hospinien remarque que dans cette ville on adoroit avec beaucoup de superstition une croix d'argent ornée de quantité de pierres précieuses, entre lesquelles il y avoit une agathe gravée qui étant portée à Orléans, & examinée par les curieux, se trouva représenter Vénus pleurant Adonis mourant.
Cette anecdote me fait souvenir d'une agathe dont parle le p. Montfaucon (antiq. expliquée, supplément. tom. I. liv. 2, c. iij.), & qui est présentement dans le cabinet du roi. On y voit aux deux côtés d'un arbre, Jupiter & Minerve ; ce qui passoit pour l'image du paradis terrestre & du péché d'Adam, dans une des plus anciennes églises de France, d'où elle a été ôtée depuis près de cent ans, après y avoir été gardée pendant plusieurs siecles. Dans ces tems de simplicité, ajoute le docte bénédictin, on n'y regardoit pas de si près. La grande agathe de la Ste. Chapelle, qui représente l'apothéose d'Auguste, a passé pendant plusieurs siecles, pour l'histoire de Joseph, fils de Jacob. Une onyce qui représente les têtes de Germanicus & d'Agrippine? a été honorée pendant 600 ans, comme la bague que S. Joseph donna à la Ste. Vierge, quand ils se marierent. On la baisoit en cette qualité tous les ans, dans certains jours de l'année ; cela dura jusqu'à ce qu'on s'apperçut sur la fin du dernier siecle, qu'une inscription greque, en caracteres fort menus, appelloit Germanicus Alphée, & Agrippine Aréthuse.
Ceux qui voudront des exemples en plus grand nombre sur les erreurs en matiere de reliques, peuvent consulter Chemnitius, examen concil. trident. Hospinien, de origine templorum, & en particulier un mémoire inséré dans la Biblioth. Histor. philolog. théolog. de M. de Hare, class. vij. fascic. vj. art. 4, sous ce titre : Jo. Jacob. Rambachii observatio, de ignorantiâ exegeticâ multarum reliquiarum sacrarum, matre & obstetrice.
Strabon observe qu'il étoit hors de vraissemblance qu'il y eût plusieurs vrais simulacres apportés de Troie ; on se vante, dit-il, à Rome, à Lavinium, à Lucérie, à Séris, d'avoir la Minerve des Troyens. Strabon pense solidement ; car dès qu'on voit plusieurs villes se glorifier de la possession d'une même relique, ou de la même image miraculeuse, c'est une très-forte présomption que toutes s'en vantent à faux, & que le même artifice, le même intérêt, les porte toutes à débiter leurs traditions.
M. de Maroles, abbé de Villeloin, a renouvellé cette remarque dans ses mémoires, pag. 132. ann. 1641.
« Comme, dit-il, on montroit à Amiens, à la princesse Marie de Gonzague, la tête de S. Jean-Baptiste, que le peuple y révere pour l'une des plus considérables reliques du monde, son altesse, après l'avoir baisée, me dit que j'approchasse, & que j'en fisse autant ; je considérai le reliquaire & ce qu'il renfermoit ; ensuite me comportant comme tous les autres, je me contentai de dire avec toute la douceur dont j'étois capable, que c'étoit la cinq ou sixieme tête de S. Jean-Baptiste que j'avois eu l'honneur de baiser ; ce discours surprit un peu son altesse, & fit naître un petit souris sur son visage ; mais il n'y parut pas. Le sacristain ou le trésorier, ayant aussi entendu mon propos, répliqua qu'il ne pouvoit nier qu'on ne fît mention de beaucoup d'autres têtes de S. Jean-Baptiste (car il avoit peut-être oüi dire qu'il y en avoit à S. Jean de Lyon, à S. Jean de Maurienne, à S. Jean d'Angely en Saintonge, à Rome, en Espagne, en Allemagne, & en plusieurs autres lieux) ; mais il ajouta que celle-là étoit la bonne ; & pour preuve de ce qu'il assuroit, il demanda qu'on prît garde au trou qui paroissoit au crâne de la relique au-dessus de l'?il droit ; & que c'étoit celui-là même que fit Hérodias avec son couteau, quand la tête lui fut présentée dans un plat. Il me semble, lui répondis-je, que l'évangile n'a rien observé d'une particularité de cette nature ; mais comme je le vis ému pour soutenir le contraire, je lui cédai avec toute sorte de respect. Et sans examiner la chose plus avant, ni lui rapporter une autorité de S. Grégoire de Naziance, qui dit que tous les ossemens de S. Jean-Baptiste furent brûlés de son tems par les Donatistes dans la ville de Sébaste, & qu'il n'en resta qu'une partie du chef qui fut portée à Alexandrie ; je me contentai de lui dire que la tradition d'une église aussi vénérable que celle d'Amiens, suffisoit pour autoriser une créance de cette espece, bien qu'elle n'eût que quatre cens ans, & que ce ne fût pas un article de foi. Cependant nous nous munîmes de force représentations de ce saint reliquaire ; & le bon ecclésiastique resta très satisfait ».
L'auteur des nouvelles de la république des lettres parlant d'un livre qui traitoit du S. Suaire, rapporte ces paroles de Charles Patin : « je suis fâché de voir trop souvent le portrait de la Vierge peint par S. Luc ; car il n'est pas vraissemblable que S. Luc ait tant de fois peint la mere de notre Sauveur. »
C'en est assez sur la folle crédulité des hommes, & sur les erreurs qui n'ont fait que se multiplier dans la vénération des reliques. Je ne suis point curieux d'examiner la question, si leur origine est payenne, ce dont S. Cyrille, lib. X. p. 336, est convenu dans sa réponse à l'empereur Julien, qui le premier a reproché aux Chrétiens le culte des morts & de leurs reliques. Je reconnois avec plus de plaisir que les lumieres du dernier siecle ont mis un grand frein à la superstition qui s'étoit si fort étendue sur les fraudes pieuses à cet égard ; mais en même tems il faut avouer qu'il n'en reste encore que trop de traces dans plusieurs lieux de la chrétienté ; c'est sans doute ce qui a engagé d'habiles gens de la communion romaine à s'élever courageusement contre les fausses reliques. M. Thiers, que je ne dois pas oublier de nommer, a discuté dans ses écrits, l'état des lieux où peuvent être les corps des martyrs ; il a publié en particulier des dissertations contre la Ste. Larme de Vendôme, & les reliques de S. Firmin. Le p. Mabillon a cru devoir aussi donner des conseils sur le discernement des reliques ; il me semble qu'on auroit dû les écouter ; mais le chancelier de France ne fut pas de cet avis ; il fit supprimer par arrêt du conseil, l'ouvrage de M. Thiers sur S. Firmin ; & l'ordre de S. Benoît condamna le p. Mabillon. On sait le bon mot qu'un sous-prieur de S. Antoine dit alors sur ces deux condamnations. Moribus antiquis, &c.
Cependant je ne crois point aujourd'hui d'être blâmé, pour avoir considéré avec M. l'abbé Fleury, sans satyre & sans irreligion, « les abus que l'ignorance & les passions humaines ont produit dans la vénération des reliques, non-seulement en se trompant dans le fait, & honorant comme reliques ce qui ne l'étoit pas, mais en s'appuyant trop sur les vraies reliques, & les regardant comme des moyens infaillibles d'attirer sur les particuliers & sur les villes, toutes sortes de benédictions temporelles & spirituelles. Quand nous aurions, continue cet illustre historien, les saints même vivans & conversans avec nous, leur présence ne nous seroit pas plus avantageuse que celle de Jesus-Christ, comme il le déclare expressément dans l'évangile, Luc xiij. 26. Vous direz au pere de famille, nous avons bu & mangé avec vous, & vous avez enseigné dans nos places ; & il vous répondra, je ne sais qui vous êtes ». Tom. I. disc. ecclésiast. (Le chevalier de Jaucourt.)
Étymologie de « relique »
Wallon, rilik?; provenç. reliquias?; espagn. et ital. reliquia?; du lat. reliquiae, restes, de relinquere, laisser, de re, et linquere, de même radical que ??? dans ???????, laisser?; sansc. ric.
- Du latin reliquiae (« les restes »).
relique au Scrabble
Le mot relique vaut 14 points au Scrabble.
Informations sur le mot relique - 7 lettres, 4 voyelles, 3 consonnes, 6 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot relique au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
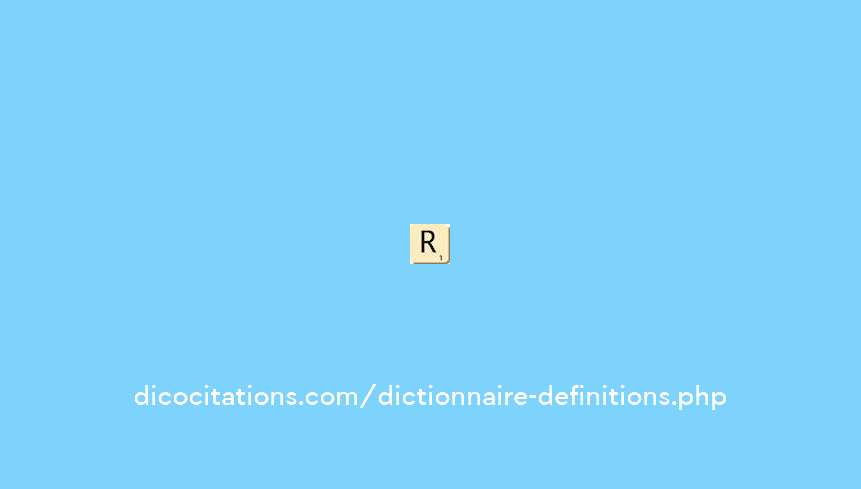
Les rimes de « relique »
On recherche une rime en IK .
Les rimes de relique peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en ik
Rimes de volumétrique Rimes de humoristique Rimes de décortique Rimes de génomiques Rimes de Gellik Rimes de tactiques Rimes de toniques Rimes de sarcastiques Rimes de Belgique Rimes de allégorique Rimes de anti-démocratiques Rimes de tactique Rimes de chique Rimes de entomologique Rimes de diplomatique Rimes de domestiques Rimes de holistiques Rimes de diastolique Rimes de néoplasique Rimes de systoliques Rimes de aéronautiques Rimes de cycliques Rimes de diabétique Rimes de désintoxique Rimes de lithique Rimes de géométriques Rimes de fanatique Rimes de homéopathiques Rimes de narcotique Rimes de talmudique Rimes de radiographique Rimes de astronomique Rimes de patriotiques Rimes de tragique Rimes de psychopathologique Rimes de tique Rimes de paraplégique Rimes de botulique Rimes de sismique Rimes de lymphatiques Rimes de bardiques Rimes de thermodynamique Rimes de statistiques Rimes de anémométrique Rimes de post-traumatiques Rimes de stochastique Rimes de flegmatique Rimes de neurasthéniques Rimes de frics Rimes de pharaoniqueMots du jour
volumétrique humoristique décortique génomiques Gellik tactiques toniques sarcastiques Belgique allégorique anti-démocratiques tactique chique entomologique diplomatique domestiques holistiques diastolique néoplasique systoliques aéronautiques cycliques diabétique désintoxique lithique géométriques fanatique homéopathiques narcotique talmudique radiographique astronomique patriotiques tragique psychopathologique tique paraplégique botulique sismique lymphatiques bardiques thermodynamique statistiques anémométrique post-traumatiques stochastique flegmatique neurasthéniques frics pharaonique
Les citations sur « relique »
- Tout bienfait qui n'est pas cher au coeur est odieux. C'est une relique ou un os de mort: il faut l'enchâsser ou le fouler aux pieds.Auteur : Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort - Source : Maximes et Pensées, Caractères et Anecdotes (1795)
- Madame Prune, un jour, était allée nous chercher une relique de sa galante jeunesse, un peigne en écaille blonde d'une transparence rare ...Auteur : Louis Marie Julien Viaud, dit Pierre Loti - Source : Madame Chrysanthème (1887)
- Saint-Suaire : Relique remarquablement bien conservée, car elle ne s'use que si l'on saint-suaire.Auteur : Marc Escayrol - Source : Mots et Grumots (2003)
- Ainsi en est-il des reliques: tout y est si brouillé et confus, qu'on ne saurait adorer les os d'un martyr qu'on ne soit en danger d'adorer les os de quelque brigand ou larron, ou bien d'un âne, ou d'un chien, ou d'un cheval.Auteur : Jean Cauvin, dit Jean Calvin - Source : Traité des reliques
- Ce pèlerin espagnol, tout glorieux d'avoir visité plus de reliques qu'aucun de ses pareils.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Eloges, Saint-Aulaire
- Parfait Anglais, voyageant sans dessein,
Achetant cher de modernes antiques,
Regardant tout avec un air hautain,
Et méprisant les saints et leurs reliques.Auteur : Voltaire - Source : La Pucelle d'Orléans (1762), Chant VIII - Ah! Durendal, comme tu es belle et sainte! Dans ton pommeau doré, il y a beaucoup de reliques: une dent de Saint Pierre, du sang de Saint Basile, et des cheveux de Monseigneur Saint Denis, et du vêtement de Sainte Marie.Auteur : Chanson de Roland - Source : Sans référence
- J'ai deux montres : une authentique et une autre en toc. L'authentique est anti-choc, mais l'autre en toc étant très chic, j'hésite toujours entre ma relique antique et ma breloque en toc. Alors, comme, les tocantes authentiques, les pickpockets les piquent, en empochant votre fric dans la poche de votre froc, pour ne pas les tenter je mets ma montre en toc. Question d'éthique. Et toc!Auteur : Marc Escayrol - Source : Mots et Grumots (2003)
- Ainsi j'appelle miraculeuse la guérison d'une maladie, faite par l'attouchement d'une sainte relique; la guérison d'un démoniaque, faite par l'invocation du nom de Jésus, etc.Auteur : Blaise Pascal - Source : Pensées (1670)
- Je sais qu'il est des yeux, des plus mélancoliques, - Qui ne recèlent point de secrets précieux; - Beaux écrins sans joyaux, médaillons sans reliques, - Plus vides, plus profonds que vous-mêmes, ô Cieux!Auteur : Charles Baudelaire - Source : Les Fleurs du Mal (1857)
- Il devrait être entendu une fois pour toutes parmi les fidèles que toutes les reliques sont authentiques, qu'il suffit en tout cas qu'on ait prié devant elles pour qu'elles le deviennent.Auteur : André Frossard - Source : Les Pensées
- Il n'en est pas des reliques d'un philosophe comme de celles d'un saint; on les garde sans profit.Auteur : Frédéric-Melchior, baron de Grimm - Source : Dans la Gazette Littéraire, mai 1774.
- Les morts dorment en paix dans le sein de la terre: - Ainsi doivent dormir nos sentiments éteints. - Ces reliques du coeur ont aussi leur poussière.Auteur : Alfred de Musset - Source : La Nuit d'octobre (1837)
- Comme on voit le glaneur - Cheminant pas à pas recueillir les reliques - De ce qui va tombant après le moissonneur.Auteur : Joachim Du Bellay - Source : Les Antiquités de Rome
- La prétendue croix miraculeuse dont nous avons parlé dans l'éloge de Fléchier, et contre laquelle il donna une lettre pastorale, avait été érigée par un berger que le prélat fit sortir de son diocèse; on ratissait le bois de cette croix comme une relique.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Eloges, Fléchier
Les mots proches de « relique »
Relabourement Relabourer Relâchant, ante Relâche Relâche Relâché, ée Relâchement Relâcher Relais Relaissé, ée Relaisser (se) Relait Relancé, ée Relancer Relaps, apse Rélargir Relater Relateur Relatif, ive Relation Relativement Relaver Relaxance Relaxation Relaxe Relaxer Relayer Relayeur Relecture Relégation Relégué, ée Reléguer Relent Relenti, ie Relevailles Relevant, ante Relevé, ée Relève Relevée Relèvement Relever Releveur Reliage Relié, ée Relief Relier Relieur Religieusement Religieux, euse ReligionLes mots débutant par rel Les mots débutant par re
relaça relaçaient relaçait relacent relacer relâcha relâchai relâchaient relâchais relâchait relâchant relâche relâche relâché relâché relâchée relâchée relâchées relâchées relâchement relâchements relâchent relâcher relâchera relâcherai relâcheraient relâcherait relâcheras relâchèrent relâcherez relâcherons relâcheront relâchés relâchés relâchez relâchiez relâchons relaie relaient relaiera relaieraient relaierait relaieront relais relaisser relança relançai relançaient relançais relançait
Les synonymes de « relique»
Les synonymes de relique :- 1. restes
2. ossement
3. cendres
4. trésor
5. fétiche
6. amulette
7. souvenir
synonymes de relique
Fréquence et usage du mot relique dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « relique » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot relique dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Relique ?
Citations relique Citation sur relique Poèmes relique Proverbes relique Rime avec relique Définition de relique
Définition de relique présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot relique sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot relique notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 7 lettres.
