Définition de « charme »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot charme de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur charme pour aider à enrichir la compréhension du mot Charme et répondre à la question quelle est la définition de charme ?
Une définition simple : Commune dans le département 45 (Loiret) en région Centre (France)
Définitions de « charme »
Trésor de la Langue Française informatisé
CHARME1, subst. masc.
CHARME2, subst. masc.
Wiktionnaire
Nom commun 1 - français
charme \?a?m\ masculin
-
(Au pluriel) Qualités aimables, attraits, séduction ou ascendant qu'exercent sur l'imagination les objets qui la frappent vivement et qui produisent sur elle l'admiration, l'enthousiasme.
- Belle Rowena, répondit de Bracy sur le même ton, c'est à vous, à vos propres charmes, qu'il faut attribuer tout ce que j'ai fait, [?]. ? (Walter Scott, Ivanhoé, traduit de l'anglais par Alexandre Dumas, 1820)
- François se dévoyait auprès des filles publiques, [?]. On dit que ces professionnelles ont des charmes secrets, des recettes magiques pour exaspérer la volupté de leurs clients et leur procurer des extases sans pareilles. ? (Jean Rogissart, Hurtebise aux griottes, L'Amitié par le livre, Blainville-sur-Mer, 1954)
-
Pouvoir de séduction ; talent de charmer.
- Son plus grand charme venait d'une physionomie dont le calme trahissait une étonnante profondeur dans l'âme. ? (Honoré de Balzac, La Femme de trente ans, Paris, 1832)
- Les Liméniennes ont toutes de belles couleurs, [?], des yeux noirs d'une expression indéfinissable d'esprit, de fierté et de langueur ; c'est dans cette expression qu'est tout le charme de leur personne. ? (Flora Tristan, Les Femmes de Lima, dans Revue de Paris, tome 32, 1836)
- Comme tous ceux qui écrivent beaucoup, Balzac parlait peu... Mais, dès qu'il parlait, le charme opérait. Il y avait, dans sa parole, une telle autorité, une telle séduction, qu'on oubliait très vite ses disgrâces physiques. ? (Octave Mirbeau, La Mort de Balzac, 1907)
-
(Au pluriel) Attraits sexuels d'une fille ou d'une femme.
- Et cependant les sabots garnis de dentelles découvraient admirablement ses bras nus, la gorge s'encadrait dans le pur corsage aux tulles jaunis, aux rubans passés, qui n'avait serré que bien peu les charmes évanouis de la tante. ? (Gérard de Nerval, Les Filles du feu, Sylvie, 1854)
- Des messieurs, [?], auscultaient des paumes les charmes de ces demoiselles servantes, impassibles mais souriantes. Il y avait aussi des femmes qui les expertisaient d'un doigt agile, les yeux endiamantés de concupiscence. ? (Victor Méric, Les Compagnons de l'Escopette, Éditions de l'Épi, Paris, 1930, page 81)
-
La bergère, après bien des larmes,
Pour se consoler prit un mari,
Et ne dévoila plus ses charmes
Que pour lui? ? (Georges Brassens, Brave Margot, in Le Vent, 1953)
-
Sentiment délicieux que fait éprouver ce qui intéresse le c?ur, ce qui fait naître de douces sensations.
- Quand on traverse pour la première fois une rivière islandaise, on ne peut se défendre de la crainte; mais on s'accoutume vite à ce genre d'émotion, et l'on finit même par y trouver un certain charme. ? (Jules Leclercq, La Terre de glace, Féroë, Islande, les geysers, le mont Hékla, Paris : E. Plon & Cie, 1883, p.11)
- Par exemple arriver chez sa nouvelle blonde avec un tétrapack de vin rouge? ça brise le charme d'un souper en tête à tête. ? (Eau d'érable sur les tablettes, sur le forum Les sucriers.com : Forum acéricole, mai 2013)
-
Sort lancé sur une personne ; sortilège, enchantement.
- Par la messe ! je crois que le vieux Lucas de Beaumanoir a bien deviné juste, quand il affirme qu'elle a jeté un charme sur vous. ? (Walter Scott, Ivanhoé, traduit de l'anglais par Alexandre Dumas, 1820)
- Mon fils, mon cher fils ! [?] c'est Dieu qui nous a envoyé cette jeune fille pour détruire l'horrible charme dont vous étiez environné, et vous venger du mal qui vous a été fait, à vous et à votre mère. ? (Les Mille et Une Nuits, traduction Antoine Galland,1704. Ve nuit)
Nom commun - ancien français
charme \t?ar.m?\ masculin
-
Charme.
- Les aucuns de ces arioles affirmoient que le roi estoit demené par sorts et par carmes. ? (FROISS., III, IV, 54)
- Il dit un charme que il avoir aprins. ? (Garin, II, 104)
Nom commun 2 - français
charme \?a?m\ masculin
- Genre d'arbres et d'arbustes de la famille des bétulacées des régions tempérées de l'hémisphère nord, d'Asie Mineure et d'Europe qui sont des arbres pouvant mesurer jusqu'à 25 mètres, à feuilles caduques, alternes, petites (de 3 à 10 cm de long), simples, avec le bord du limbe finement denté, aux fleurs regroupées en inflorescences, en forme de chatons pendants, pollinisées par le vent et dont les fruits sont des akènes.
- Le Charme très abondant forme parfois avec la Clématite des fourrés obscurs presque impénétrables. ? (Gustave Malcuit, Contributions à l'étude phytosociologique des Vosges méridionales saônoises : les associations végétales de la vallée de la Lanterne, thèse de doctorat, Société d'édition du Nord, 1929, p. 174)
- Le domaine médio-européen est caractérisé par quelques arbres qui y trouvent leur aire essentielle : le Charme, l'Érable plane, le Mélèze. ? (Henri Gaussen, Géographie des Plantes, Armand Colin, 1933, p.90)
- Le charme perdit quelques branches mais ses racines étaient si profondes qu'il arrivait à puiser de l'eau dans les couches les plus lointaines de la terre. ? (Dominique Schwob, Contes de la grande yeuse: Paroles d'arbres des quatre coins du monde, 1998)
-
(Par métonymie) Bois du même arbre.
- Le charme s'emploie beaucoup dans le charronnage.
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Enchantement, ce qu'on suppose fait par art magique pour produire un effet extraordinaire. Opérer un charme, des charmes. Rompre, ôter, lever un charme. User de charmes. Fig., Le charme est rompu, L'illusion est détruite. Les manières de cette femme m'avaient d'abord séduit, mais le charme est rompu. Il signifie aussi figurément Ce qui plaît beaucoup, ce qui touche sensiblement. Un charme irrésistible. Un charme secret, indéfinissable. Cette personne a du charme, elle est pleine de charme. Il fait le charme de ma vie. Être sous le charme. Cela a son charme. Il s'emploie souvent au pluriel dans le sens d'Attraits, d'appas en parlant d'une femme. Les charmes d'une belle femme. On ne peut se défendre de ses charmes. Rien ne résiste au pouvoir de ses charmes. Par extension, Les charmes de la vertu, de l'étude. La musique, la poésie a de grands charmes. Ces lieux ont pour moi bien des charmes. La mélancolie a des charmes.
Littré
-
1Effet prétendu d'un art magique qui change l'ordre naturel.
Le charme se rompit?; le pilote vit le rivage tel qu'il était
, Fénelon, Tél. IX.? Un charme ordinaire a trop peu de pouvoir Sur les spectres parlants qu'il faut vous faire voir
, Corneille, Illusion, I, 3.Mais je crains des chrétiens les complots et les charmes
, Corneille, Poly. I, 3.Je n'ai que des attraits et vous avez des charmes [en parlant à Médée]
, Corneille, Tois. d'or, III, 4.Un démon? Fit un charme si souverain Que?
, La Fontaine, Ch. imposs.Toute l'antiquité se servait de charmes contre la morsure des serpents
, Voltaire, M?urs, préj.Une Thessalienne a composé des charmes
, Chénier, 41.On avait saigné l'enfant, sa mère lui avait mis des charmes
, Chateaubriand, Itin. 74.Vous croyez donc que les déplaisirs et les plus mortelles douleurs ne se cachent pas sous la pourpre, ou qu'un royaume est un remède universel à tous les maux, un baume qui les adoucit, une charme qui les enchante??
Bossuet, Marie-Thérèse. -
2 Par extension.
Ces prières apostoliques qui, par un espèce de charme divin, suspendent les douleurs les plus violentes
, Bossuet, Duchesse d'Orl.Il se tait et ces mots semblent être des charmes
, Corneille, Hor. III, 2.Quel est ici ton charme, odieuse princesse??
Corneille, Rod. IV, 7.N'attendez point de moi de regrets ni de larmes?; Un grand c?ur à ses maux applique d'autres charmes
, Corneille, Pomp. V, 1.Et contre ma douleur j'aurais senti des charmes, Quand une main si chère eût essuyé mes larmes
, Corneille, Cid, III, 4.À ma douleur je chercherai des charmes
, Racine, Baj. II, 5.Quel charme l'attirait sur ces bords redoutés??
Racine, Phèdr. II, 1.Par quel charme secret laissé-je retenir Ce courroux si sévère et si prompt à punir??
Racine, Mithr. IV, 4.Par un charme fatal vous fûtes entraînée
, Racine, Phèdr. IV, 6.Ils s'aiment?! par quel charme ont-ils trompé mes yeux??
Racine, ib.Par quel charme, oubliant tant de tourments soufferts, Pouvez-vous consentir à rentrer dans ses fers??
Racine, Andr. I, 1.Fig. Le charme est rompu, l'illusion est détruite.
Il n'appartient qu'à vous de rompre le charme qui les éblouit
, Fléchier, Mont.Il est nécessaire que cet esprit lève le charme de l'amour-propre
, Bossuet, II, Fr. de P. 1.À peine y touchez-vous que le charme cesse
, Massillon, Car. Prosp.Rompez le charme fatal qui vous endort
, Massillon, ib. Tiédeur, sermon 2. -
3Ce qui plaît, ce qui touche, ce qui attire.
Reine, puisque ce titre a pour vous tant de charmes
, Corneille, Nic. III, 1.Tous ces charmes de langage Dont on s'offre à la servir, Me l'assurent [ma dame] davantage, Au lieu de me la ravir
, Malherbe, V, 3.Pour un c?ur généreux ce trépas a des charmes
, Corneille, Hor. II, 1.Qui veut que dans sa mort je trouve encor des charmes
, Corneille, ib. IV, 5.Le mérite a toujours des charmes éclatants
, Corneille, Sert. II, 1.Et s'il met à vos pieds ce charme de vos yeux [le diadème]
, Corneille, Pulch. I, 1.Mais c'était à l'insu de leurs parents cruels?; La défense est un charme
, La Fontaine, Filles de Minée.C'est proprement un charme [l'apologue]?; il rend l'âme attentive, Ou plutôt il la tient captive, Nous attachant à des récits
, La Fontaine, Fabl. VII, Dédic.Ne sentirai-je plus de charme qui m'arrête?? Ai-je passé le temps d'aimer??
La Fontaine, ib. IX, 2.Sa conversation était un charme, parce qu'il savait parler à chacun selon ses talents
, Bossuet, Louis de Bourbon.Jamais personne n'a jeté des charmes dans l'amitié comme vous faites
, Sévigné, 477.Il y a un charme pour les peuples dans la vue du prince
, Bossuet, Polit.Tout cédait au charme secret de ses entretiens
, Bossuet, Duch. d'Orl.Ce charme victorieux qui les entraîne
, Pascal, dans COUSIN.La simplicité qui fait le plus grand charme de la beauté
, Fénelon, Tél. IV.Et prête à mon discours un charme qui lui plaise
, Racine, Esth. I, 4.Retiens tes cris, et, par d'indignes larmes, De cet heureux moment [la mort] ne trouble pas les charmes
, Racine, Mithr. V, 2.Dans mon désespoir trouvez-vous tant de charmes??
Racine, Bér. V, 5.Qu'après un long hiver le printemps a de charmes?!
Racine, Poésies, 1.Pour l'homme de bien la vertu a mille fois plus de charmes que le vice
, Massillon, Car. Avenir.La vérité a des charmes dont un bon c?ur a peine à se défendre
, Massillon, ib.Vous plaignez mon exil, il a pour moi des charmes
, Voltaire, ?dipe, V, 1.La vie a ses attraits, mais la mort a ses charmes
, Voltaire, Triumv. I, 2.Il enchante ces lieux par un charme invincible
, Voltaire, Henr. IX.Rougis-tu d'être belle, ô charme de mes yeux??
Lamartine, Méd. II, 24. -
4 S. m. plur. En parlant d'une femme, attraits, appas.
Celle dont mes ennuis avaient leur guérison S'en va porter ailleurs ses appas et ses charmes
, Malherbe, V, 7.Elle pleure en secret le mépris de ses charmes
, Racine, Andr. I, 1.Hermione à Pyrrhus prodiguait tous ses charmes
, Racine, ib. I, 1.Il commençait à trouver des charmes dans sa personne
, Hamilton, Gramm. 4.Vénus avait répandu sur elle de nouveaux charmes
, Fénelon, Tél. VII.
REMARQUE
1. D'après les grammairiens, ce mot ne se dit qu'au pluriel dans le sens d'attraits, d'appas, et qu'au singulier quand il signifie cette puissance secrète qui attire, ce qui plaît, ce qui touche. La première partie de la remarque est vraie?; mais la seconde ne l'est pas, comme on peut s'en assurer en parcourant les exemples. Cette distinction, qui n'a rien en soi de logique ou de grammatical, ne pourrait être qu'une affaire d'usage?; or l'usage même est contre elle.
2. Des grammairiens prétendent que charme ne se dit pas des personnes comme des choses. Cette remarque n'est pas fondée. Lamartine a très bien dit?: ô charme de mes yeux. Corneille a dit charme à, par une tournure poétique, aujourd'hui archaïque?: Si vous n'avez un charme à [un moyen de] vous justifier
, Corneille, Rod. V, 4.
SYNONYME
1. CHARME, ENCHANTEMENT., Le charme (carmen) est une formule en vers ou en prose mesurée à laquelle on attribue la vertu de troubler l'ordre de la nature. L'enchantement (incantamentum) est l'action de prononcer cette formule. Comme à tout moment, dans le discours, on prend la cause pour l'effet ou l'antécédent pour le conséquent, la différence des deux mots disparaît, et ils sont la plupart du temps synonymes.
2. CHARMES, APPAS., On est très porté à confondre absolument ces deux termes. Mais, à une époque où l'on était plus près du sens primitif des mots, Malherbe n'a pas hésité à mettre?: ses appas et ses charmes. En effet, appas se dit des beautés qui attirent?; et charmes, de celles qui agissent par une vertu occulte, magique.
HISTORIQUE
XIIe s. Il dit un charme que il avoit aprins
, Garin, II, 104. E uns charmes truvad, par unt il soleit asuager les mals
, Rois, 241.
XIIIe s. Mès or sai bien que je feré?; Un bon charme vos aprendré
, Ren. 7650.
XVe s. Les aucuns de ces arioles affirmoient que le roi estoit demené par sorts et par carmes
, Froissart, III, IV, 54. À l'amour ne suys adonné, Et j'ame encore moins les armes, Mais le vin, dès que je fus né?; C'est pourquoi j'en fai tous mes carmes [vers]
, Basselin, 1.
XVIe s. Conjurations, charmes, characteres?
, Paré, Introd. 27.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
1. CHARME. Ajoutez?:Aimer comme un charme, s'est dit pour aimer beaucoup, être ensorcelé par la passion, Vadé, ?uvr. compl. t. II, p. 303, dans CH. NISARD, Parisianismes, Paris, 1876, p. 45.
On dit se porter comme un charme, pour se porter bien, par une fausse analogie avec aimer comme un charme
, Ch. Nisard, ib.
REMARQUE
Ajoutez?:3. Charmes, au pluriel, ne se dit qu'en parlant des femmes. Cependant Racine l'a dit, non malheureusement, d'un homme. Je plaignis Bajazet, je lui vantai ses charmes, Qui, par un soin jaloux dans l'ombre retenus, Si voisins de ses yeux, leur étaient inconnus
, Racine, Baj. I, 1.
Encyclopédie, 1re édition
CHARME, voyez Appas.
* Charme, Enchantement, Sort, (Synonymes Gram.) termes qui marquent tous trois l'effet d'une opération magique, que la religion condamne, & que l'ignorance des peuples suppose souvent où elle ne se trouve pas. Si cette opération est appliquée à des êtres insensibles, elle s'appellera charme : on dit qu'un fusil est charmé ; si elle est appliquée à un être intelligent, il sera enchanté : si l'enchantement est long, opiniâtre, & cruel, on sera ensorcelé.
* Charme, s. m. (Divinat.) pouvoir, ou caractere magique, avec lequel on suppose que les sorciers font, par le secours du démon, des choses merveilleuses, & fort au-dessus des forces de la nature. Voyez Magie & Magique.
Ce mot vient du Latin carmen, vers, poésie ; parce que, dit-on, les conjurations & les formules des magiciens étoient conçûes en vers. C'est en ce sens qu'on a dit :
Carmina vel cælo possunt deducere lunam.
On comprend parmi les charmes, les philacteres, les ligatures, les maléfices, & tout ce que le peuple appelle sorts. Voyez Philactere, Ligature &c.
La crédulité sur cet article a été de tous les tems, ou du moins il y a eu de tout tems une persuasion universellement répandue, que des hommes pervers, en vertu d'un pacte fait avec le démon, pouvoient causer du mal, & la mort même à d'autres hommes, sans employer immédiatement la violence, le fer, ou le poison ; mais par certaines compositions accompagnées de paroles, & c'est ce qu'on appelle proprement charme.
Tel étoit, si l'on en croit Ovide, le tison fatal à la durée duquel étoit attachée celle des jours de Méléagre. Tels étoient encore les secrets de Medée, au rapport du même auteur :
Devovet absentes, simulacraque cerea fingit ;
Et miserum tenues in jecur urget acus.
Horace, dans la description des conjurations magiques de Sagane & de Canidie, fait aussi mention des deux figures ; l'une de cire, & l'autre de laine, dont celle-ci, qui représentoit la sorciere, devoit persécuter & faire périr la figure de cire.
Lanea & effigies erat, altera cerea, major
Lanea quæ p?nis compesceret inferiorem.
Cerea simpliciter stabat, servilibus, utque
Jam peritura, modis.
Tacite, en parlant de la mort de Germanicus, qu'on attribuoit aux maléfices de Pison, dit qu'on trouva sous terre, & dans les murs, divers charmes. Reperiebantur solo & parietibus eructæ humanorum corporum reliquiæ, carmina & devotiones, & nomen Germanici plumbeis tabulis insculptum, semi-usti cineres, & tabo obliti, aliaque maleficia, queis creditur animas numinibus infernis sacrari. On sait que du tems de la ligue, les furieux de ce parti, & même des prêtres, avoient poussé la superstition jusqu'à faire faire de petites images de cire qui représentoient Henri III. & le roi de Navarre ; qu'ils les mettoient sur l'autel, & les perçoient pendant la messe quarante jours consécutifs, & le quarantieme jour les perçoient au c?ur, imaginant que par-là ils procureroient la mort à ces princes. Nous ne citons que ces exemples, & dans cette seule espece, entre une infinité d'autres de toutes les sortes, qu'on rencontre dans les historiens & dans les auteurs qui ont traité de la magie. On peut sur-tout consulter à cet égard Delrio disquisit. magicar. lib. III. part. j. quæst. iv. sect. 5. en observant toutefois que Delrio adopte tous les faits sur cette matiere avec aussi peu de précaution que Jean Wyer, Protestant, Medecin du duc de Cleves, qui a beaucoup écrit sur le même sujet, en apporte à les rejetter, ou à les attribuer à des causes naturelles. Ce qui n'empêche pas que Bodin, dans sa démonomanie, ne regarde Wyer comme un insigne magicien. Croire tout ou ne rien croire du tout, sont des extrèmes également dangereux sur cette matiere délicate, que nous nous contentons d'indiquer, & qui demanderoit, pour être approfondie, un tems & des recherches que la nature de cet ouvrage ne comporte pas.
Pour donner un exemple des charmes magiques, nous en rapporterons un par lequel on prétend qu'il s'est exécuté des choses fort singulieres en fait d'empoisonnement de bestiaux, de maladies aigues, & de douleurs causées à différentes personnes. Le voici tel qu'il a été décrit par un fameux sorcier nommé Bras-de-fer, au moment qu'il alloit subir son supplice en France. Il fut, dit-on, exécuté à Provins il y a 50 ans : ce que nous n'obligeons personne à croire.
On prend une terrine neuve vernissée, qu'il faut n'avoir ni achetée ni marchandée ; on y met du sang de mouton, de la laine, du poil de différens animaux, & des herbes venimeuses, qu'on mêle ensemble, en faisant plusieurs grimaces & cérémonies superstitieuses, en proférant certaines paroles, & en invoquant les démons. On met ce charme caché dans un endroit voisin de celui auquel on veut nuire, & on l'arrose de vinaigre, suivant l'effet qu'il doit produire. Ce charme dure un certain tems, & ne peut être emporté que par celui qui l'a mis, ou quelque puissance supérieure. Voyez Sorcier. (G)
Charme ; (Medec.) voy. Medecine magique.
Charme, voyez Enchantement.
Charme, s. f. (Hist. nat.) carpinus, genre d'arbre qui porte des chatons composés de plusieurs petites feuilles qui sont attachées en forme d'écailles à un axe, & qui couvrent chacune plusieurs étamines. Les embryons naissent sur le même arbre séparément des fleurs, & se trouvent entre les petites feuilles d'un épi qui devient dans la suite plus grand & plus beau. Alors au lieu d'embryon il y a des fruits osseux, marqués pour l'ordinaire d'un ombilic applati & cannelé. Ils renferment une semence arrondie, & terminée en pointe. Tournefort, Inst. rei herb. Voyez Plante. (I)
Ce grand arbre est fort commun dans les forêts, mais on en fait peu de cas : dans son état naturel il n'a nulle beauté ; il paroît vieux & chenu dès qu'il a la moitié de son âge, & il devient rarement d'une bonne grosseur. Son tronc court, mal proportionné, est remarquable sur-tout par des especes de cordes qui partent des principales racines, s'étendent le long du tronc, & en interrompent la rondeur. Son écorce blanchâtre, & assez unie, est ordinairement chargée d'une mousse brune qui la dépare. La tête de cet arbre, trop grosse pour le tronc, n'est qu'un amas de branches foibles & confuses, parmi lesquelles la principale tige se trouve confondue ; & la feuille, quoique d'un beau verd, étant petite, ne répond nullement à la grandeur de l'arbre ensorte que si à cette apparence ingrate, on ajoûte sa qualité de résister aux expositions les plus froides, de réussir dans les plus mauvais terreins, & d'être d'un bois rebours & des plus durs ; ne pourroit-on pas considérer le charme entre les arbres, comme on regarde un Lappon parmi les hommes ? Cependant en ramenant cet arbre à un état mitoyen, & en le soûmettant à l'art du jardinier, on a trouvé moyen d'en tirer le plus grand parti pour la variété, l'embellissement, & la décoration des jardins. Mais avant que d'entrer dans le détail de ce qui dépend de l'art, suivons le charme dans la simple nature.
Terrein, exposition. On met cet arbre au nombre de ceux qui par leur utilité tiennent le second rang parmi les arbres fruitiers. En effet il ne laisse pas d'avoir quelques qualités avantageuses : il remplit dans les bois des places, où presque tous les autres arbres se refusent, & il s'accommode de tous les terreins : on le voit dans les lieux froids, montagneux, & stériles ; il vient fort bien dans les terreins pierreux, graveleux, & sur-tout dans la craie, qui paroît être même son terrein naturel ; il se plaît souvent dans les terres dures, glaiseuses, humides ; enfin se trouve-t-il dans une bonne terre, où les autres arbres le gagnent de vîtesse, il vient dessous, & souffre leur ombrage. Quelque part que soit placé cet arbre, son bois est toûjours de mauvaise essence, son accroissement trop lent, & son branchage menu & court : cela peut être néanmoins compensé par la bonne garniture qu'il fait dans un taillis, où il vient épais & plus serré qu'aucune autre espece d'arbre, & par son tempérament robuste, qui le fait résister aux plus grands froids & aux gelées de printems, même lorsqu'il est en jeune rejetton sur taillis. C'est en cette nature de bois qu'on peut tirer le meilleur parti de cet arbre, qui croît trop lentement, & se couronne trop tôt, pour profiter en futaie. On prétend qu'il faut le couper à quinze ans pour le plus grand profit.
Usages du bois. Le bois du charme est blanc, compacte, intraitable à la fente, & le plus dur de tous les bois après le bouis, l'if, le cormier, &c. cependant de tous les bois durs, le charme est celui qui croît le moins lentement. On débite son bois pour le charronage, & principalement en bois à brûler, mais on ne l'employe jamais en menuiserie qu'au défaut de tout autre bois, moins parce qu'il est difficile à travailler, qu'à cause de son peu de durée, que la vermoulure interrompt bien-tôt. On s'en sert pour faire des essieux, & quelques autres pieces de charonage, dans les endroits où l'orme est rare. On en fait des vis de pressoir, des formes & des sabots, des manches d'outils champêtres, des jougs de b?ufs, des rouleaux pour les teinturiers : on l'employe aussi pour faire les menues garnitures des moulins, &c. Du reste ce bois n'est nullement propre à être employé à l'air ; il y pourrit en six ans : mais il est excellent à brûler, & il donne beaucoup de chaleur, qu'on dit être saine. C'est aussi l'un des meilleurs bois pour le charbon, qui conserve longtems un feu vif & brillant, comme celui du charbon de terre ; ce qui le fait rechercher pour les fourneaux de verrerie.
Usages de l'arbre. Des arbres que l'on connoît, le charme est le plus propre de tous à former des palissades, des haies, des portiques, des colonnades, & toutes ces décorations de verdure qui font le premier & le plus grand embellissement d'un jardin bien ordonné. Toutes les formes qu'on donne à cet arbre lui deviennent si propres, qu'il se prête à tout ce qui y a rapport : on peut le transplanter à cet effet, petit ou grand ; il souffre la tonsure en été comme en hyver ; & la souplesse de ses jeunes rameaux favorise la forme qu'on en exige, & qui est completée par leur multiplicité. Pour faire ces plantations, on tire la charmille des pépinieres, ou même des forêts, si l'on se trouve à portée : la premiere se reconnoît aisément à son écorce claire, & à ce qu'elle est bien fournie de racines ; celle au contraire qui a été prise au bois est étiolée, crochue, & mal enracinée.
Multiplication. Le charme peut se multiplier de graine qu'on recueille ordinairement au mois d'Octobre, & qu'il faut semer aussi-tôt dans un terrein frais & à l'ombre, où il en pourra lever une petite partie au printems suivant ; mais le reste ne levera souvent qu'à l'autre printems. Quand ils ont deux ans on les transplante sans les étêter en pépiniere, où on les laisse au moins trois années pour se fortifier & faire du petit plan de charmille, & jusqu'à six ou sept ans pour être propre à planter les grandes palissades de toute hauteur. Mais l'accroissement de cet arbre étant si lent quand on l'éleve de graine, on a trouvé qu'il étoit plus court & plus facile de le multiplier de branches couchées : si on fait cette opération de bonne heure, en automne elles feront suffisamment racine pour être transplantées au bout d'un an ; & dès-lors on pourra les employer en petit plan, sinon on les met en pépinieres, & on les conduit comme les plants venus de graine. Les uns & les autres n'exigent aucune culture particuliere, si ce n'est qu'on ne les élague jamais, & qu'on accourcit seulement leurs branches latérales, selon les différentes figures auxquelles on les destine.
Plantation des grandes charmilles. Les palissades de charmille, lorsqu'elles se trouveront dans une terre franche & fraîche, s'éleveront à une grande hauteur : elles réussiront même dans un terrein sec & leger, & exposé aux vents froids & impétueux ; mais on ne pourra les amener qu'à une hauteur moyenne dans ces sortes de terreins. La transplantation des charmilles devroit se faire en automne, suivant le principe reçû en Agriculture, s'il n'arrivoit pas souvent que leur tige se trouve desséchée au printems jusqu'à fleur de terre, par les frimats & les vicissitudes de la gelée & du dégel. Pour éviter cet inconvénient, on pourra ne les planter dans ces sortes de places qu'au printems, mais de bonne heure, & dès la fin de Février ; cela exigera seulement quelques arrosemens pendant le premier été, dans les sécheresses. Le mois de Mars sera le tems le plus convenable pour la transplantation des charmilles dans les lieux frais & dans les bonnes terres. Il n'y a pas long-tems que les Jardiniers avoient encore la mauvaise pratique de ne planter aucunes charmilles sans les recéper un peu au-dessus de terre ; ce qui jettoit dans un grand retard pour l'accroissement, & dans l'inconvénient que les branches qui ont peu de disposition à se dresser, se chiffonnent, & contrarient continuellement le redressement de la palissade, & le peu d'épaisseur qu'on cherche à lui laisser autant qu'il est possible. Mais pour arriver bien plus promptement à une grande hauteur, qui est l'objet desiré, & avoir en trois ans ce qu'on n'obtenoit pas en dix, on plante tout de suite les charmilles d'une bonne hauteur, par exemple, de huit à dix piés dans les mauvais terreins, & de douze ou quinze dans les bonnes terres. On a la facilité dans les campagnes de tirer des bois du plant, que l'on peut même, dans quelques terreins, faire enlever avec de petites mottes de terre. Ceux d'un pouce de diametre sont les meilleurs : on leur coupe toutes les branches latérales, en laissant toûjours des chicots pour les amener à la garniture, & on réduit toutes les têtes à la hauteur qu'on se propose de donner à la palissade : on fait un fossé profond d'environ un pié & demi, & large d'autant ; on y range à droite ligne les plants, à la distance de douze à quinze pouces, avec de petits plants qu'on réduit à un pié de hauteur, & qu'on place alternativement entre les grands : on les recouvre d'une terre meuble, & on entretient l'alignement de sa palissade avec des perches transversales, & quelques piquets où il en est besoin. Comme les plants pris au bois sont moins bien enracinés, & plus difficiles à la reprise que ceux de pépiniere, il faudra avoir la précaution d'en planter à part une provision, qui servira à faire les remplacemens nécessaires pendant les deux ou trois premieres années, qui suffisent pour joüir des palissades : on les retient alors, si on les trouve au point où on les veut, ou bien on les laisse aller à toute la hauteur qu'elles peuvent atteindre, & qui dépend toûjours de la qualité du terrein.
Petites charmilles. Ce même arbre que l'on fait parvenir à une grande hauteur pour certains compartimens de jardin, peut aussi pour d'autres arrangemens être réduit dans un état à rester sous la main : on en fait des haies à hauteur d'appui, qui servent à border des allées, à séparer différens compartimens, & à enclorre un terrein : pour ce dernier cas, on réunit une ligne de plants d'aubepin, qui défend des atteintes du dehors, à une premiere ligne de charmille qui embellit le dedans, sans se nuire l'une à l'autre.
Entretien & culture des charmilles. Le principal entretien des palissades de charmille, est de les tondre régulierement : cette opération se fait après la premiere séve, & ordinairement au commencement de Juillet : la plus grande attention qu'on doit y donner est de les tondre de droit alignement, & de les tenir étroites ; ce qui contribue en même tems à leur durée, & à les faire garnir. Elles n'exigent pour leur culture, que ce qui se pratique à l'ordinaire pour les autres arbres ; c'est sur-tout de ne souffrir ni mauvaises herbes, ni gason au-dessus de leurs racines.
On ne trouve qu'une chose à redire à cet arbre ; c'est qu'il retient pendant l'hyver ses feuilles mortes, qui font dans cette saison un coup d'?il desagréable, & une malpropreté continuelle dans un jardin bien tenu. On pourroit répondre que cela peut même avoir son utilité, pour empêcher les vûes qu'on veut éviter, & sur-tout pour défendre un terrein des vents, à la violence desquels le charme résiste mieux qu'aucun autre arbre. Mais ce défaut ne balancera jamais l'agrément que les charmilles donnent dans la belle saison par leur verdure claire & tendre, & par leur figure réguliere & uniforme, dont le noble aspect est connu de tout le monde.
Autres especes. Outre le charme commun, qui est celui dont on vient de parler, il y en a encore sept especes, dont les Botanistes font mention, & qu'on ne trouve guere que dans leurs catalogues. Il y a tout lieu de croire que ces arbres seroient moins rares, s'ils avoient plus d'utilité ou d'agrément que l'espece commune.
Le charme à feuille panachée. C'est une variété de l'espece commune, qui n'a pas grande beauté, & qu'on peut multiplier par la greffe.
Le charme à feuille plus longue & plus étroite. C'est une autre variété qui n'a nul mérite.
Le charme de Virginie à larges feuilles. Ce n'est peut-être aussi qu'une variété de l'espece commune : mais quand la feuille de cet arbre seroit en effet plus grande, cela ne décideroit pas qu'on dût lui donner la préférence, attendu que la feuille du charme commun, quoique plus étroite, est plus convenable pour l'usage qu'on fait de cet arbre dans les jardins. On peut le multiplier de branches couchées.
Le charme à fleur de Virginie. Cet arbre est encore peu connu, & très-rare en France. Quelques auteurs Anglois font mention seulement qu'il est aussi robuste que l'espece commune, & qu'on peut le multiplier de branches couchées : mais ils ne rapportent rien des qualités de sa fleur ; ce qui n'en fait rien augurer de beau.
Le charme d'Orient. Il paroît que cet arbre n'est qu'un diminutif de l'espece commune : sa graine & sa feuille sont plus petites ; l'arbre même ne s'éleve pas si haut à beaucoup près : il y a cependant entre eux quelques différences, qui sont à l'avantage du charme d'Orient ; c'est que ses feuilles sont moins plissées, plus lisses, & qu'elles tombent de l'arbre avant l'hyver : cela fait croire que cet arbre conviendroit mieux que le charme ordinaire pour les petites palissades. On peut le multiplier de graine & de branches couchées.
Le charme à fruit de houblon. Il a la même apparence que l'espece commune ; ses feuilles sont cependant moins plissées ; mais comme il les quitte entierement avant l'hyver, il ne feroit pas dans les jardins au printems, la malpropreté qu'on reproche au charme ordinaire. C'est aussi, je crois, tout ce qu'il y a d'avantageux cet arbre, qui est d'ailleurs plus petit que l'espece commune. Il se trouve fréquemment dans les bois d'Allemagne, où il croît indifféremment avec le charme ordinaire : on peut juger par là de son tempérament. Il se multiplie du même, & il se tond tout aussi-bien.
Le charme de Virginie à fruit de houblon. Cet arbre qui est très-rare, paroît n'être, sur ce qu'on en sait encore, qu'une variété du précédent, auquel il ressemble parfaitement par ses chatons & sa graine ; mais ses feuilles, quoique flétries, ne tombent qu'aux approches du printems ; circonstance desavantageuse, qui ne fera pas rechercher cet arbre. Il a cependant le mérite de croître sous les autres arbres, dont l'ombrage & le dégouttement ne lui sont point nuisibles. On peut le multiplier de graines, qui ne leveront que la seconde année. Il est très-robuste ; mais il ne fait jamais qu'un petit arbre. (c)
Étymologie de « charme »
Carmen, chant, vers, formule d'enchantement, anciennement casmen, sanscrit çasman, de çañs, célébrer.
- (Nom commun 1) Du moyen français charme, de l'ancien français charme, du latin carmen (« chanson, formule magique, incantation »), de canere (« chanter »).
- (Nom commun 2) Du latin carpinus (« charme »), mot féminin en latin classique, pris pour un mot masculin en latin populaire, en raison de sa déclinaison en -us.
Charme au Scrabble
Le mot charme vaut 12 points au Scrabble.
Informations sur le mot charme - 6 lettres, 2 voyelles, 4 consonnes, 6 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot charme au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
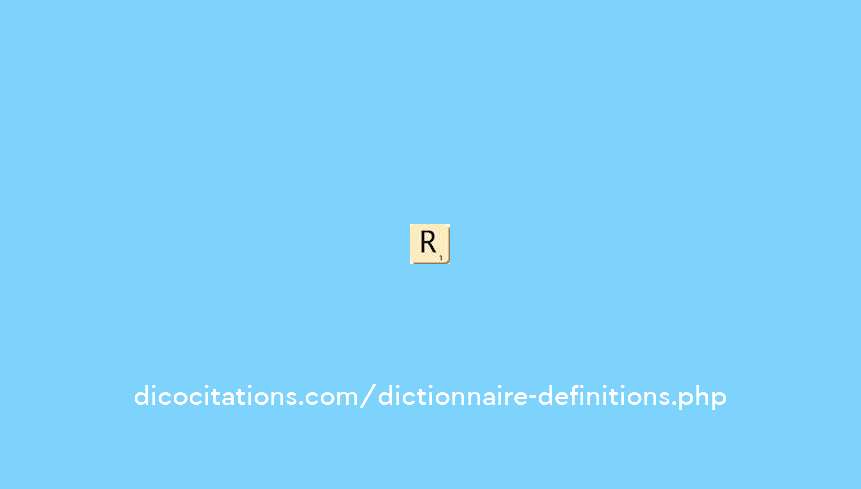
Les rimes de « charme »
On recherche une rime en RM .
Les rimes de charme peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en Rm
Rimes de germent Rimes de énormes Rimes de filiformes Rimes de réaffirme Rimes de isotherme Rimes de uniforme Rimes de spongiforme Rimes de Termes Rimes de affirment Rimes de referme Rimes de pisiforme Rimes de falciforme Rimes de forme Rimes de piriforme Rimes de larme Rimes de cruciforme Rimes de quasi-infirme Rimes de plate-forme Rimes de arment Rimes de désarme Rimes de forment Rimes de larmes Rimes de armes Rimes de permes Rimes de multiformes Rimes de difforme Rimes de plates-formes Rimes de déforment Rimes de rendorment Rimes de gendarmes Rimes de déformes Rimes de arme Rimes de serpentiforme Rimes de retransforme Rimes de rendorme Rimes de méforme Rimes de endorment Rimes de renferme Rimes de difformes Rimes de alarmes Rimes de réformes Rimes de firmes Rimes de enfermes Rimes de gourme Rimes de chloroformes Rimes de sperme Rimes de armes Rimes de germes Rimes de affirme Rimes de uniformesMots du jour
germent énormes filiformes réaffirme isotherme uniforme spongiforme Termes affirment referme pisiforme falciforme forme piriforme larme cruciforme quasi-infirme plate-forme arment désarme forment larmes armes permes multiformes difforme plates-formes déforment rendorment gendarmes déformes arme serpentiforme retransforme rendorme méforme endorment renferme difformes alarmes réformes firmes enfermes gourme chloroformes sperme armes germes affirme uniformes
Les citations sur « charme »
- Mais il faut que cet enthousiasme soit caché et presque insensible. - C'est cet enthousiasme qui fait ce qu'on appelle le charme.Auteur : Joseph Joubert - Source : Carnets
- La distinction est un charme plus grand que la beauté, comme la grâce, car il est plus rare.Auteur : Roger Peyrefitte - Source : Propos secrets (1977)
- Un charme est ce qui subjugue, plutôt que ce qui plaît.Auteur : Emile-Auguste Chartier, dit Alain - Source : Propos de littérature (1934)
- Le charme, c'est réussir à transmettre ce qu'on ne dit pas.Auteur : Claude Lelouch - Source : Sans référence
- La beauté seule inquiète : il lui faut la grâce du charme pour véritablement éblouir.Auteur : Vincent Cespedes - Source : Magique étude du Bonheur (2010)
- On me trouvait du charme, imaginez cela! Vous savez ce qu'est le charme: une manière de s'entendre répondre oui sans avoir posé aucune question claire.Auteur : Albert Camus - Source : La Chute (1956)
- Ne te détourne pas d'une épouse sage et bonne,
car son charme vaut mieux que l'or.Auteur : La Bible - Source : Ecclésiastique, VII, 19 - La campagne est une belle femme sans coquetterie: il faut la bien connaître pour la bien aimer mais quand une fois vous avez senti son charme, elle vous attache pour toujours.Auteur : Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes - Source : Pensées et Maximes
- La jeunesse, débordante de jouvence, exige d'être charmée par des aînés flamboyants, leaders d'avenir.Auteur : Vincent Cespedes - Source : Oser la jeunesse : Transmettre, s'engager, inspirer (2015)
- ... les charmes d'un corps de femme qui enflamment les sens sont comme les odeurs de cuisine - excitants quand on a faim, répugnants quand on est rassasié.Auteur : M. Aguéev - Source : Roman avec cocaïne
- Il y a jusque dans cette époque même de l'année quelque chose qui répand un charme infini sur la fête de Noël. En d'autres temps nous tirons une grande part de nos plaisirs des seules beautés de la nature. Notre sensibilité s'élance et se disperse sur le paysage baigné de soleil, et nous « vivons au large et partout ».Auteur : Washington Irving - Source : Le Livre d’esquisses
- Elle avait perdu ce qu'on est convenu d'appeler la fleur de la jeunesse, et on lui donnait bon gré mal gré la quarantaine. Mais il ne manque pas de femmes de cet âge, de qui les charmes, au lieu de faiblir, ont grandi d'année en année.Auteur : René Tardiveau, dit René Boylesve - Source : La Leçon d'amour dans un parc (1902)
- Si l'on appelle imagination la faculté d'animer tout ce qui nous environne, de créer autour de nous un monde de fictions dont nous sommes charmés sans en être dupes ; de métamorphoser la réalité d'un coup de baguette et de rendre beau ce qui est laid, sensible ce qui est inerte, éloquent ce qui est muet, vivant ce qui est mort, si, dis-je, on donne à cette singulière puissance créatrice le nom d'imagination, on peut dire qu'un enfant de cinq ans a plus d'imagination que les plus grands poètes. Auteur : Ernest Legouvé - Source : Les pères et les enfants au XIXe siècle (1867)
- Il avait une faconde extraordinaire, une voix surtout, un instrument de charme et de conquête incomparable.Auteur : Emile Zola - Source : Rome (1896)
- L'Amour charme
Ceux qu'il désarme ;
L'Amour charme,
Cédons-lui tous.
Notre peine
Serait vaine.Auteur : Molière - Source : Psyché (1671), Prologue, I, Flore - On ne graisse pas une porte qui ne grince pas et me sentant déjà sous le charme, il s'est dispensé de faire la roue. Auteur : Gilles Martin-Chauffier - Source : La femme qui dit non
- Et l'on vient quelquefois à trouver mille charmes
Aux fuites d'un hymen commencé dans les larmes.Auteur : Charles-Georges Fenouillot de Falbaire de Quingey - Source : L'Honnête Criminel, ou l'Amour Filial (1767) - Le superflu m'a toujours paru le sel de la vie et que seuls les charmes de l'inutile peuvent vous aider à supporter les horreurs de l'indispensable quotidien.Auteur : Jacques Sternberg - Source : Vivre en survivant (1977)
- D'où vient le charme des enfants, sinon de moi (la folie), qui leur épargne la raison, et, du même coup, le souci?Auteur : Erasme - Source : L'Eloge de la folie (1508)
- Mon but dans l'existence, ce n'est pas de charmer la société.Auteur : James Dean - Source : Sans référence
- Forêt : Portion de nature où l'on peut se promener sans craindre la pluie et les commerçants. Pleine de charme et de bestioles. On peut s'y perdre si l'on est seul et s'y aimer si l'on est deux.Auteur : Philippe Bouvard - Source : Bouvard de A à Z (2014)
- Après tout, l'un des grands charmes du commérage est son insondable inutilité.Auteur : Donna Leon - Source : Mort à la Fenice (1992)
- Il y avait autour de la jeune fille un tel parfum de chasteté, un tel charme de vertu que Phoebus ne se sentait pas complètement à l'aise auprès d'elle.Auteur : Victor Hugo - Source : Notre-Dame de Paris (1831)
- Pour mes amis morts en Mai
Et pour eux seuls désormais
Que mes rimes aient le charme
Qu'ont les larmes sur les armes
Et que pour tous les vivants
Qui changent avec le vent
S'y aiguise au nom des morts
L'arme blanche du remordsAuteur : Louis Aragon - Source : Art poétique - Les charmes de la jeunesse sont l'unique bagage de l'amour.Auteur : Honoré de Balzac - Source : Physiologie du Mariage (1830)
Les mots proches de « charme »
Chabichou Chablage Chableur Chablis Chabot Chabrol et chabrot Chacal Chaconne Chacun, chacune Chacunière Chafaud Chagrin Chagrin Chagrin, ine Chagrinant, ante Chagrinement Chagriner Chaillant Chaille Chailleux, euse Chaillot ou chaillou Chaîne Chaînette Chaînier ou chaîniste Chaînon Chaintre Chair Chair Chaire Chaise Chalaine Chaland, ande Chaland ou chalan Chalandise Chalcide Chalcidique Chaldaïque Chaldéen, enne Châle Chalet Chaleur Chaleureusement Chaleureux, euse Chalinoptère Châlit Chaloir Chalon Chalosse Chalot ChaloupeLes mots débutant par Cha Les mots débutant par Ch
cha-cha-cha chabanais Chabanais Chabanne Chabestan Chabeuil chabichou chabler chablis Chablis chaboisseaux Châbons chabot chabots Chabottes Chabottonnes Chabournay Chabrac chabraque Chabreloche Chabrignac Chabrillan Chabris chabrot chacal chacals Chacé Chacenay chachlik chaconne Chacrise chacun chacune Chadeleuf Chadenac Chadenet Chadrac Chadron Chadurie chafaud chafauds Chaffal Chaffaut-Saint-Jurson Chaffois chafouin chafouin chafouine chafouins chafouins chagatte
Les synonymes de « charme»
Les synonymes de Charme :- 1. crooner
- 1. beauté
2. éclat
3. splendeur
4. vénusté
5. magnificence
6. joliesse
7. harmonie
8. perfection
9. agrément
10. délicatesse
11. distinction
12. fraîcheur
13. grâce
14. blandice
15. délice
16. séduction
17. enchantement
18. appas
19. coquetterie
20. galanterie
21. afféterie
22. minauderie
23. élégance
24. raffinement
25. goût
26. dandysme
27. aisance
28. s
- 1. ensorcelé
2. envoûté
3. enchanté
synonymes de Charme
Fréquence et usage du mot Charme dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « charme » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot Charme dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Charme ?
Citations charme Citation sur charme Poèmes charme Proverbes charme Rime avec Charme Définition de Charme
Définition de Charme présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot Charme sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot Charme notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 6 lettres.
