La définition de Gui du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Gui
Nature : s. m.
Prononciation : ghi
Etymologie : Norm. vi ; Berry, gué ; ital. visco, vischio ; du latin viscus.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de gui de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec gui pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Gui ?
La définition de Gui
Terme de botanique. Nom d'un genre de plantes de la famille des loranthacées, qui sont parasites et qui naissent sur les branches de différents arbres.
Toutes les définitions de « gui »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
T. de Botanique. Plante parasite qui croît sur les branches de certains arbres, du chêne, du peuplier, de l'aubépine, de l'olivier, du genévrier, etc. Gui blanc ou gui de chêne. Les Gaulois cueillaient le gui de chêne avec beaucoup de solennité. La récolte du gui. Au gui l'an neuf, Locution ancienne pour indiquer que L'année commence avec le gui.
Littré
- Terme de botanique. Nom d'un genre de plantes de la famille des loranthacées, qui sont parasites et qui naissent sur les branches de différents arbres.
Gui de chêne, ou, simplement, le gui, le gui blanc des botanistes, nom qui vient de ce que le fruit en est blanc. Avec les baies du gui blanc on fait une glu moins bonne que celle qui est obtenue de l'écorce du houx. Le gui était particulièrement vénéré des anciens Gaulois et de leurs prêtres les Druides.
Il s'adressa d'abord au Celte comme au plus furieux?; il lui dit qu'il avait raison et lui demanda du gui
, Voltaire, Zadig, 12.La bienfaisante fée et la nymphe légère, Cueillant le gui divin ou la fleur bocagère, S'y montrèrent souvent [dans les sombres vallées] au sauvage Gaulois
, Masson, Helvét. v.Un eubage vêtu de blanc monta sur le chêne, et coupa le gui avec la faucille d'or de la druidesse
, Chateaubriand, Mart. IX.Au gui l'an neuf, espèce d'exclamation qui paraît s'être conservée en mémoire de la cérémonie où l'on distribuait le gui, chez les Gaulois.
Le grand sacrifice du gui de l'an neuf se faisait avec beaucoup de cérémonies près de Chartres, le sixième jour de la lune, qui était le commencement de l'année, suivant leur manière de compter par nuits
, Duclos, Mém. Druid. ?uv. t. I, p. 284, dans POUGENS.
HISTORIQUE
XIVe s. Et leur donneras à mengier avenne en jarbe ou yerre [lierre] ou vist de pommier
, Modus, f° LXXI.
XVe s. Unes patenostres de guix de chesne
, Bibl. des ch. 6e série, t. I, p. 434.
Encyclopédie, 1re édition
GUI, s. m. (Hist. nat. Bot.) Cette plante passoit jadis pour une panacée, & faisoit l'objet de la vénération payenne chez les anciens Gaulois ; mais les idées de leurs successeurs sont bien différentes. Le gui n'est plus pour eux qu'une plante parasite qui fait grand tort aux arbres dont elle tire sa nourriture, & que les gens soigneux de l'entretien de leurs vergers, s'efforcent à l'envi de détruire.
Cependant cette même plante parasite n'en est pas moins dans l'esprit du physicien un végétal singulier, dont l'origine, la germination, le développement méritent un examen attentif, & des recherches particulieres. C'est ainsi qu'en ont pensé Malpighi, Tournefort, Vaillant, Boerhaave, Linnæus, Barel, & Camérarius : enfin M. du Hamel a publié dans les mém. de l'Acad. des Scien. année 1740, des observations trop curieuses sur ce sujet, pour négliger de les rapporter ici ; elles rendront cet article intéressant.
Caracteres du gui. On pourroit peut-être caractériser ainsi le gui. Il est mâle & femelle ; ses feuilles sont conjuguées, étroites, & oblongues ; les fleurs de la plante mâle sont monopétales, faites en bassin, divisées d'ordinaire en quatre parties égales, marquetées de porreaux. L'ovaire est une substance tendre, environnée de quatre petites feuilles ; il devient ensuite une baie à-peu-près ronde, pleine d'une sorte de glu, & contenant une semence plate, ovale, triangulaire, en forme de c?ur, & de différente figure. Les baies du gui donnent chacune quelquefois deux semences.
Il faut remarquer que ces fruits commencent par des embryons couronnés de quatre feuilles, ou qui portent une couronne radiée, composée de quatre petites feuilles jaunâtres, articulées autour de la tête de chaque embryon. Ces embryons partent d'une masse ronde, jaunâtre, articulée avec l'extrémité de la branche & de deux feuilles opposées qui la terminent des deux côtés.
Il n'y a qu'une espece de gui qui vient sur tout arbre. On est presque d'accord à n'admettre qu'une seule espece de gui. Il est vrai que le P. Plumier en décrit plusieurs dans son histoire des Antilles, qui paroissent différentes de notre gui ordinaire ; cependant le sentiment le plus généralement reçu des botanistes modernes, est qu'il n'y en a qu'une seule espece, & ils n'en ont jamais vû davantage.
Que l'on seme sur le tilleul, sur le saule, sur le poirier, sur l'épine, &c. des semences, des piés de gui qui auront cru sur le pommier, elles végetent également sur ces différens arbres avec succès. D'ailleurs on ne remarque aucune différence considérable ni dans la figure des feuilles, ni dans la forme des fruits, ni dans le port extérieur des piés de gui qui viennent sur les divers arbres de nos forêts de France. Les expériences faites en Angleterre confirment le même fait. Concluons donc que nous ne connoissons qu'une seule espece de gui ; elle est nommée simplement par les Botanistes viscum, viscus, viscum vulgare, viscus arborum, par C. Bauh. J. Bauh. Ray, Gerard, Barkinson, Tournefort, Boerhaave, &c.
Cette plante ne vient jamais à terre, mais sur tous les arbres.
Les uns disent l'avoir trouvé sur le sapin, sur la meleze, sur le pistachier, sur le noyer, sur le coignassier, sur le poirier franc, & sur le sauvage, sur le pommier sauvage & sur le domestique, sur le nefflier, sur l'épine blanche, sur le cormier, sur le prunier, sur l'amandier, sur le rosier. D'autres disent l'avoir vû sur le liége, sur le châtaignier, sur le noisetier, sur le tilleul, sur le saule, sur le peuplier noir & sur le blanc, sur le hêtre, sur l'orme, sur le noirprun, sur le buis, sur la vigne, sur le faux acacia : enfin le gui vient sur l'yeuse, & sur le chêne commun. Comme ce dernier gui est le plus fameux, il suffira d'en donner ici la description.
Description du gui de chêne. C'est une maniere d'arbrisseau qui croît à la hauteur d'environ deux piés ; les tiges sont ordinairement grosses comme le doigt, dures, ligneuses, compactes, pesantes, de couleur rougeâtre en-dehors, blanche-jaunâtre en-dedans. Il pousse beaucoup de rameaux ligneux, plians, entrelacés souvent les uns dans les autres, & couverts d'une écorce verte.
Ses feuilles sont opposées deux-à-deux, oblongues, épaisses, dures, assez semblables, mais un peu plus longues que celles du grand buis, veineuses dans leur longueur, arrondies par le bout, de couleur verte-jaunâtre ou pâle. Ses fleurs naissent aux n?uds des branches, petites, jaunâtres, formées chacune en bassin à quatre crenelures.
Quelquefois ces fleurs ne laissent point de fruits après elles ; mais quelquefois on trouve des fruits sur des piés différens qui ne portent point de fleurs. Ces fruits sont de petites baies rondes ou ovales, molles, blanches, luisantes, ressemblantes à nos petites groseilles blanches, remplies d'un suc visqueux, dont les anciens se servoient pour faire de la glu. Au milieu de ce fruit se rencontre une petite semence applatie, & ordinairement échancrée en c?ur.
Il ne faut pas croire qu'on trouve communément des chênes qui portent du gui ; c'est un phénomene en général assez rare ; il l'est par exemple beaucoup en Angleterre.
Des semences du gui, & de leur germination. Théophraste (de caus. Plant. l. II. chap. xxjv.) & Pline (Hist. nat. l XVI. ch. xxxxjv.) avoient assûré contre le sentiment d'Aristote, que le gui venoit de semences, mais qui avoient besoin de passer par l'estomac des oiseaux, pour se dépouiller, disoient-ils, d'une qualité froide qui les empêchoit de germer. Cependant comme les semences du gui ne sont pas fort dures, on comprend avec peine, qu'elles ne soient pas digérées par l'estomac des oiseaux. Il est vrai que Boccone assûre avoir observé que les oiseaux les rendoient entieres dans leurs excrémens ; mais il faudroit savoir si Boccone a bien observé.
Quoiqu'il en soit, toutes les observations modernes prouvent que le gui se multiplie de semence, sans qu'il soit nécessaire qu'elles passent par l'estomac des oueaux. Ray dit qu'il a vû germer les semences du gui dans l'écorce même da chêne, & que depuis son observation, Doody apotiquaire de Londres, avoit mis la chose hors de doute, ayant élevé des piés de gui de graines qu'il avoit semées.
Léonhard Frédéric Hornung assûre dans une dissertation latine à ce sujet, avoir semé du gui sur un pommier, qu'il y germa en poussant deux cornes de la base du fruit, qu'il s'attacha à la branche, & qu'il y fructifia.
M. Edmond Barel, dans un mémoire qu'il a envoyé au chevalier Hans-Sloane, & qui est imprimé dans les Transactions philosophiques, témoigne aussi avoir élevé le gui de graine.
Enfin, M. Duhamel a répété toutes ces expériences sur un grand nombre d'arbres de différentes especes, & les graines du gui ont germé également bien sur tous, excepté sur le figuier, peut-être à cause du lait corrosif qui s'échappoit des plaies qu'il avoit fallu faire pour poser les semences, & qui les brûloit.
Il n'est pas surprenant que le gui germe à-peu-près également bien sur des arbres très-différens ; il ne faut que de l'humidité pour faire germer toutes sortes de semences, & celle des pluies & des rosées suffit pour la germination du gui, puisque M. Duhamel en a vû germer sur des morceaux de bois mort, sur des tessons de pots, & sur des pierres seulement tenues à l'ombre du Soleil. De plus il a posé des semences de gui sur les vases de terre à demi-cuits, qui laissent échapper l'eau peu-à-peu, & sur lesquels on se fait quelquefois un plaisir d'élever de petites salades. Les semences de gui y ont germé plus promptement, & elles sont venues plus vigoureuses que sur les corps secs ; la transpiration du vase favorise leur germination ; probablement la transpiration des arbres ne leur est pas non plus inutile.
Il faut pourtant convenir que quoique le gui germe sur des pots, sur du bois mort, & qu'il s'attache également sur tous les arbres, il ne végete pas aussi heureusement sur tous ceux auxquels il s'attache. Il ne réussit pas si bien sur le chêne & sur le noyer que sur le poirier, le pommier, l'épine-blanche, & le tilleul. Il vient avec plus de peine sur le génevrier ; mais après tout, il ne s'éleve bien que sur des arbres.
Les semences de gui mises sur des arbres en Février, commencent à germer à la fin de Juin. Alors on voit sortir de la graine du gui plusieurs radicules ; & cette multiplicité de radicules est une singularité, qui n'est peut-être propre qu'à la seule semence du gui. Quand les radicules se sont alongées de deux à trois lignes, elles se recourbent, & elles continuent de s'alonger, jusqu'à ce qu'elles ayent atteint le corps sur lequel la graine est posée ; & sitôt qu'elles y sont parvenues, elles cessent de s'alonger.
Cette radicule prend indifféremment toutes sortes de directions, tant en-haut qu'en-bas, ce qui lui est encore particulier ; car, suivant la remarque de M. Dodart, tous les germes tendent vers le bas.
Les radicules du gui sont formées d'une petite boule qui est seulement soûtenue par un pédicule qui part du corps de la semence. Elles s'alongent jusqu'à ce que la petite boule qui les termine, porte sur l'écorce des arbres ; alors elles s'épanoüissent, & s'y appliquent fortement par une matiere visqueuse.
De la formation & du progrès des racines du gui. La jeune plante commence à introduire ses racines dans cette écorce ; aussi-tôt la seve contenue dans l'écorce de l'arbre, s'extravase ; il se forme à cet endroit une grosseur, une loupe, ou si l'on veut, une espece de gale, & cette gale augmente en grosseur à mesure que les racines de la plante parasite font du progrès.
Entre les premieres racines du gui, il y en a qui rampent dans les couches les plus herbacées de l'écorce, & les autres en traversent les différens plans jusqu'au bois où elles se distribuent de côté & d'autre, se réfléchissant quand elles rencontrent quelques corps durs qui s'opposent à leur passage. Alors elles cheminent entre les lames de l'écorce, & y forment plusieurs entrelacemens ; mais comme les lames intérieures de l'écorce sont destinées à faire dans la suite de nouvelles couches de bois, ces lames s'endurcissent ; les racines du gui se trouvent donc engagées de l'épaisseur de ces lames dans le bois ; d'autres lames de l'écorce deviennent bois à leur tour ; voilà les racines du gui engagées encore plus avant dans le bois, & à la fin elles le sont beaucoup, sans que pour cela elles ayent pénétré le bois en aucune façon. On peut ajoûter que comme les racines du gui occasionnent une extravasation du suc ligneux, qui forme une loupe à l'endroit de l'insertion ; cette loupe contribue beaucoup à engager plus promptement & plus avant les racines du gui dans le bois.
Quand elles y sont engagées à un certain point, le gui a besoin de ressources pour subsister, & il en a effectivement. 1°. Les racines nouvelles épanouies dans l'écorce, & celles qui sont engagées dans le bois, lui fournissent de la nourriture. 2°. Il se trouve souvent aux piés de gui une espece de bulbe charnuë de la consistance des racines, qui est engagée dans l'écorce, & qui lui peut être d'un grand secours pour vivre.
Cependant ces ressources lui manquent quelquefois ; par exemple, lorsque la branche sur laquelle est un pié de gui se trouve grosse & vigoureuse, & qu'il ne peut plus tirer de subsistance des écorces, alors il languit & meurt à la fin. Il n'en est pas de même quand la branche est menue, & les piés de gui vigoureux ; car alors ce sont ces branches mêmes de l'arbre qui cessent de profiter. Pour que le gui coupe les vivres à l'extrémité de la branche sur laquelle il est enté, il faut que la force avec laquelle il tire la séve soit supérieure à celle que la branche avoit pour se la procurer. Le gui dans ce cas, peut être comparé à ces branches gourmandes, qui s'approprient toute la séve qui auroit dû passer aux branches circonvoisines.
Du progrès des tiges du gui. Le progrès des racines du gui est d'abord très-considérable en comparaison de celui des tiges ; en effet, ce n'est que la premiere année, & quelquefois la seconde, que les jeunes tiges commencent à se redresser, & souvent elles ont bien de la peine à y parvenir. Quand cela arrive, on voit cette jeune tige terminée par un bouton, ou par une espece de petite houppe, qui semble être la naissance de quelques feuilles, & elle en reste-là pour la premiere année, & même quelquefois pour la seconde.
Le printems de l'année suivante, ou de la troisieme, il sort de ce bouton deux feuilles, & il se forme deux boutons dans les aisselles de ces deux feuilles : de chacun de ces boutons, il sort ensuite une ou plusieurs branches, qui sont terminées par deux, & quelquefois par trois feuilles. C'est-là la production de la troisieme ou de la quatrieme année. La cinquieme, la sixieme, & les années suivantes, il continue à sortir plusieurs branches, & quelquefois jusqu'à six des aisselles des feuilles. Le gui devient ainsi un petit arbrisseau très-branchu, formant une boule assez réguliere, qui peut avoir un pié & demi, ou deux piés de diametre.
Les vieilles feuilles jaunissent & tombent, sans qu'il en vienne de nouvelles à la place ; ce qui fait que les tiges sont presque nues, & que l'arbrisseau n'est garni de feuilles qu'à l'extrémité de ses branches.
Il y a ici une chose bien digne d'être remarquée, & que M. Duhamel dit avoir observée avec M. Bernard de Jussieu, c'est que chaque bouton de gui contient presque toûjours le germe de trois branches, qu'on peut appercevoir par la dissection : ainsi chaque n?ud devroit souvent être garni de six branches, & il le seroit en effet s'il n'en périssoit pas plusieurs, ou avant que d'être sorties du bouton, ou peu de tems après en être sorties ; ce qui arrive fréquemment.
Une autre chose singuliere, c'est que les branches du gui n'ont point cette affectation à monter vers le ciel, qui est propre à presque toutes les plantes, surtout aux arbres & aux arbustes. Si le gui est implanté sur une branche d'arbre, ses rameaux s'éleveront à l'ordinaire ; s'il part de dessous la branche, il pousse ses rameaux vers la terre ; ainsi il végete en sens contraire, sans qu'il paroisse en souffrir.
Le gui garde ses feuilles pendant l'hyver, & même pendant les hyvers les plus rudes. Théophraste se trompe donc, lorsqu'il dit que le gui ne conserve ses feuilles que quand il tient à un arbre qui ne les quitte point l'hyver, & qu'il se dépouille quand il est sur un arbre qui perd ses feuilles. Mais qui est-ce qui n'a pas vû l'hyver, sur des arbres dépouillés de leurs feuilles, des piés de gui qui en étoient tous garnis ? Et ce fait est-il plus singulier que de voir le chêne verd conserver ses feuilles lorsqu'il est greffé sur le chêne ordinaire ?
De l'écorce, du bois, des tiges & des feuilles du gui. L'écorce extérieure des feuilles & des tiges du gui est d'un verd terne & foncé, sur-tout lorsqu'elles sont vieilles, car les jeunes feuilles & les nouveaux bourgeons sont d'un verd jaunâtre. Cette écorce extérieure est un peu inégale & comme grenue. Sous cette écorce il y en a une autre plus épaisse, d'un verd moins foncé, grenue & pâteuse comme l'écorce des racines, & elle est traversée par des fibres ligneuses qui s'étendent suivant la longueur des branches. Sous cette derniere écorce est le bois, qui est à-peu-près de sa couleur ; il est assez dur quand il est sec, mais il n'a presque point de fils, & se coupe presque aussi facilement de travers qu'en long.
Les tiges sont droites d'un n?ud à l'autre, où elles font de grandes inflections. Les n?uds du gui sont de vraies articulations par engrenement, & les pousses de chaque année se joignent les unes aux autres, comme les épiphyses se joignent au corps des os.
Les feuilles du gui sont épaisses & charnues, sans être succulentes. En les examinant avec un peu d'attention, on découvre cinq à six nervures saillantes qui partent du pédicule, & qui s'étendent jusqu'à l'extrémité sans fournir beaucoup de ramifications. Leur figure est un ovale fort alongé ; les feuilles & l'écorce des branches ont un goût legerement amer & astringent : leur odeur est foible à la vérité, mais desagréable.
Le gui étant vivace & ligneux, il faut le mettre au nombre des arbrisseaux, entre lesquels il y en a de mâles & de femelles.
Il y a un gui mâle, & un gui femelle. Pline n'en doutoit point, car il a distingué un gui mâle qui ne porte point de fruit, & un gui femelle qui en porte. Cependant MM. de Tournefort, Boerhaave & Linnæus dont le sentiment est d'un plus grand poids que celui de Pline, pensent que les deux sexes se trouvent sur les mêmes individus dans des endroits séparés. Des autorités si respectables ont engagé d'autres botanistes à éplucher ce fait avec une grande attention ; & c'est d'après cet examen qu'ils se sont cru en droit de décider comme Pline.
Edmond Barel, dans le mémoire que nous avons déjà cité, dit qu'il a élevé quatre piés de gui, dont deux produisirent du fruit, & les deux autres fleurirent sans fructifier.
M. Duhamel assûre aussi avoir constamment remarqué des piés de gui mâle qui ne produisoient jamais de fruit, & d'autres femelles qui presque tous les ans en étoient chargés. Il va bien plus loin ; il prétend que les piés de gui de différens sexes ont chacun un port assez différent pour qu'on les puisse distinguer les uns des autres, indépendamment de leurs fruits & de leurs fleurs.
Voici en quoi consiste cette différence, suivant notre académicien.
Les boutons qui contiennent les fleurs mâles sont plus arrondis, & trois fois plus gros que les boutons qui contiennent les fleurs femelles, ou les embryons des fruits. On distingue assez bien en Décembre ces boutons les uns des autres, quoiqu'ils ne soient point encore ouverts, & que les piés femelles soient encore chargés du fruit de l'année précédente.
Les boutons mâles viennent ordinairement trois-à-trois sur un pédicule commun, & ils commencent à s'ouvrir dans le mois de Mars. Leur fleur est d'une seule piece irréguliere, formant une cloche ouverte, échancrée par les bords en quatre jusque vers le milieu de la fleur. Ces fleurs sont ramassées par bouquets : chaque bouton mâle contient depuis deux jusqu'à sept fleurs, & ces bouquets sont placés dans les aisselles des branches, ou à leur extrémité : dans le mois de Mai toutes ces fleurs tombent, & il ne reste plus que les calices ; enfin ces calices jaunissent, se dessechent & tombent à leur tour.
Les boutons à fruit qui ne se rencontrent que sur les individus femelles, sont placés dans les mêmes endroits, & ne contiennent ordinairement que trois fleurs disposées en trefle, ou quatre, dont il y en a une plus relevée que les autres, & qui forment un triangle autour du pédicule. Toutes ces fleurs ne viennent pas à bien ; il y en a qui périssent avant que de former leur fruit ; c'est ce qui fait qu'on voit quelquefois des fruits qui sont seuls, ou deux-à-deux.
Ces boutons commencent à s'ouvrir dans le mois de Mars : quand ils sont tout-à-fait ouverts, on apperçoit les jeunes fruits ou les embryons surmontés de quatre pétales, dont ils paroissent ensuite être comme couronnés. Ces pétales tombent dans le mois de Juin, & l'on voit alors les fruits gros comme des grains de chenevi, renfermant l'amande dans le centre. Ces fruits continuent à grossir dans le mois de Juillet & d'Août ; ils mûrissent en Septembre & Octobre, & on les peut semer en Février & Mars.
Toutefois comme le plus grand nombre des plantes est hermaphrodite, on ne sauroit assûrer qu'il ne se trouve jamais de fruit sur des guis mâles, ou quelques fleurs sur des guis femelles. Tout ce qu'un observateur peut dire, c'est qu'il n'en a pas vû.
Erreurs des anciens sur le gui. Telle est l'origine, l'accroissement du gui, sa fructification, & la différence du sexe de cette plante : c'est aux recherches des modernes qu'on en doit les connoissances, les anciens n'en avoient que de fausses.
Ils ont regardé le gui comme une production spontanée, provenant ou de l'extravasation du suc nourricier des arbres qui le portent, ou de leur transpiration ; en conséquence ils lui ont refusé des racines. Ceux qui l'ont fait venir de semences, ont imaginé qu'elles étoient infructueuses, à-moins qu'elles n'eussent été mûries dans le corps des oiseaux. Ils ont créé des plantes différentes, des côtés ou des parties d'arbres sur lesquels croît le gui : de-là vient qu'ils ont nommé stelis ou ixia le gui attaché sur le bois du côté du nord, & hyphear celui qui est attaché du côté qui regarde le midi. C'est ce qu'on lit dans Pline, liv. XVI. ch. xxx.
La distinction qu'ils ont encore tire de la variété des arbres sur lesquels il vient pour en former différentes especes, n'a pas un fondement plus solide ; comme si une plante cessoit d'être la même, parce qu'elle croît dans des terreins différens. Mathiole a beau répéter, d'après Théophraste, que le gui de chêne, du roure, du châtaignier, perd ses feuilles à l'approche de l'hyver ; il n'a répété qu'une fausse observation, ainsi que nous l'avons dit ci-dessus.
Malpighi s'est bien gardé de tomber dans aucune de ces diverses erreurs. Cet admirable observateur en tout genre, qui ne s'en tenoit point aux apparences ni aux idées des autres, mais qui cherchoit à voir, & qui rapportoit après avoir bien vû, a décrit très exactement, quoiqu'en peu de mots, la semence du gui, sa germination & ses racines. M. de Tournefort ne nous a rien appris de plus, que ce qu'avoit enseigné l'ami & le medecin d'Innocent XII. & il paroît même s'être trompé sur la description des embryons qui forment le fruit du gui femelle. (D. J.)
Gui, (Med. & Mat. med.) Si le gui touche la curiosité des Botanistes, je ne lui connois aucun point de vûe qui puisse intéresser le medecin. Il est vrai que cette plante parasite passoit autrefois pour une panacée ; mais ces préjugés émanés de la superstition gauloise, doivent cesser aujourd'hui. Cependant on n'ignore pas les grandes vertus que quelques auteurs continuent de lui assigner ; les uns le louent pour chasser la fievre quarte, pour provoquer les regles, pour tuer les vers des enfans ; & d'autres le recommandent dans plusieurs remedes externes, emplâtres & onguens, pour mûrir ou pour résoudre les tumeurs.
Je sai qu'un docteur anglois nommé Colbatch, a fait un discours sur cette plante, dans lequel il a transcrit les merveilles que Pline, Galien & Dioscoride lui ont attribuées ; il la vante comme eux dans toutes les especes de convulsions, dans le vertige, l'apoplexie, la paralysie ; & pour comble de ridicule, il donne la préférence au gui du noisetier sur celui du chêne. On retrouve toutes ces sotises dans d'autres ouvrages ; mais l'entiere inutilité du gui en Medecine, & du plus beau gui de chêne qui soit au monde, n'en est pas moins constatée par l'expérience ; & dans le fond d'où tireroit-il son mérite, que des arbres dont il se nourrit ?
Il y a même en particulier du danger à craindre dans l'usage des baies du gui ; leur acreté, leur amertume & leur glutinosité, les font regarder comme une espece de poison. L'on prétend qu'employés intérieurement, elles purgent par le bas avec violence, & causent une grande inflammation dans l'estomac & les intestins. On comprend sans peine que l'acreté, la figure & la glu de ces baies, sont très propres à produire les mauvais effets dont on les accuse, en s'attachant fortement aux visceres & en les irritant : c'est néanmoins à l'expérience à décider. Mais au cas qu'on eût fait usage de ces baies en quelque quantité, soit par malheur ou par des conseils imprudens, un bon & simple remede seroit d'avaler peu-à-peu une grande abondance d'eau tiede, pour laver insensiblement cette glu, & faciliter par ce moyen l'expulsion des baies hors du corps.
On composoit jadis avec les baies de gui le viscum aucupum, ou la glu des oiseleurs ; mais présentement on a abandonné cet usage. On fait la bonne glu avec l'écorce de houx. Voyez Glu. (D. J.)
Gui ou Guy, (Marine.) c'est une piece de bois ronde & de moyenne grosseur ; on y amarre le bas de la voile d'une chaloupe & de quelques autres petits bâtimens. Il tient la voile étendue par le bas, & vient appuyer contre le mât. C'est proprement une vergue qui est au-bas de cette sorte de voile ; au lieu que les vergues sont par le haut dans les voiles à trait quarré. (Z)
Wiktionnaire
Nom commun 3 - français
gui \d?i\ masculin
-
(Picardie)(Désuet) Nom donné autrefois dans le nord de la France à la levure de bière qui avait débordée de la cuve à la brasserie. Elle était récupérée et vendue sous ce nom pour ses vertus médicinale. Il s'agissait d'un liquide gluant qui moussait.
- GUILER, v. n. ? Fermenter; couler, en parlant d'une matière épaisse comme du suif, de la mêlasse, par analogie avec !a levure ou gui. ? (Louis Vermesse, Dictionnaire du patois de la Flandre française ou wallonne, Éd. Crespin, Douai 1867)
- GUI, GÉE. s.m - Levure de bière. Écume qui sort du tonneau lorsque la bière est en fermentation.? (Louis Vermesse, Dictionnaire du patois de la Flandre française ou wallonne, Éd. Crespin, Douai 1867)
- Pour les endormir, on leur promet du « chiropqui guile », c'est-à-dire qui coule comme le gui (levure de bière). ? (Mémoires de la Société d'agriculture, sciences et arts de Douai, page 519, 1893)
Nom commun 2 - français
gui \?i\ masculin
-
(Marine) Perche qui soutient une voile.
- Le gui, violemment entraîné par le vent, heurta don Orteva et lui brisa le crâne. ? (Jules Verne, Un drame au Mexique , 1876)
- La sous-barbe de beaupré et le rouleau pour le gui, qui s'étaient brisés pendant ma traversée, sont remplacés par une sous-barbe de bronze et un rouleau de fer galvanisé beaucoup plus solide. ? (Alain Gerbault, À la poursuite du soleil; tome 1 : De New-York à Tahiti, 1929)
- (En particulier) Vergue inférieure d'une voile aurique, bermudienne ou foc.
Nom commun 1 - français
gui \?i\ masculin
-
(Phytopathologie) (Botanique) Plante verte hémiparasite et épiphyte à tiges articulées dichotomiques et à baies globuleuses qui croissent sur les branches de certains arbres, grâce à leur suçoir conique (ou haustorium) et dont les graines collantes sont disséminées par divers oiseaux.
- Il faut avoir soin de les élaguer convenablement et de détruire le gui parasite qui les envahit fréquemment. ? (Edmond Nivoit, Notions élémentaires sur l'industrie dans le département des Ardennes, E. Jolly, Charleville, 1869, page 136)
- Le plus étonnant est sans doute l'aisance avec laquelle saint Albert accepte les idées des anciens à propos de la transmutation des plantes. C'est ainsi qu'il considère le gui comme résultant de la transpiration de la sève de l'arbre qui le porte. ? (Jean Semal, Pathologie des végétaux et géopolitique, 1982)
Trésor de la Langue Française informatisé
GUI1, subst. masc.
Plante à fleurs apétales vivant en parasite de certains arbres (peupliers, pommiers, chênes, etc.), dont les fruits ronds et blancs contiennent une substance visqueuse et dont les feuilles, notamment, ont des propriétés astringentes et vomitives. Boule de gui; cueillir le gui. Il s'agissait tout bonnement de piler du gui de chêne (Sand, Hist. vie, t. 2, 1855, p. 458) :GUI2, subst. masc.
MAR. Vergue sortant du navire et qui s'appuie horizontalement par une mâchoire ou une ferrure métallique contre le pied du mât d'artimon. Écoutes de gui. La voile frémit (...) puis le gui, lentement, se déplace vers tribord (Maupass., Sur l'eau,1888, p. 252).Gui au Scrabble
Le mot gui vaut 4 points au Scrabble.
Informations sur le mot gui - 3 lettres, 2 voyelles, 1 consonnes, 3 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot gui au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
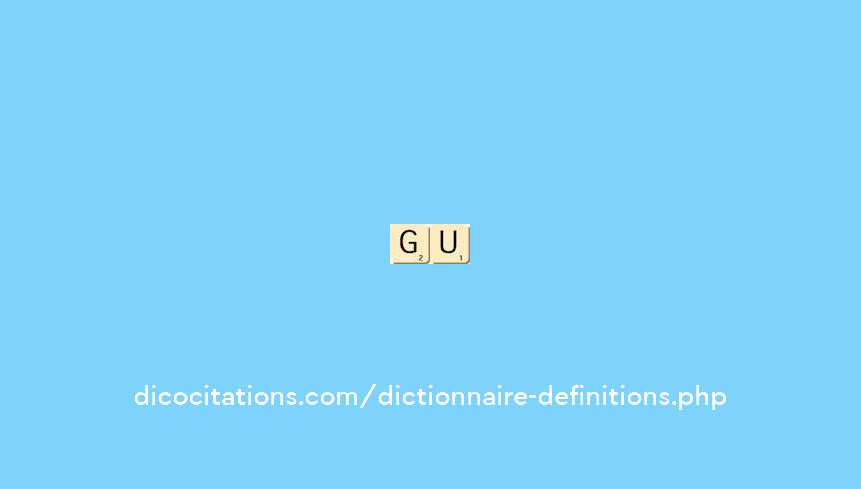
Les mots proches de Gui
Gui Guibolle Guichet Guichetier Guide Guide Guide-âne Guideau Guideau Guider Guidon Guidonnage Guignard Guigne Guigner Guignier Guignon Guildive Guilée Guillage Guilledin Guilledou Guilleret, ette Guillerettement Guilleri Guilloché, ée Guillochis Guillotiner Guimauve Guimbarde Guimée Guimpe Guimper Guimperie Guinda Guindal Guindé, ée Guinder Guinderie Guinée Guingan Guingois Guinguette Guinois Guipage Guipure Guirlande Guirlander Guise Guitare gui Guibermesnil Guibeville Guibeville guibole guiboles guibolle guibolles Guichainville guiche Guiche Guiche Guichen guiches guichet guichetier guichetière guichetiers guichets Guiclan guida guidage guidai guidaient guidais guidait guidance guidant guide guide guidé guide-interprète guidée guidées Guidel guident guider guidera guiderai guiderait guideras guidèrent guiderez guideront guides guides guidés guidez guidiez guidonMots du jour
-
magnifie martyre orthophoniste débilite martèlement broyant communistes écrasé monologuaient subventionnent
Les citations avec le mot Gui
- Les lames d'une marchombre sont comme elle, silencieuses, invisibles et mortellement efficaces. Greffées dans son corps, prêtes à jaillir entre ses doigt, prolongement de sa volonté, elles reflètent l'esprit même de la guilde. L'âme marchombre.Auteur : Pierre Bottero - Source : La Quête d'Ewilan (2003)
- Les ans, comme de grands boeufs noirs, foulent le monde. Dieu, leur gardien, les pousse de son aiguillon, et moi, leurs sabots m'ont meurtrie au passage.Auteur : William Butler Yeats - Source : La Comtesse Cathleen (1892), IV, Oona
- Nos vertus ne sont le plus souvent que des vices déguisés.Auteur : François de La Rochefoucauld - Source : Epigraphe
- Tiens l'anguille par la queue.Auteur : Proverbes latins - Source : Anguillam cauda tenes.
- Le chagrin aiguise les sens; il semble que tout se grave mieux dans les regards, après que les pleurs ont lavé les traces fanées des souvenirs.Auteur : Romain Rolland - Source : Jean-Christophe (1904-1912)
- Degault-Billau: Guide répertoriant les plus mauvais restaurants de France.Auteur : Marc Escayrol - Source : Mots et Grumots (2003)
- Chacun se fait fouetter à sa guise.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe
- Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois dans votre vie vous aviez réellement dit merci ? Un vrai merci. L'expression de votre gratitude, de votre reconnaissance, de votre dette. À qui ? Au professeur qui vous a guidé vers les livres ? Au jeune homme qui est intervenu le jour où vous avez été agressé dans la rue ? Au médecin qui vous a sauvé la vie ? À la vie elle-même ?Auteur : Delphine de Vigan - Source : Les gratitudes
- L'athéisme et le fanatisme sont deux monstres qui peuvent dévorer et déchirer la société; mais l'athée, dans son erreur, conserve sa raison qui lui coupe les griffes, et le fanatique est atteint d'une folie continuelle qui aiguise les siennes.Auteur : Voltaire - Source : Correspondance, à Mme la marquise du Deffand
- Attentif à maintenir l'écheveau bien tendu entre ses poignets crispés, et à guider le dévidage en se penchant avec régularité de droite et de gauche, il n'osait pas quitter des yeux le brin de laine ensorcelé.Auteur : Roger Martin du Gard - Source : Les Thibault
- La vérité dépouillée de toute espèce d'utilité même possible ne peut donc pas être une chose due, et par conséquent celui qui la tait ou la déguise ne ment point.Auteur : Jean-Jacques Rousseau - Source : Les Rêveries du promeneur solitaire (1776-1778, édition posthume 1782)
- Et allez pas me dire qu'un Irlandais est un modèle de civilisation. C'est peut-être un ange déguisé en diable ou un diable déguisé en ange. Quand on discute avec un Irlandais, on discute en fait avec deux individus.Auteur : Sebastian Barry - Source : Des jours sans fin (2016)
- Le poète jouit de cet incomparable privilège, qu'il peut à sa guise être lui-même et autrui.Auteur : Charles Baudelaire - Source : Petits poèmes en prose ou Le Spleen de Paris (1862)
- Moi, je me déguise en homme, pour n'être rien.Auteur : Francis Picabia - Source : Jésus-Christ Rastaquouère (1920)
- Faire rire! Devenir un roi du rire! C'est moins effrayant que d'être guillotiné, mais c'est aussi infamant.Auteur : Marcel Pagnol - Source : Le Schpountz (1938)
- Je vous le dis, il est plus aisé pour un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille, que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu.Auteur : La Bible - Source : Matthieu, XIX, 24
- Il y a des fées, des fées partout. Je ne serais pas étonnée d'en rencontrer qui seraient en train d'apporter des bûches de sapin dans l'antichambre, de mettre des guirlandes autour des poignées des portes et au-dessus des fenêtres.Auteur : Katherine Mansfield - Source : Lettres à J. Middleton Murry, 27 décembre 1915
- Epuisés par le jeûne, se roulant sur un lit d'épines, les anachorètes se sentaient percés jusqu'aux moelles des aiguillons du désir charnel.Auteur : Anatole France - Source : Les Opinions de Jérôme Coignard (1893)
- Je me souviens très bien qu'à cette époque je ne connaissais pas du tout l'impressionnisme et l'oeuvre de Gauguin nous a enthousiasmés pour elle-même, non contre quelque chose...Auteur : Pierre Bonnard - Source : A propos des Nabis.
- Son dolman bleu, moulant sa taille superbe, était orné, sur la droite, d'aiguillettes d'or fines et brillantes.Auteur : Raymond Roussel - Source : Impressions d'Afrique (1910)
- Accoucher. Sortir soi-même ce machin visqueux et braillard, qui glisse comme une savonnette, de son bain dégoulinant et sanguinolent, j'ai vraiment aimé.Auteur : François Detay - Source : Chirurgien chercheur d'or (2004)
- Tout homme veut savoir d'où il vient. C'est l'un de ses premiers et plus ardents désirs. Aussi ne peut-on pas lui refuser ou lui déguiser l'information. Ceux qui l'entourent, ses proches, ont droit de le savoir aussi, surtout là où l'on fonde une famille.Auteur : Ernst Jünger - Source : Sans référence
- Dans un coffret, qu’elle appelle sa « boite à guimauve », elle conserve précieusement ses DVD préférés. Chaque fois que son moral se fait la malle, c’est un réflexe : elle choisit l’un d’entre eux et, pendant 2 heures, s’évade de son quotidien. Love actually, Titanic, Sur la route de Madison, The notebook, Légendes d’automne, Pretty woman, Le journal de Bridget Jones, Dirty dancing, Will Hunnting, Coup de foudre à Notting Hill, The holiday, L’arnacoeur, ce sont tous des antidépresseurs sans effets secondaires. Auteur : Virginie Grimaldi - Source : Le premier jour du reste de ma vie (2015)
- Regarde alors les actualités au cinéma; des fois on t'en repasse des vieilles. Tu vois alors le tsar Nicolas qui serre la main de Poincaré, les taxis de la Marne, Guillaume II, le Kronprinz, Verdun: c'est pas del'histoire, ça?Auteur : Raymond Queneau - Source : Les Fleurs bleues (1965)
- Par la mise à mort du roi et de Dieu, l'homme a été installé sur le trône mais aussi sous le couperet de la guillotine.Auteur : François George - Source : Deux études sur Sartre (1976)
Les citations du Littré sur Gui
- Est-ce à moi de languir dans cette incertitude ?Auteur : Jean Racine - Source : Athal. III, 3
- La douleur, chaleur, tension, rougeur, nous signifie l'humeur estre sanguinAuteur : PARÉ - Source : V, 3
- Je vous écris peu de nouvelles.... d'ailleurs je n'en sais point ; je serais toute propre à vous dire que M. le chancelier a pris un lavement [Séguier, qui n'allait jamais au conseil sans avoir pris un lavement]Auteur : Madame de Sévigné - Source : 13 mars 1671
- Ils avoient esventré 15 ou 16 corps de Bourguignons, et desvidoient leurs trippes comme les trippiers à la riviereAuteur : CARLOIX - Source : IV, 32
- Quar il a mestier par couvent D'achateors, et cil s'engingnent, Qui orendroit ne le barguignent, Quar tels foiz le voudront avoir Qu'on ne l'aura pas por avoirAuteur : RUTEB. - Source : 96
- L'homme en ses passions toujours errant sans guideAuteur : BOILEAU - Source : Sat. X.
- Cil Guillaumes.... chassoit l'autre jour Un lievre qui ert à sejourAuteur : RUTEB. - Source : 290
- Personne ne pouvait comprendre une dépense si prodigieuse pour une simple guinguette, puisque une maison sans terres, sans revenus, sans seigneurie ne peut avoir d'autre nomAuteur : SAINT-SIMON - Source : 311, 103
- On donna sans quartier sur ces deux Franguis [souris de France] qui voulaient faire la loi aux autresAuteur : FÉN. - Source : t. XIX, p. 58
- Tu n'avais pour toute coiffure qu'une longue tresse de tes cheveux, roulée autour de la tête et rattachée avec une aiguille d'or, à la manière des villageoises de BerneAuteur : Jean-Jacques Rousseau - Source : Hél. II, 25
- Un excès de plaisir nous rend tout languissantsAuteur : Corneille - Source : Cid, IV, 5
- Bourguignon, ne nous tutoyons plus, je t'en prieAuteur : MARIV. - Source : Jeux de l'am. et du has. II, 9
- Pourquoi cette marche molle et pesante, dans une circonstance si critique ? Était-ce notre artillerie et nos bagages qui nous avaient tant alanguis ?Auteur : SÉGUR - Source : Hist. de Nap. IX, ch. 2
- Le duc de Guise, qui avoit preveu cet avantage, y avoit sur le ventre 300 harquebuziers choisis qui firent demordre les entrepreneursAuteur : D'AUB. - Source : Hist. I, 21
- Je suis très aise, madame, que vous approuviez mon quant-à-moi sur le sujet de M. de Guitaut ; et en effet, quand, avec le cordon bleu, il aurait encore l'ordre de la Toison et celui de la Jarretière, il n'y aurait pas de comparaison de lui à moiAuteur : BUSSY - Source : Lett. à Mme de Sév. du 14 oct. 1678, dans SÉV. t. V, p. 494, éd. RÉGNIER
- Les coucons seront enfilés, en faisant passer l'esguille par la premiere filozelle appellée bourretteAuteur : O. DE SERRES - Source : 490
- S'il faut ne te rien déguiser, Mon innocence enfin commence à me peserAuteur : Jean Racine - Source : Androm. III, 1
- Nous voyons la plante naître, croître, fleurir et fructifier, comme nous voyons l'aiguille d'une horloge parcourir d'un mouvement insensible tous les points du cadranAuteur : BONNET - Source : Contempl. nat. X, 30
- Nom, dans la Guinée, d'un insecte qui se glisse dans la trompe de l'éléphant et le fait mourir en des accès de fureurAuteur : CORTAMBERT - Source : Cours de géographie, 10e éd. 1873, p. 622
- Le jeune Edouard, qui fut depuis roi d'Angleterre, s'adonnoit plus et s'inclinoit de regard et d'amour sur Philippe [fille du comte Guillaume] que sur les autresAuteur : Jean Froissard - Source : I, I, 15
- En France on appelle cerise le fruit qu'en Languedoc on dit agriote, et la cerise de telle province est nommée en France guine.... S'en voient des grosses, moiennes, petites, rondes, longues, plattes, refendues : des rouges, blanches, noires : des aigres, des douces : des molles, des dures.... La cerise ou agriote est plus aigre que douce, comme tirant son nom de là ; au contraire la guine est plus douce que aigre.... La grosse agriote, aiant la queue courte, le noiau petit, estant de couleur rouge-brun, surpasse les autres en valeur... Parmi les douces, paraissent pour les plus prisées les duracines, appelées aussi graffions, mot pris en Dauphiné pour toutes sortes de guines.... Merises sont guines presque sauvages et petites, tenans de l'amer dont elles portent le nom. Coeurs sont assés grosses, poinctues et fendues, ainsi dittes à cause de leurs figure ressemblant, et en leur chair et en leur noiau, aucunement le coeur d'une creature humaine, par aucuns, sans grande raison, appelées aussi cerises heaumées, et leurs arbres, heaumiers. Non plus pouvons-nous dire pourquoi d'autres cerises sont dites pinguereaux, rodanes, greffions et semblables ; très bien des musquates, dont le goust rend raison de leur appellation ; ces noms sont donnés aux guines, non aux agriotesAuteur : O. DE SERRES - Source : 682
- Icellui Guillot, qui estoit tout yvresAuteur : DU CANGE - Source : ebriare.
- Après le meurtre de Henri de Guise et du cardinal son frère, il [le parlement] commença des procédures contre Henri III, et nomma deux conseillers, Pichon et Courtin, pour informerAuteur : Voltaire - Source : Dict. phil. Parlement de France.
- Un excès de plaisir nous rend tous languissantsAuteur : Corneille - Source : Cid, IV, 3
- La partie demeure languide et devient en atrophie, ou elle se meurt du toutAuteur : PARÉ - Source : VIII, 11
Les mots débutant par Gui Les mots débutant par Gu
Une suggestion ou précision pour la définition de Gui ? -
Mise à jour le lundi 9 février 2026 à 06h42

- Gendarme - Generosite - Genie - Génie - Gentillesse - Gentleman - Geographie - Gloire - Golf - Goût - Gout - Gouvernement - Grâce - Grammaire - Grandeur - Grandir - Gratitude - Gratuit - Gravite - Gregaire - Guerre
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur gui
Poèmes gui
Proverbes gui
La définition du mot Gui est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Gui sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Gui présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
