La définition de Mon du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Mon
Nature : particule adv.
Prononciation : mon
Etymologie : Origine incertaine. On a indiqué la particule grecque et la particule de l'ancien scandinave mun ; suédois, monne ; mais ces particules sont dubitatives, interrogatives, et mon est affirmatif. Diez émet une conjecture ingénieuse et plausible : il suppose que mon répond à l'adverbe latin munde (munde ayant donné mon, comme mundus avait donné mont) ; de sorte que mon signifierait purement, certainement.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de mon de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec mon pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Mon ?
La définition de Mon
qui sert à affirmer, à interroger ; elle est tout à fait inusitée.
Toutes les définitions de « mon »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
, qui répond au pronom personnel Moi, Je. Mon livre. Mon ami. Mon bien. Mon père. Mon frère. Il fait au féminin MA. Ma mère. Ma sœur. Ma maison. Ma chambre. Ma plus grande envie. Ma principale affaire. Mais lorsque le nom ou l'adjectif féminin, devant lequel il est placé, commence par une voyelle ou par h sans aspiration, au lieu de MA, on dit MON. Mon âme. Mon épée. Toute mon espérance. Mon unique ressource. Mon affaire principale. Mon heure n'est pas venue. Devant une h aspirée, on dit Ma au féminin. Ma hallebarde. Ma honte. Il fait au pluriel Mes. Mes amis. Mes livres. Mes affaires. Mes pensées. On s'en sert, familièrement, pour exprimer des rapports d'habitude, de connaissance, etc. C'est mon homme. Voilà bien mon fou. Je connais mon public.
Littré
MON, au masc.; MA au fém.?; MES au plur. pour les deux genres
-
1Il exprime la possession qu'a la personne qui parle. Mon bien. Ma mère. Mes malheurs.
Mais j'ai suivi mon ordre [l'ordre que j'ai reçu] et n'ai point deviné?
, Corneille, Suréna, II, 1.Certains auteurs, parlant de leurs ouvrages, disent?: mon livre, mon commentaire, mon histoire?; ils sentent leurs bourgeois qui ont pignon sur rue
, Pascal, Pens. XXIV, 68, éd. HAVET.Que je ne cherche point à venger mes injures [les injures que j'ai reçues]
, Racine, Athal. II, 5.Il y a une conspiration contre moi plus forte que celle de Catilina?; soyez mes Cicérons
, Voltaire, Lett. d'Argental, 8 janv. 1752. -
2Devant un nom féminin commençant par une voyelle ou par une h muette, au singulier, l'usage veut qu'on emploie le masculin. Mon amie. Mon humeur.
Prenons parti, mon âme, en de telles disgrâces
, Corneille, Hor. III, 1. -
3Il se dit aussi en parlant à une personne ou d'une personne qu'on aime.
Rends-moi mon Curiace, ou laisse agir ma flamme
, Corneille, Hor. IV, 5.Mon Hermione encor le tient-elle asservi??
Racine, Andr. I, 1.Ma Phoedime, eh?! qui peut concevoir ce miracle??
Racine, Mithr. IV, 1.Aussi bien n'ai-je point vu d'aujourd'hui ma cruelle Marine, c'est ma comtesse à moi
, Brueys, Muet, I, 10. -
4 Familièrement. Il se met pour désigner des objets qui ne nous appartiennent pas dans le sens précis du mot, mais avec lesquels la personne qui parle a pourtant quelque rapport d'habitude ou de mention faite précédemment, etc. Voilà mes fous.
Voilà mon homme pris, et ma vieille attrapée
, Corneille, Veuve, IV, 7.Il [le chat] y tombe [dans un piége] en danger de mourir?; Et mon chat de crier
, La Fontaine, Fabl. VIII, 22.Notre interprète transmit en indou le discours impie de mon jeune homme
, Voltaire, Voyages de Scarmentado.Je connais mon public?: l'enthousiasme passe?; il n'y a que l'amitié qui reste
, Voltaire, Lett. d'Argental, 11 mars 1752.Je renverrai mon fat, et mon affaire est faite
, Gresset, Méchant, III, 10.Il se dit dans le même sens devant les noms propres.
Non, baron, je connais assez mon Londres, quoique je n'y sois que depuis trois semaines
, Boissy, Français à Lond. I, 1.Je ne suis pas scrupuleux?; je lis quelquefois mon Pétrone
, Diderot, Essai sur la peint. ch. 5. - 5Mon, ma, mes devant les adverbes ou adjectifs comparatifs forment le superlatif. Mon meilleur ami. Ma plus chère espérance. Mes moindres chagrins.
REMARQUE
1. Autrefois on disait ma devant une voyelle et on élidait l'a comme nous l'élidons dans la?: m'espée, m'esperance, etc. Il en est resté seulement m'amie, m'amour. C'est dans le courant du XIVe siècle que ce solécisme a commencé à s'introduire et à prendre force d'usage?; vrai solécisme, car le féminin a toujours été ma, ta, sa, et jamais mone, tone, sone. Comment s'est-il fait?? l'ancien picard, qui disait le pour les deux genres, disait aussi pour les deux genres men au lieu de mon, ma?; il est possible que l'influence picarde, qui a été considérable, se soit fait sentir et ait causé devant les voyelles la confusion de mon et de ma.
2. Il faut dire?: j'ai mal à la tête, et non pas à ma tête, parce que le pronom je montre suffisamment que c'est ma tête dont je veux parler, et que d'ailleurs on ne peut avoir mal à la tête d'un autre. Mais il faudra dire?: je vois que ma jambe s'enfle, si je veux parler de ma jambe, et non pas seulement?: je vois que la jambe s'enfle, parce que je peux très bien voir la jambe d'un autre s'enfler.
3. Mon, ma, mes se répètent devant chaque substantif et devant chaque adjectif, à moins que ces adjectifs n'aient à peu près le même sens. On dit donc?: Mon père et ma mère sont venus?; Je lui ai montré mes beaux et mes vilains habits. Mais on dit?: Je lui ai montré mes beaux et brillants équipages. Il est évident dans le dernier exemple que les adjectifs beaux et brillants sont appliqués au même substantif.
HISTORIQUE
IXe s. Si salvarai eo [je] cist [ce] meon fradre Karlo
, Serment. Et Karlus meos sendra [mon selgneur]
, ib.
XIe s. Conseiler mei come mi hume saive [mes hommes sages], Ch. de Rol, II., Que jel suivrai od [avec] mil de mes fedelz
, ib. VI. Là vous suirat, ce dist, mis avoez
, ib. IX. Tu n'es mes hom, ne je ne sui tis sire
, ib. XX.
XIIe s. Baron, amenez-moi mon felon boisseor [trompeur]
, Ronc. 198. Ma seror te donai par bone volonté
, ib. 198. Men escient [à mon escient]
, ib. p. 26. Tenez m'espée
, ib. p. 29. [à] Marsilion de moie part nonciez?
, ib. 120. En Rencevals gisent mort mi Frenzois
, ib. 137. Que m'amor ne soit doutée
, Couci, I. Tuit mi penser sont à ma douce amie
, Couci, II.
XIIIe s. Je voudroie, par m'ame, qu'ele fust decolée
, Berte, XVI.
XIVe s. Et reçoy m'ame en ta benoite foy
, Ménagier, I, 1. J'ay par mon ire esmeu plusieurs à jurer moult vilainement et de moult vilains sermens
, ib. I, 3. Et que on le deist en ma presence et à mon ouie
, ib. I, 3. Je me suis excusé et mectoie mon excusation premierement
, ib.
XVe s. Je ferray [frapperai] d'estoc et de taille De m'espée sur lui tous jours
, Resurrect. N. S. Mystère.
XVIe s. Pourtant je veux, m'amie et mon desir?
, Marot, I, 343. Sus, louez Dieu, mon ame, en toute chose
, Marot, IV, 308. Un soleil voit naistre et mourir la rose?; Mille soleils ont veu naistre m'amour
, Ronsard, 52. Il m'est souvenu de mon homme
, Montaigne, I, 382. Depuis le temps des rois de très louable memoire, mes pere et aieul
, D'Aubigné, Hist. II, 242.
Wiktionnaire
Adjectif - ancien français
mon \Prononciation ?\ masculin
- Mon, à moi.
Nom commun - français
mon \m?n\ masculin
- Insigne héraldique japonais.
Adverbe - français
mon \m??\
-
(Archaïsme) Assurément, vrai. Note d'usage : Utilisé avec le pronom ce et le verbe être, avoir ou faire[1][2].
- C'est mon.
- Ç'a mon.
- Exemple d'utilisation manquant. (Ajouter)
Adjectif possessif - français
mon \m??\
-
(Génériquement) (Sens propre) Marque la possession ou l'appartenance. Le possesseur est le locuteur, ce qu'il possède est au masculin singulier. Note : Il s'emploie également dans le cas où la chose possédée est un féminin commençant par une voyelle ou un h muet : mon arme (caractère euphonique).
- Je n'ai pas besoin qu'on ajoute qu'il a les yeux sortants, le ventre protubérant; je l'ai vu, et ces traits, gravés dans ma mémoire, suffisent pour le représenter à mon esprit. ? (Nicolas-Maximilien-Sidoine Séguier de Saint-Brisson, marquis Séguier de Saint-Brisson, La philosophie du langage exposée d'après Aristote, à Paris chez Bourgeois-Maze, 1838, page 104)
- Messieurs, la vérité est que ces prétendues expériences qui auraient fait bonne justice de mon arme, sont de toute fausseté. ? (Perrot, Nouvelle Arme de Guerre, 1838, page 11)
-
(Par extension) (Figuré) Pour exprimer des rapports d'habitude, de connaissance, de proximité, etc.
- Mon voisin n'a pas respecté les règles du Code civil, que puis-je obtenir en justice?? ? (Jean-Michel Guérin, Nathalie Giraud, Gérer les relations de voisinage : À jour des dernières lois, chez Eyrolles, 2012, page 73)
-
(Familier) Avec, en plus, une note d'affection.
- Mon bien-aimé le plus chéri, cette nuit sont arrivées les terribles nouvelles de votre duel. ? (Viviane Janouin-Benanti, Le chéri magnifique : histoire d'un crime, Cheminements, 2002, page 267)
- Avec une marque de respect ou de reconnaissance.
- La Gloire de mon père ? (Marcel Pagnol, La Gloire de mon père, 1957)
- Avec un caractère identificatoire.
- C'est ainsi que j'ai fait de mon docteur Larch un avorteur, et de Homer Wells, le jeune orphelin qu'il forme, quelqu'un qui répugne à pratiquer l'avortement. ? (John Irving, Mon cinéma, aux éditions du seuil, 2013)
- Avec une marque de subordination.
- Mon supérieur se sent concerné par le bien être de ses subordonnés. ? (Gérard Chasseigne, Cognition, santé et vie quotidienne, volume 3, chez Publibook, 2010, page 65)
-
(Militaire) Est une forme d'allégeance ou de soumission (obligatoire dans sa forme vocative). Note : Par dérivation de l'expression ancienne mon sire ou mon sieur. Cette forme ne s'applique pas aux grades inférieurs (caporal, sergent, ?), aux maréchaux, aux amiraux et aux femmes gradées.
- J'ai été réveillé à trois heures et demie du matin par mon adjudant, qui m'a dit : M. le major, dépêchez-vous de vous lever, le commandant vous demande chez lui. ? (Causes politiques célèbres du dix-neuvième siècle : Procès du général Malet, chez H. Langlois fils, 1827, page 51)
- À la caserne, l'adjudant demande à une nouvelle recrue : ? Votre nom?? ? Lévy, mon adjudant?! ? (Bernard Guyso, L'année du rire, City éditions, 2015)
Interjection - français
mon \m??\, parfois \m???\
-
(Lorraine) (Familier) Interjection exprimant l'étonnement, la surprise ou l'admiration. Note : Abréviation de mon Dieu. [3]
- Mon ! Le beau petit chien !
- Exemple d'utilisation manquant. (Ajouter)
Trésor de la Langue Française informatisé
MON, MA, MES, adj. poss.
[Déterm. du subst. ayant d'une part une fonction d'actualisation comparable à celle de l'art. le et, d'autre part, marquant la 1repers. du sing. dans le groupe nom. Comme déterm., il s'accorde en genre et en nombre avec le subst. du groupe nom.; comme 1repers., il est porteur de la marque de nombre (le sing.), mais non de celle de genre]Mon au Scrabble
Le mot mon vaut 4 points au Scrabble.
Informations sur le mot mon - 3 lettres, 1 voyelles, 2 consonnes, 3 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot mon au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
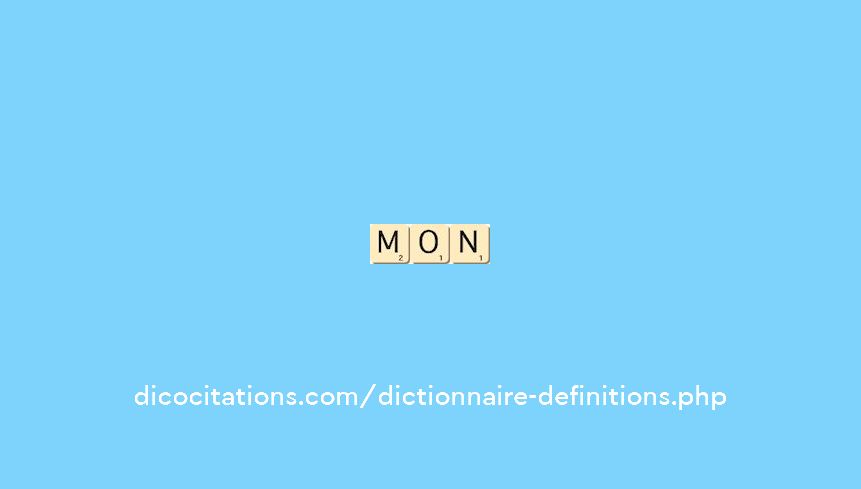
Les mots proches de Mon
Mon ou ma ou mes Mon Monacaille Monacal, ale Monacalement Monachisme Monade Monadologie Monadologique Monarchie Monarchique Monarque Monastère Monastique Monauriculaire Monaut Moncade Monceau Mondain, aine Mondainement Mondaniser Mondanité Monde Monde Mondement Monder Mondeuse Mondificatif, ive Mondification Mondifier Mondilles Mondrain Mone Monétaire Monétairement Monétisation Moniteur Monition Monitoire Monitor Monitorial, ale Monnaie Monnaierie Monnayage Monnayé, ée Monnayer Monnayeur Monobromé, ée Monochromie Monocle mon mon monacal monacale monacales monachisme Monacia-d'Aullène Monacia-d'Aullène Monacia-d'Orezza Monacia-d'Orezza Monaco monades monadologie Monampteuil monarchie monarchies monarchique monarchiste monarchiste monarchistes monarchistes monarque monarques Monassut-Audiracq monastère Monastère monastères Monastier-Pin-Moriès Monastier-sur-Gazeille monastique monastiques Monay Monbadon Monbahus Monbalen Monbardon monbazillac Monbazillac Monbéqui Monbert Monblanc Monbos Monbrun Moncale Moncale Moncassin Moncaup Moncaup Moncaut Moncayolle-Larrory-MendibieuMots du jour
Monter Purgatoire Réquisitionnement Goujonner Délectablement Scintiller Compris, ise Lépas Intuitif, ive Brelan
Les citations avec le mot Mon
- On a du mal à imaginer que ceux qui ne sont pas encore au monde ont une existence terrestre. Alors pourquoi ceux qui quittent la vie en auraient-ils une?Auteur : Yvan Francis Le Louarn, dit Chaval - Source : Sans référence
- J’en suis arrivée au point où cela m’est à peu près égal de mourir ou de rester en vie. Le monde continuera de tourner sans moi et, de toute façon, je ne peux rien contre les événements actuels. Auteur : Anne Frank - Source : Journal d'Anne Frank (1947)
- Il est puéril de se demander où vont les choses et les mondes. Ils ne vont nulle part et ils sont arrivés.Auteur : Maurice Maeterlinck - Source : La Vie des abeilles (1901)
- Si tous tiraient dans la même direction, le monde basculerait.Auteur : Proverbes yiddish - Source : Proverbe
- Cueillons la rose dès le matin de ce jour brillant, le soir elle sera flétrie; cueillons la rose d'amour. Aimons, puisqu'en aimant nous pouvons encore être aimés.Auteur : Torquato Tasso, dit le Tasse - Source : Jérusalem délivrée (1581)
- L'idéal n'est pas de ce monde, si fort que nous y tendions.Auteur : Anne-Marie Garat - Source : Dans la main du diable (2006)
- La courbe de tes yeux fait le tour de mon coeur.Auteur : Paul Éluard - Source : Capitale de la douleur (1926), La courbe de tes yeux...
- Ah! madame, toutes nos langues modernes sont sèches, pauvres, et sans harmonie, en comparaison de celles qu'ont parlées nos premiers maîtres, les Grecs et les Romains.Auteur : Voltaire - Source : Correspondance, 12 mai 1754
- Petite aumône grande joie ?Auteur : Homère - Source : L'Odyssée, XIV, 57
- Tout le monde a du talent. Ce qui est plus rare est d'avoir le courage de développer ce talent.Auteur : Erica Jong - Source : Sans référence
- Que ce fût en famille ou dans l'exercice de son métier, j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait chez mon père cette appétence à palper l'âme humaine et à la tripoter comme on joue avec de la pâte à modeler. Auteur : Jean-Paul Dubois - Source : La succession (2016)
- Hélas ! Qu'y a-t-il de certain dans ce monde, hormis la mort et l'impôt ?Auteur : Benjamin Franklin - Source : Lettre à Jean-Baptiste Leroy, 1789.
- Les arbres aux racines profondes sont ceux qui montent haut.Auteur : Frédéric Mistral - Source : Les Iles d'or (1875)
- Ou bien, c'est la fusion avec le monde, ma disparition dans tout ce qui me touche, que je vois, et dans tout ce que je ne vois pas encore. Sans doute ne puis-je alors supporter de n'être qu'un seul moi, devant tous ces autres moi et d'être immobile malgré l'effervescence de mes sens, d'être immobile dans cet espace où l'on saute, s'élance, s'envole…
Plutôt mourir (comme peut « mourir » un enfant) que de ne pas être multiple, voire multiple jusqu'à l'infini.Auteur : Pierre Guyotat - Source : Coma
- Admonestant le peuple d'elire, non pas les plus gracieux, mais les plus aspres et rigoureux medecins.Auteur : Jacques Amyot - Source : Caton, 33
- Mon Dieu ! pensa Edouard, consterné, mais en lui souriant comme s'il trouvait cette idée merveilleuse, pourquoi les enfants sont-ils si compliqués ?Auteur : Jean-Michel Guenassia - Source : La Vie rêvée d'Ernesto G. (2012)
- Il est vrai que, quand tout le monde se ferait Diogène, comme Rousseau, il faudrait parcourir bien des tonneaux avant de rencontrer un Diogène comme celui-là.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Jugement sur Émile
- Soleil, source de feu, haute merveille ronde
Soleil, l'âme, l'esprit, l'oeil, la beauté du monde.Auteur : Pierre de Ronsard - Source : Eglogues, I, Bergerie - Je voulais dire quelque chose de mon temps, et davantage sur les hommes que sur les femmes d'ailleurs ... sur la jeunesse aussi. Je me suis rendue compte à quel point je ne voudrais pas être un homme aujourd'hui. Toutes les définitions de la masculinité ont disparu ; l'injonction à être un homme est restée, mais le paradigme a disparu. Ce personnage de Clément , il est dans cette espèce de vide juridique, où on lui demande toujours d'être viril, mais on ne lui dit pas comment, et donc du coup ... il n'essaye même plus. Auteur : Maria Pourchet - Source : Maria Pourchet et l’amour pyromane, La Grande Table culture par Olivia Gesbert, 16/09/2021
- Se masturber, c'est faire l'amour avec la personne qu'on aime le plus au monde.Auteur : Woody Allen - Source : Sans référence
- Dans l'abandon de sa vive amitié, - Hier à son rival Montfort s'est confié.Auteur : Casimir Delavigne - Source : Les vêpres siciliennes (1819), I, 2
- Je peux vous assurer, Monsieur le Juge, que j'ai en cemoment sur moi tout ce qu'il faut pour commettre un attentat à la pudeur... et l'idée ne m'en effleure même pas!Auteur : Henri Rochefort - Source : Sans référence
- Monsieur Emmanuel Macron n'a pas de programme économique. Il ne peut pas en avoir parce que nous ne sommes plus qu'un territoire à l'intérieur de l'Union européenne. Il faut sortir de là le plus rapidement possible, quel qu'en soit le coût, car mieux vaut la liberté que l'esclavage.Auteur : Marie-France Garaud - Source : Interview Le Figaro, 2 avril 2017, par Emmanuel Galiero
- Monsieur,
Pouvez-vous SVP m'appeler au 06 01 02 03 04 car je n'ai plus de crédits.
Merci.Auteur : Patrice Romain - Source : Mots d'excuse - Les parents écrivent aux enseignants (2010), Les demandes diverses - Il règne en nos coeurs un dictateur implacable prêt à envisager la catastrophe pour un millier d'étrangers pourvu que cette catastrophe assure le bonheur des quelques êtres que nous aimons.Auteur : Graham Greene - Source : Le Fond du problème (1948)
Les citations du Littré sur Mon
- Je parlai à ses parents que je rangeai de mon parti : la demoiselle était de bonne volontéAuteur : MARIVAUX - Source : Pays. parv. 4e part.
- Là [entre la mer Caspienne et les monts de l'Indou-Kousch] fut parlée, avant que les diverses tribus de Japhet se dispersassent, quand elles vivaient encore réunies, la langue première qui fut la souche de toutes les autres [langues aryennes] ; la science moderne l'appelle aryaque, et parvient à en reconstituer en partie les traits les plus essentielsAuteur : FR. LENORMANT - Source : Manuel de l'hist. anc. t. I, p. 126, 4e édit.
- C'est là [dans la passion] que Jésus-Christ a supprimé les cérémonies de la loi, qu'il a transmis l'Ancien Testament au Nouveau, changé le sacerdoce lévitique....Auteur : FLÉCH. - Source : Sermons, Messe.
- J'avais prévu ma chute en montant sur le faîteAuteur : Jean de La Fontaine - Source : Fabl. X, 10
- Je suis Gros-Jean qui remontre à son curé : j'aime bien mieux lui demander sa bénédictionAuteur : Voltaire - Source : Lett. M. de Vaines, 30 mars 1776
- Pour cacher mon départ je demeure un momentAuteur : Jean Racine - Source : Phèd. V, 1
- Marchez contre elle des extrémités du mondeAuteur : SACI - Source : Bible, Jérémie, XIX, 9
- Ils [les évêques] ont eu l'humilité de changer en monseigneur le titre de révérendissime père en Dieu, qu'ils avaient porté douze cents ans ; pour Jean-George [évêque du Puy], il n'est assurément que ridiculissimeAuteur : Voltaire - Source : dans LAVEAUX
- Je vous prie, mon nepveu, en user [de mon mari] comme de vostre propre frereAuteur : MARG. - Source : ib. 165
- Montez à travers Blois cet escalier de rues Que n'inonde jamais la Loire au temps des cruesAuteur : Victor Hugo - Source : F. d'aut. 2
- Il me fit d'abord connaître clairement l'avenir en exaltant mon âme ; je fis de si prodigieux efforts d'exaltation que j'en tombai maladeAuteur : Voltaire - Source : l'H. aux 40 écus, Nouveaux systèmes.
- Mme la duchesse, la reine des plaisirs, chez qui Monseigneur s'était réfugié, chassé par le mésaise [de chez Mme la princesse de Conti]Auteur : SAINT-SIMON - Source : 177, 105
- Partout où j'ai, comme un mouton, Qui laisse sa laine au buisson, Senti se dénuer mon âmeAuteur : A. DE MUSSET - Source : Poésies nouv. Nuit de décembre
- Mande-moi si mon horoscope Veut que je suive la varlopeAuteur : MAÎTRE ADAM BILLAUT - Source : Oeuv. p. 137, dans POUGENS
- Je sçais très bien sentir, à mesurer ma portée, que mon terroir n'est aulcunement capable d'aulcunes fleurs trop riches que j'y treuve semées et que touts les fruicts de mon creu ne les sçauroient payerAuteur : MONT. - Source : II, 99
- La conversion du monde était le fruit de sa croix [de Jésus]Auteur : BOSSUET - Source : Hist. II, 11
- Car tel est bien hault juché qu'on demonteAuteur : MAROT - Source : V, 355
- Ô Seigneur, dit le roi-prophète, mon coeur ne s'est point haussé ; voilà l'orgueil attaqué dans sa sourceAuteur : BOSSUET - Source : Mar.-Thér.
- Rappelons-nous ce moment de la découverte, cette première entrevue des deux mondes, pour détester le nôtreAuteur : RAYNAL - Source : Hist. phil. VI, 5
- Et si on veut savoir le nom de ces deux monstres, l'un se nomme massacre, et l'autre picorée ; le premier jamais on ne l'a pu rassasier de sang, ni le second de richessesAuteur : LANOUE - Source : 57
- Quand il ot monstré ses lettres de creanceAuteur : Jean Froissard - Source : II, II, 223
- Les décurions et les autres inspecteurs, en remontant jusqu'au millénaire, devaient rendre compte à celui-ci des bonnes et des mauvaises actions, solliciter le châtiment et la récompense, avertir si l'on manquait de vivres, d'habits, de grains pour l'année ; le millénaire rendait compte au ministre de l'incaAuteur : RAYNAL - Source : Hist. phil. VII, 6
- Il fait tous ses efforts pour gagner mes parents, Et, s'il les peut fléchir, quant à moi, je me rends ; Non, à dire le vrai, que son objet me tente ; Mais, mon père content, je dois être contenteAuteur : Corneille - Source : la Place roy. V, 6
- Les reflets du chagrin prévu, sur quoi elle avait matrimonialement spéculéAuteur : CH. DE BERNARD - Source : la Cinquantaine, § IX.
- Il ne servait à rien à notre sujet d'employer quatre grandes pages à expliquer le fait de Synesius, ni de se montrer savant dans une chose si trivialeAuteur : BOSSUET - Source : Rem. Réponse, VII, 11, 52
Les mots débutant par Mon Les mots débutant par Mo
Une suggestion ou précision pour la définition de Mon ? -
Mise à jour le vendredi 13 février 2026 à 02h06

- Machiavelisme - Magie - Main - Maison - Maitre - Maître - Maitresse - Maîtresse - Maitrise - Mal - Malade - Maladie - Male - Malheur - Malheureux - Malveillance - Maman - Maman Enfant - Maman Fille - Maman Fils - Maman - Management - Manger - Manie - Manque - Marcher - Mari - Mariage - Mariage amour - Mariage heureux - Marseillais - Masturbation - Materialisme - Mathematique - Matiere - Maux - Maxime - Mechancete - Méchanceté - Méchant - Medaille - Medecin - Médecin - Medecine - Medias - Mediocrite - Medisance - Méfiance - Mefiance - Meilleur - Melancolie - Melomane - Memoire - Mémoire - Mensonge - Menteur - Mentir - Mepris - Mere - Mère_enfant - Mère_fils - Mère_fille - Mériter - Metaphysique - Methode - Metier - Métier - Meurtre - Militaire - Miracle - Miroir - Misère - Misere - Misogyne - Mode - Moderation - Moderne - Modestie - Moeurs - Mondanite - Monde - Mondialisation - Monogamie - Montagne - Monture - Moquerie - Moquerie - Morale - Mort - Mot - Mots d'amour - Motivation - Mourir - Mouvement - Moyens - Musique - Mystere - Mysticisme - Mythe - Mythologie
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur mon
Poèmes mon
Proverbes mon
La définition du mot Mon est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Mon sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Mon présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
