La définition de Rame du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Rame
Nature : s. f.
Prononciation : ra-m'
Etymologie : Espagn. et portug. resma ; ital. risma ; dan. riis ; suéd. ris ; angl. ream ; holl. riem. D'après Souza, ce mot vient de l'arabe rizma, paquet d'habits. M. Dozy, Gloss. p. 333, a mis hors de doute cette étymologie, montrant que rizma signifiait ballot en général, et, en particulier, ballot de papier, rame. Dans le passage en Occident, l's s'est perdue en plusieurs langues. à l'objection de Diez qu'il est contre la vraisemblance que l'Europe eût reçu ce mot des Arabes, il oppose que le papier de coton, qui précéda le papier de chiffon, avait en Espagne des fabriques renommées, d'où les chrétiens le tiraient. Il faut remarquer en outre que l'ancien français est raime, ce qui lève la difficulté de l'a de rame et le met d'accord avec l'i de risma ; rame est une altération de rayme. Avec cela tombe l'étymologie du grec, nombre, proposée par Muratori, et appuyée par Diez.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de rame de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec rame pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Rame ?
La définition de Rame
Mesure usitée en papeterie et qui est de vingt mains de papier. La rame de papier contient cinq cents feuilles.
Toutes les définitions de « rame »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Pièce de bois en forme de pelle qui sert à manœuvrer une embarcation. Il s'emploie surtout en parlant de la Navigation sur les rivières, les lacs; pour la navigation sur mer, on emploie de préférence son synonyme AVIRON. Le plat ou la pale d'une rame. Le manche d'une rame. Manier la rame. Les galères étaient des bâtiments à rames. Galère à trois rangs de rames. Faire force de rames. Lever les rames.
Littré
-
1Petit branchage que l'on plante en terre pour soutenir des plantes grimpantes, et, en particulier, les pois, les haricots.
Les quenouilles du maïs étant destinées à servir de tuteurs ou de rames au légume grimpant
, Chateaubriand, Amér. Moissons. -
2Instrument pour sécher et tendre les pièces de drap.
La rame est un long châssis, ou un très grand assemblage de bois aussi large et aussi long que les plus grandes pièces de drap,
Dict. des arts et mét. Drapier. - 3Outil de faïencier pour remuer la terre dans les baquets.
HISTORIQUE
XIIIe s. Quatre-vingt milliers de reime
, Du Cange, Constantinople, Chartres, p. 26. La batoit d'un rain d'aiglentier
, la Violette, p. 212. ?moult a dur cuer qui n'aime, Quant il ot [entend] chanter sur la raime As oisiaus les dous chans piteus
, la Rose, 82.
XVe s. Comme deux raims en une tige
, Chartier, p. 627.
XVIe s. La palme et raim de louenge immortelle
, Marot, J. V, 221. Vous mettrés les olives dans des pots, avec force sel menu, dispersant le fruit et le sel par littées, avec du fenouil en rame parmi
, De Serres, 843.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
1. RAME. Ajoutez?:Dans l'exploitation des bois du Morvan, rame, résidu de la bûche marchande, susceptible d'être transformé en menuise, en charbonnette et en fagots,Mém. de la Soc. cent. d'agriculture, 1873, p. 277.
Encyclopédie, 1re édition
RAME, s. f. (Marine.) longue piece de bois, dont l'une des extrémités étoit applatie, & qui étant appuyée sur le bord d'un bâtiment, sert à le faire siller. La partie qui est hors du vaisseau & qui entre dans l'eau, s'appelle le plat ou la pale, & celle qui est en-dedans, où les rameurs appliquent leurs mains afin de la mettre en mouvement, se nomme le manche de la rame. Pour faire siller un bâtiment par le moyen de cette piece de bois, les rameurs tournent le dos à la proue, & tirent le manche de la rame vers eux, c'est-à-dire la tirent vers la proue afin que la pale avance vers la poupe ; mais la pale ne peut point avancer dans ce sens sans frapper l'eau ; & comme cette impulsion est la même que si l'eau frappoit la pale de poupe à proue, le bâtiment est mu selon cette direction. De-là il suit que plus la pale se meut dans l'eau avec force, c'est-à-dire plus son choc est grand, plus le vaisseau sille vîte. Pour augmenter ce choc, presque tous les mathématiciens prétendent qu'on doit situer tellement la rame sur le bord du bâtiment, qu'elle soit divisée en deux parties égales par l'apostis, ou le point autour duquel elle se meut. Cette prétention est fondée sur ce que dans cette situation le produit des deux parties de la rame est un maximum, c'est-à-dire le plus grand qu'il est possible. Cependant malgré cette raison, M. Euler qui a publié là-dessus un beau mémoire, parmi les derniers de l'académie royale des Sciences de Berlin ; M. Euler, dis-je, veut que la partie extérieure excede l'autre. Il a inséré aussi un long chapitre sur les effets de cette machine, dans sa science navale : Scientia navalis, de actione remorum, chap. vij. Il y a des choses bien curieuses dans ce chapitre. L'auteur y calcule la vîtesse que doit acquérir le vaisseau, suivant l'action des rames ; il propose des machines qu'il estime plus efficaces que cette action, &c. & tout cela doit être lu dans l'ouvrage même. Voyez aussi l'article suivant. On trouvera aussi de nouvelles idées sur ces machines qu'on veut substituer aux rames, dans le Dictionnaire universel de Mathématique, &c. & la théorie en quelque sorte de ces avirons.
Les Latins appelloient les rames, remi, & quelquefois palmæ ou palmulæ. On leur donnoit aussi autrefois le nom de tonsæ, à cause qu'elles frappent les flots, & qu'elles les coupent : Et in lento luctantur marmore tonsæ. Un quatrieme nom qu'avoient les rames dans l'antiquité, étoient scalmes, qui signifie cheville, parce qu'il y avoit une cheville à chaque rame.
Plutarque dit que César s'embarqua à Brindes, pour passer un trajet de mer, sur une barque à douze scalnies. A l'égard des bancs où étoient assis ceux qui les faisoient mouvoir, les Grecs les appelloient ????, & les Latins transtra.
Quasi transversim strata considunt transtris.
Rame, Ramille, (Jardinage.) est une petite branche qui se ramasse dans l'exploitation des bois, après qu'on en a tiré le bois de corde, les coterets & les fagots ; elle n'est bonne qu'à faire des bourrées.
Rame, s. f. (Draperie.) machine ou instrument dont on se sert dans les manufactures de draperie pour allonger ou élargir les draps, ou seulement pour les unir & dresser quarrément.
Cette machine qui est haute d'environ quatre piés & demi, & qui a plus de longueur que la plus longue piece de drap, est composée de plusieurs petites solives ou morceaux de bois quarrés, placés de même que ceux qui forment les barrieres d'un manege ; en sorte néanmoins que les traverses d'en-bas puissent se hausser & se baisser, suivant qu'on le juge à propos, & être arrêtées solidement par le moyen de quelques chevilles. Il y a le long des traverses tant hautes que basses, des clous à crochet placés de distance en distance. Indiquons en peu de mots la maniere de mettre une piece de drap sur la rame.
La piece de drap étant encore toute mouillée, le chef en est attaché à l'un des bouts de la rame, puis on la tire, à force de bras, par le côté de la queue, pour la faire aller au point de longueur que l'on s'est proposé. La queue du drap étant bien arrêtée, on accroche la lisiere d'en-haut aux traverses d'en-bas, que l'on fait descendre par force jusqu'à ce que le drap soit à la largeur qu'on desire. Ayant été ainsi bien étendu & arrêté tant sur son long que sur son large, on brosse la piece à poil, & on la laisse sécher, ensuite on la leve dessus la rame, & tant qu'elle n'est point remouillée, elle conserve toujours la même largeur & longueur que cette machine lui a donnée. Dict. du Comm. (D. J.)
Rame, s. f. (Papeterie.) c'est un paquet de papier composé de vingt mains, chaque main de vingt-cinq feuilles, en sorte que la rame contient en tout cinq cens feuilles. La premiere & la derniere main doit être de même pâte & de même compte que le reste de la rame. Dict. de Trévoux.
Rame, mettre à la (terme de Librairie.) mettre un livre à la rame signifie ranger par rame une partie de l'impression d'un livre dont on a eu peu ou point de débit, pour le vendre de la sorte à vil prix aux épiciers & aux beurrieres, & à tous ceux qui en ont besoin, pour envelopper leurs marchandises, ou en faire autre usage. Richelet dit qu'Amelot pensa devenir fou, lorsqu'il apprit qu'on alloit mettre son Tacite à la rame. (D. J.)
Rame, (Manuf. en soirie.) faisceau de cordes de fil, au nombre de 400 dans les métiers ordinaires, de la longueur de 15 piés plus ou moins, auxquelles sont attachées les 400 cordes de semple, & qui ont au bout les arcades. L'endroit où les cordes du rame sont gansées & doublées sur le bâton, s'appelle la queue du rame.
RAME ou ROAMÉ, (Géogr. anc.) ville d'Italie dans les Alpes. L'Itinéraire d'Antonin la marque sur la route de Milan à Arles, en prenant par les Alpes cottiennes. Elle étoit entre Brigantio & Eburodunum, à 19 milles du premier de ces lieux, & à 18 milles du second. C'est maintenant un village du Dauphiné sur la Durance, à 2 lieues au-dessous d'Embrun, près du passage des Alpes appellé le Pertuis-Rostau.
Rame, adj. en termes de Blason, a la même signification que chevillé, & se dit des ramures d'une corne de cerf. Fredorf en Baviere, d'argent au cerf de gueules, ramé d'or.
France Terme
Assemblage de tiges de forage.
Wiktionnaire
Nom commun 1 - ancien français
rame \Prononciation ?\ masculin
- Cuivre.
Nom commun 3 - français
rame \?am\ féminin
-
(Papeterie) Réunion de vingt mains de papier ? voir rame de papier.
- Acheter, vendre du papier à la rame.
- Ce papier coûte tant la rame.
- Mais avec votre papelard à dix sacs la rame, vous pourrez toujours vous établir marchand de papier, ou vous en servir à ce que je pense, comme ça vous liquiderez votre stock ! ? (Michel Audiard, Le cave se rebiffe, 1962)
-
(Transport) Ensemble de plusieurs véhicules routiers ou ferroviaires attelés entre eux.
- (Chemin de fer) Attelage de wagons sans motrice.
-
(Chemin de fer) Train avec sa ou ses motrices.
- Rame de métro, de train.
Nom commun 2 - ancien français
rame \Prononciation ?\ masculin
- Variante de raime.
Nom commun 2 - français
rame \?am\ féminin
- Petit branchage que l'on plante en terre pour servir de tuteur à des pois, à des haricots, etc.
- Il est temps de mettre des rames à ces pois.
- Les arbres, tiges et branches que l'on convertit en bois de feu sont découpés, partie en bûches de rondin ou de quartier, partie en rames destinées à entrer dans les fagots. ? (Edmond Nivoit, Notions élémentaires sur l'industrie dans le département des Ardennes, E. Jolly, Charleville, 1869, page 163)
- C'était aussi des plants de fraisiers, des pois à grandes rames. ? (Alphonse Daudet, Maison à vendre, dans Contes du lundi, 1873, Fasquelle, collection Le Livre de Poche, 1974, page 186.)
- (Zoologie) Une des deux branches d'un appendice biramé.
- (Industrie pétrolière) Assemblage de tiges de forage.
- (Technique) Appareil qui servait à allonger les draps par étirement, et plus récemment les films de plastique.
Nom commun 1 - français
rame \?am\ féminin
-
Pièce de bois en forme de pelle qui sert à man?uvrer une embarcation.
- Le plat ou la pale d'une rame.
- Manier la rame.
- Les galères étaient des bâtiments à rames.
- Fatigue, paresse.
Trésor de la Langue Française informatisé
RAME1, subst. fém.
RAME2, subst. fém.
RAME3, subst. fém.
RAME4, subst. fém.
INDUSTR. TEXT. Appareil permettant de ramer une pièce de tissu. Après ces traitements, le tissu est séché sur rame. C'est alors en général qu'on teint s'il y a lieu (J.-É. Burlet, La Laine et l'industr. lainière, 1972, p. 101).Rame au Scrabble
Le mot rame vaut 5 points au Scrabble.
Informations sur le mot rame - 4 lettres, 2 voyelles, 2 consonnes, 4 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot rame au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
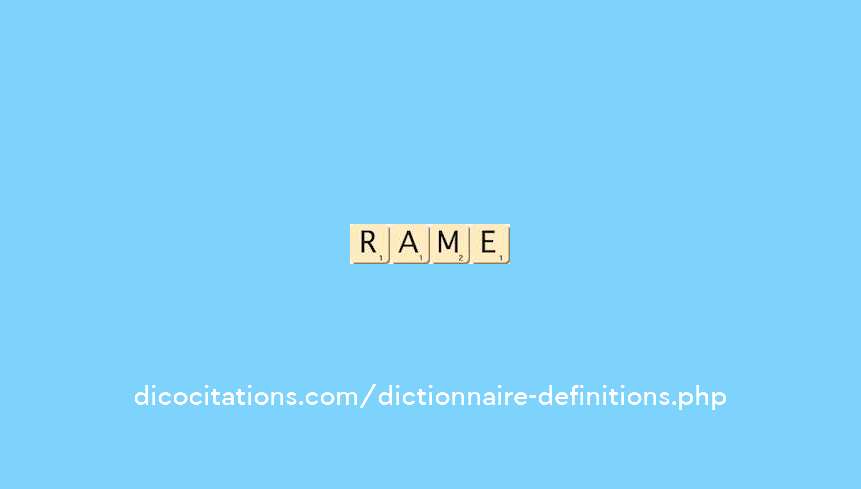
Les mots proches de Rame
Ram Ramadan ou ramazan Ramade Ramadouer Ramage Ramage Ramagé, ée Ramager Ramaigrir Ramaigrissement Ramas Ramasse Ramassé, ée Ramasse-miettes Ramasser Ramasser Ramassis Ramberge Rame Rame Rame Rame Ramé, ée Ramé, ée Rameau Ramée Ramendage Ramender Ramendeuse Ramené, ée Ramènement Ramener Rameneur Ramenteur Ramentevoir Ramer Ramereau Rameur Rameux, euse Ramie Ramier Ramier Ramification Ramifier (se) Ramilles Ramillon Raminagrobis ou rominagrobis Ramoindrir Ramoitir Ramoitissement ram rama ramadan ramage ramageait ramager ramages ramai ramaient ramais ramait ramant ramarraient ramarrer ramas ramas ramassa ramassage ramassages ramassai ramassaient ramassais ramassait ramassant ramassât ramasse ramassé ramassé Ramasse ramasse-miettes ramasse-poussière ramassée ramassée ramassées ramassées ramassent ramasser ramassera ramasserai ramasseraient ramasserais ramasserait ramasseras ramassèrent ramasseront ramasses ramassés ramassés ramasseur ramasseursMots du jour
-
extra-souples prospérera grands-mères atteignirent pudeur murmureraient garais refermeraient restituaient vireront
Les citations avec le mot Rame
- Il est bon d'être ferme par tempérament, et flexible par réflexion.Auteur : Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargues - Source : Réflexions et Maximes (1746)
- Notre vie n’est qu'un fil d’or dans une trame qui se déchire.Auteur : Maurice Chappaz - Source : Pages choisies (1977)
- C'est le drame lorsqu'on vit dans un village , il y a tellement de racontars. Comme une vieille amie de ma mère le disait toujours , on dirait qu'il n'y a pas de suffisamment de mots gentils pour chacun en ait de sa part. Auteur : Patricia Wentworth - Source : La plume du corbeau (1980)
- Bien que des circonstances extérieures m'aient empêché d'observer un régime strictement végétarien, j'adhère depuis longtemps à la cause par principe. En plus d'être d'accord avec les objectifs du végétarisme pour des raisons esthétiques et morales, je pense qu'une manière vivre par son effet purement physique sur le tempérament humain influencerait le plus avantageusement le sort de l'humanité.Auteur : Albert Einstein - Source : Lettre à Hermann Huth, 27 décembre 1930
- J'ai vu fleurir le pêcher rose,
Le vieux pêcher noir et chenu.
Il rit sous le ciel ingénu,
Il rit de sa métamorphose.
Le mois d'avril est revenu :
J'ai vu fleurir le pêcher rose,
Le vieux pêcher noir et chenu.
Devant le toit de tuiles roses,
Un oiseau gris parfois se pose
Sur le bout d'un rameau ténu...
Le mois d'avril est revenu...Auteur : Madeleine Ley - Source : Petites voix (1930) - Leurs maris sont revenus sur ce même bâtiment qui a ramené Yves, et elles sont là postées; soutenues déjà par quelque peu d'eau-de-vie, elles font le guet, l'oeil moitié égrillard, moitié attendri.Auteur : Louis Marie Julien Viaud, dit Pierre Loti - Source : Mon frère Yves (1883)
- Le fils cannibale ramène la fille en la tirant par les cheveux et la fourre dans la grosse marmite. - «T'es fou, dis le père, faut l'éplucher.» - Il l'épluche et l'emmène dans sa case.Auteur : Boris Vian - Source : Sans référence
- Soyez comme l'oiseau posé pour un instant sur des rameaux trop frêles qui sent plier la branche, et qui chante pourtant, sachant qu'il a des ailes.Auteur : Victor Hugo - Source : Sans référence
- Peut-être que les morts sont toujours comme des noyés. On croit les ensevelir dans le flot quotidien des joies et des peines ordinaires, des millions d'autres choses à penser ou à faire, et la moindre tempête d'insomnie les ramène au rivage au milieu d'une vague de sueur et d'angoisse.Auteur : Thomas B. Reverdy - Source : Il était une ville
- Apétit vigoureux, tempérament de fer,
Member languit, Member se meurt ; ami si cher...
Qu'a Member ?Auteur : Maurice Etienne Legrand, dit Franc-Nohain - Source : Inattentions et sollicitudes (1894) - Et ne sauroit on dire qu'il se soit emeu jamais debat en une maison entre le mari et la femme à raison de la trame et de l'estaim.Auteur : Jacques Amyot - Source : Que la vertu se peut apprendre, 2
- Tous les développements qu'on donne à une vérité convergent, et c'est pourquoi nous sommes ramenés ici à une observation déjà faite à propos d'Horace : il y a dans cette page superbe une surface et un fond ; la surface, c'est ce que vous appelez l'idée première, c'est la louange courtisane à Auguste ; le fond, c'est la forme. Par la vertu du grand style, la surface, la flatterie au maître, immonde écorce du sublime, se brise et s'ouvre, et par la déchirure, le fond étoile de l'art, l'éternel beau, apparaît.Auteur : Victor Hugo - Source : Proses philosophiques (1901-1937), Utilité du Beau
- Les vignes sauvages, les bignonias, les coloquintes, s'entrelacent au pied de ces arbres, escaladent leurs rameaux ...Auteur : François-René de Chateaubriand - Source : Atala, ou Les Amours de deux sauvages dans le désert (1801)
- Prenez la question de l'immigration. Il serait simple que les politiques nous expliquent en quoi l'immigration serait aujourd'hui une gêne ou un péril pour la France. Avec près de mille ans d'histoire derrière nous, notre culture, notre langue, de quoi avons-nous peur ? Quand on sait que chaque expulsion est un drame... Que vingt mille personnes expulsées, ce sont vingt mille drames humains... Je suis conscient des réalités de l'État, mais je demande juste que l'on m'explique en quoi il y a danger. Auteur : Pierre Guyotat - Source : Interview pour Télérama 3138 - Propos recueillis par Nathalie Crom le 05/03/2010.
- La femme, bien plus que nous, aime la vie pour vivre ; les femmes de génie sont rares. Aussi lorsque poussés par quelque amour mystique, nous voulons entrer dans quelque voie antinaturelle, lorsque nous donnons toutes nos pensées à quelque œuvre qui nous éloigne de l'humanité qui nous touche, nous avons à lutter avec les femmes ; — et la lutte presque toujours est inégale, car c'est au nom de la vie et de la nature qu'elles essaient de nous ramener.Auteur : Pierre Curie - Source : Pierre Curie par Marie Curie
- Cela explique aussi notre fascination pour l’histoire. Nous sommes dans une chaloupe à rames. Nous avançons droit devant, mais regardons toujours vers l’arrière. Auteur : Louise Penny - Source : Enterrez vos morts (2013)
- Il ne cessait de se regarder vivre de l'extérieur. La lutte de sa vie, c'était d'enfouir ce drame. Mais comment faire ? De toute sa vie il n'avait jamais eu l'occasion de se demander : « Pourquoi est-ce que les choses sont ce qu'elles sont ? » Pourquoi se tourmenter lorsque les choses vont toujours à merveille. « Pourquoi les choses sont-elles ce qu'elles sont ? » C'est la question sans réponse, et, jusque-là, il avait eu le bonheur d'ignorer même que cette question se posait. Auteur : Philip Roth - Source : Pastorale américaine (1997)
- Quant aux armes blanches, elles avaient été puisées dans le musée d'antiquités, haches de silex, heaumes, masses d'armes, francisques, framées, guisardes, pertuisanes, verdiers, rapières, etc.Auteur : Jules Verne - Source : Le Docteur Ox (1874)
- Le neuf et l'ancien croisaient leurs trames, comme dans la reprise d'une chaussette.Auteur : Tracy Chevalier - Source : La Jeune Fille à la perle (2000)
- Les drames de la vie ne sont pas dans les circonstances, ils sont dans les sentiments, ils se jouent dans le coeur, ou, si vous voulez, dans ce monde immense que nous devons nommer le monde spirituel.Auteur : Honoré de Balzac - Source : Honorine (1844)
- Les vices partent d'une dépravation du coeur; les défauts, d'un vice de tempérament; le ridicule, d'un défaut d'esprit.Auteur : Jean de La Bruyère - Source : Les Caractères (1696), 47, VII, Des jugements
- Oui, notre devoir est d'être logique, car on ne défend pas autrement la vérité.
Sans la logique, on a des opinions, on a pas de croyances. Les opinions tiennent au tempérament du moment et au milieu. Les croyances naissent des principes certains que l'étude seule peut nous révéler. Aussi l'on peut, sans crime et de bonne foi, varier dans les opinionsAuteur : Hippolyte Prosper Olivier Lissagaray - Source : Conférences de la rue de la Paix du 25 février 1864, Alfred de Musset devant la jeunesse (1864).
- Cela devrait être plus simple, bon Dieu, la vie ! Pourquoi toujours jouer au drame, alors que, tout bien pesé, l'amour, la politique, les hommes, tout est plutôt ridicule ou rigolo ?Auteur : Jean Anouilh - Source : Les Poissons rouges ou Mon père ce héros (1970)
- Il faut à un Français un an pour comprendre la monnaie des Anglais; dix ans, leur tempérament; cinquante ans, leur manque de tempérament; l'éternité, leurs femmes.Auteur : Georges Elgozy - Source : Sans référence
- Parce qu'elle est un immense espace de liberté, où l'on peut tout dire, où l'on peut côtoyer le mal, raconter l'horreur, s'affranchir des règles de la morale et de la bienséance, la littérature est plus que jamais nécessaire. Elle ramène de la complexité et de l'ambiguïté dans un monde qui les rejette. Elle peut ausculter, sans fard et sans complaisance, ce que nos sociétés produisent de plus laid, de plus dangereux et de plus infâme. Elle demande du temps dans un monde où tout est rapide, où l'image
et l'émotion l'emportent sur l'analyse. Mais pour jouer pleinement son rôle, elle doit être à la hauteur d'elle-même et de ces idéaux.Auteur : Leïla Slimani - Source : Le diable est dans les détails
Les citations du Littré sur Rame
- L'amour de la patrie eut plus de pouvoir sur moi, et m'obligea de m'embarquer [à Zante] pour Venise sur une londre chargée de tabac, qui allait à voile et à rameAuteur : J. SPON - Source : Voy. d'Italie, 1678, dans JAL
- Cet ouvrage sera un antidote destiné à réparer en moi un tempérament affaibli....Auteur : DIDER. - Source : À mon frère.
- C'est [M. Cassandre, tragédie bourgeoise] une espèce de parade en style burlesquement tragique, où l'on emploie les tournures, les expressions, le galimatias, l'interponctuation extravagante, la pantomime puérile de tous les mauvais dramesAuteur : LA HARPE - Source : Corresp. litt. Lett. XV
- Où est le patron ? La fortune cruelle A ramené des champs le patron de la belleAuteur : Molière - Source : École des f. III, 4
- Il [Alexandre] ramena son armée par une autre route que celle qu'il avait tenueAuteur : BOSSUET - Source : Hist. III, 5
- Comme un vieux cerf dans une forêt porte son bois rameux au-dessus des têtes des jeunes faons dont il est suiviAuteur : FÉN. - Source : Tél. V
- Les choses qu'on nomme morales ne sauraient être ramenées au calculAuteur : BONNET - Source : Paling. XI, 8
- La veine qui est faite des deux [céphalique et basilique] est appellée vulgairement mediane, à raison qu'elle est faite de deux rameaux, et située entre iceuxAuteur : PARÉ - Source : IV, 21
- Les quenouilles du maïs étant destinées à servir de tuteurs ou de rames au légume grimpantAuteur : CHATEAUBR. - Source : Amér. Moissons.
- Voyant que toute apparence de peste estoit hors du chasteau de Rosny, où l'on avoit osté les meubles des lieux où il y avoit eu de la peste, et bien éventé et flambé les logements, vous y ramenastes madame vostre femmeAuteur : SULLY - Source : Mém. t. I, p. 256, dans LACURNE
- Chacune [barque, sur la Tamise] avait deux rameurs, tous vêtus comme l'étaient autrefois nos pages, avec des trousses et de petits pourpoints ornés d'une plaque d'argent sur l'épauleAuteur : Voltaire - Source : Mél. litt. à M***, 1727
- Comme les vieillards aiment à conter et même à répéter, je vous ramentevrai qu'un jour les beaux esprits du royaume....Auteur : Voltaire - Source : Mél. litt. à M. de la Harpe.
- Il aimait extrêmement la musique, et avait pris en passion celle de RameauAuteur : Jean-Jacques Rousseau - Source : Conf. V
- À ces mots, sous la ramée Je suis ma route, et j'entends La voix de ma bien-aimée Me redire : je t'attendsAuteur : MILLEV. - Source : Élég. liv. I
- Le conte de Charolois vouloit dire que de son vivant le roy ne les devoit rachapter, luy ramentevant combien il estoit tenu à sa maison durant qu'il estoit fugitif de son pereAuteur : COMM. - Source : I, 12
- Je me conservai pur de toute souillure jusqu'à l'âge où les tempéraments les plus froids et les plus tardifs se développentAuteur : Jean-Jacques Rousseau - Source : Conf. I
- ....les Anglais pensent profondément ; Leur esprit, en cela, suit leur tempéramentAuteur : Jean de La Fontaine - Source : Fabl. XII, 23
- Tout ce qu'ils [les auteurs des Sacramentaires] composaient était fait sur le modèle de ce qu'avaient fait leurs prédécesseurs ; le style même ressent l'antiquité, et les choses la ressentent encore plusAuteur : BOSSUET - Source : Explic. de la messe, 19
- Telles manieres de gens avoient esté appellez, de nostre jeunesse, lutheriens à cause de Martin Luther, depuis calvinistes, et d'un mot general sacramentairesAuteur : PASQUIER - Source : Recherches, liv. VIII, p. 738, dans LACURNE
- Nous demeurâmes un peu derrièreAuteur : FÉN. - Source : Tél. I
- Le peroxyde ramené à un degré inférieur d'oxydationAuteur : THENARD - Source : Instit Mém. scienc. t. III, p. 471
- À tant s'en retorna moult tos, à son manoir vint les galos ; Un prier ot grant, fu ramés, Qui de son avie [lisez aive, aïeul] fu remés ; D'une quignie le coperent, Et puis arriere s'en tornerentAuteur : PH. MOUSKES - Source : Chronique, V. 17019
- Pourtant teste comme est d'ung cerf, avecques cornes insignes largement raméesAuteur : François Rabelais - Source : Pant. IV, 2
- Ne doit-on pas craindre que cette fureur de ramener nos connaissances à des signes physiques ne conduise la jeunesse au matérialisme ?Auteur : Chateaubriand - Source : Génie, III, II, 2
- N'ayant pas voulu rompre le fil des affaires d'Angleterre, je me ramène à ce qui se passait dans le continentAuteur : Voltaire - Source : Louis XIV, 16
Les mots débutant par Ram Les mots débutant par Ra
Une suggestion ou précision pour la définition de Rame ? -
Mise à jour le samedi 7 février 2026 à 14h24

- Racine - Racisme - Raillerie - Raison - Raisonnement - Rancune - Realisme - Realite - Rebelle - Reception - Recevoir - Recherche - Recolter - Recompense - Reconnaissance - Reconnaître - Record - Reddition - Reflechir - Regard - Regime - Regle - Regret - Reincarnation - Reine - Religion - Remède - Remords - Rencontre - Rengaine - Renoncement - Repartie - Repas - Repentir - Repos - Reproduction - Reputation - Resilience - Respect - Respecter - Responsabilite - Restaurant - Retraite - Retrospective - Réussite - Reussite - Reve - Rêve - Reveil - Revolte - Revolution - Riche - Richesse - Ridicule - Rire - Roman - Romantique - Rumination - Rupture - Rythme
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur rame
Poèmes rame
Proverbes rame
La définition du mot Rame est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Rame sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Rame présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
