La définition de Voilà du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Voilà
Nature : loc. prépos.
Prononciation : voi-là ; vela dit par quelques-uns au XV
Etymologie : Vois, impératif de voir, et là ; Berry, velà ; picard, v'lo ; bourguign. velai.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de voilà de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec voilà pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Voilà ?
La définition de Voilà
Il sert à désigner, à indiquer une personne ou un objet un peu éloigné de la personne à qui l'on parle, par opposition à voici.
Toutes les définitions de « voilà »
Trésor de la Langue Française informatisé
VOILÀ, verbe et prép.
Voilà au Scrabble
Le mot voilà vaut 8 points au Scrabble.
Informations sur le mot voila - 5 lettres, 3 voyelles, 2 consonnes, 5 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot voilà au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
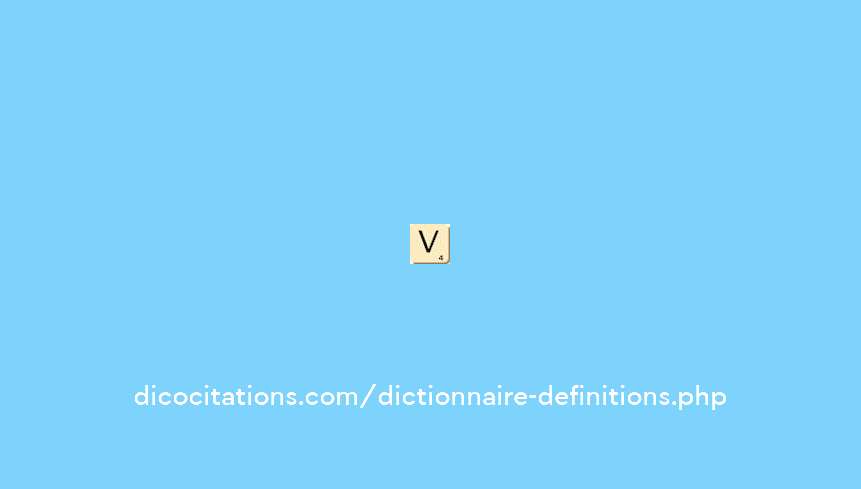
Les mots proches de Voilà
Voi Voici Void Voie Voilà Voile Voile Voilé, ée Voilé, ée Voilé, ée Voiler Voiler Voilier Voilure Voir Voire Voirement Voirie Voirine Voir-venir Voisin, ine Voisinage Voisinance Voisiner Voiturage Voiture Voiturée Voiturer Voiturier Voiturin Voix voici Void-Vacon Voide voie voie voient voies voies Voigny voilà voila voilage voilages voilaient voilais voilait voilant voile voile voilé voilé voilée voilée voilées voilées Voilemont voilent voiler voilera voilèrent voileront voiles voiles voilés voilés voilette voilettes voilez voilier voiliers Voillans Voillecomte voilons voilure voilures Voimhaut Voinémont Voingt Voinsles VoipreuxMots du jour
Canette Chevaucheur Diffamer Vesse Couplé, ée Adhérence Ris Rapprocher Paraplégie Gagne-denier
Les citations avec le mot Voilà
- C'est une blague, voilà ce que je me dis tous les matins depuis vingt ans, en me regardant dans la glace, sous l'éclairage pourtant flatteur de ma salle de bains. Heureusement que passé un certain âge, Dieu nous envoie la presbytie. Et puis quand la presbytie ne suffit plus, l'Alzheimer prend le relais, ce qui fait que l'un dans l'autre, nous ne serons jamais tout à fait conscients de l'étendue des dégâts. Mais même avec cette faible conscience, même avec cette acuité visuelle amoindrie et cette tête qui n'y est plus vraiment, je n'en reviens toujours pas et je m'y fais encore moins.Auteur : Emmanuelle Bayamack-Tam - Source : Je viens
- Les yeux des hommes écoutent ; il y en a même qui parlent, tous surtout sollicitent, tous guettent et épient, mais aucun ne regarde. L'homme moderne ne croit plus, et voilà pourquoi il n'a plus de regard.Auteur : Jean Lorrain - Source : Monsieur de Phocas (1901)
- Un bol de riz avec de l'eau et le coude pour oreiller, voilà un état qui a sa satisfaction.Auteur : Confucius - Source : Sentences
- Capitaine de la Houlette : Un trèfle à quatre feuilles ! Vous avez les pieds dans le bonheur, mon ami. Votre nom ?
Fanfan : Fanfan la Tulipe.
Capitaine de la Houlette : La Tulipe ?
Fanfan : Oui.
Capitaine de la Houlette : Que voilà donc un joli sobriquet ! Nous avions déjà Brin-d'amour, Pied-d'alouette, Bouton-d'or, Lilas-blanc. Ça n'est pas un régiment, c'est une plate-bande !Auteur : Henri Jeanson - Source : Fanfan la Tulipe - L'égalité de tous devant le néant, voilà ce qu'est la mort.Auteur : Hitonari Tsuji - Source : Le Bouddha blanc (1997)
- Ainsi la guerre était déclarée. Deux chefs se sont jeté le gant. Voilà que s'affrontent deux puissances ...Auteur : Maurice Barrès - Source : La Colline inspirée (1913)
- Le coeur de la plupart des hommes est sans doute fait comme un crible; voilà pourquoi tout passe à travers.Auteur : Hypolite de Livry - Source : Pensées, réflexions, impatiences, maximes, sentences (1808)
- Si tu es prêt à quitter père et mère, frère et soeur, femmes et enfants et amis pour ne plus jamais les revoir
Si tu as payé tes dettes, fait ton testament, mis tes affaires en ordre, et si tu es un homme libre, alors te voilà prêt à marcher.Auteur : Henry David Thoreau - Source : De la marche (1862) - Un peuple qui ne vise qu'à se divertir, voilà le blanc-seing des gouvernants.Auteur : Bernard Willems-Diriken, dit Romain Guilleaumes - Source : Le Bûcher des Illusions, Impertinences (2004)
- Un homme entendu à tout, voilà Perrault. De nos jours, il eût construit tour à tour un chemin de fer et un vaudeville. Il aurait donné ses idées pour le palais de cristal de Londres, et aurait perfectionné le daguerréotype.Auteur : Charles-Augustin Sainte-Beuve - Source : Causeries du lundi (1851-1881), 29 décembre 1851
- J'ai la sensation que ma vie est achevée, c'est-à-dire que je ne vois rien à présent qui demande un lendemain. Ce qui me reste à vivre ne peut plus désormais être que du temps à perdre. Après tout j'ai fait ce que j'ai pu. Je connais 1. assez mon esprit. Je crois que ce que j'ai trouvé d'important — je suis sûr de cette valeur — ne sera pas facile à déchiffrer de mes notes. — Peu importe. Je connais my heart aussi. Il triomphe. Plus fort que tout, que mon esprit, que l'organisme. — Voilà le fait. Le plus obscur des faits. Plus fort que le vouloir vivre et que le pouvoir comprendre est donc ce sacré coeur. — « Coeur », c'est mal nommé. Je voudrais au moins, trouver le vrai nom de ce terrible résonateur. Il y a quelque chose en l'être qui est créateur de valeurs, et cela est tout-puissant, irrationnel, inexplicable, ne s'expliquant pas. Source d'énergie séparée mais qui peut se décharger aussi bien pour que contre la vie de l'individu.Auteur : Paul Valéry - Source : Cahiers, 10 mai 1945
- Le corps d'un athlète et l'âme d'un sage, voilà ce qu'il faut pour être heureux ...Auteur : Voltaire - Source : Lettre à Hélvétius, 27 octobre 1740.
- Etre un grand homme et un saint pour soi-même, voilà l'unique chose importante.Auteur : Charles Baudelaire - Source : Journaux intimes (1887), Mon coeur mis à nu
- Ni aimer ni haïr comprend la moitié de toute sagesse ; ne rien dire et ne rien croire, voilà l'autre moitié. Il est vrai qu'on tournera volontiers le dos à un monde qui rend nécessaires des règles comme celles-là et comme les suivantes.Auteur : Arthur Schopenhauer - Source : Parerga et Paralipomena (1851)
- L'amour n'a pas plus de force sur mon coeur. La retraite et le célibat, voilà toute mon ambition.Auteur : Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux - Source : Le Paysan parvenu (1736)
- Non l'économie, la tempérance, le travail, voilà mes trois cartes gagnantes ! C'est avec elles que je doublerai, que je décuplerai mon capital. Ce sont elles qui m'assureront l'indépendance et le bien-être.Auteur : Alexandre Pouchkine - Source : La Dame de pique (1834)
- Il y a l'amour, Bardamu !
– Arthur, l'amour c'est l'infini mis à la portée des caniches et j'ai ma dignité moi ! que je lui réponds.
– Parlons-en de toi! T'es un anarchiste et puis voilà tout !Auteur : Louis-Ferdinand Destouches, dit Céline - Source : Voyage au bout de la nuit (1932) - Le milieu scolaire demeure l'endroit privilégié où l'enfant construit sa personnalité propre et son identité sociale. C'est le plus souvent à l'école que l'enfant se cherche en faisant l'expérience de ses relations avec les autres : est-il le dernier à être choisi au sein de l'équipe de ballon-chasseur ? a-t-il du succès lors de l'élection du représentant de classe ? est-ce que les autres rient quand il leur fait une grimace ? se moque-t-on de lui à la récréation ? Voilà autant de questions essentielles dont les réponses enseigneront peu à peu à l'enfant qui il est. Est-il populaire, aimable, admiré ? Modérément marginal, différent ou handicapé ? Un peu trop gros, un peu trop laid, boutonneux ou niaiseux ? Rien de tout cela n'est simple ni facile pour personne. L'écolier affronte l'apprentissage de la vie en société. Cela aussi, on le sait très bien. Auteur : Bernard Arcand - Source : Du pipi, du gaspillage et sept autres lieux communs (2001)
- il n’y a ni bonheur ni malheur en ce monde, il y a la comparaison d’un état à un autre, voilà tout. Celui-là seul qui a éprouvé l’extrême infortune est apte à ressentir l’extrême félicité. Auteur : Alexandre Dumas - Source : Le comte de Monte-Cristo (1845-1846)
- Et voilà ce que François redoutait fort: c'est cette chaude fièvre du paysan qui ne veut pas se départir de sa glèbe.Auteur : George Sand - Source : François le Champi (1847-1848)
- Être ou jouer le jeu voilà la question de la vie entièreAuteur : Michel Bouthot - Source : Chemins parsemés d'immortelles pensées (1999)
- Oui, voilà l'amour vrai; il ne peut rien dire. Sa sincérité se distingue par les actes bien mieux que par les paroles.Auteur : William Shakespeare - Source : Les deux gentilhommes de Vérone
- Je ne vous dis plus rien; la vertu, quand on l'aime,
Porte de nos bienfaits le salaire elle-même.
Mon admiration, mon respect, mon amour,
Voilà ce que je puis vous offrir en ce jour.Auteur : Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux - Source : Annibal (1720), V, 4 - Franchement qui pouvait prétendre que la météorologie était une science ? Les rares fois où les prévisions concordaient avec la réalité, ce n’était que pure coïncidence. Voilà pourquoi, dans les journaux, la rubrique se trouvait placée à côté des prédictions fantaisistes des astrologues. Auteur : Alexis Aubenque - Source : Des larmes sur River Falls (2018)
- Le voilà fou d'amour extrême,
De fou qu'il était d'amitié.Auteur : Jean de La Fontaine - Source : Fables (1668 à 1694), Livre deuxième, XVIII, la Chatte métamorphosée en femme
Les citations du Littré sur Voilà
- Tout ce que j'ai prédit est arrivé ; au premier coup de fusil qui fut tiré, je dis : En voilà pour sept ans.... c'est parce que je ne suis plus dans mon pays que je suis prophèteAuteur : Voltaire - Source : Lett. d'Argental, 28 sept. 1761
- C'est le coup, scélérat, par où tu m'expédies ; Et voilà couronner toutes tes perfidiesAuteur : Molière - Source : Tart. V, 7
- À présent me voilà seul, à présent je me retrouve, et toutes mes blessures vont se rouvrirAuteur : STAËL - Source : Corinne, IX, 3
- Me voilà, comme une marmotte, terré pour sept moisAuteur : Jean-Jacques Rousseau - Source : Lett. à Mme de Luze, 27 oct. 1764
- Il y choisit une aiguille d'or, s'empare de la soie, et voilà mon colonel qui fait de la tapisserieAuteur : POINSINET - Source : Cercle, sc. 2
- ....Voilà mon loup par terre, Mal en point, sanglant et gâtéAuteur : Jean de La Fontaine - Source : Fabl. XII, 17
- Me voilà sans brillants ni perles.... au milieu de cette foule enrubannée et même endiamantéeAuteur : DECOURCHAMP - Source : Souv. de la marquise de Créquy, III, III
- S'expliquer avec un détail aussi superflu, c'est être lourd et pesant ; voilà le contraire de la finesseAuteur : GENLIS - Source : Veillées du château t. I, p. 262, dans POUGENS
- Voilà ce qui attire l'approbation et fait faire le brouhahaAuteur : Molière - Source : Impr. 1
- Mon fils a été spectateur des deux armées rangées si longtemps en bataille ; voilà la seconde fois qu'il n'y manque rien que la petite circonstance de se battre ; mais comme deux procédés [préliminaires de duel] valent un combat, deux fois à la portée du mousquet valent une batailleAuteur : Madame de Sévigné - Source : 280
- Eh bien, ne voilà pas mon enragé de maîtreAuteur : Molière - Source : ib. V, 7
- Me voilà tout à coup jeté parmi le beau mondeAuteur : Jean-Jacques Rousseau - Source : Conf. V
- Ah ! voilà notre imbécile avec ses vieux proverbes ! hé bien ! pédant, que dit la sagesse des nations ?...Auteur : BEAUMARCH. - Source : Mar. de Fig. I, 11
- C'est qu'il sent le bâton du côté que voilàAuteur : Molière - Source : le Dép. V, 4
- Ce ne sont pas toujours les pardons [cérémonies d'église] qui font aller les femmes : c'est l'envie de trotter ; voilà pourquoi on dit plaisamment que saint Trottet, saint Caquet et saint Babil sont les plus grands patrons de ce sexe dévotAuteur : GUI PATIN - Source : Lett. t. I, p. 384, dans POUGENS
- Voilà la huguenotaille à gronder, chacun à part, sans pouvoir dire nousAuteur : D'AUB. - Source : Conf. II, 111
- Voilà les excès où l'on tombe quand on veut concilier ce qui est inconciliable, et expliquer ce qui est inexplicableAuteur : Voltaire - Source : Dict. phil. Populat.
- Vous voilà bien malade d'avoir un méchant rôle à jouer !Auteur : Molière - Source : Impromptu, 1
- La voilà telle que la mort nous l'a faite ; encore ce reste tel quel va-t-il disparaître ; nous l'allons voir dépouillée même de cette triste décorationAuteur : BOSSUET - Source : Duch. d'Orl.
- J'admire de le voir au point où le voilàAuteur : Molière - Source : Éc. des f. I, 6
- .... J'ai ri, me voilà désarméAuteur : PIRON - Source : Métrom. III, 9
- Au premier plus effronté qui dict son chois, voilà un consentement de voix encores plus grand à refuser celuy-làAuteur : MONT. - Source : IV, 83
- Un arbre la voilait presque de ses frondes qui touchaient la terreAuteur : Mme DE GASPARIN - Source : Vesper, 2e éd. Paris, 1862
- Voilà ce qui doit fonder votre tranquillitéAuteur : Madame de Sévigné - Source : 422
- Eh bien ! qu'est-ce que cela, soixante ans ? voilà bien de quoiAuteur : Molière - Source : l'Avare, II, 6
Les mots débutant par Voi Les mots débutant par Vo
Une suggestion ou précision pour la définition de Voilà ? -
Mise à jour le jeudi 12 février 2026 à 21h25
- Vacance - Vache - Vacuite - Vaincre - Valeur - Vanite - Vanité - Vengeance - Verbe - Verge - Vérité - Verite - Vertu - Vetement - Vice - Victoire - Vie - Vieillard - Vieillesse - Vierge - Vieux - Vie_heureuse - Ville - Vin - Violence - Visage - Visite - Vitesse - Vivre - Vivre - Voeux - Voisinage - Voiture - Voleur - Volonte - Volonté - Volupté - Vote - Voyage - Voyager
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur voilà
Poèmes voilà
Proverbes voilà
La définition du mot Voilà est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Voilà sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Voilà présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
