Définition de « fard »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot fard de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur fard pour aider à enrichir la compréhension du mot Fard et répondre à la question quelle est la définition de fard ?
Une définition simple : (fr-rég|fa?) fard (m)
Définitions de « fard »
Trésor de la Langue Française informatisé
FARD, subst. masc.
Wiktionnaire
Nom commun 2 - français
fard \fa?\ masculin
- (Marine) Fard de l'avant : Ensemble du mât de misaine et du mât de beaupré.
- (Marine) Fard de l'arrière : Ensemble du mât d'artimon et du grand mât.
Nom commun 1 - français
fard \fa?\ masculin
-
(Cosmétologie) Enduit qu'on applique sur la peau ou une partie du visage pour la colorer ou pour la protéger.
- Une petite boîte de bois rose, qui venait de l'île Dioscoride, contenait des fards de toutes les couleurs. ? (Pierre Louÿs, Aphrodite, Mercure de France, Paris, 1896)
- Elle achetait les onguents, des pots de fard, des crayons, qui traînaient sur tous les meubles, avec des houppettes de poudre de riz et des flacons d'odeur. Ses journées, elle les passait, devant sa glace, à se maquiller, à se contempler [?] ? (Octave Mirbeau, Lettres de ma chaumière : La Tête coupée, A. Laurent, 1886)
- L'emploi des fards que l'on applique sur la figure pour en modifier l'aspect doit être fait avec la plus extrême prudence [?] il serait délicat d'insister sur l'apparence regrettable qu'ont pris certains visages féminins qui ont été trop longtemps exposés aux attaques des fards ; ceux-ci ont pu à un certain moment donner un éclat particulier au visage, mais ils l'ont souvent irrémédiablement flétri. ? (Marcel Hégelbacher, La Parfumerie et la savonnerie, 1924, page 126)
- Je vis que sa beauté, comme son caractère, était absolument sans fard. Ni rouge aux lèvres, ni fer aux cheveux ; rien aux cils ni aux paupières. ? (Pierre Louÿs, Trois filles de leur mère, René Bonnel, Paris, 1926, chapitre IV)
- Ses airs penchés, sa ravissante et luxueuse pochette de soie, son bracelet-montre en or, le fard étalé sur ses joues le tenaient quitte de manifester son opinion. ? (Francis Carco, L'Homme de minuit, Éditions Albin Michel, Paris, 1938)
-
(Figuré) Déguisement, feinte, dissimulation.
- Privé de tout accommodement, de ses fards, de ses sourires et de ses ruses, le vice a peu de chance de séduire la vertu la plus chancelante. ? (Francis Carco, Images cachées, Éditions Albin Michel, Paris, 1928 ; Préface de la 3e édition de 1929)
- Livres, discours, manifestes, la remise en cause de cet esprit qui a irrigué le XVIIIe siècle autour des figures totémiques de Voltaire, de Rousseau, de Kant et de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, ce mouvement fondateur de la modernité politique européenne et matrice intellectuelle de la Révolution française, s'affiche aujourd'hui sans fard. ? (Ariane Chemin, Vincent Martigny, Mais qui veut éteindre les Lumières ?, Le Monde. Mis en ligne le 15 novembre 2018)
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Enduit qu'on applique sur la peau pour la colorer ou pour la protéger. Elle met du fard pour donner plus d'éclat à son teint. L'acteur met du fard avant d'entrer en scène. Sa table de toilette était couverte de fards. Il signifie encore, figurément, Déguisement, feinte, dissimulation. Un aveu sans fard. C'est un homme sans fard. Parlez-moi sans fard.
Littré
-
1Composition destinée à embellir le teint, en remédiant aux défauts qu'il a.
C'est pour eux [les étrangers] qu'elle étale et l'or et le brocard, Que chez toi se prodigue et le rouge et le fard
, Boileau, Sat. X.Une courtisane qui tire toutes ses grâces du fard, qui n'a qu'une beauté empruntée, et qui sait tout au plus charmer les oreilles par le son d'une voix douce et mélodieuse
, Rollin, Hist. anc. t. XI, 2e part. p. 773, dans POUGENS.L'air la noircit [la céruse] en assez peu de temps, et les vapeurs du charbon ou les mauvaises odeurs des égouts, des latrines, etc. changent presque subitement le beau blanc de perle en gris obscur, en sorte qu'il est souvent arrivé aux femmes qui se servent de ce fard de devenir tout à coup aussi noires qu'elles voulaient paraître blanches
, Buffon, Min. t. V, p. 387, dans POUGENS. -
2 Fig. Déguisement, feinte, dissimulation dans les discours.
Leurs paroles n'ont point de fard
, Malherbe, VI, 10.Les bons esprits? Qui savent, avisés, avecque différence, Séparer le vrai bien du fard de l'apparence
, Régnier, Sat. v.Toutes les couleurs et le fard de la poésie ne l'ont su peindre [Angélique, de l'Arioste] aussi belle que nous vous voyons
, Voiture, Lett. 4.Je vois trop que vos c?urs n'ont point pour moi de fard
, Corneille, Cinna, Il, 1.Je te parle sans fard, et veux être chrétien
, Corneille, Poly. v, 2.De ses pleurs tant vantés je découvre le fard
, Corneille, Rodog. II, 4.Seigneur, moi qui connais le fond de son courage Et qui n'ai jamais vu de fard en son langage
, Corneille, Clit. v, 3.Et n'y doit point chercher ni le fard du langage Ni la subtilité
, Corneille, Imit. I, 5.La sévérité des femmes est un ajustement et un fard qu'elles ajoutent à leur beauté
, La Rochefoucauld, Réfl. 204.Sans envie, sans fard, sans ostentation, toujours grand dans l'action et dans le repos, il parut à Chantilly comme à la tête des troupes
, Bossuet, Louis de Bourbon.Tout ne fut plus que fard, qu'erreur, que tromperie
, Boileau, Épît. IX.Terme de littérature. Faux ornements.
Soyez simple avec art, Sublime sans orgueil, agréable sans fard
, Boileau, Art p. I.
HISTORIQUE
XIIIe s. Renart, qui set assez de fart, Li avoit dit?
, Ren. 14938.
XVIe s. Fard est perdu dessus mine de singe
, Marot, J. p. 20, dans LACURNE. Et d'eau de fard son visage ne lave
, Marot, IV, 148. Les regrets de quelque femmelette, qui regrette la perte des bouettes où estoient ses fards
, Amyot, Timol. 22. Si on y adjouste demie dragme de sublimé, lavé et preparé comme celui des fars, il sera de grande efficace
, Paré, XVI, 36.
Encyclopédie, 1re édition
FARD, s. m. (Art cosmétique.) fucus, pigmentum ; se dit de toute composition soit de blanc, soit de rouge, dont les femmes, & quelques hommes mêmes, se servent pour embellir leur teint, imiter les couleurs de la jeunesse, ou les réparer par artifice.
Le nom de fard, fucus, étoit encore plus étendu autrefois qu'il ne l'est aujourd'hui, & faisoit un art particulier qu'on appella Commotique, ?????????, c'est-à-dire l'art de farder, qui comprenoit non-seulement toutes les especes de fard, mais encore tous les médicamens qui servoient à ôter, à cacher, à rectifier les difformités corporelles ; & c'est cette derniere partie de l'ancienne Commotique que nous nommons Orthopédie. Voyez Orthopédie.
L'amour de la beauté a fait imaginer de tems immémorial tous les moyens qu'on a crû propres à en augmenter l'éclat, à en perpétuer la durée, ou à en rétablir les breches ; & les femmes, chez qui le goût de plaire est très-étendu, ont cru trouver ces moyens dans les fardemens, si je puis me servir de ce vieux terme collectif, plus énergique que celui de fard.
L'auteur du livre d'Enoc assûre qu'avant le déluge, l'ange Azaliel apprit aux filles l'art de se farder, d'où l'on peut du moins inférer l'antiquité de cette pratique.
L'antimoine est le plus ancien fard dont il soit fait mention dans l'histoire, & en même tems celui qui a eu le plus de faveur. Job, chap. xl. v. 14. marque assez le cas qu'on en faisoit, lorsqu'il donne à une de ses filles le nom de vase d'antimoine, ou de boîte à mettre du fard, cornu stibii.
Comme dans l'Orient les yeux noirs, grands & fendus passoient, ainsi qu'en France aujourd'hui, pour les plus beaux, les femmes qui avoient envie de plaire, se frotoient le tour de l'?il avec une aiguille trempée dans du fard d'antimoine pour étendre la paupiere, ou plûtôt pour la replier, afin que l'?il en parût plus grand. Aussi Isaïe, ch. iij. v. 22. dans le dénombrement qu'il fait des parures des filles de Sion, n'oublie pas les aiguilles dont elles se servoient pour peindre leurs yeux & leurs paupieres. La mode en étoit si reçue, que nous lisons dans un des livres des rois, liv. IV. ch. jx. v. 30. que Jésabel ayant appris l'arrivée de Jehu à Samarie, se mit les yeux dans l'antimoine, ou les plongea dans le fard, comme s'exprime l'Ecriture, pour parler à cet usurpateur, & pour se montrer à lui. Jéremie, chap. jv. v. 50. ne cessoit de crier aux filles de Judée : En vain vous vous revêtirez de pourpre & vous mettrez vos colliers d'or ; en vain vous vous peindrez les yeux avec l'antimoine, vos amans vous mépriseront. Les filles de Judée ne crurent point le prophete, elles penserent toujours qu'il se trompoit dans ses oracles ; en un mot, rien ne fut capable de les dégoûter de leur fard : c'est pour cela qu'Ezéchiel, chap. xxiij. v. 40. dévoilant les déréglemens de la nation juive, sous l'idée d'une femme débauchée, dit, qu'elle s'est baignée, qu'elle s'est parfumée, qu'elle a peint ses yeux d'antimoine. qu'elle s'est assise sur un très-beau lit & devant une table bien couverte, &c.
Cet usage du fard tiré de l'antimoine ne finit pas dans les filles de Sion ; il se glissa, s'étendit, se perpétua par-tout. Nous trouvons que Tertullien & S. Cyprien déclamerent à leur tour très-vivement contre cette coûtume usitée de leur tems en Afrique, de se peindre les yeux & les sourcils avec du fard d'antimoine : inunge oculos tuos, non stibio diaboli, sea collyrio Christi, s'écrioit S. Cyprien.
Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'aujourd'hui les femmes Syriennes, Babyloniennes, & Arabes, se noircissent du même fard le tour de l'?il, & que les hommes en font autant dans les deserts de l'Arabie, pour se conserver les yeux contre l'ardeur du soleil. Voyez Tavernier, voyage de Perse, liv. II. ch. vij. & Gabriel Sionita, de moribus orient. cap. xj. M. d'Arvieux, dans ses voyages imprimés à Paris en 1717, livre XII. pag. 27, remarque, en parlant des femmes Arabes, qu'elles bordent leurs yeux d'une couleur noire composée avec de la tuthie, & qu'elles tirent une ligne de ce noir en-dehors du coin de l'?il, pour le faire paroître plus fendu.
Depuis les voyages de M. d'Arvieux, le savant M. Shaw rapporte dans ceux qu'il a faits en Barbarie, à l'occasion des femmes de ces contrées, qu'elles croiroient qu'il manqueroit quelque chose d'essentiel à leur parure, si elles n'avoient pas teint le poil de leurs paupieres & leurs yeux de ce qu'on nomme al-co-hol, qui est la poudre de mine de plomb. Cette opération se fait en trempant dans cette poudre un petit poinçon de bois de la grosseur d'une plume, & en le passant ensuite entre les paupieres : elles se persuadent que la couleur sombre, que l'on parvient de cette façon à donner aux yeux, est un grand agrément au visage de toutes sortes de personnes.
Entr'autres colifichets des femmes d'Egypte, ajoûte le voyageur anglois, j'ai vû tirer des catacombes de Sakara, un bout de roseau ordinaire renfermant un poinçon de la même espece de ceux des Barbaresques, & une once de la même poudre dont on se sert encore actuellement (1740) dans ce pays-là, pour le même usage.
Les femmes greques & romaines emprunterent des Asiatiques, la coûtume de se peindre les yeux avec de l'antimoine ; mais pour étendre encore plus loin l'empire de la beauté, & réparer les couleurs flétries, elles imaginerent deux nouveaux fards inconnus auparavant dans le monde, & qui ont passé jusqu'à nous : je veux dire le blanc & le rouge. Delà vient que les Poëtes feignirent que la blancheur d'Europe ne lui venoit que parce qu'une des filles de Junon avoit dérobé le petit pot de fard blanc de cette déesse, & en avoit fait présent à la fille d'Agenor. Quand les richesses affluerent dans Rome, elles y porterent un luxe affreux ; la galanterie introduisit les recherches les plus rafinées dans ce genre, & la corruption générale y mit le sceau.
Ce que Juvénal nous dit des bapses d'Athènes, de ces prêtres efféminés qu'il admet aux mysteres de la toilette, se doit entendre des dames romaines, sur l'exemple desquelles, ceux dont le poëte veut parler, mettoient du blanc & du rouge, attachoient leurs longs cheveux d'un cordon d'or, & se noircissoient le sourcil, en le tournant en demi-rond avec une aiguille de tête.
Ille supercilium madidâ fuligine factum,
Obliquâ producit acu, pingitque trementes,
Attollens oculos. Juvén. Sat. 2.
Nos dames, dit Pline le naturaliste, se fardent par air jusqu'aux yeux, tanta est decoris affectatio, ut tingantur oculi quoque ; mais ce n'étoit-là qu'un leger crayon de leur mollesse.
Elles passoient de leurs lits dans des bains magnifiques, & là elles se servoient de pierres-ponces pour se polir & s'adoucir la peau, & elles avoient vingt sortes d'esclaves en titre pour cet usage. A cette propreté luxurieuse, succéda l'onction & les parfums d'Assyrie : enfin le visage ne reçut pas moins de façons & d'ornemens que le reste du corps.
Nous avons dans Ovide des recettes détaillées de fards, qu'il conseilloit de son tems aux dames romaines, je dis aux dames romaines, car le fard du blanc & du rouge étoit reservé aux femmes de qualité sous le regne d'Auguste ; les courtisanes & les affranchies n'osoient point encore en mettre. Prenez donc de l'orge, leur disoit-il, qu'envoyent ici les laboureurs de Libye ; ôtez-en la paille & la robe ; prenez une pareille quantité d'ers ou d'orobe, détrempés l'un & l'autre dans des ?ufs, avec proportion ; faites sécher & broyer le tout ; jettez-y de la poudre de corne de cerf ; ajoûtez-y quelques oignons de narcisse ; pilez le tout dans le mortier ; vous y admettrez enfin la gomme & la farine de froment de Toscane ; que le tout soit lié par une quantité de miel convenable : celle qui se servira de ce fard, ajoûte-il, aura le teint plus net que la glace de son miroir.
Quæcumque afficiet tali medicamine vultum,
Fulgebit speculo lævior ipsa suo.
Mais on inventa bien-tôt une recette plus simple que celle d'Ovide, & qui eut la plus grande vogue : c'étoit un fard composé de la terre de Chio, ou de Samos, que l'on faisoit dissoudre dans du vinaigre. Horace l'appelle humida creta. Pline nous apprend que les dames s'en servoient pour se blanchir la peau, de même que de la terre de Selinuse, qui est, dit-il, d'un blanc de lait, & qui se dissout promptement dans l'eau. Fabula, selon Martial, craignoit la pluie, à cause de la craie qui étoit sur son visage ; c'étoit une des terres dont nous venons de parler. Et Pétrone, en peignant un efféminé, s'exprime ainsi : Perfluebant per frontem sudantis acaciæ rivi, & inter rugas malarum, tantùm erat cretæ, ut putares detractum parietem nimbo laborare : « Des ruisseaux de gomme couloient sur son front avec la sueur, & la craie étoit si épaisse dans les rides de ses joues, qu'on auroit dit que c'étoit un mur que la pluie avoit déblanchi ».
Poppée, cette célebre courtisane, doüée de tous les avantages de son sexe, hors de la chasteté, usoit pour son visage d'une espece de fard onctueux, qui formoit une croûte durable, & qui ne tomboit qu'après avoir été lavée avec une grande quantité de lait, lequel en détachoit les parties, & découvroit une extrème blancheur : Poppée, dis-je, mit ce nouveau fard à la mode, lui donna son nom, Poppæana pingicia, & s'en servit dans son exil même, où elle fit mener avec elle un troupeau d'ânesses, & se seroit montrée avec ce cortége, dit Juvénal, jusqu'au pole hyperborée.
Cette pâte de l'invention de Poppée qui couvroit tout le visage, formoit un masque, avec lequel les femmes alloient dans l'intérieur de leur maison : c'étoit-là, pour ainsi dire, le visage domestique, & le seul qui étoit connu du mari. Ses levres, si nous écoutons Juvénal, s'y prenoient à la glu :
Hinc miseri viscantur labra mariti.
Ce teint tout neuf, cette fleur de peau, n'étoit faite que pour les amans ; & sur ce pié-là, ajoûte l'abbé Nadal, la nature ne donnoit rien ni aux uns ni aux autres.
Les dames romaines se servoient pour le rouge, au rapport de Pline, d'une espece de fucus qui étoit une racine de Syrie avec laquelle on teignoit les laines. Mais Théophraste est ici plus exact que le naturaliste romain : les Grecs, selon lui, appelloient fucus, tout ce qui pouvoit peindre la chair ; tandis que la substance particuliere dont les femmes se servoient pour peindre leurs joues de rouge, étoit distinguée par le nom de rizion, racine qu'on apportoit de Syrie en Grece à ce sujet. Les Latins, à l'imitation du terme grec, appellerent cette plante radicula ; & Pline l'a confondue avec la racine dont on teignoit les laines.
Il est si vrai que le mot fucus étoit un terme général pour désigner le fard, que les Grecs & les Romains avoient un fucus métallique qu'ils employoient pour le blanc, & qui n'étoit autre chose que la céruse ou le blanc de plomb de nos revendeuses à la toilette. Leur fucus rouge se tiroit de la racine rizion, & étoit uniquement destiné pour rougir les joues : ils se servirent aussi dans la suite pour leur blanc, d'un fucus composé d'une espece de craie argentine ; & pour le rouge du purpurissum, préparation qu'ils faisoient de l'écume de la pourpre, lorsqu'elle étoit encore toute chaude. Voyez Pourpre, (Coquille).
C'en est assez sur les dames greques & romaines. Poursuivons à-présent l'histoire du fard jusqu'à nos jours, & prouvons que la plûpart des peuples de l'Asie & de l'Afrique sont encore dans l'usage de se colorier diverses parties du corps de noir, de blanc, de rouge, de bleu, de jaune, de verd, en un mot de toutes sortes de couleurs, suivant les idées qu'ils se sont formées de la beauté. L'amour-propre & la vanité ont également leur recherche dans tous les pays du monde ; l'exemple, les tems, & les lieux, n'y mettent que le plus ou le moins d'entente, de goût, & de perfection.
En commençant par le Nord, nous apprenons qu'avant que les Moscovites eussent été policés par le czar Pierre premier, les femmes Russes savoient déjà se mettre du rouge, s'arracher les sourcils, se les peindre ou s'en former d'artificiels. Nous voyons aussi que les Groenlandoises se bariolent le visage de blanc & de jaune ; & que les Zembliennes, pour se donner des graces, se font des raies bleues au front & au menton. Les Mingreliennes, sur le retour, se peignent tout le visage, les sourcils, le front, le nez, & les joues. Les Japonoises de Jédo se colorent de bleu les sourcils & les levres. Les Insulaires de Sombréo au nord de Nicobar, se plâtrent le visage de verd & de jaune. Quelques femmes du royaume de Décan se font découper la chair en fleurs, & teignent les fleurs de diverses couleurs, avec des jus de racines de leur pays.
Les Arabes, outre ce que j'en ai dit ci-dessus, sont dans l'usage de s'appliquer une couleur bleue aux bras, aux levres, & aux parties les plus apparentes du corps ; ils mettent hommes & femmes cette couleur par petits points, & la font pénétrer dans la chair avec une aiguille faite exprès : la marque en est inaltérable.
Les Turquesses africaines s'injectent de la tuthie préparée dans les yeux, pour les rendre plus noirs, & se teignent les cheveux, les mains, & les piés en couleur jaune & rouge. Les femmes maures suivent la mode des Turquesses ; mais elles ne teignent que les sourcils & les paupieres avec de la poudre de mine de plomb. Les filles qui demeurent sur les frontieres de Tunis se barbouillent de couleur bleue le menton & les levres ; quelques-unes impriment une petite fleur, dans quelque autre partie du visage, avec de la fumée de noix de galle & du safran. Les femmes du royaume de Tripoli font consister les agrémens dans des piquûres sur la face, qu'elles pointillent de vermillon ; elles peignent leurs cheveux de même. La plûpart des filles Negres du Sénégal, avant que de se marier, se font broder la peau de différentes figures d'animaux & de fleurs de toutes couleurs. Les Négresses de Serra-Liona se colorent le tour des yeux de blanc, de jaune, & de rouge.
Les Floridiennes de l'Amérique septentrionale se peignent le corps, le visage, les bras, & les jambes de toutes sortes de couleurs ineffaçables ; parce qu'elles ont été imprimées dans les chairs par le moyen de plusieurs piquûres. Enfin les femmes sauvages Caraïbes se barbouillent toute la face de rocou.
Si nous revenons en Europe, nous trouverons que le blanc & le rouge ont fait fortune en France. Nous en avons l'obligation aux Italiens, qui passerent à la cour de Catherine de Medicis : mais ce n'est que sur la fin du siecle passé, que l'usage du rouge est devenu général parmi les femmes de condition.
Callimaque, dans l'hymne intitulée les bains de Pallas, a parlé d'un fard bien plus simple. Les deux déesses Vénus & Pallas se disputoient le prix & la gloire de la beauté : Vénus fut long-tems à sa toilette ; elle ne cessa point de consulter son miroir, retoucha plus d'une fois à ses cheveux, regla la vivacité de son teint ; au lieu que Minerve ne se mira ni dans le métal, ni dans la glace des eaux, & ne trouva point d'autre secret pour se donner du rouge, que de courir un long espace chemin, à l'exemple des filles de Lacédémone qui avoient accoûtumé de s'exercer à la course sur le bord de l'Eurotas. Si le succès alors justifia les précautions de Vénus, ne fut-ce pas la faûte du juge, plûtôt que celle de la nature ?
Quoi qu'il en soit, je ne pense point qu'on puisse réparer par la force de l'art les injures du tems, ni rétablir sur les rides du visage la beauté qui s'est évanoüie. Je sens bien la justesse des réflexions de Rica dans sa lettre à Usbek : « Les femmes qui se sentent finir d'avance par la perte de leurs agrémens, voudroient reculer vers la jeunesse ; eh comment ne chercheroient-elles pas à tromper les autres ! elles font tous leurs efforts pour se tromper elles-mêmes, & pour se dérober la plus affligeante de toutes les idées ». Mais comme le dit Lafontaine :
Les fards ne peuvent faire
Que l'on échappe au tems, cet insigne larron ;
Les ruines d'une maison
Se peuvent réparer ; que n'est cet avantage
Pour les ruines du visage ?
Cependant loin que les fards produisent cet effet, j'ose assûrer au contraire qu'ils gâtent la peau, qu'ils la rident, qu'ils alterent & ruinent la couleur naturelle du visage : j'ajoûte qu'il y a peu de fards dans le genre du blanc, qui ne soit dangereux. Aussi les femmes qui se servent de l'huile de talc comme d'un fard excellent, s'abusent beaucoup ; celles qui employent la céruse, le blanc de plomb, ou le blanc d'Espagne, n'entendent pas mieux leurs intérêts ; celles qui se servent de préparations de sublimé, font encore plus de tort à leur santé : enfin l'usage continuel du rouge, sur-tout de ce vermillon terrible qui jaunit tout ce qui l'environne, n'est pas sans inconvénient pour la peau. Voyez Rouge.
Afranius répétoit souvent & avec raison à ce sujet : « des graces simples & naturelles, le rouge de la pudeur, l'enjoüement, & la complaisance, voilà le fard le plus séduisant de la jeunesse ; pour la vieillesse, il n'est point de fard qui puisse l'embellir, que l'esprit & les connoissances ».
Je ne sache aucun ouvrage sur les fards ; j'ai lû seulement que Michel Nostradamus, ce medecin si célebre par les visites & les présens qu'il reçut des rois & des reines, & par ses centuries qui l'ont fait passer pour un visionnaire, un fou, un magicien, un impie, a donné en 1552 un traité des fardemens & des senteurs, que je n'ai jamais pû trouver, & qui peut-être n'est pas fort à regretter. Article de M. le Chevalier de Jaucourt.
Étymologie de « fard »
Diez, trouvant que le lat. tincta, teinte, est traduit en vieil haut allemand par gi-farwit, gifarit, de farwjan, teindre, tire de là le mot fard. Scheler cite de Palsgrave?: paynting of ones face, farcement?; ce qui supposerait un verbe farcer. C'est une faute de Palsgrave?; le verbe est farder?; et non farcer (voy. FARDER).
fard au Scrabble
Le mot fard vaut 8 points au Scrabble.
Informations sur le mot fard - 4 lettres, 1 voyelles, 3 consonnes, 4 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot fard au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
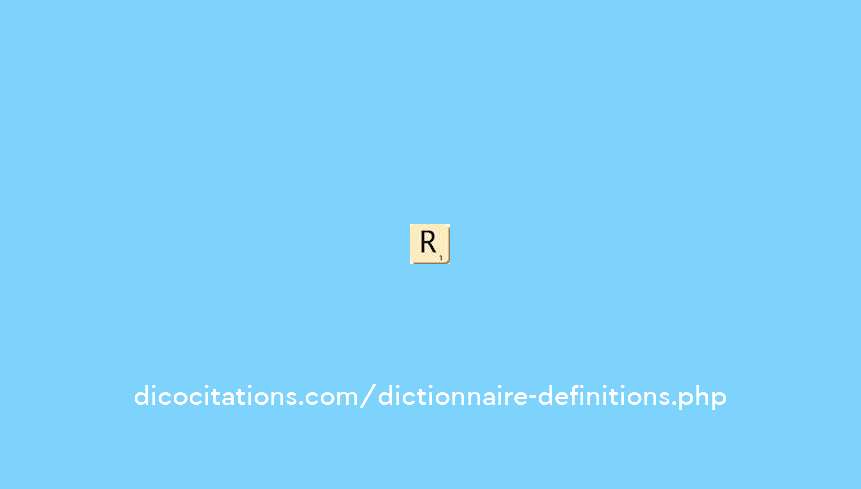
Les rimes de « fard »
On recherche une rime en AR .
Les rimes de fard peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en aR
Rimes de Orroir Rimes de pommards Rimes de connards Rimes de parloir Rimes de frétillard Rimes de aérogares Rimes de anar Rimes de blédard Rimes de provisoire Rimes de gare Rimes de brown sugar Rimes de magyars Rimes de clébards Rimes de rafraîchissoir Rimes de drageoir Rimes de plumards Rimes de connard Rimes de écart Rimes de isoloirs Rimes de exutoires Rimes de goguenard Rimes de épaulard Rimes de tintamarres Rimes de billard Rimes de ivoire Rimes de passoire Rimes de camping-car Rimes de mansard Rimes de natatoire Rimes de escarres Rimes de parloirs Rimes de gaillards Rimes de mi-pleurnichard Rimes de campagnard Rimes de douar Rimes de fermoirs Rimes de tamponnoir Rimes de rasoirs Rimes de boyard Rimes de démarrent Rimes de échappatoire Rimes de traînards Rimes de vasards Rimes de musard Rimes de caviar Rimes de empare Rimes de ovipares Rimes de demi-part Rimes de balbuzard Rimes de jaguarsMots du jour
Orroir pommards connards parloir frétillard aérogares anar blédard provisoire gare brown sugar magyars clébards rafraîchissoir drageoir plumards connard écart isoloirs exutoires goguenard épaulard tintamarres billard ivoire passoire camping-car mansard natatoire escarres parloirs gaillards mi-pleurnichard campagnard douar fermoirs tamponnoir rasoirs boyard démarrent échappatoire traînards vasards musard caviar empare ovipares demi-part balbuzard jaguars
Les citations sur « fard »
- Malheur à vous aussi, docteur de la Loi! car vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, et vous-mêmes vous n'y touchez pas du bout du doigt.Auteur : La Bible - Source : Luc, XI, 46
- Cet épineux fardeau qu'on nomme vérité.Auteur : Théodore Agrippa d' Aubigné - Source : Les Tragiques (1616)
- La renommée est dangereuse son fardeau est léger à soulever, pénible à supporter et difficile à déposer.Auteur : Hésiode - Source : La Théogonie
- Sans le fard de l'amour par qui tout s'apprécie,
Les graces sont sans force, et la beauté sans vie.
Daignez donc jusqu'à vous, laissant aller ses traits,
Leur laisser embellir encore vos attraits.Auteur : Antoine Bret - Source : La Double Extravagance (1750), VII - Temps pommelé,
Pomme ridée;
Femme fardée,
Courte durée.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe - La végétation est le fard de la Géologie.Auteur : Sylvain Tesson - Source : Aphorismes sous la lune et autres pensées sauvages (2008)
- Le suicide est un lourd fardeau pour ceux qu'on laisse derrière soi.Auteur : Magdalen Nabb - Source : Mort d'un orfèvre (2001)
- Prenez mieux votre ton. Soyez simple avec art, sublime sans orgueil, agréable sans fard.Auteur : Nicolas Boileau-Despréaux - Source : Sans référence
- La dissimulation farde les amitiés nouvelles et recrépit les vieilles haines.Auteur : Charles, sieur de La Rivière Dufresny - Source : Le Double Veuvage (1701)
- L'on m'a dit aussi que vous vous fardiez. Fort bien! Dieu vous a donné un visage, et vous vous en fabriquez un autre.Auteur : William Shakespeare - Source : Hamlet (1601), III, 1, Hamlet à Ophélie
- Ce sont les pieds qui portent le fardeau d'une cervelle vide.Auteur : Proverbes kurdes - Source : Proverbe
- J’avais oublié à quel point les parisiens faisaient la gueule en permanence. Un stage de chaleur irlandais devrait être obligatoire au programme scolaire. Je pensais ça, mais je savais pertinemment que, dans moins de deux jours, j’aurais le même visage blafard et peut avenant qu’eux. Auteur : Agnès Martin-Lugand - Source : Les gens heureux lisent et boivent du café (2012)
- Lisse-moi, farde-moi. Colore mon absence.
Désoeuvre ce regard qui méconnaît la nuit.Auteur : Yves Bonnefoy - Source : Poèmes 1947–1975 (1978), Cassandre - La reconnaissance est un fardeau, et tout fardeau est fait pour être secoué.Auteur : Denis Diderot - Source : Le Neveu de Rameau (1762)
- C'est un lourd fardeau d'être raisonnable et j'aurais volontiers secoué les épaules pour m'en débarrasser.Auteur : Jacqueline Harpman - Source : La Plage d'Ostende (1991)
- Achèves ta vie : n'en dépose point le fardeau, à la première fatigue.Auteur : Pythagore - Source : Lois Politiques et Morales de Pythagore in Voyages de Pythagore En Egypte, Dans La Chaldee, Dans L'Inde, En Crete, a Sparte de Pierre-Sylvain Maréchal (1798)
- La lumière remontait de la poitrine au front, rasait les lèvres fardées, dorait un léger duvet blond, au coin des lèvres, rougissait un peu les narines.Auteur : Jean-Paul Sartre - Source : Les chemins de la liberté (1945), le sursis
- Contre les femmes fardées: - Elle a vingt ans le jour et cinquante ans la nuit.Auteur : Georges de Brébeuf - Source : Sans référence
- Il y a chez les hommes, quand ils sont pris en particulier par les yeux, un fard de jobardise dont leur majestueuse sagesse se doute peu et qui fait que les plus avisés d'entre eux sont souvent nos dupes.Auteur : John Cleland - Source : Mémoires de Fanny Hill, femme de plaisir (2006)
- L'amour clamé, le bien affiché, c'est toujours pour farder quelque chose de terrible. Dans mon cas, ce que j'ai voulu un temps comprimer, c'était ma tristesse qui menaçait d'exploser comme une grenade.Auteur : Christian Bobin - Source : La lumière du monde (2001)
- Oh! n'insultez jamais une femme qui tombe! - Qui sait sous quel fardeau la pauvre âme succombe!Auteur : Victor Hugo - Source : Les Chants du crépuscule (1835), Oh! n'insultez jamais...
- Le cafard. Noir et collé comme un trou de serrure.Auteur : Jules Renard - Source : Histoires naturelles (1894)
- La part de comédie qui entre dans l'amour est pour le coeur comme les parfums, les fards et les parures pour le corps.Auteur : Maurice Chapelan - Source : Amours, amour (1967)
- Ce qu'on nomme cafard n'est souvent qu'une éclipse de nos illusions et un éclair de notre lucidité.Auteur : Fernand Vanderem - Source : Gens de qualité (1938)
- Apprendre à étouffer ses doutes, les jeter, s'en débarrasser. Le poids des morts est un fardeau. Les doutes détruisent. Les certitudes élèvent. Les ambitions, la volonté, la force et le courage font la grandeur. Le doute est une mort lente, un épuisement de la race. Il y aura une victoire ou une chute. Auteur : Sébastien Spitzer - Source : Ces rêves qu'on piétine (2017)
Les mots proches de « fard »
Faradique Faraud Farce Farce Farcer Farceur, euse Farci, ie Farcin Farcineux, euse Farcir Farcissure Fard Fardage Farde Fardé, ée Fardeau Fardement Farder Farder Fardeur Farfadet Faribole Farine Fariner Farineux, euse Farinière Far-niente Farouche Farrago Far-westLes mots débutant par far Les mots débutant par fa
far far-west farad farads Faramans Faramans faramineuse faramineuses faramineux farandolaient farandole farandoles faraud faraud faraude faraude farauder faraudes farauds farauds Farbus farce farce Farceaux farces farces farceur farceur farceurs farceurs farceuse farceuse farceuses farci farci farcie farcie Farciennes farcies farcies farcir farcirai farcirait farcis farcis farcissaient farcissais farcissait farcissant farcisse
Les synonymes de « fard»
Les synonymes de fard :- 1. barbouillage
2. artifice
3. grimage
4. maquillage
5. escroquerie
6. fraude
7. trafic
8. rimmel
9. mascara
10. kohol
synonymes de fard
Fréquence et usage du mot fard dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « fard » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot fard dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Fard ?
Citations fard Citation sur fard Poèmes fard Proverbes fard Rime avec fard Définition de fard
Définition de fard présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot fard sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot fard notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 4 lettres.
