La définition de Militaire du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Militaire
Nature : adj.
Prononciation : mi-li-tê-r'
Etymologie : Lat. militaris, de miles, militis, soldat.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de militaire de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec militaire pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Militaire ?
La définition de Militaire
Qui concerne la guerre. Les institutions militaires.
Toutes les définitions de « militaire »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
. Qui concerne la guerre ou les armées. L'art militaire. La discipline militaire. Gloire militaire. Exploits militaires. Service militaire. L'esprit militaire. Il a de grands talents militaires. Occupation militaire d'un pays. Par extension, Parler d'un ton militaire. Il répondait avec une concision toute militaire. Justice militaire, Celle qui s'exerce parmi les troupes, suivant des lois spéciales composant le code militaire. Exécution militaire, La peine de mort infligée aux soldats pour délit militaire. Il se dit aussi des Violences qu'on exerce militairement dans un pays, en temps de guerre, pour punir les habitants de leur résistance, ou pour les contraindre à quelque chose. Menacer un pays d'exécution militaire. Architecture militaire, L'art de fortifier les places. Route militaire, Chemin ouvert pour faciliter des mouvements de troupes. On dit dans le même sens Ligne, gare militaire. Il s'emploie par opposition à Civil. Il s'est montré également propre aux emplois civils et aux emplois militaires. Les autorités civiles et les autorités militaires. Les ordres religieux et militaires, Les ordres religieux dont les membres font vœu de combattre les infidèles. Substantivement, C'est un bon militaire. Un vieux militaire. Les civils et les militaires.
Littré
-
1Qui concerne la guerre. Les institutions militaires.
L'ordre et la discipline militaire s'augmentaient avec les armées
, Bossuet, Marie-Thér.[à Rome] les actions militaires avaient mille récompenses qui ne coûtaient rien au public et qui étaient infiniment précieuses aux particuliers
, Bossuet, Hist. III, 6.Il est triste que j'aie trouvé si peu de mémoires sur les négociations du baron de Gortz?; c'est un point d'histoire très intéressant?; et c'est à de tels événements que tous les lecteurs s'attachent, beaucoup plus qu'à tous les détails militaires qui se ressemblent presque tous
, Voltaire, Lett. Schouvaloff, 1er nov. 1761.Les dignités et les récompenses militaires furent prodiguées sous le ministère de Chamillart
, Voltaire, Louis XIV, 18.Art militaire, l'art de la guerre.
Nos Espagnols formés à votre art militaire
, Corneille, Sertor. IV, 2.Puisque, pour notre malheur, ce qu'il y a de plus fatal à la vie humaine, c'est-à-dire l'art militaire, est en même temps ce qu'elle a de plus ingénieux et de plus habile
, Bossuet, Louis de Bourbon.Justice militaire, celle qui s'exerce parmi les troupes, suivant des lois spéciales, suivant le code militaire.
Exécution militaire, la peine de mort infligée aux soldats pour délits militaires.
Exécution militaire signifie aussi les violences qu'on exerce militairement dans un pays pour punir les habitants de leur résistance ou pour les contraindre à quelque chose.
Architecture militaire, l'art de fortifier les places.
Chantier militaire, chantier où se construisent les vaisseaux de guerre.
Les ordres religieux et militaires, les ordres religieux dont les membres font v?u de combattre les infidèles.
Confins militaires, se dit des territoires assignés, dans certains États, à une population formée d'anciens soldats, mariés, mais encore enrégimentés.
Testament militaire, testament fait à l'armée et dans lequel on est dispensé d'observer la plupart des formalités ordinaires.
Herbe militaire, voy. MILLE-FEUILLE.
Heure militaire, heure exacte, ponctuelle.
Honneurs militaires, honneurs qu'on rend en certaines circonstances aux commandants des troupes.
- 2Il se dit par opposition à civil. Les autorités civiles et les autorités militaires. Les emplois civils et les emplois militaires.
-
3Qui est fondé sur la force militaire, sur les m?urs militaires.
Le royaume de Votre Majesté est purement militaire?; la gloire et l'amour des armes ont toujours distingué la nation française de toutes les autres, et ce n'est que depuis un certain temps qu'il semblait qu'on se fût attaché d'avilir l'état militaire (1743)
, Corresp. de Louis XV et de Noailles, t. I, p. 182.La plupart des gouvernements sont ou deviennent militaires
, Raynal, Hist. phil. XIX, 2.La mort de Néron causa une révolution dans l'État?; l'élection passa aux légions, et la constitution devint militaire
, Chateaubriand, Études hist. I, 1.Dans cette révolution toute militaire [la restauration de Napoléon en 1815], dans cet avénement d'empereur romain proclamé par une garde prétorienne, ce qui manquait c'était le nombre des soldats
, Villemain, Souvenirs contemporains, Cent-Jours, ch. V. -
4Guerrier, guerrière (il n'est plus guère usité en ce sens).
Ayant régné sept ans, son ardeur militaire Rallume cette guerre où succomba son frère
, Corneille, Rodog. I, 1.Laissez moins de fumée à vos feux militaires
, Corneille, Nicom. II, 3. -
5 S. m. Militaire, un homme de guerre. Les militaires et les bourgeois.
Il jeûnait régulièrement tous les samedis? bien différent de ces militaires qui déshonorent la profession des armes par cette honte trop commune de bien faire les exercices de la piété
, Bossuet, Gornay.Militaire oublié par ses maîtres altiers
, Voltaire, Irène, I, 2. -
6 Collectivement. Le militaire, la totalité des gens de guerre.
Si jamais la noblesse ou le militaire adoptait une pareille maxime
, Rousseau, Écon. 1.J'ose espérer qu'on fera bientôt une nouvelle édition in-4° [de l'Histoire du maréchal de Saxe], avec des planches qui me paraissent absolument nécessaires pour l'instruction de tout le militaire
, Voltaire, Lett. d'Espagnac, 15 déc. 1773.Le ministre éclairé qui, en changeant la forme de notre militaire, a diminué le nombre des officiers
, Saint-Lambert, Saisons, Discours préliminaire.Son gouvernement [celui de l'Angleterre] formé de royauté et d'aristocratie, sa religion moins pompeuse que la catholique et plus brillante que la luthérienne, son militaire à la fois lourd et actif?; tout participe des deux sources dont il découle
, Chateaubriand, Génie, III, III, 5. -
7Le militaire, la carrière des armes.
? que M. le duc d'Aiguillon avait très bien servi l'État et le roi, tant dans le militaire que dans le civil
, Voltaire, Lett. Morangiès, 30 oct. 1772.
REMARQUE
1. Saint-Simon a dit?: Le baron de Bressé acquit bientôt la confiance du roi et toute l'estime militaire [des gens de guerre], I, 26. Cet emploi n'est pas usité.
2. Militaire n'était point entré dans l'usage commun de la langue au temps de Vaugelas?: p. 364 de l'éd. in-4° 1704, à propos du mot expédition, auquel on commençait à donner le sens de campagne, il dit?: " Si je m'en servais, j'y voudrais toujours ajouter mititaire, et dire une expédition militaire, des expéditions militaires?; car cette épithète l'explique en quelque façon, quoique la plupart des dames entendent aussi peu militaire qu'expédition. "
HISTORIQUE
XIVe s. Et ainci ot on comices de tribuns militaires
, Bercheure, f° 100.
Encyclopédie, 1re édition
MILITAIRE, adj. & s. (Art milit.) On appelle ainsi tout officier servant à la guerre.
Ainsi un militaire exprime un officier ou toute autre personne dont le service concerne la guerre, comme ingénieur, artilleur, &c.
On donne aussi le nom de militaire à tout le corps en général des officiers. Ainsi l'on dit d'un ouvrage, qu'il sera utile à l'instruction du militaire, pour exprimer l'utilité que les officiers peuvent en tirer. On dit de même la science militaire, pour la science de la guerre ou celle qui convient à tous les officiers pour agir par regles & principes.
Militaire, discipline des Romains, (Art. milit.) La discipline militaire consistoit principalement dans les services, les exercices, & les lois. Les services étoient différens devoirs dont il falloit s'acquitter, comme des gardes & des sentinelles pendant la nuit. Des qu'on étoit campé, les tribuns nommoient deux soldats principes, ou hastati, pour avoir soin de faire tenir propre la rue appellée principia, & ils en tiroient trois autres de chacune des compagnies, pour faire dresser les tentes, fournir de l'eau, du bois, des vivres, & autres choses de cette nature.
Il paroît que les tribuns avoient deux corps-de-garde de quatre hommes chacun, soit pour honorer leur dignité, soit pour leur commodité particuliere. Le questeur & les lieutenans généraux avoient aussi les leurs. Pendant que les chevaliers étoient de garde, les triariens les servoient, & avoient soin de leurs chevaux. Saluste nous apprend que tous les jours une compagnie d'infanterie, & une de cavalerie, faisoient la garde près de la tente du général ; c'étoit la même chose pour les alliés. Il y avoit à chaque porte une cohorte & une compagnie de cavalerie qui faisoit la garde ; on la relevoit vers midi selon la regle établie par Paul Emile.
Le second service militaire étoit donc de faire la garde durant la nuit. Il y avoit, comme parmi nous, la sentinelle, la ronde, & le mot du guet, tessera. Sur dix compagnies, on choissoit tour-à-tour un soldat, appellé pour cet effet tesserarius, qui vers le coucher du soleil, se rendoit chez le tribun, qui étoit de jour, & recevoit de lui une petite tablette de bois, où par l'ordre du général étoient écrits un ou plusieurs mots ; par exemple, à la bataille de Philippe, César & Antoine donnerent le nom d'Appollon pour mot du guet. On écrivoit encore sur ces mêmes tablettes quelques ordres pour l'armée. Celui qui avoit reçu le mot du guet, après avoir rejoint sa compagnie, le donnoit, en présence de témoins, au capitaine de la compagnie suivante. Celui-ci le donnoit à l'autre, & toujours de même, ensorte qu'avant le coucher du soleil toutes ces tablettes étoient apportées au tribun, lequel par une inscription particuliere qui marquoit tous les corps de l'armée, comme les piquiers, les princes, &c. pouvoient connoître celui qui n'avoit point rapporté sa tablette : sa faute ne pouvoit être niée, parce qu'on entendoit sur cela des témoins.
Toutes les-sentinelles étoient de quatre soldats, comme les corps-de-gardes, usage qui paroît avoir été toujours observé. Ceux qui la nuit faisoient la sentinelle auprès du général & des tribuns, étoient en aussi grand nombre que ceux de la garde du jour. On posoit même une sentinelle à chaque compagnie. Il y en avoit trois chez le questeur, & deux chez les lieutenans généraux. Les vélites gardoient les dehors du camp. A chaque porte du camp on plaçoit une décurie, & l'on y joignoit quelques autres soldats. Ils faisoient la garde pendant la nuit, quand l'ennemi étoit campé près de l'armée. On divisoit la nuit en quatre parties qu'on appelloit veilles, & cette division se faisoit par le moyen des clepsydres : c'étoient des horloges d'eau qui leur servoient à regler le tems. Il y avoit toujours un soldat qui veilloit pendant que les autres se reposoient à côté de lui, & ils veilloient tour-à-tour. On leur donnoit à tous une tablette différente, par laquelle on connoissoit à quelle veille tel soldat avoit fait la sentinelle, & de quelle compagnie il étoit.
Enfin il y avoit la ronde, qui se faisoit ordinairement par quatre cavaliers, que toutes les compagnies fournissoient chacune à leur tour. Ces cavaliers tiroient leurs veilles au sort. Un centurion faisoit donner le signal avec la trompette, & partageoit le tems également par le moyen d'une clepsydre. Au commencement de chaque veille, lorsqu'on renvoyoit ceux qui veilloient à la tente du général, tous les instrumens donnoient le signal. Celui à qui étoit échu la premiere veille, & qui recevoit la tablette des autres qui étoient en sentinelle, s'il trouvoit quelqu'un dormant, ou qui eût quitté son poste, il prenoit à témoin ceux qui étoient avec lui & s'en alloit. Au point du jour chacun de ceux qui faisoient la ronde reportoit les tablettes au tribun qui commandoit ce jour là, & quand il en manquoit quelqu'une, on cherchoit le coupable que l'on punissoit de mort si on le découvroit. Tous les centurions, les décurions, & les tribuns alloient environ à la même heure saluer leur général, qui donnoit ses ordres aux tribuns, qui les faisoient savoir aux centurions, & ceux ci aux soldats. Le même ordre s'observoit parmi les alliés.
Les exercices militaires faisoient une autre partie de la discipline ; aussi c'est du mot exercitium, exercice, que vient celui d'exercitus, armée, parce que plus des troupes sont exercées, plus elles sont aguerries. Les exercices regardoient les fardeaux qu'il falloit porter, les ouvrages qu'il falloit faire, & les armes qu'il falloit entretenir. Les fardeaux que les soldats étoient obligés de porter, étoient plus pesans qu'on ne se l'imagine, car ils devoient porter des vivres, des ustensiles, des pieux, & outre cela leurs armes. Ils portoient des vivres pour quinze jours & plus ; ces vivres consistoient seulement en blé, qu'ils écrasoient avec des pierres quand ils en avoient besoin ; mais dans la suite ils porterent du biscuit qui étoit fort léger ; leurs ustensiles étoient une scie, une corbeille, une bèche, une hache, une faulx, pour aller au fourrage : une chaîne, une marmite pour faire cuire ce qu'ils mangeoient. Pour des pieux, ils en portoient trois ou quatre, & quelquefois davantage. Du reste, leurs armes n'étoient pas un fardeau pour eux, ils les regardoient en quelque sorte comme leurs propres membres.
Les fardeaux dont ils étoient chargés ne les empêchoient pas de faire un chemin très-long. On lit que dans cinq heures ils faisoient vingt mille pas. On conduisoit aussi quelques bêtes de charge, mais elles étoient en petit nombre. Il y en avoit de publiques, qui portoient les tentes, les meules, & autres ustensiles. Il y en avoit aussi qui appartenoient aux personnes considérables. On ne se servoit presque point de chariots, parce qu'ils étoient trop embarrassans. Il n'y avoit que les personnes d'un rang distingué qui eussent des valets.
Lorsque les troupes décampoient, elles marchoient en ordre au son de la trompette. Quand le premier coup du signal étoit donné, tous abattoient leurs tentes & faisoient leurs paquets ; au second coup, ils les chargeoient sur des bêtes de somme ; & au troisieme, ou faisoit défiler les premiers rangs. Ceux-là étoient suivis des alliés de l'aîle droite avec leurs bagages : après eux défiloient la premiere & la deuxieme légion, & ensuite les alliés de l'aîle gauche, tous avec leurs bagages ; ensorte que la forme de la marche & celle du camp, étoient à-peu-près semblables. La marche de l'armée étoit une espece de camp ambulant : les cavaliers marchoient tantôt sur les aîles, & tantôt à l'arriere-garde. Lorsqu'il y avoit du danger, toute l'armée se se roit, & cela s'appelloit pilatum agmen ; alors on faisoit marcher séparément les bêtes de charge, afin de n'avoir aucun embarras, au cas qu'il fallût combattre : les vélites marchoient à la tête. Le général qui étoit toujours accompagné de soldats d'élite, se tenoit au milieu, ou dans l'endroit où sa présence étoit nécessaire, la marche ne se faisoit ainsi que quand on craignoit d'être attaqué.
Quand on étoit prêt d'arriver à l'endroit où l'on devoit camper, on envoyoit devant les tribuns & les centurions avec des arpenteurs, ou ingénieurs, pour choisir un lieu avantageux, & en tracer les limites ; les soldats y entroient comme dans une ville connue & policée, parce que les camps étoient presque toujours uniformes.
Les travaux des soldats dans les siéges, & dans d'autres occasions, étoient fort pénibles. Ils étoient obligés, par exemple, de faire des circonvallations, de creuser des fossés, &c. Durant la paix, on leur faisoit faire des chemins, construire des édifices, & bâtir même des villes entieres, si l'on en croit Dion Cassius, qui l'assure de la ville de Lyon. Il en est ainsi de la ville de Doesbourg dans les Pays-Bas, dans la Grande-Bretagne, de cette muraille dont il y a encore des restes, & d'un grand nombre de chemins magnifiques.
Le troisieme exercice, étoit celui des armes qui se faisoit tous les jours dans le tems de paix, comme dans le tems de guerre, par tous les soldats excepté les vétérans ; les capitaines mêmes & les généraux, comme Scipion, Pompée, & d'autres, se plaisoient à faire l'exercice ; c'étoit sur-tout dans les quartiers d'hyver qu'on établissoit des exercices auxquels présidoit un centurion, ou un vétéran d'une capacité reconnue. La pluie ni le vent ne les interrompoient point, parce qu'ils avoient des endroits couverts destinés à cet usage. Les exercices des armes étoient de plusieurs especes ; dans la marche on avoit surtout égard à la vîtesse, c'est pourquoi trois fois par mois on faisoit faire dix mille pas aux soldats armés, & quelquefois chargés de fardeaux fort pesans ; ils en faisoient même vingt mille ; si l'on en croit Végece, ils étoient obligés d'aller & de venir avec beaucoup de célérité.
Le second exercice, étoit la course sur la même ligne ; on obligeoit les soldats de courir quatre mille pas armés & sous leurs enseignes. Le troisieme consistoit dans le saut, afin de savoir sauter les fossés quand il en étoit besoin. Un quatrieme exercice, regardé comme important, étoit de nager ; il se pratiquoit dans la mer, ou dans quelque fleuve, lorsque l'armée se trouvoit campée sur le rivage, ou dans le Tibre proche le champ de Mars. Le cinquieme exercice étoit appellé palaria ; il consistoit à apprendre à frapper l'ennemi, & pour cela le soldat s'exerçoit à donner plusieurs coups à un pieu qui étoit planté à quelque distance, ce qu'ils faisoient en présence d'un vétéran, qui instruisoit les jeunes. Le sixieme exercice montroit la maniere de lancer des fleches & des javelots ; c'étoit proprement l'exercice de ceux qui étoient armés à la légere. Enfin le septieme étoit pour les cavaliers, qui fondoient l'épée à la main sur un cheval de bois. Ils s'exerçoient aussi à courir à cheval, & à faire plusieurs évolutions différentes : voilà les exercices qui étoient les plus ordinaires chez les Romains ; nous supprimons les autres.
La troisieme partie de la discipline militaire consistoit dans les lois de la guerre. Il y en avoit une chez les Romains qui étoit très-sévere, c'étoit contre les vols. Frontin, Stratag. liv. I. ch. iv. nous apprend quelle en étoit la punition. Celui qui étoit convaincu d'avoir volé la plus petite piece d'argent étoit puni de mort. Il n'étoit pas permis à chacun de piller indifféremment le pays ennemi. On y envoyoit des détachemens ; alors le butin étoit commun ; & après que le questeur l'avoit fait vendre, les tribuns distribuoient à chacun sa part, ainsi personne ne quittoit son poste ou son rang. C'étoit encore une loi de ne point obliger les soldats à vuider leurs différends hors du camp, ils étoient jugés par leurs camarades.
Jusqu'à l'an 347, les soldats Romains ne reçurent aucune paye, & chacun servoit à ses dépens. Mais depuis ce tems-là jusqu'à Jules-César, on leur donnoit par jour environ deux oboles, qui valoient cinq sols. Jules-César doubla cette paye, & Auguste continua de leur donner dix sols par jour. Dans la suite la paye augmenta à un point, que du tems de Domitien, ils avoient chacun quatre écus d'or par mois, au rapport de Juste-Lipse ; mais je crois que Gronovius de Pecun. vet. liv. III. chap. 21. pense plus juste, en disant que les soldats avoient douze écus d'or par an. Les centurions recevoient le double de cette somme, & les chevaliers le triple. Quelquefois on donnoit une double ration, ou bien une paye plus forte qu'à l'ordinaire à ceux qui s'étoient distingués par leur courage. Outre cela on accordoit aux soldats quatre boisseaux de blé, mesure romaine, par mois, afin que la disette ne les obligeât pas à piller ; mais il leur étoit défendu d'en vendre. Les centurions en avoient le double, & les chevaliers le triple, ce n'est pas qu'ils mangeassent plus que les autres ; mais ils avoient des esclaves à nourrir : on leur fournissoit aussi de l'orge pour leurs chevaux.
Les fantassins des alliés avoient autant de blé que ceux des Romains ; mais leurs chevaliers n'avoient que huit boisseaux par mois, parce qu'ils n'avoient pas tant de monde à nourrir que les chevaliers romains. Tout cela se donnoit gratis aux alliés, parce qu'ils servoient de même. On retranchoit aux Romains une fort petite partie de leur paye, pour le blé & les armes qu'on leur fournissoit. On leur donnoit aussi quelquefois du sel, des légumes, du lard ; ce qui arriva sur-tout dans les derniers tems de la république. Il n'étoit permis à personne de manger avant que le signal fût donné, & il se donnoit deux fois par jour ; ils dinoient debout, frugalement, & ne mangeoient rien de cuit dans ce repas : leur souper qu'ils apprêtoient eux-mêmes, valoit un peu mieux que leur dîner. La boisson ordinaire des soldats étoit de l'eau pure, ou de l'eau mêlée avec du vinaigre ; c'étoit aussi celle des esclaves.
La récompense & les punitions sont les liens de la société & le soutien de l'état militaire : c'est pour cela que les Romains y ont toûjours eu beaucoup d'égard. Le premier avantage de l'état militaire étoit que les soldats n'étoient point obligés de plaider hors du camp ; ils pouvoient aussi disposer à leur volonté de l'argent qu'ils amassoient à la guerre. Outre cela, le général victorieux récompensoit les soldats qui s'étoient distingués par leur bravoure ; & pour distribuer les récompenses, il assembloit l'armée. Après avoir rendu graces aux dieux, il la haranguoit, faisoit approcher ceux qu'il vouloit récompenser, leur donnoit des louanges publiques, & les remercioit.
Les plus petites récompenses qu'il distribuoit, étoient par exemple, une pique sans fer, qu'il donnoit à celui qui avoit blessé son ennemi dans un combat singulier ; celui qui l'avoit renversé & dépouillé, recevoit un brasselet s'il étoit fantassin ; & s'il étoit cavalier, une espece de hausse-col d'or ou d'argent. On leur faisoit aussi quelquefois présent de petites chaînes, ou de drapeaux, tantôt unis, tantôt de différentes couleurs, & brodés en or.
Les grandes récompenses étoient des couronnes de différentes especes : la premiere & la plus considérable, étoit la couronne obsidionale que l'on donnoit à celui qui avoit fait lever un siége. Cette couronne étoit regardée comme la plus honorable : on la composoit d'herbes que l'on arrachoit dans le lieu même où étoient campés les assiégeans. Après cette couronne, venoit la couronne civique qui étoit de chêne : on en peut voir la raison dans Plutarque, vie de Coriolan. Cette couronne étoit réservée pour un citoyen qui avoit sauvé la vie à un autre citoyen, en tuant son ennemi. Le général ordonnoit que cette couronne fût donnée d'abord à celui à qui on avoit sauvé la vie, afin qu'il la présentât lui-même à son libérateur, qu'il devoit toûjours regarder comme son pere. La couronne murale d'or, qui étoit faite en forme de mur, & où il y avoit des tours & des mantelets représentés, se donnoit à celui qui avoit monté le premier à la muraille d'une ville assiégée. Il y en avoit deux autres qui lui ressembloient assez ; l'une s'appelloit corona castrensis, couronne de camp ; & l'autre corona vallaris, couronne de retranchement. La premiere s'accordoit à celui qui dans un combat, avoit pénétré le premier dans le camp de l'ennemi ; & la seconde, à celui qui étoit entré le premier dans le retranchement. La couronne d'or navale, étoit pour celui qui avoit sauté le premier les armes à la main dans le vaisseau ennemi. Il y en avoit une autre qu'on appelloit classica ou rostrata, dont on faisoit présent au général qui avoit remporté quelque grande victoire sur mer. On en donna une de cette espece à Varron, & dans la suite à M. Agrippa : cette couronne ne le cédoit qu'à la couronne civique.
Il y avoit encore d'autres couronnes d'or, qui n'avoient aucun nom particulier ; on les accordoit aux soldats à cause de leur valeur en général. Au reste, on leur donnoit plutôt des louanges, ou des choses dont on ne considéroit point le prix, que de l'argent, pour faire voir que la récompense de la valeur devoit être l'honneur, & non les richesses. Quand ils alloient aux spectacles, ils avoient soin de porter ces glorieuses marques de leur vaillance : les chevaliers s'en paroient aussi quand ils passoient en revûe.
Ceux qui avoient remporté quelques dépouilles, les faisoient attacher dans le lieu le plus fréquenté de leur maison, & il n'étoit pas permis de les arracher, même quand on vendoit la maison, ni de les suspendre une seconde fois, si elles tomboient. Les dépouilles opimes étoient celles qu'un officier, quoique subalterne, comme nous le voyons par l'exemple de Cossus, remportoit sur un officier des ennemis. On les suspendoit dans le temple de Jupiter férétrien : ces dépouilles ne furent remportées que trois fois pendant tout le tems de la république romaine. On les appelloit opimes, selon quelques-uns, d'Ops, femme de Saturne, qui étoit censée la distributrice des richesses ; selon d'autres, ce mot vient d'opes, richesses ; parce que ces dépouilles étoient précieuses : c'est pour cela qu'Horace dit, un triomphe opime, Od. xliv.
Un des honneurs qu'on accordoit au commandant de l'armée, étoit le nom d'imperator ; il recevoit ce titre des soldats, après qu'il avoit fait quelque belle action, & le sénat le confirmoit. Le commandant gardoit ce nom jusqu'à son triomphe : le dernier des particuliers qui ait eu le nom d'imperator, est Junius Blæsus, oncle de Séjan : un autre honneur étoit la supplication ordonnée pour rendre graces aux dieux de la victoire que le général avoit remportée ; ces prieres étoient publiques & ordonnées par le sénat. Cicéron est le seul, à qui ces prieres ayent été accordées dans une autre occasion que celle de la guerre. Ce fut après la découverte de la conjuration de Catilina ; mais le comble des honneurs auxquels un général pouvoit aspirer, étoit le triomphe. Voyez Triomphe.
S'il y avoit des récompenses à la guerre pour animer les soldats à s'acquitter de leurs devoirs, il y avoit aussi des punitions pour ceux qui y manquoient. Ces punitions étoient de la compétence des tribuns, des préfets avec leur conseil, & du général même, duquel on ne pouvoit appeller avant la loi Porcia, portée l'an 556. On punissoit les soldats, ou par des peines afflictives, ou par l'ignominie. Les peines afflictives consistoient dans une amende, dans la saisie de leur paye, dans la bastonade, sous laquelle il arrivoit quelquefois d'expirer ; ce châtiment s'appelloit fustuarium. Les soldats mettoient à mort à coups de bâton ou de pierre, un de leurs camarades qui avoit commis quelque grand crime, comme le vol, le parjure, pour quelque récompense obtenue sur un faux exposé, pour la désertion, pour la perte des armes, pour la négligence dans les sentinelles pendant la nuit. Si la bastonnade ne devoit pas aller jusqu'à la mort, on se servoit d'un sarment de vigne pour les citoyens, & d'une autre baguette, ou même de verges pour les alliés. S'il y avoit un grand nombre de coupables, on les décimoit, ou bien l'on prenoit le vingtieme, ou le centieme, selon la griéveté de la faute.
Comme les punitions qui emportent avec elles plus de honte que de douleur, sont les plus convenables à la guerre, l'ignominie étoit aussi une des plus grandes. Elle consistoit, par exemple, à donner de l'orge aux soldats au lieu de blé, à les priver de toute la paye, ou d'une partie seulement. Cette derniere punition étoit sur-tout pour ceux qui quittoient leurs enseignes ; on leur retranchoit la paye pour tout le tems qu'ils avoient servi avant leur faute. La troisieme espece d'ignominie, étoit d'ordonner à un soldat de sauter au delà d'un retranchement ; cette punition étoit faite pour les poltrons. On les punissoit encore en les exposant en public avec leur ceinture détachée, & dans une posture molle & efféminée. Cette exposition se faisoit dans la rue du camp appellée principia : c'est-là que s'exécutoient aussi les autres châtimens. Enfin, pour comble d'ignominie, on les faisoit passer d'un ordre supérieur dans un autre fort au-dessous, comme des triariens dans les piquiers, ou dans les vélites. Il y avoit encore quelques autres punitions peu usitées.
La derniere chose dont il nous reste à parler touchant la discipline militaire, est le congé ; il étoit honnête, ou diffamant : le congé honnête, étoit celui que l'on obtenoit après avoir servi pendant tout le tems prescrit, ou bien à cause de maladie, ou de quelqu'autre chose. Ceux qui quittoient le service après avoir servi leur tems, étoient mis au nombre de ceux qu'on appelloit beneficiarii, qui étoient exempts de servir, & souvent on prenoit parmi eux les gens d'élite, evocati. Ce congé honnête pouvoit encore s'obtenir du général par faveur. Le congé diffamant, étoit lorsqu'on étoit chassé & déclaré incapable de servir, & cela pour quelque crime.
Sous Auguste, on mit en usage un congé appellé exauctoratio, qui ne dégageoit le soldat que lorsqu'il étoit devenu vétéran. On nommoit ce soldat vexillaire, parce qu'il étoit attaché à un drapeau, & que dans cet état il attendoit les récompenses militaires. De plus, quand le tems de son service étoit fini, on lui donnoit douze mille sesterces. Les prétoriens qui furent institués par cet empereur, au bout de seize ans de service, en recevoient vingt milles : quelquefois on donnoit aux soldats des terres en Italie, ou en Sicile.
On peut maintenant se former une idée complette de la discipline militaire des Romains, & du haut point de perfection où ils porterent l'art de la guerre, dont ils firent sans cesse leur étude jusqu'à la chûte de la république : c'est sans doute un dieu, dit Végece, qui leur inspira la légion, Ils jugerent qu'il falloit donner aux soldats qui la composoient, des armes offensives & défensives plus fortes & plus pesantes que celles de quelqu'autre peuple que ce fût. J'en ai dit quelque chose, mais je prie le lecteur d'en voir les détails dans Polybe & dans Josephe. Il y a peu de différence, conclut ce dernier, entre les chevaux chargés & les soldats romains. Ils portent, dit Cicéron, leur nourriture pour plus de quinze jours, tout ce qui est à leur usage, tout ce qu'il faut pour se fortifier ; & à l'égard de leurs armes, ils n'en sont pas plus embarrassés que de leurs mains. Tuscul. livre III.
Pour qu'ils pussent avoir des armes plus pesantes que celles des autres hommes, il falloit qu'ils se rendissent plus qu'hommes : c'est ce qu'ils firent par un travail continuel qui augmentoit leur force, & par des exercices qui leur donnoient de l'adresse, laquelle n'est autre chose qu'une juste dispensation des forces que l'on a.
Il faut bien que j'ajoute un mot à ce que j'ai déja dit de la discipline des soldats romains. On les accoutumoit à aller le pas militaire, c'est-à-dire, à faire en cinq heures vingt milles, & quelquefois vingt-quatre. Pendant ces marches, on leur faisoit porter des poids de soixante livres : on les entretenoit dans l'habitude de courir & de sauter tout armés. Ils prenoient dans leurs exercices des épées, des javelots, des fleches d'une pesanteur double des armes ordinaires ; & ces exercices étoient continuels. Voyez dans Tite-Live, les exercices que Scipion l'Afriquain faisoit faire aux soldats après la prise de Carthage la neuve. Marius, malgré sa vieillesse, alloit tous les jours au champ de Mars. Pompée, à l'âge de cinquante-huit ans, alloit combattre tout arme, avec les jeunes gens ; il montoit à cheval, couroit à bride abattue, & lançoit ses javelots.
Toutes les fois que les Romains se crurent en danger, ou qu'ils voulurent réparer quelque perte, ce fut une pratique constante chez eux d'affermir la discipline militaire. Ont-ils à faire la guerre aux Latins, peuples aussi aguerris qu'eux-mêmes, Manlius songe à augmenter la force du commandement, & fait mourir son fils qui avoit vaincu sans ordre. Sont-ils battus à Numance, Scipion Emilien les prive d'abord de tout ce qui les avoit amollis. Il vendit toutes les bêtes de somme de l'armée, & fit porter à chaque soldat du blé pour trente jours, & sept pieux.
Comme leurs armées n'étoient pas nombreuses, il étoit aisé de pourvoir à leur subsistance ; le chef pouvoit mieux les connoître, & voyoit plus aisément les fautes & les violations de la discipline. La force de leurs exercices, les chemins admirables qu'ils avoient construits, les mettoient en état de faire des marches longues & rapides. Leur présence inopinée glaçoit les esprits ; ils se montroient sur-tout après un mauvais succès, dans le tems que leurs ennemis étoient dans cette négligence que donne la victoire.
Leurs troupes étant toujours les mieux disciplinées, il étoit difficile que dans le combat le plus malheureux, ils ne se ralliassent quelque part, ou que le desordre ne se mît quelque part chez les ennemis. Aussi les voit-on continuellement dans les histoires, quoique surmontés dans le commencement par le nombre & par l'ardeur des ennemis, arracher enfin la victoire de leurs mains.
Leur principale attention étoit d'examiner en quoi leur ennemi pouvoit avoir de la supériorité sur eux ; & d'abord ils y mettoient ordre. Les épées tranchantes des Gaulois, les éléphans de Pyrrhus, ne les surprennent qu'une fois. Ils suppléerent à la foiblesse de leur cavalerie, d'abord en ôtant les brides des chevaux, pour que l'impétuosité n'en pût être arrêtée, ensuite en y mélant des vélites. Quand ils eurent connu l'épée espagnole, ils quitterent la leur. Ils éluderent la science des pilotes, par l'invention d'une machine que Polybe nous a décrite. En un mot, comme dit Josephe, la guerre étoit pour eux une meditation, la paix un exercice.
Si quelque nation tint de la nature ou de son institution, quelque avantage particulier, ils en firent d'abord usage : ils n'oublierent rien pour avoir des chevaux numides, des archers crétois, des frondeurs baléares, des vaisseaux rhodiens ; enfin jamais nation ne prépara la guerre avec tant de prudence, & ne la fit avec tant d'audace.
Elle parvint à commander à tous les peuples, tant par l'art de la guerre que par sa prudence, sa sagesse, sa constance, son amour pour la gloire & pour la patrie. Lorsque sous les empereurs, toutes ces vertus s'évanouirent, l'art militaire commença à décheoir ; mais lorsque la corruption se mit dans la milice même, les Romains devinrent la proie de tous les peuples. La milice étoit déja devenue très à charge à l'état. Les soldats avoient alors trois sortes d'avantages, la paie ordinaire, la récompense après le service, & les libéralités d'accident, qui devinrent des droits pour des gens qui avoient le prince & le peuple entre leurs mains. L'impuissance où l'on se trouva de payer ces charges, fit que l'on prit une milice moins chere. On fit des traités avec des nations barbares qui n'avoient ni le luxe des soldats romains, ni le même esprit, ni les mêmes prétentions.
Il y avoit une autre commodité à cela : comme les Barbares tomboient tout-à-coup sur un pays, n'y ayant point chez eux de préparatifs après la résolution de partir, il étoit difficile de faire des levées à tems dans les provinces. On prenoit donc un autre corps de Barbares toujours prêt à recevoir de l'argent, à piller & à se battre. On étoit servi pour le moment ; mais dans la suite on avoit autant de peine à réduire les auxiliaires que les ennemis.
Enfin les Romains perdirent entierement leur discipline militaire, & abandonnerent jusqu'à leurs propres armes. Végéce dit que les soldats les trouvant trop pesantes, ils obtinrent de l'empereur Gratien de quitter leur cuirasse, & ensuite leur casque ; de façon qu'exposés aux coups sans défense, ils ne songerent qu'à fuir. De plus, comme ils avoient perdu la coutume de fortifier leurs camps, leurs armées furent aisément enlevées par la cavalerie des Barbares. Ce ne fut pas néanmoins une seule invasion qui perdit l'empire, ce furent toutes les invasions. C'est ainsi qu'il alla de degré en degré de l'affoiblissement à la dégénération, de la dégénération à la décadence, & de la décadence à sa chûte, jusqu'à ce qu'il s'affaissa subitement sous Arcadius & Honorius. L'empire d'occident fut le premier abattu, & Rome fut détruite parce que toutes les nations l'attaquant à la fois, la subjuguerent, & pénétrerent par-tout. Voyez tout ce tableau dans les considérations sur les causes de la grandeur des Romains & de leur décadence. (D. J.)
Militaire, pécule (Jurisprud.) voyez Pécule castrense.
Militaire, testament (Jurisprud.) voyez Testament.
Wiktionnaire
Nom commun - français
militaire \mi.li.t??\ masculin et féminin identiques
-
Personne membre d'une armée.
- Je connais les militaires, ma Julie ; j'ai vécu aux armées. Il est rare que le c?ur de ces gens-là puisse triompher des habitudes produites ou par les malheurs au sein desquels ils vivent, ou par les hasards de leur vie aventurière. ? (Honoré de Balzac, La Femme de trente ans, Paris, 1832)
- Après l'armée des incendiaires, l'armée des voleurs ! Il n'y a pas ici de corps spéciaux. Tout le monde, par le fait qu'il est militaire, fait partie de la grande organisation de pillage. ? (Pierre Nothomb, Les barbares en Belgique, 1915)
- le général Sarrail [?] interdit aux militaires sous ses ordres d'envoyer leurs lettres par la poste. ? (Pierre Audibert, Les Comédies de la Guerre, 1928, p.93)
-
Tant qu'il y aura des militaires
Soit ton fils, soit le mien,
On ne verra, par toute la terre
Jamais rien de bien !
On te tuera pour te faire taire,
Par derrière, comme un chien :
Et tout ça pour rien ! Et tout ça pour rien ! ? (Rosa Holt, Giroflé, girofla, 1935) - [?]; j'appris dans la suite à mieux connaître le militaire qui est à portée du bruit et non à portée des coups. Il admire plus qu'on ne croirait ceux qui vont plus loin ; il les prend aisément pour des héros ; peut-être il les envie. ? (Alain, Souvenirs de guerre, page 14, Hartmann, 1937)
Adjectif - français
militaire \mi.li.t??\ masculin et féminin identiques
- Qui concerne la guerre ou les armées.
- La dernière grande guerre qu'avait soutenue l'Angleterre, la guerre contre les Boers, était oubliée, et le public avait perdu l'habitude de la critique militaire experte. ? (H. G. Wells, La Guerre dans les airs, 1908, traduction d'Henry-D. Davray et B. Kozakiewicz, Mercure de France, Paris, 1910, page 54 de l'édition de 1921)
- Acceptons que le courage militaire demeure l'apanage d'une caste enfantine et bruyante, et ne se répande pas, comme l'a fait la Légion d'honneur, son insigne, parmi les professeurs, les contrôleurs, les peintres... ? (Jean Giraudoux, Retour d'Alsace - Août 1914, 1916)
- Un adolescent est retiré de la file. Juste avant qu'une forte détonation venue d'une tour militaire l'envoie bouler sur l'asphalte, la tête broyée par une balle de mitrailleuse. ? (Calixte Baniafouna, Devoir de mémoire, page 160, L'Harmattan, 2001)
- La supériorité militaire écrasante de l'hyperpuissance américaine lui permet certes d'organiser ses expéditions sans l'aide de personne. Mais ces opérations punitives ne peuvent fonder un nouvel ordre du monde. ? (Pour un autre monde ; Un autre chemin, motion pour le congrès socialiste de Dijon du 16 au 18 mai 2003)
-
Destiné à l'usage des troupes.
- Cette voie est une route militaire.
-
(Par extension) Autoritaire ; discipliné.
- Cependant il est un agent de la Compagnie, qui ne doit pas quitter son poste, c'est Popof, ? Popof, notre chef de train, un vrai Russe, l'air militaire avec sa houppelande plissée et sa casquette moscovite, très chevelu et très barbu. ? (Jules Verne, Claudius Bombarnac, chapitre V, J. Hetzel et Cie, Paris, 1892)
Trésor de la Langue Française informatisé
MILITAIRE, adj. et subst. masc.
Militaire au Scrabble
Le mot militaire vaut 10 points au Scrabble.
Informations sur le mot militaire - 9 lettres, 5 voyelles, 4 consonnes, 7 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot militaire au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
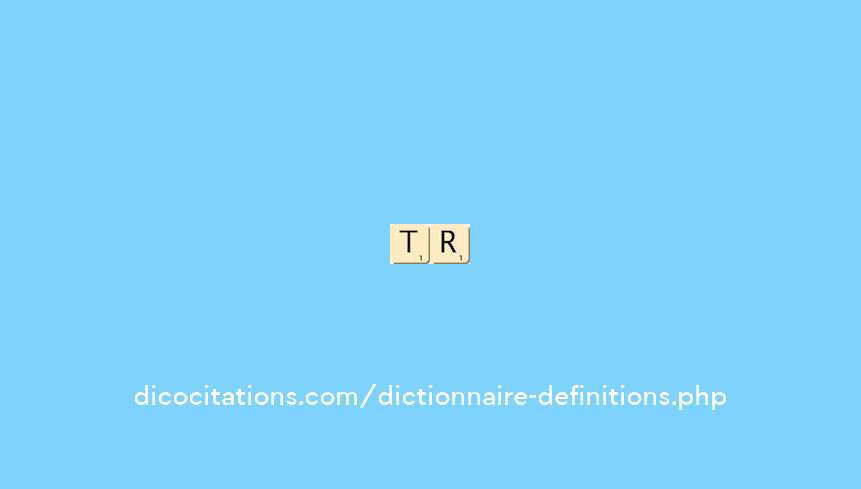
Les mots proches de Militaire
Mil Milady Milan Milanière Miliaire Milice Milieu Militaire Militairement Militant, ante Militarisation Militariser Militer Millade Mille Mille-feuille Millénaire Mille-pertuis Mille-pieds Millerolle Millet Millette Milliaire Milliard Milliasse Millième Millier Million Millionnaire Millionnairement Milord mil mil milady milan milanais milanais milanaise milanaise milanaises milanaises milans mildiou mile miles milésiennes Milesse Milhac Milhac-d'Auberoche Milhac-de-Nontron Milhaguet Milhars Milhas Milhaud Milhavet milice milices milicien miliciennes miliciennes miliciens milieu milieu milieux milita militaient militaire militaire militairement militaires militaires militait militant militant militant militante militante militantes militantes militantisme militantsMots du jour
Obsédant, ante Par Recamper Patron, onne Péricaustique Sayon Excepté, ée Élancement Portereau Sensuel, elle
Les citations avec le mot Militaire
- Dans ce siècle de concurrence sans limite et de surproduction, il y a aussi concurrence entre les armées et surproduction militaire : l'industrie elle-même étant un combat, la guerre devient la première, la plus excitée, la plus fiévreuse des industries.Auteur : Jean Jaurès - Source : Discours prononcé à la chambre des députés de l'Assemblée nationale le 7 mars 1895,
- Des militaires bourreaux ce n'était pas une nouveauté, mais ce qu'on avait encore jamais vu dans cette armée, c'étaient des médecins assassins.Auteur : André Lacaze - Source : Le Tunnel (1978)
- Ce que ces hommes voulaient: une Amérique qui contrôlerait le monde et toutes ses ressources, un monde qui obéirait aux ordres de cette Amérique, une force militaire américaine qui ferait appliquer les règlements définis par l'Amérique, et un système banquier et commercial international qui soutiendrait l'Amérique comme PDG de l'empire global.Auteur : John Perkins - Source : Les Confessions d'un assassin financier (2005)
- Au moins le service militaire c'était clair. Le service consommateur c'est plus subtil.Auteur : Denis Langlois - Source : Slogans pour les prochaines révolutions (2008)
- Curieux, chez ce peuple si sensible au rythme, la déformation caricaturale de nos sonneries militaires. Les notes y sont, mais le rythme en est changé au point de les rendre méconnaissables.Auteur : André Gide - Source : Voyage au Congo (1926)
- Tant que le militaire ne tue pas, c'est un enfant. On l'amuse aisément. N'ayant pas l'habitude de penser, dès qu'on lui parle il est forcé pour essayer de vous comprendre de se résoudre à des efforts accablants.Auteur : Louis-Ferdinand Destouches, dit Céline - Source : Voyage au bout de la nuit (1932)
- Les vrais chrétiens doivent refuser de se soumettre au service militaire.Auteur : Léon Tolstoï - Source : Les temps sont proches
- Dans ce contexte, l'usage de la force ne se justifie pas aujourd'hui. Il y a une alternative à la guerre : désarmer l'Irak par les inspections. De plus, un recours prématuré à l'option militaire serait lourd de conséquences.Auteur : Dominique de Villepin - Source : Discours au Conseil de Sécurité des Nations unies, New-York, 14 février 2003
- Même retraité, on reste militaire toute sa vie. Le colonel Buffet reçoit un blâme en 1905. Il est allé à la messe dominicale en uniforme juste après la séparation de l’Église et de l’État. Cette histoire de blâme peut paraitre surprenante à plus d'un siècle de distance mais à l'époque, les militaires se devaient de ne pas mélanger la fonction au service de l’État et les croyances personnelles. Une anecdote amusante de la vie de Charles de Gaulle éclaire cette dichotomie. Un des soupers organisé par le général tombant un vendredi , sa femme imagina de servir du poisson aux convives. L'histoire dit que l'échange fut sans appel :
- Du poisson à des militaires un vendredi ? Yvonne, vous n'y pensez pas !Auteur : Claire Berest - Source : Gabriële (2017)
- Les intellectuels sont comme les femmes, les militaires les font rêver.Auteur : André Malraux - Source : Les Noyers de l'Altenburg (1943)
- La justice militaire est à la justice ce que la musique militaire est à la musique.
Auteur : Georges Clemenceau - Source : In Bonjour, Monsieur Zola d'Armand Lanoux (1954)
- Celui qui n'est que militaire n'est qu'un mauvais militaire, celui qui n'est que professeur n'est qu'un mauvais professeur, celui qui n'est qu'industriel n'est qu'un mauvais industriel. L'homme complet, celui qui veut remplir sa pleine destinée et être digne de mener des hommes, être un chef en un mot, celui-là doit avoir ses lanternes ouvertes sur tout ce qui fait l'honneur de l'humanité.Auteur : Louis Hubert Gonzalve Lyautey - Source : Paroles d'action
- Qui êtes-vous, Victor Segalen ? Et pourquoi, depuis si longtemps, m'avez-vous hanté ? Breton, certes. Brestois, aussi. Militaire, marin et poète. Auteur : Jean-Luc Coatalem - Source : Mes pas vont ailleurs (2019)
- Je regrette, militaire, mais je refuse de serrer une main qui foule aux pieds les droits imprescriptibles de la personne humaine ! ...Auteur : Georges Remi, dit Hergé - Source : Les Aventures de Tintin, 23. Tintin et les Picaros (1976)
- C'est terrible, une guerre civile. Surtout quand c'est fait par des militaires.Auteur : Guy Bedos - Source : Journal d'un mégalo (1995)
- Internet est le produit d'une combinaison unique de stratégie militaire, de coopération scientifique et d'innovation contestataire.Auteur : Manuel Castells - Source : L'Ere de l'information, 1. La Société en réseaux (1998)
- Français ! à l'appel de M. le président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée, qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes, sûr que par sa magnifique résistance elle a rempli son devoir vis-à-vis de nos alliés, sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander, sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur.
Auteur : Philippe Pétain - Source : Discours du maréchal Pétain le 17 juin 1940
- Pourquoi avons-nous, en France, la curieuse habitude de célébrer la paix par des revues militaires?Auteur : André Frossard - Source : Sans référence
- Echecs (jeu des): Image de la tactique militaire. Tous les grands capitaines y étaient forts. Trop sérieux pour un jeu, trop futile pour une science.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Dictionnaire des idées reçues (1913)
- Les beaux militaires, depuis un siècle, remplissent merveilleusement leurs culottes, mais ils ne remplissent pas leurs destins.Auteur : Georges Bernanos - Source : La Grande Peur des biens-pensants (1931)
- La Servitude militaire est lourde et inflexible comme le masque de fer du prisonnier sans nom, et donne à tout homme de guerre une figure uniforme et froide.Auteur : Alfred de Vigny - Source : Servitude et grandeur militaires (1835)
- L'une des plus grandes sagesses de l'art militaire, c'est de ne pas pousser son ennemi au désespoir.Auteur : Michel de Montaigne - Source : Essais
- Durant ce périple où, en comparaison, tout nous est obligé et prévisible, nos lectures parallèles que nous commentons avec ardeur nous mettent du baume au coeur. Elles nous sont un antidote à cette Corée fade qui défile par la lunette arrière et d'où l'on aperçoit, floutés par la vitesse, des grumeaux de gens qui marchent, des camions hoquetant leur nuage de charbon, des jeeps avec des militaires, des colonnes de types courbés, tenant des pelles, des râteaux, des sacs en toile de jute, des baluchons d'herbes, nous adressant parfois des signes puis se ravisant, tous très jeunes, la plupart du temps hébétés, somnanbuliques, cassés, comme des pestiférés du Moyen Age éparpillés sur la parcelle d'un châtelain invisible et démoniaque.Auteur : Jean-Luc Coatalem - Source : Nouilles froides à Pyongyang (2013)
- C'est un soldat encore, où plutôt la moitié d'un soldat, car il est vêtu d'un calot et d'une vareuse militaires, mais avec un pantalon civil de couleur noire et des souliers en daim gris.Auteur : Alain Robbe-Grillet - Source : Dans le labyrinthe (1959)
- La Fièvre a été une épidémie tsunami. Trop rapide, trop mortelle.
Malgré les protocoles, les systèmes et les vaccins, malgré l’activité paniquée de virologistes et d’épidémiologistes, de centres pour le contrôle et la prévention des maladies, les décisions de gouvernements et les interventions militaires – et parfois à cause de certaines de ces actions –, la Fièvre a décimé quatre-vingt-quinze pour cent de la population mondiale. En quelques mois seulement. Auteur : Deon Meyer - Source : L'Année du lion (2016)
Les citations du Littré sur Militaire
- Tout l'intérieur bourgeois du beau soldat est illuminé par l'éclat de cet endimanchement militaireAuteur : E. BERGERAT - Source : Journ. offic. 15 fév. 1876, p. 1230, 3e col.
- Il y avait dans la Grèce deux sortes de républiques : les unes étaient militaires, comme Lacédémone ; d'autres étaient commerçantes, comme AthènesAuteur : Montesquieu - Source : ib. V, 6
- Laissez moins de fumée à vos feux militairesAuteur : Corneille - Source : Nicom. II, 3
- Je serai au désespoir, s'il faut que je reprenne encore les pensées de la guerre... il est triste de s'avancer dans le pays de la misère ; c'est ce qui est indubitable dans votre métier [militaire]Auteur : Madame de Sévigné - Source : à Bussy, 12 octobre 1678
- Le dit Monstrelet appelle les dits soldats pietons, comme aussi M. du Bellay en son livre de l'art militaireAuteur : BRANT. - Source : Cap. franç. t. IV, p. 37, dans LACURNE
- Ayant régné sept ans, son ardeur militaire Rallume cette guerre où succomba son frèreAuteur : Corneille - Source : Rodog. I, 1
- La discipline militaire, l'âme du service, si rigidement soutenue par Louvois, tomba dans un relâchement funesteAuteur : Voltaire - Source : Louis XIV, 18
- Il faut envoyer dans les guerres étrangères la jeune noblesse ; ceux-là suffisent pour entretenir toute la nation dans une émulation de gloire, dans l'amour des armes, dans le mépris des fatigues et de la mort même, enfin dans l'expérience de l'art militaireAuteur : FÉN. - Source : ib. XII
- Des militaires largement stipendiés pendant de longues années d'oisivetéAuteur : RAYNAL - Source : Hist. phil. IV, 18
- Dans cette révolution toute militaire [la restauration de Napoléon en 1815], dans cet avénement d'empereur romain proclamé par une garde prétorienne, ce qui manquait c'était le nombre des soldatsAuteur : VILLEMAIN - Source : Souvenirs contemporains, Cent-Jours, ch. V.
- On vit au VIIIe siècle une foule de propriétaires succombant sous le poids des charges publiques, et notamment du service militaire, abandonner leur propriété et la recevoir en usufruit sous forme de précaireAuteur : E. BOUTARIC - Source : ib. p. 11
- On voit, dans l'histoire de la Chine, un grand nombre de lois pour ôter aux eunuques tous les emplois civils et militaires ; mais ils reviennent toujours ; il semble que les eunuques en Orient soient un mal nécessaireAuteur : Montesquieu - Source : Espr. XV, 19
- Le ministre éclairé qui, en changeant la forme de notre militaire, a diminué le nombre des officiersAuteur : ST-LAMBERT - Source : Saisons, Discours préliminaire
- Le premier precelle en exploits militairesAuteur : MONT. - Source : III, 129
- Un cacique, un corrégidor, des régidors et des alcades formaient le corps militaire, civil et politique, des RéductionsAuteur : Chateaubriand - Source : Génie, IV, IV, 5
- Des xylofers ; le fusil avec sa bayonnette garnie de son fourreau peut très bien remplacer cet instrument pour les militairesAuteur : N. LAISNÉ - Source : Notions pratiq. sur les exercices du corps, p. 28
- Les Morvandiaux sont bons soldats ; conscrits, ils quittent leurs chères montagnes avec regret ; mais à peine ont-ils posé leurs sabots et endossé l'habit militaire....Auteur : DUPIN - Source : Morvand, p. 24
- La mort de Néron causa une révolution dans l'État ; l'élection passa aux légions, et la constitution devint militaireAuteur : CHATEAUBR. - Source : Études hist. I, 1
- Jamais ils ne connurent le fond de l'art militaireAuteur : BOSSUET - Source : ib. III, 5
- Ils [les vexillaires] tenaient levés les signes militaires des cohortes, l'aigle, le dragon, le loup, le minotaureAuteur : CHATEAUBR. - Source : Mart. VI
- Nulle cadence, nul accent mélodieux dans les airs du peuple ; les instruments militaires, les fifres de l'infanterie, les trompettes de la cavalerie, tous les cors, tous les hautbois, les chanteurs des rues, les violons de guinguette, tout cela est d'un faux à choquer l'oreille la moins délicateAuteur : Jean-Jacques Rousseau - Source : Hél. II, 23
- Il fut nourry en cest apprentissage de la discipline militaireAuteur : AMYOT - Source : Flamin. 1
- On l'appeloit en Piemont un des rodomones de là [brave militaire]Auteur : BRANT. - Source : Dames gal. t. II, p. 261, dans LACURNE
- Un groupe de jeunes gens qui n'avaient pas eu besoin d'avoir recours aux autorités pour se construire un sautoir [au moyen de cordes tendues sur des pieux fourchus].... je préférerais beaucoup pour les militaires les tertres gazonnés de différentes hauteurs...Auteur : N. LAISNÉ - Source : Notions pratiques sur les exercices du corps, p. 27
- Je dois aux yeux d'Alcmène un portrait militaire Du grand combat qui met nos ennemis à bas ; Mais comment diantre le faire Si je ne m'y trouvai pas ?Auteur : Molière - Source : Amph. I, 1
Les mots débutant par Mil Les mots débutant par Mi
Une suggestion ou précision pour la définition de Militaire ? -
Mise à jour le mercredi 11 février 2026 à 03h02

- Machiavelisme - Magie - Main - Maison - Maitre - Maître - Maitresse - Maîtresse - Maitrise - Mal - Malade - Maladie - Male - Malheur - Malheureux - Malveillance - Maman - Maman Enfant - Maman Fille - Maman Fils - Maman - Management - Manger - Manie - Manque - Marcher - Mari - Mariage - Mariage amour - Mariage heureux - Marseillais - Masturbation - Materialisme - Mathematique - Matiere - Maux - Maxime - Mechancete - Méchanceté - Méchant - Medaille - Medecin - Médecin - Medecine - Medias - Mediocrite - Medisance - Méfiance - Mefiance - Meilleur - Melancolie - Melomane - Memoire - Mémoire - Mensonge - Menteur - Mentir - Mepris - Mere - Mère_enfant - Mère_fils - Mère_fille - Mériter - Metaphysique - Methode - Metier - Métier - Meurtre - Militaire - Miracle - Miroir - Misère - Misere - Misogyne - Mode - Moderation - Moderne - Modestie - Moeurs - Mondanite - Monde - Mondialisation - Monogamie - Montagne - Monture - Moquerie - Moquerie - Morale - Mort - Mot - Mots d'amour - Motivation - Mourir - Mouvement - Moyens - Musique - Mystere - Mysticisme - Mythe - Mythologie
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur militaire
Poèmes militaire
Proverbes militaire
La définition du mot Militaire est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Militaire sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Militaire présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
