La définition de Ourdir du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Ourdir
Nature : v. a.
Prononciation : our-dir
Etymologie : Berry, ordir ; prov. ordir ; esp. urdir ; ital. ordire ; du bas-lat. ordire (dans Isidore), ourdir ; du lat. ordiri, commencer.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de ourdir de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec ourdir pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Ourdir ?
La définition de Ourdir
Disposer, arranger les fils de la chaîne pour faire un tissu.
Toutes les définitions de « ourdir »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
T. d'Arts. Préparer ou disposer sur une machine les fils de la chaîne d'une étoffe, d'une toile, etc., pour mettre cette chaîne en état d'être montée sur le métier, où l'on doit la tisser en faisant passer au travers, avec la navette, le fil de la trame. Ourdir de la toile. Ourdir la trame d'un drap. Fig., Ourdir une trame, Former un complot. C'est lui qui a ourdi cette trame. On dit de même Ourdir un complot, ourdir une trahison, une intrigue.
Littré
-
1Disposer, arranger les fils de la chaîne pour faire un tissu.
Tous ces tapis Qu'a tissus la Savonnerie, Ceux que les Persans ont ourdis
, Voltaire, Ép. 28.Terme de corderie. Étendre, élonger tous les fils de caret qui doivent composer un cordage.
Entrelacer des cordons de paille pour faire une natte.
Tourner l'osier autour du moule, le tortiller pour en faire des paniers ou d'autres ouvrages.
Terme de pêche. Ourdir les cannes, faire des espèces de claies semblables aux paillassons des jardiniers.
Poétiquement et fig.
Et vous, fatales s?urs, reines des destinées, Vous dont les noires mains ourdissent nos années
, Rotrou, Herc. mour. V, 2.La Parque à filets d'or n'ourdira point ma vie, Je ne dormirai point sous de riches lambris?; Mais voit-on que le somme en perde de son prix??
La Fontaine, Fabl. XI, 4. -
2 Fig. Disposer comme le tisserand dispose ses fils.
Cependant, son Dauphin? De faits si renommés ourdira son histoire Que ceux qui dedans l'ombre éternellement noire Ignorent le soleil, ne l'ignoreront pas
, Malherbe, II, 1.De leur mollesse léthargique Le discord sortant des enfers, Des maux que nous avons soufferts Nous ourdit la toile tragique
, Malherbe, VI, 29.C'est elle [notre âme] qui forme la liaison de nos sensations, et qui ourdit la trame de nos existences par un fil continu d'idées
, Buffon, Disc. nat. anim. ?uv. t. V, p. 317. -
3 Fig. Tramer, machiner.
Que ne sait point ourdir une langue traîtresse Par sa pernicieuse adresse?!
La Fontaine, Fabl. III, 6.Quand on est à cent lieues de Paris, il est difficile de prévoir et de parer les effets des petites cabales, des petites intrigues, des petites méchancetés qu'on y ourdit sans cesse pour s'amuser
, Voltaire, Lett. d'Alemb. 19 mai 1773.En voyant ourdir autour de moi mille trames, je ne savais me plaindre que de la tyrannie de ceux que j'appelais mes amis
, Rousseau, Conf. IX.Vous y verrez avec quel artifice il a ourdi sa calomnie
, Marmontel, Mém. VIII. -
4 Fig. Il se dit de la contexture des ouvrages d'esprit.
Son talent [de Virgile] était de faire des tableaux plutôt que d'ourdir avec art la trame d'une fable intéressante
, Voltaire, Ess. poés. ép. ch. 3. - 5S'ourdir, v. réfl. Être ourdi. La toile s'ourdissait.
HISTORIQUE
XIIe s. Trenchede est ensement cum de teissant [tissant] la meie vie?; dementres uncore que ordisseie, suztrenchad mei [me trancha par dessous]
, Liber psalm. p. 233.
XIIIe s. Nules mestresses du mestier ne pueent ne ne doivent ourdir fil aveques soie ne flourin [espèce de bourre de soie] aveques soie, parce que l'uevre est fause et mauvese
, Liv. des mét. 88.
XVe s. Sans ourdir on ne peut tiltre [tisser]
, Coquillart, p. 15, dans LACURNE.
XVIe s. Tarquinius faisoit soubs main tenter le peuple, et ourdissoit une trahison
, Amyot, Publ. 5. Pendant que ceste trame s'ourdissoit
, Amyot, Fab. 44. Ourdir, pour s'empestrer, mille nouveaux liens, Estre serf d'un tyran qui rit du mal des siens?
, Desportes, Amours d'Hippolyte, XLIV.
Encyclopédie, 1re édition
OURDIR, terme de Manufacture, ce mot signifie préparer ou disposer sur une machine faite exprès, les fils de la chaîne d'une étoffe, d'une toile, d'une futaine, d'un basin, &c. pour la mettre en état d'être montée sur le métier, afin de la tisser en faisant passer à travers avec la navette le fil de la trème : après que la chaîne d'une étoffe de laine a été ourdie, on la colle, & on la fait sécher, sans quoi il seroit difficile de la pouvoir bien travailler. (D. J.)
Ourdir une corde, terme de Corderie, qui signifie disposer le long de la corderie autant de fils qu'il en faut pour former la corde qu'on se propose de faire, & leur donner une longueur & une tension égale.
Quand le cordier a étendu un nombre suffisant de fils, il les divise en autant de parties, qu'il veut que sa corde ait de cordons ; il fait un n?ud au bout de chacun de ces faisceaux pour réunir tous les fils qui les composent, puis il divise chaque faisceau en deux pour passer dans le milieu l'extrémité des manivelles, où il les assujettit par le moyen d'une clavette. Voyez l'article Corderie.
Ourdir, terme de Mâçons ; les mâçons disent ourdir un mur, pour signifier qu'ils y mettent le premier enduit ; ainsi ourdir en terme de mâçon, c'est faire un grossier enduit avec de la chaux ou du plâtre sur un mur de moëlon, par-dessus lequel on en met un autre fin qu'on unit proprement avec la truelle. (D. J.)
Ourdir a la tringle, terme de Nattier en paille ; c'est bâtir & arrêter les cordons de la natte sur les clous de deux grosses & longues pieces de bois que les Nattiers nomment des tringles.
Ourdir, (Rubanier.) est l'action d'assembler une quantité plus ou moins considérable de brins de soie pour en former un tout qui composera la chaîne telle qu'elle soit. Nous supposerons dans tout cet article une piece ourdie à seize rochets pour nous fixer à une idée déterminée, ce que nous dirons relativement à cette quantité devant s'entendre de toute autre ; outre que c'est la façon la plus ordinaire, sur-tout pour le ruban, que nous envisagerons spécialement dans cette explication : je suppose même que ce ruban est à vingt portées, qui formeront six cens quarante brins de soie dont cette chaîne sera composée ; expliquons tout ceci séparément. Les rochets sont placés dans les broches de la banque, ces banques varient quant à la forme chez plusieurs ouvriers, mais reviennent toutes à un même but ; les rochets sont placés, dis-je, à cette banque, huit d'un côté & huit de l'autre, de façon qu'il y ait sept déroulemens en-dessus & en-dessous, & cela pour la facilité de l'encroix, & alternativement depuis le premier rochet jusqu'au dernier ; ce qui étant fait, l'ourdisseur prend les seize bouts de soie qu'il noue ensemble, & en les ouvrant à-peu-près en égale quantité, il fixe ce n?ud sur la cheville du moulin qui est en-haut, puis il encroise par deux brins. Voyez Encroix. Il décharge ses doigts qui sont le pouce & l'index de la main droite, de ces seize brins de soie ainsi encroisés sur deux autres chevilles qui avoisinent celle dont on vient de parler ; puis au moyen de la manivelle du banc à ourdir sur lequel il est assis qu'il tourne de droite à gauche, l'ourdissoir tourne dans le même sens & les soies par la descente continuelle & mesurée du blin, voyez Blin, s'arrangent sur le moulin & prennent la figure spirale que le blin leur impose, étant parvenu à la longueur qu'il veut donner à la piece (& qui se connoît par la quantité de tours de la spirale, puisque sachant ce qu'un tour contient, on saura ce qu'une quantité en doit contenir) il arrête & encroise par portée à cet endroit, ce qui se fait en prenant à la fois les seize brins, & les passant dessus puis dessous les chevilles de l'encroix d'en-bas, & revenant sur ses pas de maniere qu'il passe ces seize brins dessus puis dessous les mêmes chevilles ; il remonte en tournant la manivelle en sens contraire, c'est-à-dire, qu'il tourne à présent de gauche à droite ; il remonte jusqu'en haut où étant arrivé, il encroise de nouveau par deux brins comme la premiere fois, & voilà ce qu'on appelle portée ; on voit que par cette opération il y a trente-deux brins sur l'ourdissoir, c'est ce qui constitue une portée, & que pour faire une piece de vingt portées, il faut vingt descentes & vingt remontées, ce qui formera les six cens quarante brins requis, en multipliant trente-deux par vingt. Si l'on vouloit qu'il y eût une demi-portée avec un nombre de portées complettes, on comprend assez que pour lors, il ne faudroit qu'arrêter au bas de la derniere descente : pour savoir si on a le nombre de portées que l'on souhaite, on les peut compter sur l'encroix d'en bas, en amenant la totalité auprès des boutons des chevilles de l'encroix, & les repoussant une à une dans le fond, ce qui se fait aisément, puisque chaque demi-portée se distingue de sa voisine, parce qu'ayant été encroisée en totalité, c'est-à-dire, les seize brins à la fois, & tournée dessus une cheville puis sous l'autre, ensuite sur cette derniere & sous la premiere, comme il a été déja dit dans cet article, ce sont les doigts index des deux mains qui font cette opération en les amenant un peu à soi ; ils attirent un peu en-devant toutes les portées, on lâche l'un ou l'autre de ces deux doigts, mais non pas tous deux à la fois ; il se détache par ce moyen une demi-portée qui est reçue sur le doigt mitoyen de la main vacante qui s'introduit entr'elle & toutes les autres, puis donnant le même mouvement avec l'index de cette même main, l'autre demi-portée est de même reçue sur le mitoyen de l'autre main. Voilà donc ces deux doigts introduits entre une portée entiere & la totalité des autres, cette portée est poussée au fond des chevilles par le dos de ces deux doigts, & ainsi des autres jusqu'au bout. Lorsqu'on veut ourdir de plusieurs couleurs à côté les unes des autres pour faire du ruban rayé, il n'y a pour cela qu'à changer les seize rochets de la premiere & y en substituer un autre nombre de différente couleur, & cela pour autant de portées que l'on voudra, puis reprendre encore les premiers ou même d'autres encore de différentes couleurs, prenant garde d'observer l'égalité des couleurs dans les distances des rayeures, c'est à-dire qu'il y ait pareille quantité d'une couleur à un bord qu'à l'autre, le contraire étant dérangeroit la symmétrie, à-moins qu'on ne voulût faire du ruban appellé boiteux, voyez Boiteux. Pour les ouvrages nuancés, c'est-à-dire dont la couleur va en diminuant par gradation, il ne s'agit que de mettre à la banque les deux rochets de la couleur la plus foncée de celle que l'on traite, par exemple, la couleur de rose ; les deux rochets seront presque de couleur de cerise ou au moins de couleur de rose foncée ; les deux autres rochets seront de couleur de rose tant soit peu plus clair, les deux suivans encore un peu plus clair que les derniers & toujours de même, jusqu'à deux rochets qui se trouveront être de couleur de chair, étant encroisés deux à deux, comme il a été dit plus haut ; ces différentes nuances se trouveront distinguées chacune à leur place dans le fil de l'encroix. Après que la piece quelle qu'elle soit a été ainsi ourdie ; il est question de se préparer pour l'ôter de dessus l'ourdissoir, voici comme il faut s'y prendre pour y parvenir ; il faut commencer par passer le bout d'un fil (pendant que l'on tient l'autre dans la main), à travers le premier vuide que laissent entr'elles les soies sur les chevilles de l'encroix, puis ramenant ce bout de fil par-devant, après qu'il a passé par le second vuide des mêmes chevilles ; ce bout est noué avec celui qui étoit resté dans la main, ce n?ud doit être exactement fait pour n'être point sujet à se dénouer ou à se casser, ce qui perdroit totalement tout ce qui vient d'être fait, puisque le tout se confondroit pêle-mêle, & deviendroit impossible à débrouiller ; ce fil conserve les soies dans le même arrangement où elles étoient sur les chevilles de l'encroix, il doit être un peu long ; cette longueur lui est nécessaire pour pouvoir débrouiller chaque brin qui est à présent composé de deux (puisqu'il a été ainsi encroisé) pour le pouvoir passer dans les lisses & ensuite dans le peigne chacun à sa place & dans l'ordre de l'ourdissage. Ce qui vient d'être fait à l'encroix d'en-haut doit être fait aussi à l'encroix d'en-bas, où l'on a encroisé par demi-portée, ce qui distinguera encore chaque portée pour pouvoir être mise chacune à part dans les dents de l'escalette, lorsqu'il s'agira de ployer la piece en large pour la mettre sur le métier, voyez Ployoir ; ce bout de fil est d'une telle conséquence, qu'il y a quantité d'ourdisseurs qui encroisent par deux, en-bas comme en-haut, afin que si par malheur un des deux fils d'encroix venoit à se rompre, on pût avoir recours à l'autre en retournant la piece, étant sûrs de recouvrer cet encroix à l'autre bout, précaution louable & qui devroit être généralement suivie ; étant assuré par ce moyen de la solidité de ces encroix, il faut ôter cette piece de dessus l'ourdissoir ; si les deux encroix sont encroisés par deux, il n'importera par lequel bout commencer ; mais si l'un étoit par portée, il faudroit commencer par l'autre, c'est-à-dire par celui qui est encroisé par deux, afin que le bout encroisé par portées se trouvât sur le billot où le tout va être mis, & qui se trouvera par ce moyen dessus lorsqu'il faudra plier la piece en large ; ce bout quel qu'il soit par lequel on veut commencer, est dépassé de dessus les chevilles de l'encroix, & passé au moyen de plusieurs tours qu'on lui fait faire à l'entour du billot, dont on tient les deux bouts dans les deux paumes des mains, en le faisant tourner entre elles par le moyen des pouces qui posent sur les bords ; il tourne de dedans en-dehors, en enroulant avec lui la piece contenue sur l'ourdissoir ; mais cet ourdissoir libre déroulera trop vîte & fera relever trop lâche, il y a plusieurs moyens pour obvier à cet inconvénient ; premierement, lorsque l'ourdissoir a un plancher ; après avoir dépassé la corde de dessus la grande poulie d'en-bas, on attache au moyen d'un petit clou qui est sur le bord de cette poulie, une boîte remplie de ferrailles ou de pierres, laquelle boîte s'appelle charrette ; cette charge qui est à plat sur le plancher dont on parle, & qu'il faut que l'ourdissoir fasse tourner avec lui le fait aller doucement, & il ne cede que conséquemment au tirage du billot ; si ce plancher n'y étoit pas, ainsi qu'à beaucoup d'ourdissoirs où il manque, il faut en ce cas approcher le pié gauche & le poser de façon qu'il puisse recevoir sur le bout l'extrémité de chaque aîle du moulin, on est maître par-là de diriger le mouvement de ce moulin, ou même de l'arrêter tout-à-fait lorsqu'il est nécessaire. J'ai parlé plus haut du banc à ourdir, il y a beaucoup d'ourdissoirs où cette partie manque, pour éviter, disent ceux qui n'en veulent pas, l'embarras qu'il cause n'y ayant jamais trop de place pour tout ce métier, pour lors il faut y suppléer en faisant tourner ce moulin par l'impulsion de la main gauche contre l'aîle du moulin où elle le rencontre ; il suffit d'une chaise pour être assis auprès de l'ourdissoir, il y en a même qui se tiennent debout, chacun fait à sa façon : quelquefois l'ourdissoir devient rude à tourner, ce qui nuit à l'ourdissage, sur-tout si ce sont des soies extrèmement fines ; on y remédie en faisant sortir le moulin de sa situation suffisamment pour découvrir la petite crapaudine qui lui sert de centre, & y mettre de l'huile, puis le moulin est remis en son lieu & tourne avec plus de douceur : j'ai dit dans cet article, que les rochets étoient mis à la banque alternativement en sens contraire, c'est-à-dire que le déroulement se fait en-dessus & en-dessous alternativement, voici à quoi je destine cet usage ; lorsqu'il s'agira d'encroiser par deux, les deux brins qui doivent être encroisés ensemble se seront plus approchés par la différence de leur mouvement ; ensorte que l'ourdisseur les trouvera sous ses doigts presque comme il les lui faut pour les encroiser ; il doit être encore dit ici, qu'il faut que l'ourdisseur ait presque toujours les yeux sur la banque, pour être en état de renouer sur le champ les brins qui viennent à casser, ce qu'il apperçoit par la cessation du mouvement du rochet.
Ourdir, (Soierie.) c'est distribuer la quantité de fils qui doivent former la chaîne sur l'ourdissoir.
Pour cet effet, on prend les quarante fils qui composent la cantre, & après les avoir fait passer chacun dans une boule de verre, attachée au-dessus de chaque rochet sur lequel la soie est devidée, on noue tous ces fils ensemble ; ensuite on les met sur une premiere cheville qui est à une traverse au haut de l'ourdissoir ; après quoi on les enverge par l'insertion des doigts, voyez Enverger. Envergées, on les place sur deux autres chevilles à quelque distance de la premiere, puis on passe tous les fils ensemble sur une tringle de fer bien polie, la moitié de ces mêmes fils étant séparée par une autre tringle également polie. Les deux tringles de fer étant attachées au plot de l'ourdissoir, qui au moyen d'une mortoise quarrée & de la grandeur d'un des quatre montans qui sont arrêtés en-haut & on-bas des deux croisées, dont celle d'en-bas ayant une crapaudine de cuivre dans le milieu où entre le tourillon de l'arbre de l'ourdissoir, leur donne la liberté de tourner, a la liberté de monter & de descendre. A la croisée d'en-haut est passée une broche de fer, sur laquelle s'enroule & déroule une corde de boyau, passée sur une poulie du plot, & arrêtée à un tourniquet posé perpendiculairement à la poulie du plot.
Quand l'ouvrier met l'ourdissoir en mouvement, la corde qui se déroule laisse descendre le plot ; ce piot conduit tous les fils qu'il tient arrêtés entre deux poulies, de même que par la tringle supérieure, jusqu'à ce que le nombre de tours qui indique la quantité d'aunes qu'on veut ourdir soit complet.
Quand on a le nombre de tours desiré, on prend la demi-portée avec la main droite, & la passant sur une cheville, on la fait passer dessous une seconde, & la ramenant par le dessus, on la passe ensuite dessous la premiere ; de maniere que la demi portée ou la brassée placée alternativement dessus & dessous les deux chevilles, forme une espece d'envergeure pour les portées seulement ; ce qui donne la facilité de les compter.
Quand cette opération est faite, on fait tourner l'ourdissoir en sens contraire ; de maniere que la corde du plot s'enroule & le fait monter jusqu'à l'endroit d'où il étoit descendu. Alors on enverge de nouveau, fil par fil, & l'on mêle les fils envergés sur les chevilles où ont été posés les premiers ; & faisant passer la brassée sur la premiere, on enverge de nouveau, on descend comme la premiere fois & on remonte de même, jusqu'à ce que la quantité de portées qui doivent former la chaîne soient ourdies.
La piece ourdie, on passe des envergeures en-bas & en-haut ; celle d'en bas servant à séparer les portées pour les mettre au rateau, quand on plie la piece sur l'ensuple de dessus. L'envergeure d'en-haut sert à prendre les fils de suite & de la même façon qu'ils ont été ourdis ; pour tendre la piece on la remonte.
Les envergeures passées & arrêtées, on tire les chevilles d'en-bas, & on leve la piece en chaînette, & pour lors on lui donne le nom de chaîne. Voyez l'article Chaine & Ourdissage.
Ourdir, terme de Vanier, signifie tourner & placer l'osier autour d'un moule, pour commencer à monter l'ouvrage.
Wiktionnaire
Verbe - français
ourdir \u?.di?\ transitif 2e groupe (voir la conjugaison)
-
(Tissage) Préparer ou disposer sur une machine, l'ourdissoir, les fils de la chaîne d'une étoffe, d'une toile, etc., pour mettre cette chaîne en état d'être montée sur le métier, où l'on doit la tisser en faisant passer au travers, avec la navette, le fil de la trame.
- Dans d'immenses pièces où règne une atmosphère chaude et humide afin d'éviter toute électricité statique, les fibres sont ourdies et ensuite tissées.? (Fabrice LÉONARD ? Au pays des fils d'or - Journal Le POINT, page 144, N° 2193-25, septembre 2014)
-
(Par extension) (Figuré) Préparer la trame d'une action.
-
La ruse la mieux ourdie
Peut nuire à son inventeur
Et souvent la perfidie
Retourne à son auteur. ? (Jean de La Fontaine, Fables, « La Grenouille et le Rat ») - Malgré moi, j'ourdissais des plans abominables ; et chaque jour Madeleine, à son insu peut-être, mettait le pied dans des trahisons. ? (Eugène Fromentin, Dominique, L. Hachette et Cie, 1863, réédition Gründ, page 177)
- Que les instruments qui ont servi à ourdir cette sanglante machination politique doivent disparaître, cela est évident ? ? (Victor Serge, Portrait de Staline, 1940)
- Ah ! elle avait été bien ourdie la machination du docteur de La Pommerais ! Il est bien connu que la civilisation ne tend nullement à faire disparaitre la délinquance mais bien à la faire évoluer. ? (Achille Dehel, Le poison au service du crime, 1946)
- J'imaginais les affres du Dominateur, allongé dans son sépulcre, essayant d'ourdir une contre-attaque. ? (Glen Cook, Le Château noir, 1984)
-
La ruse la mieux ourdie
Trésor de la Langue Française informatisé
OURDIR, verbe trans.
Ourdir au Scrabble
Le mot ourdir vaut 7 points au Scrabble.
Informations sur le mot ourdir - 6 lettres, 3 voyelles, 3 consonnes, 5 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot ourdir au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
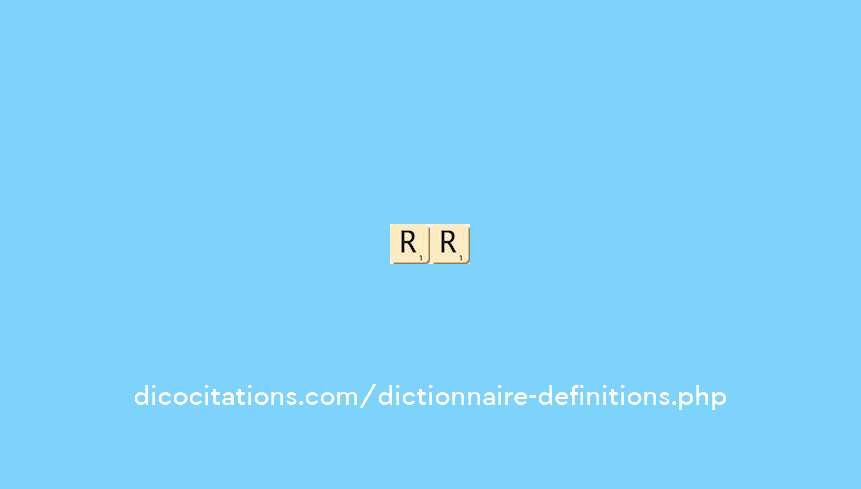
Les mots proches de Ourdir
Ouragan Ouraque Ource Ourdi, ie Ourdir Ourdissage Ourdisseur, euse Ourdissure Ourlé, ée Ourler Ourlet Ours Ourse Ourseau Oursin Oursin, ine Ourson Our ouragan ouragans ouralienne ouraniennes Ourches Ourches-sur-Meuse Ourde ourdi ourdie ourdies ourdir ourdira ourdis Ourdis-Cotdoussan ourdissage ourdissait ourdissant ourdissent ourdisseur ourdisseurs ourdisseuses ourdissoir ourdit Ourdon ourdou ourlaient ourlait ourlant ourle ourlé ourlée ourlées ourlent ourler ourlés ourlet ourlets ouroboros Ourouër Ourouer-les-Bourdelins Ouroux Ouroux-en-Morvan Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie Ouroux-sur-Saône ours Ours-Mons Oursbelille ourse Oursel-MaisonMots du jour
-
préméditée pointillistes libérons esbroufer efforcé chaparder démasquée romances bromures embellissons
Les citations avec le mot Ourdir
- Son arsenal anti-émeutes... Il a un tas de trucs comme ça: Pour assourdir, pour aveugler, pour faire éternuer, pour faire pleurer...Auteur : Aimé Césaire - Source : Une tempête (1969)
- On peut comparer les malheureuses productions de cette espèce à ces jours affligeants de l'hiver, où un brouillard épais, joint à une gelée pénétrante, semble à la fois engourdir et contrister tous les êtres vivants.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Eloges, Crébillon
- Il ne faut pas ourdir plus qu'on ne peut tisser.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe
- Mais peu à peu ses membres s'engourdirent, sa pensée s'assoupit, devint incertaine, flottante.Auteur : Guy de Maupassant - Source : Contes de la bécasse (1883)
- Quand nos doigts engourdis de froid ne pouvaient plus tenir la plume, la flamme de la lampe était le seul foyer où nous pouvions les dégourdir.Auteur : Jean-François Marmontel - Source : Mémoires
- M’étourdir. Évacuer. Vivre. Je noyai mon chagrin en m’épuisant dans les bras du père de mes enfants, de cet homme que j’avais aimé, je pleurais dans les larmes, la sueur, les rires, les vapeurs d’alcool, ma tristesse d’avoir perdu le père que je n’avais pas eu.Auteur : Agnès Martin-Lugand - Source : La Datcha (2021)
- Nous ne sommes jamais plus mécontents des autres que lorsque nous sommes mécontents de nous. La conscience d'un tort nous rend impatients, et notre coeur rusé querelle au-dehors pour s'étourdir au-dedans.Auteur : Henri-Frédéric Amiel - Source : Journal intime, 10 février 1846
- Dieu est amour (et humour), mais nous passons notre temps à l'alourdir, à le déformer et à l'oublier. Auteur : Philippe Sollers - Source : Grand beau temps. Aphorismes et pensées
- Ne pas alourdir ses pensées du poids de ses souliers.Auteur : André Breton - Source : Nadja (1928)
- Ma seule solution, et je m'en félicite vivement, était de faire ce que j'avais envie de faire : la fête. Ce fut une bien belle fête, d'ailleurs, entrecoupée de romans divers et de pièces diverses. Et là finit mon histoire. Après tout, qu'est-ce que j'y peux ? Ce qui m'a toujours séduite, c'est de brûler ma vie, de boire, de m'étourdir. Et si ça me plaît, à moi, ce jeu dérisoire et gratuit à notre époque mesquine, sordide et cruelle, mais qui, par un hasard prodigieux dont je la félicite vivement, m'a donné les moyens de lui échapperAuteur : Françoise Sagan - Source : Des bleus à l'âme (1972)
- Péguy a montré que l'on pouvait assourdir le coup de cymbale du point d'exclamation en le remplaçant par un simple point.Auteur : Charles Dantzig - Source : Dictionnaire égoïste de la littérature française (2005)
- Elle avait caché là sa tête, afin d'assourdir ses horribles cris, obéissant à une sorte d'instinct pudique: c'étaient des sanglots, des pleurs d'enfant, mais plus pénétrants, plus plaintifs.Auteur : Honoré de Balzac - Source : Le Message
- Ci-gît qui ne cessa d'étourdir les humains - Et qui, dans le barreau, n'eut relâche ni pause: - Le meilleur droit du monde eût péri dans ses mains, - Aussi, contre la mort, perdit-il pas sa cause?Auteur : Isaac de Benserade - Source : Epitaphe d'un avocat
- Le seul moyen de supporter l'existence, c'est de s'étourdir dans la littérature comme dans une orgie perpétuelle. Le vin de l'Art cause une longue ivresse et il est inépuisable. C'est de penser à soi qui rend malheureux.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Correspondance, à Mlle Leroyer de Chantepie, 4 septembre 1858
- Il y a des gens qu'il faut étourdir pour les persuader.Auteur : Claude Adrien Helvétius - Source : Notes, maximes et pensées
- L'anse de fer achevait d'engourdir et de geler ses petites mains mouillées.Auteur : Victor Hugo - Source : Les Misérables (1862)
- Quand on a comme moi l'âme pliée en foetus, on a besoin de provoquer pour la dégourdir.Auteur : Serge Gainsbourg - Source : Pensées, provocs et autres volutes (2006)
- Et ses mains ourdiraient les entrailles du prêtre, - A défaut d'un cordon, pour étrangler les rois.Auteur : Denis Diderot - Source : Poésies diverses
- Ce qui m'a toujours séduite, c'est de brûler ma vie, de boire, de m'étourdir. Et si ça me plaît, à moi, ce jeu dérisoire et gratuit à notre époque mesquine, sordide et cruelle, mais qui, par un hasard prodigieux dont je la félicite vivement, m'a donné les moyens de lui échapperAuteur : Françoise Sagan - Source : Des bleus à l'âme (1972)
- Ce qui m'a toujours séduite, c'est de brûler ma vie, de boire, de m'étourdir. Auteur : Françoise Sagan - Source : Des bleus à l'âme (1972)
- Il aime mieux étourdir le sentiment qu'il a de ses fautes que d'avoir le chagrin de les connaître.Auteur : Jacques Bénigne Bossuet - Source : Traité de la connaissance de Dieu et de soi-même (1670)
- Pressé d'échapper au sentiment intérieur qui l'oppresse, il semble vouloir s'étourdir en s'abandonnant à une joie expansive.Auteur : Philippe-Paul de Ségur - Source : Histoire de Napoléon et de la Grande Armée en 1812 (1824)
- Jamais les arbres ne ramassent leurs feuilles, savait Bazelle.
Automne après automne, elle sentait s'alourdir le poids de ses hanches et tandis que d'âge en âge son esprit ressassait, elle se persuadait qu'à trop oublier qui l'on est, on s'efface, on s'amenuise. Auteur : Jean Vautrin - Source : Un grand pas vers le bon Dieu (1989)
- Justement il allait avoir seize ans vers la fin d'août, il était temps, pour lui, de se dégourdir un peu.Auteur : Valéry Larbaud - Source : Fermina Marquez (1911)
- Les régimes changent, reste inchangé le désir des hommes de posséder, d'écraser leurs semblables, de s'engourdir dans l'indifférence d'animaux bien nourris.Auteur : Andreï Makine - Source : Le Livre des brèves amours éternelles (2011)
Les citations du Littré sur Ourdir
- Je ne puis soutenir ces grandes paroles par lesquelles l'arrogance humaine tâche de s'étourdirAuteur : BOSSUET - Source : Duch. d'Orl.
- L'empereur regardait et souriait, s'avançant toujours et croyant à une terreur panique ; ses aides de camp soupçonnaient des cosaques ; mais ils les voyaient marcher si bien pelotonnés qu'ils en doutaient encore ; et, si ces misérables n'eussent pas hurlé en attaquant, comme ils le font tous pour s'étourdir sur le danger, peut-être que Napoléon ne leur eût pas échappéAuteur : SÉGUR - Source : Hist. de Nap. IX, 3
- Avant que de bercer les enfants, il faut être sûr qu'il ne leur manque rien, et on ne doit jamais les agiter au point de les étourdirAuteur : BUFF. - Source : De l'enfance.
- Cependant, son Dauphin.... De faits si renommés ourdira son histoire Que ceux qui dedans l'ombre éternellement noire Ignorent le soleil, ne l'ignoreront pasAuteur : MALH. - Source : II, 1
- La Parque à filets d'or n'ourdira pas ma vie, Je ne dormirai point sous de riches lambris ; Mais voit-on que le somme en perde de son prix ?... Je lui voue au désert de nouveaux sacrificesAuteur : Jean de La Fontaine - Source : Fabl. XI, 4
- Ceux qui joignent le sublime au nouveau, le grand à l'extraordinaire, ne manquent presque jamais d'enlever et d'étourdir le commun des hommes, quand même ils ne diraient que des sottisesAuteur : MALEBR. - Source : Rech. vér. v, 7
- ....Nature ingenieuse, Voyant les coeurs humains d'une paresse oiseuse S'engourdir lentement, pour les deparesser S'en vint au mont Pholois à Chiron s'adresserAuteur : RONS. - Source : 938
- Crédule par espoir, par désespoir peut-être, il s'enivre quelques instants de cette apparence [de négociations], et, pressé d'échapper au sentiment intérieur qui l'oppresse, il semble vouloir s'étourdir en s'abandonnant à une joie expansiveAuteur : SÉGUR - Source : Hist. de Nap. VIII, 10
- Quelle dureté est semblable à la nôtre, si un accident si étrange [la mort de la duchesse], qui devrait nous pénétrer jusqu'au fond de l'âme, ne fait que nous étourdir pour quelques moments !Auteur : BOSSUET - Source : Duch. d'Orl.
- Que ne sait point ourdir une langue traîtresse ?Auteur : Jean de La Fontaine - Source : Fabl. III, 6
- Quand nos doigts engourdis de froid ne pouvaient plus tenir la plume, la flamme de la lampe était le seul foyer où nous pouvions les dégourdirAuteur : MARMONTEL - Source : Mém. liv. I
- Il se prenait à tout ce qui pouvait engourdir son impatienceAuteur : HAMILT. - Source : Gramm. 11
- La grandeur et la gloire ?... je ne puis plus soutenir ces grandes paroles, par lesquelles l'arrogance humaine tâche de s'étourdir elle-même pour ne pas apercevoir son néantAuteur : BOSSUET - Source : Duch. d'Orl.
- La grandeur et la gloire ? pouvons-nous encore entendre ces noms dans ce triomphe de la mort ? non, messieurs, je ne puis plus soutenir ces grandes paroles par lesquelles l'arrogance humaine tâche de s'étourdir elle-même, pour ne pas apercevoir son néantAuteur : BOSSUET - Source : ib.
- Occupation propre à desgourdir un esprit et un corps poisantAuteur : MONT. - Source : III, 379
- Qui donc est ce coquin qui prend tant de licence Que de chanter et m'étourdir ainsi ?Auteur : Molière - Source : Amph. I, 2
- Quelle dureté est semblable à la nôtre, si un accident si étrange [la mort de la duchesse d'Orléans]..., ne fait que nous étourdir pour quelques moments ?Auteur : BOSSUET - Source : Duch. d'Orl.
- En voyant ourdir autour de moi mille trames, je ne savais me plaindre que de la tyrannie de ceux que j'appelais mes amisAuteur : Jean-Jacques Rousseau - Source : Conf. IX.
- Quelques pages plus loin, vous retrouverez la vivacité impétueuse de Lovelace, son incorrigible folie, et cette gaîté non plus du vice, mais du remords qui cherche à s'étourdirAuteur : VILLEMAIN - Source : Litt. fr. XVIIIe siècle, 1re leçon.
- Son talent [de Virgile] était de faire des tableaux plutôt que d'ourdir avec art la trame d'une fable intéressanteAuteur : Voltaire - Source : Ess. poés. ép. ch. 3
- Ma foi ! j'en suis d'avis, que ces penards chagrins Nous viennent étourdir de leurs contes badinsAuteur : Molière - Source : l'Ét. I, 2
- Mon frère m'ayant tenu quelque temps auprès de lui pour me dégourdirAuteur : HAMILT. - Source : Gramm. 3
- Ourdir, pour s'empestrer, mille nouveaux liens, Estre serf d'un tyran qui rit du mal des siens....Auteur : DESPORTES - Source : Amours d'Hippolyte, XLIV
- La grandeur et la gloire, ces grandes paroles par lesquelles l'arrogance humaine tâche de s'étourdir elle-même pour ne pas apercevoir son néantAuteur : BOSSUET - Source : Duch. d'Orl.
- Que ne sait point ourdir une langue traîtresse Par sa pernicieuse adresse !Auteur : Jean de La Fontaine - Source : Fabl. III, 6
Les mots débutant par Our Les mots débutant par Ou
Une suggestion ou précision pour la définition de Ourdir ? -
Mise à jour le samedi 7 février 2026 à 08h35

- Oasis - Obéir - Obeissance - Obligation - Obscurite - Occasion - Occident - Odeur - Oeuvre - Offenser - Oil - Oisivete - Olympique - Ombre - Opinion - Opportuniste - Optimisme - Ordinateur - Ordre - Organisation - Orgasme - Orgueil - Orgueil - Originalite - Origine - Orthographe - Oubli - Oublier - Ouvrage
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur ourdir
Poèmes ourdir
Proverbes ourdir
La définition du mot Ourdir est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Ourdir sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Ourdir présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
