La définition de Voleur, Euse du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Voleur, euse
Nature : s. m. et f.
Prononciation : vo-leur, leû-z'
Etymologie : Voler 2.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de voleur, euse de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec voleur, euse pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Voleur, Euse ?
La définition de Voleur, Euse
Celui, celle qui a volé, qui vole habituellement.
Toutes les définitions de « voleur, euse »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Celui, celle qui a volé une fois ou qui vole habituellement. Voleur de grands chemins. Crier au voleur. C'est une voleuse, Une bande de voleurs. Fam., Il est fait comme un voleur se dit de Quelqu'un dont l'habillement est en désordre, est en mauvais état.
VOLEUR se dit, par exagération, de Celui qui exige plus qu'il ne devrait demander. Ce marchand est un voleur.
VOLEUR s'emploie aussi adjectivement. Cet individu est menteur et voleur.
Littré
- Terme de fauconnerie. Se dit des faucons et autres oiseaux de proie.
Bon voleur, oiseau qui vole sûrement.
Encyclopédie, 1re édition
VOLEUR, (Droit civil.) le voleur est puni différemment chez les divers peuples de l'Europe. La loi françoise condamne à mort, & celle des Romains les condamnoit à une peine pécuniaire, distinguant même le vol en manifeste & non-manifeste. Lorsque le voleur étoit surpris avec la chose volée, avant qu'il l'eût portée dans le lieu où il avoit résolu de la cacher ; cela s'appelloit chez les Romains, un vol manifeste ; quand le voleur n'étoit découvert qu'après, c'étoit un vol non-manifeste.
La loi des douze tables ordonnoit que le voleur manifeste fût battu des verges, & réduit en servitude, s'il étoit pubere, ou seulement battu de verges, s'il étoit impubere ; elle ne condamnoit le voleur non-manifeste qu'au payement du double de la chose volée. Lorsque la loi Porcia eût aboli l'usage de battre de verges les citoyens, & de les réduire en servitude, le voleur manifeste fut condamné au quadruple, & on continua à punir du double le voleur non-manifeste.
Il paroît bizarre que ces loix missent une telle différence dans la qualité de ces deux crimes, & dans la peine qu'elles infligeoient : en effet, que le voleur fût surpris avant ou après avoir porté le vol dans le lieu de sa destination ; c'étoit une circonstance qui ne changeoit point la nature du crime.
M. de Montesquieu ne s'est pas contenté de faire cette remarque, il a découvert l'origine de cette différence des loix romaines, c'est que toute leur théorie sur le vol, étoit tirée des constitutions de Lacédémone. Lycurgue, dans la vue de donner à ses citoyens de l'adresse, de la ruse & de l'activité, voulut qu'on exerçât les enfans au larcin, & qu'on fouettât ceux qui s'y laisseroient surprendre : cela établit chez les Grecs, & ensuite chez les Romains, une grande différence entre le vol manifeste & le vol non-manifeste.
Parmi nous les voleurs souffrent une peine capitale, & cette peine n'est pas juste. Les voleurs qui ne tuent point, ne méritent point la mort, parce qu'il n'y a aucune proportion entre un effet quelquefois très-modique qu'ils auront dérobé, & la vie qu'on leur ôte. On les sacrifie, dit-on, à la sûreté publique. Employez-les comme forçats à des travaux utiles : la perte de leur liberté, plus ou moins long-tems, les punira assez rigoureusement de leur faute, assurera suffisamment la tranquillité publique, tournera en même tems au bien de l'état, & vous éviterez le reproche d'une injuste inhumanité. Mais il a plû aux hommes de regarder un voleur comme un homme impardonnable, par la raison sans doute que l'argent est le dieu du monde, & qu'on n'a communément rien de plus cher après la vie que l'intérêt. (D. J.)
Maraudeur, (Art militaire.) on appelle maraudeurs les soldats qui s'éloignent du corps de l'armée, pour aller piller dans les environs. De la maraude naissent les plus grands abus, & les suites les plus fâcheuses. 1°. Elle entraîne après elle l'esprit d'indiscipline qui fait négliger ses devoirs au soldat, & le conduit à mépriser les ordres de ses supérieurs. 2°. Les maraudeurs en portant l'épouvante dans l'esprit des paysans détruisent la confiance que le général cherche à leur inspirer ; malheureuses victimes du brigandage ! aulieu d'apporter des provisions dans les camps, ils cachent, ils enterrent leurs denrées, ou même ils les livrent aux flammes pour qu'elles ne deviennent pas la proie du barbare soldat. 3°. Enfin les dégâts que font les maraudeurs, épuisent le pays. Un général compte pouvoir faire subsister son armée pendant quinze jours dans un camp, il le prend en conséquence ; & au bout de huit, il se trouve que tout est dévasté ; il est donc obligé d'abandonner plutôt qu'il ne le vouloit, une position peut-être essentielle à la réussite de ses projets ; il porte ailleurs son armée, & les mêmes inconvéniens la suivent. Nécessairement il arrive de-là que tout son plan de campagne est dérangé ; il avoit tout prévu, le tems de ses opérations étoit fixé, le moment d'agir étoit déterminé, il ne lui restoit plus qu'à exécuter, lorsqu'il s'est apperçu que toutes ses vues étoient renversées par les désordres des maraudeurs qu'il avoit espéré d'arrêter. Il faut à présent que le général dépende des événemens, au-lieu qu'il les eût fait dépendre de lui. Il n'est plus sûr de rien ; comment pourroit-il encore compter sur des succès ? On s'étendroit aisément davantage sur les maux infinis que produit la maraude ; mais l'esquisse que nous venons de tracer, suffit pour engager les officiers à veiller sur leur troupe avec une attention scrupuleuse. Cependant l'humanité demande qu'on leur présente un tableau qui parlant directement à leur c?ur, fera sans doute sur lui l'impression la plus vive. Qu'ils se peignent la situation cruelle où se trouvent réduits les infortunés habitans des campagnes ruinées par la guerre ; que leur imagination les transporte dans ces maisons dévastées que le chaume couvroit, & que le désespoir habite ; ils y verront l'empreinte de la plus affreuse misere, leurs c?urs seront émus par les larmes d'une famille que les contributions ont jettée dans l'état le plus déplorable ; ils seront témoins du retour de ces paysans qui, la tristesse sur le front, reviennent exténués par la fatigue que leur ont causé les travaux que, par nécessité, on leur impose ; qu'ils se retracent seulement ce qui s'est passé sous leurs yeux. Ils ont conduit des fourrageurs dans les granges des malheureux laboureurs. Ils les ont vu dépouiller en un moment les fruits d'une année de travail & de sueurs ; les grains qui devoient les nourrir, les denrées qu'ils avoient recueillies leur ont été ravis. On les a non-seulement privés de leur subsistance actuelle, mais toute espece de ressources est anéantie pour eux. N'ayant plus de nourriture à donner à leurs troupeaux, il faut qu'ils s'en défassent, & qu'ils perdent le secours qu'ils en pouvoient tirer ; les moyens de cultiver leurs terres leur sont ôtés ; tout est perdu pour eux, tout leur est arraché : il ne leur reste pour soutenir la caducité d'un pere trop vieux pour travailler lui-même, pour nourrir une femme éplorée & des enfans encore foibles ; il ne leur reste que des bras languissans, qu'ils n'auront même pas la consolation de pouvoir employer à leur profit pendant que la guerre subsistera autour d'eux. Cette peinture, dont on n'a pas cherché à charger les couleurs, est sans doute capable d'attendrir, si l'on n'est pas dépourvu de sensibilité ; mais comment ne gémiroit-elle pas cette sensibilité en songeant que des hommes livrés à tant de maux sont encore accablés par les horribles désordres que commettent chez eux des soldats effrénés, qui viennent leur enlever les grossiers alimens qui leur restoient pour subsister quelques jours encore ? Leur argent, leurs habits, leurs effets, tout est volé, tout est détruit. Leurs femmes & leurs filles sont violées à leurs yeux. On les frappe, on menace leur vie, enfin ils sont en butte à tous les excès de la brutalité, qui se flatte que ses fureurs seront ignorées ou impunies. Malheur à ceux qui savent que de pareilles horreurs existent, sans chercher à les empêcher !
Les moyens d'arrêter ces désordres doivent être simples & conformes à l'esprit de la nation dont les troupes sont composées. M. le maréchal de Saxe en indique de sages, dont il prouve la bonté par des raisons solides.
« On a, dit-il, une méthode pernicieuse, qui est de toujours punir de mort un soldat qui est pris en maraude ; cela fait que personne ne les arrête, parce que chacun répugne à faire périr un misérable. Si on le menoit simplement au prevôt ; qu'il y eût une chaîne comme aux galeres ; que les maraudeurs fussent condamnés au pain & à l'eau pour un, deux ou trois mois ; qu'on leur fit faire les ouvrages qui se trouvent toujours à faire dans une armée, & qu'on les renvoyât à leur régiment la veille d'une affaire, ou lorsque le général le jugeroit à propos ; alors tout le monde concourroit à cette punition : les officiers des grands-gardes & des postes avancés les arrêteroient par centaines, & bientôt il n'y auroit plus de maraudeurs, parce que tout le monde y tiendroit la main. A présent il n'y a que les malheureux de pris. Le grand-prevôt, tout le monde détourne la vue quand ils en voient ; le général crie à cause des desordres qui se commettent ; enfin le grand-prevôt en prend un, il est pendu, & les soldats disent, qu'il n'y a que les malheureux qui perdent. Ce n'est là que faire mourir des hommes sans remédier au mal. Mais les officiers, dira-t-on, en laisseront également passer à leurs postes. Il y a un remede à cet abus. C'est de faire interroger les soldats que le grand-prevôt aura pris dehors : leur faire déclarer à quel poste ils auront passé, & envoyer dans les prisons pour le reste de la campagne les officiers qui y commandoient : cela les rendra bientôt vigilans & inexorables. Mais lorsqu'il s'agit de faire mourir un homme, il y a peu d'officiers qui ne risquassent deux ou trois mois de prison ».
Avec une attention suivie de la part des officiers supérieurs, & de l'exactitude de la part des officiers particuliers, on parviendra dans peu à détruire la maraude dans une armée. Qu'on cherche d'abord à établir dans l'esprit des soldats, qu'il est aussi honteux de voler un paysan, que de voler son camarade. Une fois cette idée reçue, la maraude sera aussi rare parmi eux, que les autres especes de vols. Une nation où l'honneur parle aux hommes de tous les états, a l'avantage de remédier aux abus bien plutôt que les autres. Sans les punir de mort, qu'on ne fasse jamais de grace aux maraudeurs, que les appels soient fréquens, que les chefs des chambrées où il se trouvera de la maraude soient traités comme s'ils avoient maraudé eux-mêmes ; qu'il soit défendu aux vivandiers sous les peines les plus severes de rien acheter des soldats ; que le châtiment enfin soit toujours la suite du desordre, & bientôt il cessera d'y avoir des maraudeurs dans l'armée, le général & les officiers seront plus exactement obéis, les camps mieux approvisionnés, & l'état conservera une grande quantité d'hommes qui périssent sous la main des bourreaux, ou qui meurent assassinés par les paysans révoltés contre la barbarie. Article de M. le marquis de Marnesia.
Si c'est M. le maréchal de Broglio qui a substitué au supplice de mort dont on punissoit les maraudeurs, la bastonade, qu'on appelle schlaguer, appliquée par le caporal, qu'on appelle caporal schlagueur, il a fait une innovation pleine de sagesse & d'humanité : car à considérer la nature de la faute, il paroît bien dur d'ôter la vie à un brave soldat, dont la paye est si modique, pour avoir succombé, contre la discipline, à la tentation de voler un choux. Les coups de bâton qui peuvent être bons pour des allemands, sont un châtiment peu convenable à des françois. Ils avilissent celui qui les reçoit, & peut-être même celui qui les donne. Je n'aime point qu'on bâtonne un soldat. Celui qui a reçu une punition humiliante craindra moins dans une action de tourner à l'ennemi un dos bâtonné, que de recevoir un coup de feu dans la poitrine. M. le maréchal de Saxe faisoit mieux : il condamnoit le maraudeur au piquet ; & dans ses tournées, lorsqu'il en rencontroit un, il l'accabloit de plaisanteries ameres, & le faisoit huer.
Nous ajoutons ici quelques réflexions sur les moyens d'empêcher la désertion, & sur les peines qu'on doit infliger aux déserteurs. Ces réflexions nous sont venues trop tard pour être mises à leur véritable place.
Réflexions sur les moyens d'empêcher la désertion, & sur les peines qu'on doit infliger aux déserteurs. Il est plusieurs causes de désertion. Il en est qui entrent souvent dans le caractere d'une nation, & qui lui sont particulieres. S'il existe, par exemple, un peuple léger, inconstant, avide de changement, & prompt à se dégoûter de tout, il n'est pas douteux qu'on n'y trouve un grand nombre de gens qui se dégoûtent des états gênans qu'ils auront embrassés. Si cet esprit d'inconstance & de légereté regne parmi ceux qui suivent la profession des armes, il est certain qu'on trouvera plus de déserteurs chez eux, que chez les peuples qui n'auront pas le même esprit.
On voit de-là pourquoi les troupes françoises désertent plus facilement que les autres troupes de l'Europe. On voit aussi que c'est cet esprit d'inconstance, ou plutôt ce vice du climat qu'il faudroit corriger pour empêcher la désertion. J'en indiquerai les moyens.
Une autre cause de désertion est en second lieu la trop longue durée des engagemens. Les soldats suisses ne sont engagés que pour trois ans, & ils sont aussi bons soldats que les nôtres. On m'objectera que par la façon dont les Suisses sont élevés & exercés dans leur pays, ils sont plutôt formés que nous pour la guerre. Je réponds que cela peut être : mais qu'il faut choisir un milieu entre l'engagement des suisses, s'il est trop court, & celui des françois, dont le terme de huit ans est trop long, relativement au caractere de la nation & à l'esprit de chacun d'eux. Que de soldats n'a-t-on pas fait déserter lorsque, sous différens prétextes, on les forçoit de servir le double & plus de leur engagement !
Les autres causes de désertion sont la dureté avec laquelle on les traite, la misere des camps, le libertinage, le changement perpétuel de nouvel exercice, le changement de vie & de discipline, comme dans les troupes légeres, qui, accoutumées pendant la guerre au pillage & à moins de dépendance, désertent plus facilement en tems de paix.
Il est aisé de remédier à ces dernieres causes. Voyons comme on peut corriger cet esprit d'inconstance, & attacher à leur état des gens si prompts à s'en détacher.
Les troupes romaines tirées de la classe du peuple, ou de celle des citoyens, ou des alliés ayant droit de bourgeoisie, désertoient peu. Il regnoit parmi eux un amour de la patrie qui les attachoit à elle ; ils étoient enorgueillis du titre de citoyen, & ils étoient jaloux de se le conserver ; instruits des intérêts de la république, éclairés sur leurs devoirs, encouragés par l'exemple ; la raison, le préjugé, la vanité les retenoient dans ces liens sacrés.
Pourquoi sur leur modele ne pas communiquer au soldat françois un plus grand attachement pour sa patrie ? Pourquoi ne pas embraser son c?ur d'amour pour elle & pour son roi ? Pourquoi ne pas l'enorgueillir de ce qu'il est né françois ? Voyez le soldat anglois. Il déserte peu, parce qu'il est plus attaché à son pays, parce qu'il croit y trouver & y jouir de plus grands avantages que dans tout autre pays.
Cet amour de la patrie, dit un grand homme, est un des moyens le plus efficace qu'il faille employer pour apprendre aux citoyens à être bons & vertueux. Les troupes mercenaires qui n'ont aucun attachement pour le pays qu'elles servent, sont celles qui combattent avec le plus d'indifférence, & qui désertent avec le plus de facilité. L'appât d'une augmentation de solde, l'espoir du pillage, l'abondance momentanée d'un camp contribueront à leur désertion, dont on peut tirer partie. Voyez la différence de fidélité & de courage entre les troupes romaines & les troupes mercenaires de Carthage. Les Suisses seuls font à présent exception à cette regle, aussi l'esprit militaire, & la réputation de bravoure qu'a cette nation, nourrissent sa valeur naturelle, & l'exactitude à tenir parole au soldat au terme de son engagement empêche la désertion, en facilitant les recrues. Si, comme on le dit souvent, on faisoit en France un corps composé uniquement d'enfans-trouvés, ce seroit le corps le plus sujet à déserter ; outre qu'ils auroient le vice du climat, ils ne seroient point retenus par l'espoir de partager un jour le peu de bien qu'ont souvent les peres ou les meres ; espoir qui retient assez de soldats.
Ce qui attache aujourd'hui les Turcs au service de leur maître, ce sont les préjugés & les maximes dans lesquelles on les éleve envers le sultan & envers leur religion. Nous avons vu que les Romains autrefois l'étoient par l'amour de la patrie ; & les Anglois à présent par cet esprit de fierté, de liberté, & par les avantages qu'ils croiroient ne pas trouver ailleurs. Ce qui doit attacher le soldat françois, est l'amour de sa patrie & de son roi ; amour, qu'il faut augmenter, c'est l'amour de son état de soldat ; amour, qu'il faut nourrir par des distinctions, des prérogatives, des récompenses, & de la considération attachée à cet état honorable qu'on n'honore point assez ; amour, qu'il faut nourrir par la fidélité & l'exactitude à tenir parole au soldat, par une retraite honnête & douce, s'il a bien rempli ses devoirs. Plus il aimera son état de soldat, son roi & sa patrie, plus le vice du climat sera corrigé, la désertion diminuera & les déserteurs seront notés d'infamie.
Les peines à décerner contre les déserteurs doivent donc dériver de ce principe ; car toutes les vérités se tiennent par la main. Ces peines seront la privation & la dégradation de ces honneurs, distinctions, &c. l'infamie qui doit suivre cette dégradation, la condamnation aux travaux publics, quelque flétrissure corporelle qui fasse reconnoître le déserteur, & qui l'expose à la risée de ses camarades, à l'insulte des femmes & du peuple. Les déserteurs qu'on punit de mort, sont perdus pour l'état. En 1753, on en comptoit plus de trente-six mille fusillés, depuis qu'on avoit cessé de leur couper le nez & les oreilles pour crime de désertion. L'état a donc perdu & perd encore des hommes qui lui auroient été utiles dans les travaux publics, & qui auroient pû lui donner d'autres citoyens. Cette punition de mort qui n'est point déshonorante, ne sauroit d'ailleurs retenir un homme accoutumé à mépriser & à exposer sa vie.
Qu'on pese d'un côté la honte, l'infamie, la condamnation perpétuelle aux travaux publics contre le changement qui doit se faire dans l'esprit du soldat, contre la certitude qu'il aura d'être récompensé, & d'obtenir son congé au terme de son engagement, & l'on verra s'il peut avoir l'idée de déserter. Dans ce cas, comme en tout autre, l'espece de liberté dont on jouit, ou à laquelle on pense atteindre, engage les hommes à tout faire & à tout endurer. Cet article est de M. de Montlovier, gendarme de la garde du roi.
Voleur, terme de Fauconnerie ; on dit oiseau bon voleur ou beau voleur, quand il vole bien & surement.
Wiktionnaire
Adjectif - français
voleur \v?.l??\
- Qui aime à voler ou à dérober.
- C'est une race [?] peu scrupuleuse dans le choix de ses moyens, peu véridique et volontiers voleuse, pillarde et homicide. ? (Frédéric Weisgerber, Trois mois de campagne au Maroc : étude géographique de la région parcourue, Paris : Ernest Leroux, 1904, page 233)
Nom commun - français
voleur \v?.l??\ masculin (pour une femme, on dit : voleuse)
-
Homme qui effectue un vol, qui dérobe, s'approprie le bien d'autrui, ou l'a déjà fait.
- Harpagon criant au voleur dès le jardin, et venant sans chapeau. Au voleur ! au voleur ! à l'assassin ! au meurtrier ! Justice, juste ciel ! Je suis perdu, je suis assassiné ; on m'a coupé la gorge : on m'a dérobé mon argent. ? (Molière, L'Avare ou l'École du mensonge, acte IV, scène 7)
- Le chevalier d'industrie, la fille de joie, le voleur, le brigand, et l'assassin, le joueur, le bohème sont immoraux, et le brave bourgeois éprouve à l'égard de ces « gens sans m?urs » la plus vive répulsion. ? (Max Stirner, cité dans Le Stirnérisme, Émile Armand, 1934)
- Bref, bredouille la maréchaussée, autant que pour un voleur ou un contrebandier ! On y était bien habitué, allez : pas de semaines qu'une poule disparaisse. ? (Jean Rogissart, Mervale, Éditions Denoël, Paris, 1937, page 20)
- En plus, son papa, qui a parfois des idées saugrenues, lui raconte l'histoire de la cour des Miracles, le repaire au Moyen Âge de tous les voleurs, tire-laine et autres bandits qui infestaient la ville de Paris. ? (Alain Chennevière, La Cour des Miracles, Magnard, 2002)
- Posté à proximité, Yann put apercevoir à l'intérieur tout le matériel du parfait voleur de voiture : deux perceuses sans fil, deux riveteuses, des forets de toutes tailles, des rivets pop, des câbles électriques, [?]. ? (Anthony Buils, Haize Hegoa, Éditions Cairn, 2021, chap. 1)
-
(Par extension) Personnes morales effectuant un vol (des sociétés, des entreprises ou encore des gouvernements).
- Le voleur, dans cette histoire, c'est le gouvernement lui-même.
-
(Par hyperbole) Personne qui exige plus qu'elle ne devrait demander.
- Ce marchand est un voleur, il vend ce vieux truc pour cent euros !
-
(Par extension) Êtres vivants dont les actes sont interprétés comme du vol.
- La hyène est souvent considérée comme une voleuse, car elle tente parfois de s'accaparer des proies tuées par d'autres animaux.
Trésor de la Langue Française informatisé
VOLEUR, -EUSE, subst. et adj.
Voleur, Euse au Scrabble
Le mot voleur, euse vaut 13 points au Scrabble.
Informations sur le mot voleur--euse - 10 lettres, 6 voyelles, 4 consonnes, 7 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot voleur, euse au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
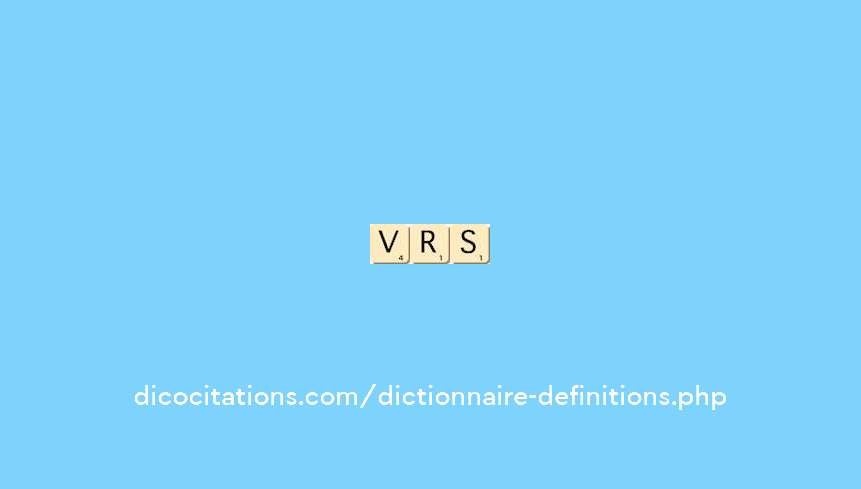
Les mots proches de Voleur, Euse
Vol Vol Volable Volage Volagement Volageté Volaille Volailler Volant, ante Volant Volant Volante Volateur Volatil, ile Volatile Volatilisation Volatiliser Volatilité Volatille Volcan Volcanicité Volcanique Volcanisé, ée Volcanisme Vole Volée Volement Voler Voler Volereau Volerie Volerie Volet Voleter Volettement Voleur, euse Volière Volige Voligeage Volition Volksting Volontaire Volontairement Volontariat Volonté Volontiers Volselle Voltaïque Volte Volte-face vol vol-au-vent vola volage volages volai volaient volaille volailler volaillers volailles volais volait volant volant volant volante volante volanté volantes volantes volants volants volapük volassent volât volatil volatile volatile volatiles volatiles volatilisa volatilisaient volatilisait volatilisant volatilisation volatilise volatilisé volatilisée volatilisées volatilisent volatiliser volatilisés volatilité volatils volcan volcanique volcaniques volcanologique volcanologueMots du jour
-
réclamaient vigilantes yolande répétitrice re-récurait imaginaire bredouillis emboîtée surévalué embrouilles
Les citations avec le mot Voleur, Euse
Les citations du Littré sur Voleur, Euse
Les mots débutant par Vol Les mots débutant par Vo
Une suggestion ou précision pour la définition de Voleur, Euse ? -
Mise à jour le lundi 9 février 2026 à 23h30
- Vacance - Vache - Vacuite - Vaincre - Valeur - Vanite - Vanité - Vengeance - Verbe - Verge - Vérité - Verite - Vertu - Vetement - Vice - Victoire - Vie - Vieillard - Vieillesse - Vierge - Vieux - Vie_heureuse - Ville - Vin - Violence - Visage - Visite - Vitesse - Vivre - Vivre - Voeux - Voisinage - Voiture - Voleur - Volonte - Volonté - Volupté - Vote - Voyage - Voyager
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur voleur, euse
Poèmes voleur, euse
Proverbes voleur, euse
La définition du mot Voleur, Euse est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Voleur, Euse sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Voleur, Euse présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
