La définition de Potencé, ée du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Potencé, ée
Nature : adj.
Prononciation : po-tan-sé, sée
Etymologie : Bas-lat. potentia, potence, du lat. potentia, puissance, et de là, appui, bâton, béquille, et, par comparaison avec la forme, gibet.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de potencé, ée de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec potencé, ée pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Potencé, ée ?
La définition de Potencé, ée
Terme de blason. Dont chaque branche se termine en forme de double potence ou de T. Croix potencée.
Toutes les définitions de « potencé, ée »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Assemblage de trois pièces de bois ou de fer, dont une est dressée verticalement, une autre est posée horizontalement sur la première, et la troisième soutient l'extrémité de celle-ci. Mettre une potence pour étayer une poutre. Il faut mettre une double potence pour mieux soutenir cette poutre. Les potences de fer servent principalement à porter des balcons, des poulies, des lanternes, etc. Les enseignes des aubergistes sont ordinairement soutenues par des potences de fer ou de bois. Il se dit particulièrement d'un Gibet, dé l'instrument servant au supplice de ceux que l'on pend. Planter, dresser une potence. Mener à la potence. Mettre, attacher à la potence. Il se dit aussi du Supplice même. On l'a condamné à la potence. Il mérite la potence. Fig. et fam., Gibier de potence, se dit d'Un ou de plusieurs hommes dont les actions semblent mériter d'être punies en justice. Cet homme est un gibier de potence. Ces gens-là sont du gibier de potence.
POTENCE, en termes de Manège, désigne le Morceau de bois où pend la bague. Brider la potence, Donner contre ce morceau. de bois, au lieu d'emporter la bague, ou de la toucher. Table en potence, Table longue, vers l'un des bouts de laquelle il y en a une autre qui est en travers.
POTENCE, en termes de Blason, désigne une Croix en forme de T.
Littré
-
1Béquille, bâton d'appui qui a la forme d'un T. Marcher avec des potences.
Il [un mendiant] pourra se servir de deux potences, et avoir un pied attaché au derrière
, Lesage, Guzm. d'Alf. III, 3.Table en potence, longue table à l'un des bouts de laquelle une autre est placée en travers.
En termes militaires, on dit qu'une partie d'une troupe est en potence, quand elle est placée en retour relativement au front général de la troupe.
-
2Sorte de béquille isolée, nommée appuial, sur laquelle on s'appuie la poitrine pour se reposer debout quand on est malade, et dans les églises de l'Orient, où les chaises sont inconnues, quand on est à l'office.
J'ai entendu la messe dans le grand couvent de l'oasis des Lacs Natrons, ainsi appuyé sur une potence
, De Laborde, Émaux, p. 460. - 3Appareil qui sert à mesurer la taille des hommes et des animaux?: c'est une large règle qui porte des divisions numériques, et sur laquelle glisse à frottement une petite pièce de bois. Avoir cinq pieds sous potence.
-
4Gibet, instrument de supplice, ainsi dit à cause de la ressemblance de forme avec la béquille.
Commandez qu'on dresse une potence fort élevée, qui ait cinquante coudées de haut
, Sacy, Bible, Esther, v, 14.Xerxès, outré de dépit contre Léonide qui avait osé lui tenir tête, fit attacher son cadavre à une potence
, Rollin, Hist. anc. ?uv. t. III, p. 217 dans POUGENS.Pendant un mois entier, on ne vit dans Amboise que des échafauds sanglants et des potences chargées de cadavres
, Voltaire, M?urs, 170.Le supplice même.
Harlay fut prié chez M. de Chaulnes, et il y alla comme un homme qu'on mène à la potence
, Saint-Simon, 42, 240.Il faut effrayer le crime?; oui, sans doute?; mais le travail forcé et la honte durable l'intimident plus que la potence
, Voltaire, l'Homme aux 40 écus, Des proportions.Fig. et familièrement.
La campagne qu'on peut appeler la potence d'une jeune personne
, Hamilton, Gramm. 9.Gibier de potence, homme dont les actions appellent la sévérité des lois.
Allons, que l'on détale de chez moi, maître juré filou, vrai gibier de potence
, Molière, Avare, I, 3.Traîne-potence, voy. TRAÎNER.
Terme de blason. Meuble de l'écu, qui indique le droit de haute justice.
-
5 Terme de manége. Le morceau de bois où pend la bague.
Brider la potence, donner contre ce morceau de bois, au lieu d'emporter la bague ou de la toucher.
-
6Pièce de bois ou de fer qui se met sous une poutre, pour soutenir un plancher, et dont le sommet forme un triangle. On distingue la potence à un ou à deux liens?: la première qui se met contre le mur, l'autre qui se met au milieu de la poutre.
Barre de fer tournée en volute à une de ses extrémités, servant de support à un balcon, à une poulie de puits, etc.
Le fer qui sert à suspendre une enseigne devant la boutique d'un artisan.
Terme d'administration. Long tuyau soutenu par une console, qui porte à un mètre environ de la maison où il est attaché le bec de gaz et la lanterne qui l'enveloppe.
- 7Potences, les bouts des branches d'une trompette, qui sont formés en arc.
- 8Instrument avec lequel le verrier transporte des objets trop chauds pour être maniables.
-
9Pièce qui porte deux des pivots de l'échappement, dans les montres à roue de rencontre.
Une des pièces du moulin du lapidaire.
-
10 Terme de marine. Sorte d'épontille fourchue qu'on place sous le faux pont, à l'endroit où correspond le pied du mât d'artimon, lorsque ce pied ne repose pas sur la quille.
Se dit encore de divers montants, arcs-boutants, supports saillants et retenus par des cordages.
- 11Petite enclume de chaudronnier.
HISTORIQUE
XIIIe s. Li blanc moine me traïstrent fors, Mès tant me batirent le cors Ô potences et o bastons, Qu'il me mistrent à ventrillons
, Ren. 14363. Mès por ses membres apuier, Ot ausinc cum par impotence De traïson une potence [bâton]
, la Rose, 12296. Et vraiement, fist le chevalier, vous le comparrez [payerez]?; et lors il hauça sa potence, et feri le juif les l'oÿe [près de l'oreille], et le porta à terre
, Joinville, 198.
XIVe s. Estoit si malade que il aloit toz jors à potences sous ses esseles, ne autrement il ne pooit aler, et sembloit que il eust le dos rompu
, De Laborde, Émaux, p. 460.
XVe s. En icelle salle avoit trois tables drecées, dont l'une fut au bout dessus, traversant à potence, et estoit la table pour l'honneur
, De la Marche, Mém. II, p. 528, dans LACURNE.
XVIe s. Le blessé doit cheminer longtemps sur une potence
, Paré, VIII, 37. Le pere mena son fils à Paris, et, en passant par Amboise un jour de foire, il vit les testes de ses compaignons d'Amboise encore reconnoissables sur un bout de potence
, D'Aubigné, Mémoires, édit. LALANNE, p. 5.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
POTENCE. Fig. Brider la potence, ne pas réussir, manquer son coup. Il [M. de Chaulnes] me mande qu'il se pourrait vanter d'avoir fourni une assez belle carrière et de n'avoir point bridé la potence, sans la douleur mortelle qu'il a d'avoir été contraint d'offrir au pape ce charmant comtat [d'Avignon]
, Sévigné, Lettres inédites, éd. Capmas, t. I, p. 147. L'édition Regnier portait d'avoir fourni bride la potence, leçon inexplicable.
Encyclopédie, 1re édition
POTENCE, s. f. (Gram.) gibet de bois, composé d'un montant, à l'extrémité duquel il y a un chevron assemblé, lequel chevron est soutenu en-dessous par une piece de bois qui s'emmortaise & avec le montant & avec le chevron. C'est à l'extrémité de ce chevron qu'est attachée la corde que l'exécuteur passe au col du malfaiteur.
Potence, furcilla subalaris, bâton ou béquille en forme de la lettre T, dont les estropiés se servent pour se soutenir. Le bâton est de la longueur du corps depuis le dessous de l'aisselle jusqu'au talon ; il est garni à son bout inférieur d'un morceau de fer à plusieurs pointes, afin qu'il ne glisse point sur un terrein uni. La partie supérieure porte une traverse de bois de 7 à 8 pouces, qu'on fait garnir ordinairement d'étoffe rembourrée, pour ne point blesser l'aisselle. Le mot de potence a vieilli dans l'usage vulgaire ; on donne à ce soutien le nom de béquille. Les personnes qui ont eu les jambes ou les cuisses fracturées, ou qui ont été tenues long-tems dans l'inaction des parties inférieures, par quelque cause que ce soit, ne peuvent marcher dans les premiers tems de leur guérison qu'avec le secours des potences. Elles leur servent de point d'appui jusqu'à ce que les muscles aient repris leur vigueur, & que les ligamens assouplis cedent à la force motrice.
Si, par quelqu'accident, une jambe demeuroit plus courte que l'autre, le malade seroit boiteux. On remédie à cet inconvénient, lorsqu'il est leger, en portant un talon plus haut que l'autre. Les personnes qui sont dans ce cas ne sont pas fermes, & ont besoin du secours d'une canne. Si la disproportion est trop considérable pour que l'augmentation de hauteur d'un talon puisse y remédier, on peut se servir utilement de la potence à siege, décrite dans Ambroise Paré, & qu'il dit avoir recouvert de maître Nicolas Picard, chirurgien du duc de Lorraine. Elle a un crochet de fer à la hauteur convenable pour servir d'étrier & porter la plante du pié. Une autre piece de fer en demi-cercle embrasse la cuisse sous le pli de la fesse, & sert de siege ; ensorte que le pié est appuyé, & l'estropié est comme assis de ce côté, étant de bout & en marchant.
Ces sortes de machines sont du ressort de la Chirurgie, & appartiennent à l'opération de cet art, connue sous le nom de prothese. Voyez Prothèse. (Y)
Potence, (Commer.) on appelle potence d'un minot à mesurer les grains une verge de fer qui traverse diamétralement le minot d'un bord à l'autre, & qui sert à le lever. C'est par-dessus cette verge qu'on passe la radoire quand on mesure raz & non comble. Voyez Comble, Raz, Radoire & Minot. Dict. de comm.
Potence, terme d'académiste ; c'est un certain bâton où l'on met le canon de la bague, lorsqu'on court la bague. On dit brider la potence, lorsque la lance de celui qui court la bague touche ou frappe la potence ; ce qui est une maladresse. (D. J.)
Potence, (Arquebusier.) outil d'arquebusier, qui prend son nom de sa figure, qui n'est guere différente de celle de l'équerre ; une des branches de la potence a divers trous ; elle est toute de fer & sert à limer dessus cette partie des armes à feu, montées sur des fusts, qu'on appelle la platine.
Potence, (Charpent.) piece de bois de bout comme un pointal, couverte d'un chapeau ou semelle par-dessus, & assemblée avec un ou deux liens, ou contre-fiches, qui sert pour soulager une poutre d'une trop longue portée, ou pour en soutenir une qui est éclatée.
Potence de brimbale, (Charpenterie.) piece de bois fourchue, qui est soutenue par la pomme, & dans laquelle entre la brimbale. (D. J.)
Potence, en terme de Chauderonnier ; est une espece de bigorne à deux bras, dont l'un forme une table, sur laquelle on peut planer, & l'autre une sorte de tas sur lequel on rétraint si l'on veut. Voyez les Pl. du Chauderonnier.
Potence, (Maréchal.) on appelle ainsi une regle de 6 piés de haut, designée & marquée par pié & pouces. Une autre regle qui fait l'équerre avec celle-là, & qui y tient de maniere qu'elle coule tout du long, détermine la mesure de la hauteur des chevaux. On pose la regle de 6 piés droite le long de l'épaule posant à terre près du sabot : on fait ensuite descendre l'autre regle jusqu'à ce qu'elle pose sur le garot, puis regardant à l'endroit où ces deux regles se joignent, comptant les piés & pouces de la grande regle jusqu'à cet endroit, on connoît précisément la hauteur du cheval.
Potence est aussi un bâtis de charpente, en forme de potence, au bout de laquelle on laisse pendre la bague lorsqu'on la veut courre.
Brider la potence, se dit, en terme de Manege, pour signifier toucher avec la lance le bois d'où pend la bague ou l'anneau.
Potence, (Horlogerie.) dans une montre, c'est une forte piéce de laiton qu'on voit dans la cage, elle est quelquefois rivée, mais le plus communément, elle est vissée fermement & perpendiculairement à la platine du coq, elle sert à contenir la verge du balancier & un des pivots de la roue de rencontre. Voyez nos Planches de l'Horlogerie & leur explication.
On distingue dans une potence ordinaire trois choses, le nez, le talon, & les lardons ; le nez est la partie t dans laquelle roule un des pivots de la roue de rencontre ; le talon t est celle où roule le pivot d'en bas de la verge du balancier ; les lardons sont les petites pieces qui entrent en queue d'aronde dans le nez & le talon. Je dis dans le nez, parce que le plus communément ce nez au lieu d'avoir un petit trou pour recevoir le pivot de la roue de rencontre, il a une petite rainure en queue d'arronde, dans laquelle entre le lardon n, qui porte lui-même le trou pour recevoir ce pivot ; cet ajustement est nécessaire pour rendre égales les chutes de la roue de rencontre sur chacune des palettes. Voyez Chute.
On a donné le nom de potence à la royale à des potences que M. Le Roy a imaginées où le nez n, fig. 44. ajustée dans une rainure, y est mobile, au moyen d'une petite clé e qui tourne à vis dans le corps de la potence ; par cette disposition on retranche le lardon du nez, & l'on peut rendre égales les chûtes de la roue de rencontre avec beaucoup plus de facilité que dans les potences ordinaires ; & cela même quand la montre est remontée, avantage très-considérable, parce qu'il donne le moyen de faire l'échappement avec la plus grande précision. Voyez Chute, Echappement, Montre, &c.
On voit cette potence & ses différentes parties dans une suite de plusieurs figures qui la représentent vue par-dessus, & attachée à la platine. La figure premiere la représente vue du côté de la contre-potence o, n est le nez du lardon, t le talon, & e la clé, au moyen de laquelle on fait avancer ou reculer le lardon de n en e, il y a une petite vis qui sert à presser le lardon contre la potence, de façon que mobile lateralement, il ne peut avoir de jeu dans aucun sens, ce qui est absolument nécessaire. Les deux suivantes représentent la premiere ; le lardon vu en face, & la seconde en est le profil. La quatrieme est la clé dont la virole prend dans une entaille pratiquée au lardon. Les trois fig. 5. 6. 7. représentent la potence vue de trois faces : la premiere sur le côté par-dehors : la seconde dans le sens opposé ; & la troisieme par-dessous : 22 p l a est le lardon du talon, qui doit être d'acier trempé dur & bien poli : l'extremité du pivot d'en-bas de la verge du balancier s'y repose quand la montre est sur le cristal. Voyez Tigeron.
Potence, piece du moule servant à fondre les caracteres d'Imprimerie. Cette piece par un trou quarré traverse le blanc, la longue piece & la platine, & joint ces trois pieces ensemble par le moyen de la vis qui est à un de ces bouts ; à l'autre extrémité est une tête quarrée & oblongue ; cette tête s'emboîte dans la fourchette de la longue piece, & sert de coulisse pour faire agir ensemble & également la piece de dessus & celle de dessous. Voyez Moule, Planche, Figures.
Potence, en terme de Lapidaire, est une sorte de chevron brisé, planté dans la table du moulin, dont le bras placé horisontalement, tient un pivot dans lequel entre l'arbre de la roue à trailler. Voyez les Pl. & fig. du Diamantaire.
Potence de fer, (Serrurier.) maniere de grande console en saillie, ornée d'enroulemens & de feuillages de tole, pour porter des balcons, des enseignes des marchands, des poulies à puits, des lanternes, &c.
Wiktionnaire
Nom commun - français
potence \p?.t??s\ féminin
-
Assemblage de trois pièces de bois ou de fer, dont une est dressée verticalement, une autre est posée horizontalement sur la première, et la troisième soutient l'extrémité de celle-ci.
- Zarzavadjian avait appris à aimer l'univers enchevêtré des arrière-gares et des voies de triage. Tous les poteaux, les potences et les portiques et leurs signalisations suspendues. [?]. Et bien entendu l'infinie arborescence des rails. ? (Ian Manook, Les Temps sauvages, Paris : Éditions Albin Michel, 2015)
- Les potences de fer servent principalement à porter des balcons, des poulies, des lanternes, etc.
- Les enseignes des aubergistes sont ordinairement soutenues par des potences de fer ou de bois.
-
Gibet, instrument servant au supplice de ceux que l'on pend.
- Dans la logique mentale de leur temps, les magistrats l'accusent et la condamnent de « sorcellerie », crime pour lequel le bourreau l'énuque avec la « hart » de la potence (corde d'infamie). ? (Michel Porret, L'ombre du diable: Michée Chauderon, dernière sorcière exécutée à Genève (1652), Éditions Georg, 2009, p. 64)
-
Pendaison.
- On l'a condamné à la potence.
- Il mérite la potence.
- (Cyclisme) Élément d'une bicyclette fixé sur le cadre et sur lequel est monté le cintre.
-
Support à deux branches utilisé pour les perfusions.
- L'infirmière suspendit le ballon de sérum glucosé à une potence de métal. ? (Maurice Druon, Les Grandes Familles, Livre de Poche, p. 234).
- Poignée fixée au-dessus d'un lit d'hôpital permettant au patient de se soulever.
-
(Manège) Morceau de bois où pend la bague.
- Brider la potence, donner contre ce morceau de bois, au lieu d'emporter la bague, ou de la toucher.
- Table en potence, table longue, vers l'un des bouts de laquelle il y en a une autre qui est en travers.
- (Héraldique) Croix en forme de T.
- Mots horizontal et vertical qui commencent sur la première case (à gauche) de la première ligne, aux mots croisés.
Trésor de la Langue Française informatisé
POTENCE, subst. fém.
Potencé, ée au Scrabble
Le mot potencé, ée vaut 13 points au Scrabble.
Informations sur le mot potence--ee - 9 lettres, 5 voyelles, 4 consonnes, 6 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot potencé, ée au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
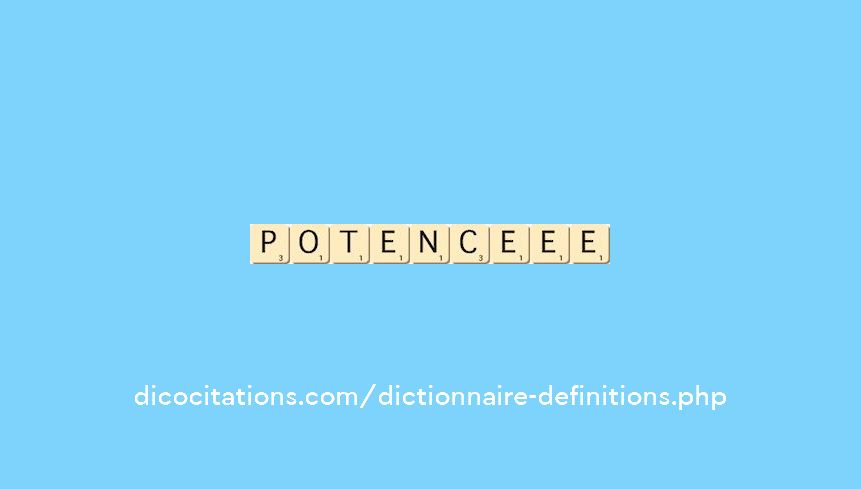
Les mots proches de Potencé, ée
Pot Potable Potage Potager, ère Potagiste Potasse Pote Poteau Potée Potéité Potelé, ée Potence Potencé, ée Potentat Potentiel, elle Potentiellement Poterie Poterne Potestatif, ive Potichomanie Potier Potin Potinage Potion Potiron pot pot-au-feu pot-au-feu pot-bouille pot-de-vin pot-pourri potable potables potache potaches potage potager potager potagère potagères potagers potagers potages Potangis potard potassa potassait potasse potasse potassé potassent potasser potasserai potasses potassez potassium pote poteau poteaux potée potées potelé potelée potelées potelés Potelières Potelle potence potencée potences potentat potentats potentialisation potentialiser potentialitéMots du jour
Lunure Glycériner Polysynodie Écouchures Élucubration Banalité Louangeur, euse Charnage Concurrence Ingrédient
Les citations avec le mot Potencé, ée
Les citations du Littré sur Potencé, ée
Les mots débutant par Pot Les mots débutant par Po
Une suggestion ou précision pour la définition de Potencé, ée ? -
Mise à jour le samedi 7 février 2026 à 00h57
- Paix - Papa - Paradis - Paradoxe - Paraître - Pardon - Pardonner - Parent - Paresse - Parler - Parole - Parole chanson - Partage - Partir - Pas - Passé - Passé - Passion - Passoire - Patience - Patient - Patrie - Patriotisme - Pauvre - Pauvrete - Pauvreté - Payer - Pays - Paysan - Péché - Peche - Pédagogie - Pédanterie - Peine - Peinture - Pensée - Pensées - Penser - Perception - Père - Père noel - Père fils - Amour Papa - Enfants Père - Amour Père - Aime Père - Aime Papa - Père coeur - Père enfant - Père Mère - Père Fille - Père Fils - Fête des Pères - Bonne fête des pères - Perfection - Perfidie - Permanence - Perséverance - Personnage - Personnalité - Personne - Persuader - Pessimisme - Peuple - Peur - Philosophie - Phrases - Physiologie - Physique - Piano - Piege - Piston - Pitie - Pitié - Plagiat - Plaindre - Plaire - Plaisir - Plannification - Pleonasme - Pleur - Pleurer - Poésie - Poesie - Poète - Poete - Pognon - Police - Politesse - Politicien - Politique - Ponctualite - Populaire - Popularité - Pornographie - Porte - Posologie - Posséder - Postérité - Pouvoir - Prédiction - Préférence - Préjugé - Prendre - Présent - Président - Pret - Prétention - Prévoir - Prier - Principes - Prison - Privilege - Prix - Probabilite - Probleme - Producteur - Profit - Progres - Proletariat - Promenade - Promesse - Promettre - Prononciation - Proposer - Propriété - Prose - Prostituée - Prouver - Proverbe - Prudence - Psychanalyse - Psychologie - Psychose - Publicité - Pucelage - Pudeur - Punition - Pureté
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur potencé, ée
Poèmes potencé, ée
Proverbes potencé, ée
La définition du mot Potencé, ée est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Potencé, ée sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Potencé, ée présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
