La définition de Boulanger du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Boulanger
Nature : v. a.
Prononciation : bou-lan-jé
Etymologie : Berry, boulange, mélange de foin et de paille, préparé pour la nourriture des bestiaux ; boulanger de la paille et du foin, en faire un mélange. Du Cange le tire de boule ; d'où boulange qui se trouve en effet dans le Berry, et enfin boulanger, mêler, pétrir.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de boulanger de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec boulanger pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Boulanger ?
La définition de Boulanger
Pétrir et faire cuire le pain.
Toutes les définitions de « boulanger »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Celui, celle dont le métier est de faire et de vendre du pain. Garçon boulanger. La boutique, le fonds d'un boulanger.
Littré
-
1Celui, celle qui fait et vend du pain. Garçon boulanger.
Boulangère, s?ur converse qui fait le pain.
-
2 S. f. La boulangère, espèce de danse ou plutôt de ronde qui commence par un grand rond, après lequel un cavalier fait la grande chaîne, c'est-à-dire donne alternativement la main droite et la main gauche aux dames, en décrivant le cercle entier jusqu'à sa propre danseuse?; alors le grand rond recommence, et le cavalier qui vient après lui fait la chaîne à son tour.
L'air sur lequel la boulangère se danse. C'est un air à six-huit, comprenant d'abord dix mesures pendant lesquelles on fait le grand rond, et ensuite un refrain de quatre mesures qu'on répète à volonté pour la chaîne. L'air a probablement donné son nom à la danse, parce qu'il se chante sur les paroles?: la Boulangère a des écus, etc.
HISTORIQUE
XIIIe s. Et s'il ia boulengier ne boulengiere là ù li eswardeur viennent pour le pain eswarder?
, Tailliar, Recueil, p. 415. Boulenghier qui estoient relevé pour pestrir
, Chron. de Rains, 96.
XVIe s. Imitant tant que faire se pourra les boulengers
, De Serres, 822.
Encyclopédie, 1re édition
* BOULANGER, s. m. (Police anc. & mod. & Art.) celui qui est autorisé à faire, à cuire, & à vendre du pain au public.
Cette profession qui paroît aujourd'hui si nécessaire, étoit inconnue aux anciens. Les premiers siecles étoient trop simples pour apporter tant de façons à leurs alimens. Le blé se mangeoit en substance comme les autres fruits de la terre ; & après que les hommes eurent trouvé le secret de le réduire en farine, ils se contenterent encore long-tems d'en faire de la bouillie. Lorsqu'ils furent parvenus à en pétrir du pain, ils ne préparerent cet aliment que comme tous les autres, dans la maison & au moment du repas. C'étoit un des soins principaux des meres de famille ; & dans les tems où un prince tuoit lui-même l'agneau qu'il devoit manger, les femmes les plus qualifiées ne dédaignoient pas de mettre la main à la pâte. Abraham, dit l'Ecriture, entra promptement dans sa tente, & dit à Sara : pétrissez trois mesures de farine, & faites cuire des pains sous la cendre. Les dames Romaines faisoient aussi le pain. Cet usage passa dans les Gaules ; & des Gaules, si l'on en croit Borrichius, jusqu'aux extrémités du Nord.
Les pains des premiers tems n'avoient presque rien de commun avec les nôtres, soit pour la forme, soit pour la matiere : c'étoit presque ce que nous appellons des galettes ou gâteaux ; & ils y faisoient souvent entrer avec la farine le beurre, les ?ufs, la graisse, le safran, & autres ingrédiens. Ils ne les cuisoient point dans un four, mais sur l'atre chaud, sur un gril, sous une espece de tourtiere. Mais pour cette sorte de pain même, il falloit que le blé & les autres grains fussent convertis en farine. Toutes les nations, comme de concert, employerent leurs esclaves à ce travail pénible ; & ce fut le châtiment des fautes légeres qu'ils commettoient.
Cette préparation ou trituration du blé se fit d'abord avec des pilons dans des mortiers, ensuite avec des moulins à bras. Voyez Pain ; voyez Moulin. Quant aux fours, & à l'usage d'y cuire le pain, il commença en Orient. Les Hébreux, les Grecs, les Asiatiques, connurent ces bâtimens, & eurent des gens préposés pour la cuite du pain. Les Cappadociens, les Lydiens, & les Phéniciens y excellerent. Voyez Pain ; voyez Four.
Ces ouvriers ne passerent en Europe que l'an 583 de la fondation de Rome : alors ils étoient employés par les Romains. Ces peuples avoient des fours à côté de leurs moulins à bras ; ils conserverent à ceux qui conduisoient ces machines, leur ancien nom de pinsores ou pistores, pileurs, dérivé de leur premiere occupation, celle de piler le blé dans des mortiers ; & ils donnerent celui de pistoriæ aux lieux où ils travailloient : en un mot Pisior continua de signifier un Boulanger ; & pistoria, une boulangerie.
Sous Auguste, il y avoit dans Rome jusqu'à trois cents vingt-neuf boulangeries publiques distribuées en différens quartiers : elles étoient presque toutes tenues par des Grecs. Ils étoient les seuls qui sussent faire de bon pain. Ces étrangers formerent quelques affranchis, qui se livrerent volontairement à une profession si utile, & rien n'est plus sage que la discipline qui leur fut imposée.
On jugea qu'il falloit leur faciliter le service du public autant qu'il seroit possible : on prit des précautions pour que le nombre des Boulangers ne diminuât pas, & que leur fortune répondît pour ainsi dire de leur fidélité & de leur exactitude au travail. On en forma un corps, ou selon l'expression du tems, un collége, auquel ceux qui le composoient, restoient nécessairement attachés ; dont leurs enfans n'étoient pas libres de se séparer ; & dans lequel entroient nécessairement ceux qui épousoient leurs filles. On les mit en possession de tous les lieux où l'on mouloit auparavant, des meules, des esclaves, des animaux, & de tout ce qui appartenoit aux premieres boulangeries. On y joignit des terres & des héritages ; & l'on n'épargna rien de ce qui les aideroit à soûtenir leurs travaux & leur commerce. On continua de reléguer dans les boulangeries tous ceux qui furent accusés & convaincus de fautes légeres. Les juges d'Afrique étoient tenus d'y envoyer tous les cinq ans ceux qui avoient mérité ce châtiment. Le juge l'auroit subi lui-même, s'il eut manqué à faire son envoi. On se relâcha dans la suite de cette sévérité ; & les transgressions des juges & de leurs officiers à cet égard, furent punies pécuniairement : les juges furent condamnés à cinquante livres d'or.
Il y avoit dans chaque boulangerie un premier patron ou un surintendant des serviteurs, des meules, des animaux, des esclaves, des fours, & de toute la boulangerie ; & tous ces surintendans s'assembloient une fois l'an devant les magistrats, & s'élisoient un prote ou prieur, chargé de toutes les affaires du collége. Quiconque étoit du collége des Boulangers ne pouvoit disposer, soit par vente, donation ou autrement, des biens qui leur appartenoient en commun : il en étoit de même des biens qu'ils avoient acquis dans le commerce, ou qui leur étoient échûs par succession de leurs peres ; ils ne les pouvoient léguer qu'à leurs enfans ou neveux qui étoient nécessairement de la profession ; un autre qui les acquéroit, étoit aggrégé de fait au corps des Boulangers. S'ils avoient des possessions étrangeres à leur état, ils en pouvoient disposer de leur vivant, sinon ces possessions retomboient dans la communauté. Il étoit défendu aux magistrats, aux officiers & aux sénateurs, d'acheter des Boulangers mêmes ces biens dont ils étoient maîtres de disposer. On avoit cru cette loi essentielle au maintien des autres ; & c'est ainsi qu'elles devroient toutes être enchaînées dans un état bien policé. Il n'est pas possible qu'une loi subsiste isolée. Par la loi précédente, les riches citoyens & les hommes puissans furent retranchés du nombre des acquéreurs. Aussitôt qu'il naissoit un enfant à un Boulanger, il étoit réputé du corps : mais il n'entroit en fonction qu'à vingt ans ; jusqu'à cet âge, la communauté entretenoit un ouvrier à sa place. Il étoit enjoint aux magistrats de s'opposer à la vente des biens inaliénables des sociétés de Boulangers, nonobstant permission du prince & consentement du corps. Il étoit défendu au Boulanger de solliciter cette grace, sous peine de cinquante livres d'or envers le fisc, & ordonné au juge d'exiger cette amende, à peine d'en payer une de deux livres. Pour que la communauté fût toûjours nombreuse, aucun Boulanger ne pouvoit entrer, même dans l'état ecclésiastique : & si le cas arrivoit, il étoit renvoyé à son premier emploi : il n'en étoit point déchargé par les dignités, par la milice, les décuries, & par quelqu'autre fonction ou privilége que ce fût.
Cependant on ne priva pas ces ouvriers de tous les honneurs de la république. Ceux qui l'avoient bien servie, sur-tout dans les tems de disette, pouvoient parvenir à la dignité de sénateur : mais dans ce cas il falloit ou renoncer à la dignité, ou à ses biens. Celui qui acceptoit la qualité de sénateur, cessant d'être Boulanger, perdoit tous les biens de la communauté ; ils passoient à son successeur.
Au reste, ils ne pouvoient s'élever au-delà du degré de senateur. L'entrée de ces magistratures, auxquelles on joignoit le titre de perfectissimatus, leur étoit défendue, ainsi qu'aux esclaves, aux comptables envers le fisc, à ceux qui étoient engagés dans les décuries, aux marchands, à ceux qui avoient brigué leur poste par argent, aux fermiers, aux procureurs, & autres administrateurs des biens d'autrui.
On ne songea pas seulement à entretenir le nombre des Boulangers ; on pourvut encore à ce qu'ils ne se mésalliassent pas. Ils ne purent marier leurs filles ni à des comédiens, ni à des gladiateurs, sans être fustigés, bannis, & chassés de leur état ; & les officiers de police permettre ces alliances, sans être amendés. Le bannissement de la communauté fut encore la peine de la dissipation des biens.
Les boulangeries étoient distribuées, comme nous avons dit, dans les quatorze quartiers de Rome ; & il étoit défendu de passer de celle qu'on occupoit dans une autre, sans permission. Les blés des greniers publics leur étoient confiés ; ils ne payoient rien de la partie qui devoit être employée en pains de largesses ; & le prix de l'autre étoit réglé par le magistrat. Il ne sortoit de ces greniers aucun grain que pour les boulangeries, & pour la personne du prince, mais non sa maison.
Les Boulangers avoient des greniers particuliers ; où ils déposoient le grain des greniers publics. S'ils étoient convaincus d'en avoir diverti, ils étoient condamnés à cinq cents livres d'or. Il y eut des tems où les huissiers du préfet de l'Annone leur livroient de mauvais grains, & à fausse mesure ; & ne leur en fournissoient de meilleurs, & à bonne mesure, qu'à prix d'argent. Quand ces concussions étoient découvertes, les coupables étoient livrés aux boulangeries à perpétuité.
Afin que les Boulangers pussent vaquer sans relâche à leurs fonctions, ils furent déchargés de tutelles, curatelles, & autres charges onéreuses : il n'y eut point de vacance pour eux, & les tribunaux leur étoient ouverts en tout tems.
Il y avoit entre les affranchis, des Boulangers chargés de faire le pain pour le palais de l'empereur. Quelques-uns de ceux-ci aspirerent à la charge d'intendans des greniers publics, comites horreorum : mais leur liaison avec les autres Boulangers les rendit suspects, & il leur fut défendu de briguer ces places.
C'étoient les mariniers du Tibre & les jurés-mesureurs, qui distribuoient les grains publics aux Boulangers ; & par cette raison, ils ne pouvoient entrer dans le corps de la boulangerie. Ceux qui déchargeoient les grains des vaisseaux dans les greniers publics, s'appelloient saccarii ; & ceux qui les portoient des greniers publics dans les boulangeries, catabolenses. Il y avoit d'autres porteurs occupés à distribuer sur les places publiques le pain de largesse. Ils étoient tirés du nombre des affranchis ; & l'on prenoit aussi des précautions pour les avoir fideles, ou en état de répondre de leurs fautes.
Tous ces usages des Romains ne tarderent pas à passer dans les Gaules : mais ils parvinrent plûtard dans les pays septentrionaux. Un auteur célebre, c'est Borrichius, dit qu'en Suede & en Norvege, les femmes pétrissoient encore le pain, vers le milieu du xvi. siecle. La France eut dès la naissance de la monarchie des Boulangers, des moulins à bras ou à eau, & des marchands de farine appellés ainsi que chez les Romains, Pestors, puis Panetiers, Talmeliers, & Boulangers. Le nom de Talmeliers est corrompu de Tamisiers. Les Boulangers furent nommés anciennement Tamisiers, parce que les moulins n'ayant point de bluteaux, les marchands de farine la tamisoient chez eux & chez les particuliers. Celui de Boulangers vient de Boulents, qui est plus ancien ; & Boulents, de polenta ou pollis, fleur de farine. Au reste, la profession des Boulangers est libre parmi nous : elle est seulement assujettie à des lois, qu'il étoit très-juste d'établir dans un commerce aussi important que celui du pain.
Quoique ces lois soient en grand nombre, elles peuvent se réduire à sept chefs.
1° La distinction des Boulangers en quatre classes ; de Boulangers des villes, de Boulangers des faubourgs & banlieue, des Privilégiés, & des Forains.
2° La discipline qui doit être observée dans chacune de ces classes.
3° La jurisdiction du grand pannetier de France sur les Boulangers de Paris.
4° L'achat des blés ou farines, dont ces marchands ont besoin.
5° La façon, la qualité, le poids, & le prix du pain.
6° L'établissement & la discipline des marchés où le pain doit être exposé en vente.
7° L'incompatibilité de certaines professions avec celle de Boulanger.
Des Boulangers de Paris. Les fours banaux subsistoient encore avant le regne de Philippe Auguste. Les Boulangers de la ville fournissoient seuls la ville : mais l'accroissement de la ville apporta quelque changement, & bien-tôt il y eut Boulangers de ville & Boulangers de faubourgs. Ce corps reçut ses premiers reglemens sous S. Louis : ils sont très-sages, mais trop étendus pour avoir place ici. Le nom de gindre, dont l'origine est assez difficile à trouver, & qui est encore d'usage, est employé pour désigner le premier garçon du Boulanger. Philippe le Bel fit aussi travailler à la police des Boulangers, qui prétendoient n'avoir d'autre juge que le grand pannetier. Ces prétentions durerent presque jusqu'en 1350, sous Philippe de Valois, que parut un réglement général de police, où celle des Boulangers ne fut pas oubliée, & par lequel 1° l'élection des jurés fut transferée du grand pannetier au prévôt de Paris : 2° le prévôt des marchands fut appellé aux élections : 3° les Boulangers qui feroient du pain qui ne seroit pas de poids, payeroient soixante sous d'amende, outre la confiscation du pain. Le sou étoit alors de onze sous de notre monnoie courante. Henri III. sentit aussi l'importance de ce commerce, & remit en vigueur les ordonnances que la sagesse du chancelier de l'Hopital avoit méditées.
Il n'est fait aucune mention d'apprentissage ni de chef-d'?uvre dans les anciens statuts des Boulangers. Il suffisoit, pour être de cette profession, de demeurer dans l'enceinte de la ville, d'acheter le métier du Roi ; & au bout de quatre ans, de porter au maître Boulanger ou au lieutenant du grand pannetier un pot de terre, neuf, & rempli de noix & de nieulle, fruit aujourd'hui inconnu ; casser ce pot contre le mur en présence de cet officier, des autres maîtres, & des gindres, & boire ensemble. On conçoit de quelle conséquence devoit être la négligence sur un pareil objet : les Boulangers la sentirent eux-mêmes, & songerent à se donner des statuts en 1637. Le roi approuva ces statuts, & ils font la base de la discipline de cette communauté.
Par ces statuts, les Boulangers sont soûmis à la jurisdiction du grand pannetier. Il leur est enjoint d'élire des jurés le premier dimanche après la fête des Rois ; de ne recevoir aucun maître sans trois ans d'apprentissage ; de ne faire qu'un apprenti à la fois ; d'exiger chef-d'?uvre, &c.
Du grand Pannetier. Les anciens états de la maison de nos rois, font mention de deux grands officiers, le dapifer ou sénéchal, & le bouteiller ou échanson. Le dapifer ou sénéchal ne prit le nom de pannetier, que sous Philippe Auguste. Voyez l'article Grand-Pannetier. Depuis Henri II. cette dignité étoit toûjours restée dans la maison de Cossé de Brissac. Ses prérogatives étoient importantes. Le grand pannetier, ou sa jurisdiction, croisoit continuellement celle du prévôt de Paris, ce qui occasionnoit beaucoup de contestations, qui durerent jusqu'en 1674, que le roi réunit toutes les petites justices particulieres à celle du châtelet.
Des Boulangers de faubourgs. Les ouvriers des faubourgs étoient partagés, par rapport à la police, en trois classes : les uns étoient soûmis à la jurande & faisoient corps avec ceux de la ville : d'autres avoient leur jurande & communauté particulieres ; & il étoit libre d'exercer toute sorte d'art & maîtrise dans le faubourg S. Antoine. En faveur de l'importance de la Boulangerie, on permit à Paris & dans toutes les villes du royaume, de s'établir Boulanger dans tous les faubourgs, sans maîtrise. On assujettit les Boulangers de faubourgs, quant au pain qu'ils vendoient dans leurs boutiques, à la même police que ceux de ville ; quant au pain qu'ils conduisoient dans les marchés, on ne sçut si on les confondroit ou non, avec les forains.
Cette distinction des Boulangers de ville, de faubourgs, & forains, a occasionné bien des contestations ; cependant on n'a pas osé les réunir en communauté, & l'on a laissé subsister les maîtrises particulieres, de peur de gêner des ouvriers aussi essentiels.
Des Boulangers privilégiés ; ils sont au nombre de douze, & tous demeurent à Paris ; il ne faut pas les confondre avec ceux qui ne tiennent leur privilége que des lieux qu'ils habitent. Les premiers ont brevet & sont Boulangers de Paris ; les autres sont traités comme forains.
Des Boulangers forains, ou de ceux qui apportent du pain à Paris, de Saint-Denys, Gonesse, Corbeil, Villejuif, & autres endroits circonvoisins. Ces pourvoyeurs sont d'une grande ressource ; car deux centscinquante Boulangers que Paris a dans son enceinte, & six cents-soixante dans ses faubourgs, ne lui suffiroient pas. Elle a besoin de neuf cents forains, qui arrivent dans ses marchés deux fois la semaine. Ils ne venoient autrefois que le samedi. Il leur fut permis, en 1366, de fournir dans tous les jours de marché. Ils obtinrent ou prirent sur eux, au lieu d'arriver dans les marchés, de porter chez les bourgeois : mais on sentit & l'on prévint en partie cet inconvénient.
De l'achat des blés & des farines par les Boulangers. Deux sortes de personnes achetent des blés & des farines ; les Boulangers & les bourgeois & habitans de la campagne : mais on donne la préférence aux derniers, & les Boulangers n'achetent que quand les bourgeois sont censés pourvûs. Ils ne peuvent non plus enlever qu'une certaine quantité ; & pour leur ôter tout prétexte de renchérir le pain sans cause, on a établi des poids pour y peser le blé que reçoit un meûnier, & la farine qu'il rend. Voyez Blé & Farine. Il n'arrivoit jadis sur les marchés que des blés ou des farines non blutées : la facilité du transport a fait permettre l'importation des farines blutées.
De la façon & de la vente du pain. Voyez à l'article Pain, la maniere de le faire & de le vendre, avec ses différentes especes.
Du poids & du prix du pain. Voy. encore l'art. Pain.
Du débit & des places où il se fait. Tout Boulanger qui prend place sur un marché, contracte l'obligation de fournir une certaine quantité de pain chaque jour de marché, ou de payer une amende. Il faut qu'il s'y trouve lui ou sa femme, & que tout ce qu'il apporte soit vendu dans le jour. Il leur est enjoint de vendre jusqu'à midi le prix fixé, passé cette heure il ne peut augmenter, mais il est obligé de rabaisser pour faciliter son débit.
Il lui est défendu de vendre en gros à des Boulangers. Les marchés au pain se sont augmentés, à mesure que la ville a pris des accroissemens : il y en a maintenant quinze ; les grandes halles ; les halles de la Tonnelerie ; la place Maubert ; le cimétiere saint Jean ; le marché neuf de la cité ; la rue saint Antoine vis-à-vis les grands Jésuites ; le quai des Augustins ; le petit marché du faubourg S. Germain ; les Quinze-vingts ; la place du Palais royal ; le devant de l'hôtellerie des bâtons royaux, rue S. Honoré ; le marché du Marais du Temple ; le devant du Temple ; la porte S. Michel. Il se trouve, le mercredi & le samedi de chaque semaine, dans ces endroits, quinze cents trente-quatre Boulangers, dont cinq à six cents ou forains ou des faubourgs.
Profession incompatible avec la Boulangerie. On ne peut être Boulanger, meûnier, & marchand de grain parmi nous, ainsi que chez les Romains, on ne pouvoit être pilote, marinier, ou mesureur. Il n'est pas nécessaire d'en apporter la raison.
On trouvera aux articles Meûnier, Pain, Farine, Levain, Blé, Four, Grain, &c. le reste de ce qui concerne la profession de Boulanger.
S'ils vendent à faux poids, ils sont punis corporellement. Comme le pain est la nourriture la plus commune & la plus nécessaire, le marché au pain tient à Paris le mercredi & le samedi, quelques jours qu'ils arrivent, excepté seulement l'Épiphanie, Noël, la Toussaint, & les fêtes de Vierge ; dans ces cas le débit se fait le mardi & le vendredi. Quant au commerce des boutiques, il n'est jamais interrompu ; les Boulangers sont seulement obligés les dimanches & fêtes, de tenir les ais de leurs boutiques fermés.
BOULANGER, v. neut. qui n'est guere François que chez les Boulangers, où il signifie pétrir la farine & en faire du pain. Voyez Pétrir.
Wiktionnaire
Adjectif - français
boulanger \bu.l??.?e\
-
(Rare) Relatif à la boulangerie, à la fabrication du pain.
- Nous revenons maintenant sur ce sujet, mais à un autre point de vue : au lieu d'étudier la composition chimique de la farine en général, il s'agit cette fois d'appliquer l'examen chimique à la détermination de la valeur boulangère relative d'une farine donnée. ? (Léon Boutroux, Le pain et la panification, J.-B. Baillière & Fils, Paris, 1897, page 201)
Verbe - français
boulanger \bu.l??.?e\ transitif ou intransitif 1er groupe (voir la conjugaison)
-
Préparer et faire cuire le pain.
- La grande Nanon, son unique servante, quoiqu'elle ne fût plus jeune, boulangeait elle-même tous les samedis le pain de la maison. ? (Honoré de Balzac, Eugénie Grandet, 1834)
Nom commun - français
boulanger \bu.l??.?e\ masculin (pour une femme, on dit : boulangère)
-
Artisan dont le métier est de fabriquer ou de vendre le pain.
- Gabelle des boulangers. ? Ladite gabelle consiste en ce que tous les boulangers qui vendent pains cuits en la ville doivent 2 deniers par resal de farine ; les déforains, 1 gr. 8 den. par chacune charrette, et 4 den. de chacune charpagnée ou hottée. ? (Les archives de Nancy ou documents inédits relatifs à l'histoire de cette ville, publiées par Henri Lepage, volume 3, Nancy, Lucien Wiener, 1865, page 56)
- Si les corporations exclusivement féminines restent l'exception, les corporations mixtes qui admettent indistinctement les hommes et les femmes sont extrêmement nombreuses. Parmi celles-ci, il faut citer les drapiers, les tisserands, les grainiers (Rouen, Paris), les passementiers (Paris, Tours, Clermont), les cabaretiers (Tours, Orléans), les tonneliers (Nîmes), les tailleurs (Coutances, Angoulême, Dijon), les boulangers (Orléans, Paris), les merciers (Paris, Caen), les poissonniers (Paris, Dijon), les imprimeurs (Paris, Orléans, Caen), les limonadiers (Caen), les maçons (Apt), les corroyeurs (Annonay), les orfèvres (Lyon), les chaudronniers (Orléans), les charcutiers. ? (Léon Abensour, La Femme et le Féminisme avant la Révolution, Éditions Ernest Leroux, Paris, 1923, page 186)
- [?] ; les boulangers plaçaient les petits pains au chocolat et les chaussons aux pommes sous des présentoirs encadrés de laiton doré, comme des bijoux de joailliers. ? (Cécile de La Baume, Béguin, éd. Grasset, 1996, chapitre 7)
- Tenant d'une boulangerie.
- La boutique, le fonds d'un boulanger.
Trésor de la Langue Française informatisé
BOULANGER1, ÈRE, subst.
BOULANGER2, verbe.
Boulanger au Scrabble
Le mot boulanger vaut 12 points au Scrabble.
Informations sur le mot boulanger - 9 lettres, 4 voyelles, 5 consonnes, 9 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot boulanger au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
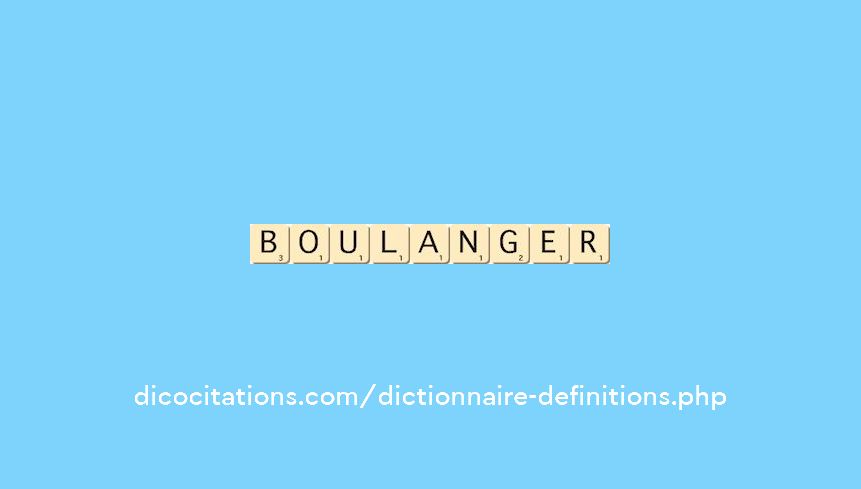
Les mots proches de Boulanger
Bouc Boucaner Boucanier Boucanière Boucassin Boucaut Boucaut Bouchalès Bouche Bouché, ée Bouchée Bouchement Boucher Boucher Boucherie Bouchet Boucheton (à) Bouchette Boucheur Bouchon Bouchon Bouchonné, ée Bouchonner Bouchure Boucle Bouclé, ée Boucler Bouclerie Bouclette Bouclier Boucon Bouder Bouderie Boudin Boudine Boudineuse Boudoir Boue Bouée Boueux, euse Bouffant, ante Bouffe Bouffe Bouffée Bouffer Bouffette Bouffi, ie Bouffir Bouffissage Bouffisseur Bou Bouafle Bouafles Bouan Bouaye Boubers-lès-Hesmond Boubers-sur-Canche Boubiers boubou bouboule bouboules boubous bouc Bouc-Bel-Air Boucagnères boucan boucanait boucané boucanée boucanées boucaner boucanerie boucanés boucanier boucaniers Boucau Boucé Boucé Boucey boucha bouchage Bouchage Bouchage bouchai bouchaient Bouchain bouchais bouchait Bouchamps-lès-Craon bouchant bouchardant boucharde boucharder Bouchaud Bouchaud Bouchavesnes-Bergen bouche bouche bouché bouchéMots du jour
-
avortait matelassés existant courtisans filatures mitochondrial feu triquais craquelins littérateurs
Les citations avec le mot Boulanger
- Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais plutôt du soin qu'ils apportent à la recherche de leur propre intérêt. Nous ne nous en remettons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme.Auteur : Adam Smith - Source : Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations (1776)
- A midi, le boulanger chargea son four en plein avec des fagots de chêne bien sec.Auteur : Jean Giono - Source : Jean le Bleu (1932)
- L'amour est grand poète: sa matière est inépuisable; mais si la fin à laquelle il vise n'arrive jamais, il morfond comme la pâte chez le boulanger.Auteur : Giacomo Giovanni Girolamo Casanova - Source : Histoire de ma vie (1960-1961)
- Dans le sous-sol d'une boulangerie un grillon chante, et on voudrait l'en faire sortir, comme de son trou avec un chaume, en fouillant de la canne dans le soupirail.Auteur : Jean Giraudoux - Source : Simon le Pathétique (1918)
- Ne gaspille jamais ni le vin du Curé, ni le pain du Boulanger.Auteur : Benjamin Franklin - Source : L'Almanach du Pauvre Richard (1732-1758)
- Pour le malade cloué au lit, les rues, les villes, les prés deviennent objets d’un douloureux désir qu’il a honte d’avouer aux bien-portants. Cette boulangerie devant laquelle le malade passait tous les jours lui apparaît comme un paradis perdu. Ce ne sont pas seulement les bien-portants qui abandonnent le malade, mais le malade qui abandonne et le monde et les bien-portants. Son seul bien, c’est sa fenêtre qui ouvre une brèche sur l’horizon rétréci. Les nuages qui défilent devant cette découpe rectangulaire changent, se dissipent, s’assombrissent, se colorent. Et peut-être, à travers la fenêtre, un de ces nuages rapportera-t-il à son cœur l’envie de vivre.Auteur : Milena Jesenská - Source : Vivre (1985)
- J'ai la maladie du boulanger ; j'ai la brioche qui cache la baguette.Auteur : Bernard Mabille - Source : La Revue de presse, 4 avril 2016
- A Delphis je vis le Peintre Vermeer qui n'avoit point de ses ouvrages; mais nous en vismes chez un boulanger qu'on avait payé de six cents livres, quoiqu'il n'y eust qu'une figure, que j'aurois trop payé de six pistoles.Auteur : Balthazar de Monconys - Source : Sans référence
- Ici repose Julie Tournelle, morte de honte il y a une heure. Voilà ce qui aurait été marqué sur ma tombe, avec à côté des petites plaques en marbre déposées par mes proches : Je vais vendre moins de croissants - sa boulangère.Auteur : Gilles Legardinier - Source : Demain j'arrête ! (2011)
- Sur le pas de la porte, deux chaises vides, celles du boulanger et de sa femme: ils allaient sans doute venir prendre le frais.Auteur : Henri Bosco - Source : Un rameau de la nuit (1950)
- Le boulanger cassait de temps en temps la gueule au receveur-buraliste qui flirtait avec sa femme.Auteur : Louis Aragon - Source : Les Beaux Quartiers (1936)
- Le boulanger déposa trois énormes pains bis et un sac de son dans le couffin de droite.Auteur : Henri Bosco - Source : L'Ane Culotte (1937)
- Louis XVI fut un assez mauvais roi qui ne donnait pas assez à boire et à manger à ses sujets. Ils allèrent le chercher à Versailles, et en revenant ils criaient : « On ramène le boulanger, la boulangère et le petit mitron. » Auteur : Claude Schnerb - Source : L'Humour vert (sous le pseudonyme de Claude Sergent), Éditions Buchet-Chastel, (1964)
- Un garçon boulanger à Paris gagne plus que deux douaniers, plus qu'un lieutenant d'infanterie, plus que tel magistrat, plus que la plupart des professeurs; il gagne autant que six maîtres d'école!Auteur : Jules Michelet - Source : Le Peuple
- Être aimée. Être désirée. Comme les pâtisseries aux framboises dans la vitrine de la boulangerie. Auteur : Camilla Grebe - Source : Un cri sous la glace (2017)
- On ne trompe point le boulanger sur le pain.Auteur : Proverbes espagnols - Source : Proverbe
- En été tavernière, en hiver boulangère.Auteur : Proverbes espagnols - Source : Proverbe
- Le pain gonfle en prenant la forme de la paume du boulanger. Le porter à sa bouche, c'est comme serrer la main de qui l'a pétri.Auteur : Erri De Luca - Source : Trois Chevaux (1992)
- C'est marrant de dire qu'une boulangerie est un gagne-pain...Auteur : Gilles Legardinier - Source : Demain j'arrête ! (2011)
- En temps de guerre, la vie est suspendue. On passe des jours dans les abris à ne rien faire, à tourner en rond, à l’écoute des dernières nouvelles du front. On ne sait plus vraiment ce qui se passe dehors, si la radio ment ou pas, si les déflagrations qu’on entend sont des « départs » ou des « arrivées ». En temps de guerre, on bannit le confort : on s’adapte à tout, on fait avec. En cas de pénurie d’essence, on attend des heures devant les stations-service ; quand le pain manque, on prend d’assaut les boulangeries ; et lorsque l’eau tarit dans les réservoirs, on court à la fontaine remplir les bidons. En temps de guerre, plus rien ne compte sauf Dieu, seule planche de salut dans un pays livré à la violence aveugle des hommes. Églises et mosquées ne désemplissent pas ; ceux qui n’ont jamais cru se retrouvent à genoux. En temps de guerre, enfin, les normes n’existent plus : le milicien fait la loi ; le gendarme se planque. Ceux qui ne se battent pas deviennent des lâches ; ceux qui tuent, des héros.Auteur : Alexandre Najjar - Source : Le Roman de Beyrouth (2005)
- Où le brasseur va, le boulanger ne va pas.Auteur : Proverbes belges - Source : Proverbe
- Si tu as la tête de beurre, ne te fais pas boulanger.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe
- Le chômage c’est la misère. Le travail est l’exploitation. On ne veut pas des miettes on veut tout de la boulangerie. Le travail est à la vie ce que le pétrole est à la mer. Auteur : Lola Lafon - Source : Chavirer (2020)
Les citations du Littré sur Boulanger
- ; Boulanger, le maître, avait pris pour devise, copiant l'Évangile : Venite ad me omnes qui stomacho laboratis, et ego vos restauraboAuteur : ÉD. FOURNIER - Source : Paris démoli, introd. p. XXXIX.
- Dans les dernières années de sa vie, il eut la consolation de voir former un établissement destiné à perfectionner la pratique de la mouture et de la boulangerieAuteur : CONDORCET - Source : Duhamel.
- Elle a payé au boulanger, il ne luy cuit plusAuteur : OUDIN - Source : ib.
- Il [Louis XI] entrait dans les moindres détails de la police, et il punit sévèrement les boulangers, qui avaient fait une cabale pour renchérir le painAuteur : DUCLOS - Source : Oeuv. t. III, p. 335
- Ce nouveau venu [Alma Tadema] doit inquiéter M. Gérôme, M. Rodolphe Boulanger et les autres résurrectionistes des bizarreries de l'antiquitéAuteur : BÜRGER - Source : Salons de 1861 à 1868, t. II, p. 43
- De huit à dix-huit ans [des pins], on obtient, par le dépressage, une grande quantité de bourrées, sur lesquelles se jettent tous les villages de la contrée [Sologne] et tous les boulangers des villesAuteur : JOHANET - Source : Journ. des Débats, 28 mars 1876, Feuilleton, 1re page 6e col.
- Il fit empaler un boulanger qu'il avait surpris en fraudeAuteur : Montesquieu - Source : Esp. XXVI, 24
- Elle n'avait plus rien et devait à toute la terre : à son boucher, à son boulanger, à ses femmes, à ses valets, à sa couturière, à son cordonnierAuteur : DIDER. - Source : Salon de 1767, Oeuv. t. XIV, p. 325, dans POUGENS
- Le peuple qui pille les boutiques de boulangers n'en prend pas conseil dans les livresAuteur : MARMONTEL - Source : Mém. XII
- Ordinairement les propriétaires confient la garde de leurs magasins à blé à un boulanger, qui se charge de remuer le bléAuteur : GENLIS - Source : Maison rust. t. III, p. 52, dans POUGENS
- Il [un traducteur d'Hérodote] ne nommera pas le boulanger de Crésus, le palefrenier de Cyrus, le chaudronnier Macistos ; il dit grand panetier, écuyer, armurier, avertissant en note que cela est plus nobleAuteur : P. L. COUR. - Source : Traduction d'Hérod. Préface
- Louis XIV, qui avait proscrit le calvinisme avec tant de hauteur, fit la paix, sous le nom d'amnistie, avec un garçon boulanger [chef des protestants insurgés dans les Cévennes]Auteur : Voltaire - Source : Louis XIV, 36
- Ly rois Philippe establi que les talemeliers [boulangers] demourans dedens la banlieue de Paris peussent vendre leur pain reboutiz, c'est assavoir leur reffus, si comme leur pain raté, que rat ou soris ont entamé, pain trop dur ou ars ou eschaudé, pain trop levé, pain aliz [trop compacte], pain mestourné, c'est à dire pain trop petit, qu'ilz n'osent mettre à estalAuteur : DU CANGE - Source : panis.
- À la plus robuste des servantes donnera charge la mere de famille de boulanger son pain, le paistrir et parfaireAuteur : O. DE SERRES - Source : 822
- Le pain le plus delicat est celui qu'on appelle pain mollet ; que les boulangers font par souffrance, n'estant permis par la police.... le pain dit bourgeois, et celui nommé de chapitre, suivent le mollet. ....le bourgeois s'esleve plus en rondeur, que celui de chapitre, qui est plus pressé et plus plat.... le bis-blanc suit après ; il est un peu gris ; finalement le bis.... tous lesquels pains faits par boulengers, qu'on nomme estrangers, sont dits, pain-chalan (hor-mis celui de Gonesse) qu'on vend à discretion sans autre police que des places....Auteur : O. DE SERRES - Source : 822
- La peine infligée au boulanger qui vole le pain du pauvre doit être au moins égale à la peine du pauvre qui vole le pain du boulangerAuteur : ALPH. KARR - Source : les Guêpes, 2 sept. 1840
- Il prendra vos filles pour les faire peintresses, cuisinieres et boulangeresAuteur : CALV. - Source : Instit. 1212
Les mots débutant par Bou Les mots débutant par Bo
Une suggestion ou précision pour la définition de Boulanger ? -
Mise à jour le samedi 7 février 2026 à 04h40
Dictionnaire des citations en B +
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur boulanger
Poèmes boulanger
Proverbes boulanger
La définition du mot Boulanger est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Boulanger sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Boulanger présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
