La définition de Déduction du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Déduction
Nature : s. f.
Prononciation : dé-du-ksion ; en poésie, de quatre sylla
Etymologie : Provenç. deductio ; espagn. deduccion ; ital. deduzione ; du latin deductionem, de deducere (voy. ).
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de déduction de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec déduction pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Déduction ?
La définition de Déduction
Soustraction, retranchement. Faire, demander une déduction. Il redoit tant, déduction faite des à-compte qu'il a payés.
Toutes les définitions de « déduction »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Action de soustraire une somme d'une autre. On lui a payé tant en déduction du principal. La succession, déduction faite des dettes et legs, monte à cent mille francs. Il signifie également, surtout en termes didactiques, Action de tirer une conséquence, d'inférer une chose d'une autre. Cette déduction n'est pas exacte. Une suite de déductions. Par extension, il se dit, en termes de Logique, du Procédé par lequel on va de la cause aux effets, du principe aux conséquences, du général au particulier. Le syllogisme est la principale forme de déduction. La déduction est opposée à l'induction.
Littré
- 1Soustraction, retranchement. Faire, demander une déduction. Il redoit tant, déduction faite des à-compte qu'il a payés.
- 2Récit détaillé, exposition minutieuse. Faire une longue déduction de ses plaintes.
-
3 Terme didactique. Conséquence tirée d'un raisonnement. Une déduction claire. Une déduction fausse.
Sorte de synthèse où l'on va de la cause aux effets, du principe aux conséquences, du général au particulier (voy. SYNTHÈSE), par une suite de propositions dépendant les unes des autres, qui s'enchaînent et se soutiennent mutuellement. La déduction est opposée à l'induction.
- 4 Terme de musique. Suite, dans le plain-chant, de notes montant diatoniquement ou par degrés conjoints.
HISTORIQUE
XIVe s. Si comme il est dit devant en la deduction de la quarte raison
, Oresme, Eth. 163.
XVe s. Sur et en deducion et rabat de la somme de six mille nobles d'or, cent marcs d'argent
, Bibl. des Chartes, 4e série, t. IV, p. 86.
XVIe s. Les deductions [récits] des exploits où ils se sont trouvez en personne
, Montaigne, I, 58. C'est [le livre de Tacite] plustost un jugement que deduction d'histoire?; il y a plus de preceptes que de contes?; ce n'est pas un livre à lire, c'est un livre à estudier et apprendre
, Montaigne, IV, 61.
Encyclopédie, 1re édition
DÉDUCTION, s. f. (Philosophie.) ce mot se prend en notre langue dans deux sens différens.
En matiere de calcul, d'affaires, &c. il signifie soustraction, l'action d'écarter, de mettre à part, &c. comme quand on dit : ce bénéfice, déduction faite des charges, des non-valeurs, des réparations, vaut 10000 livres de revenu : cette succession, déduction faite des dettes & legs, monte à 200000 liv. & ainsi des autres.
En matiere de Sciences, & sur-tout de Logique, déduction se dit d'une suite & d'une chaîne de raisonnemens, par lesquels on arrive à la preuve d'une proposition : ainsi une déduction est formée d'un premier principe, d'où l'on tire une suite de conséquences. Donc, pour qu'une déduction soit bonne, il faut 1°. que le premier principe d'où l'on part soit ou évident par lui-même, ou reconnu pour vrai : 2°. que chaque proposition ou conséquence suive exactement de la proposition ou conséquence précédente : 3°. on peut ajoûter que pour qu'une déduction soit bonne, non-seulement en elle-même & pour celui qui la fait, mais par rapport aux autres, il faut que la liaison entre chaque conséquence & la suivante puisse être facilement apperçûe, ou du moins que cette liaison soit connue d'ailleurs. Par exemple, si dans une suite de propositions on trouvoit immédiatement l'une après l'autre ces deux-ci : les planetes gravitent vers le Soleil en raison inverse du quarré des distances : donc elles décrivent autour du Soleil des ellipses. Cette conséquence, quoique juste, ne seroit pas suffisamment déduite, parce qu'il est nécessaire de faire voir la liaison par plusieurs propositions intermédiaires : ainsi on ne pourroit s'exprimer ainsi que dans un ouvrage dont le lecteur seroit supposé connoître d'ailleurs la liaison de ces deux vérités.
D'où il s'ensuit en général, que pour juger de la bonté d'une déduction, il faut connoître le genre d'ouvrage où elle se trouve, & le genre d'esprits & de lecteurs auxquels elle est destinée. Telle déduction est mauvaise dans un livre d'élémens, qui seroit bonne ailleurs.
Les ouvrages de Géométrie sont ceux où l'on peut trouver plus facilement des exemples de bonnes déductions ; parce que les principes de cette science sont d'une évidence palpable, & que les conséquences y sont rigoureuses : par conséquent s'il faut un certain degré plus ou moins grand de patience, d'attention & même de sagacité, pour entendre la plûpart de nos livres de Géométrie tels qu'ils sont, il en faudroit très-peu, & même si peu qu'on voudroit pour les entendre tels qu'ils pourroient être ; car il n'y a point de proposition mathématique si compliquée qu'elle soit en apparence, de laquelle on ne puisse former une chaîne continue jusqu'aux premiers axiomes. Ces axiomes sont évidens pour les esprits les plus bornés, & la chaîne peut être si bien serrée que l'esprit le plus médiocre apperçoive immédiatement la liaison de chaque proposition à la suivante. Chaque proposition bien entendue est, pour ainsi dire, un lieu de repos où il prend des forces pour passer aux autres, en oubliant, s'il veut, toutes les propositions précédentes. On pourroit donc dire qu'en matiere de Sciences exactes, les esprits ne different que par le plus ou le moins de tems qu'ils peuvent mettre à comprendre les vérités : je dis à comprendre, car je ne parle ici que de la faculté de concevoir, & non du génie d'invention, qui est d'un genre tout différent.
On pourroit demander ici, si dans une déduction l'esprit apperçoit ou peut appercevoir plusieurs propositions à la fois. Il est certain d'abord qu'il en apperçoit au moins deux ; autrement il seroit impossible de former un raisonnement quelconque : & pourquoi d'ailleurs l'esprit ne pourroit-il pas appercevoir deux propositions à la fois, comme il peut avoir à la fois deux sensations, par exemple celle du toucher & de la vûe, ainsi que l'expérience le prouve ? mais l'esprit apperçoit-il ou peut-il appercevoir à la fois plus de deux propositions ? C'est une question que la rapidité des opérations de notre esprit rend très-difficile à décider. Quoi qu'il en soit, il suffit pour une déduction quelconque, qu'on puisse appercevoir deux vérités à la fois, comme nous l'avons prouvé.
A toutes les qualités que nous avons exigées pour une bonne déduction, on pourroit ajoûter encore qu'afin qu'elle soit absolument parfaite, il est nécessaire qu'elle soit le plus simple qu'il est possible, c'est-à-dire que les propositions y soient rangées dans leur ordre naturel ; ensorte qu'en suivant tout autre chemin, on fût obligé d'employer un plus grand nombre de propositions pour former la déduction. Par exemple, les élémens d'Euclide sont un exemple de bonne déduction, mais non pas de déduction parfaite ; parce que l'ordre des propositions auroit pû être plus naturel & plus simple. Voyez sur cela les différens élémens de Géométrie, & l'art de penser. Voyez aussi Élémens, Géométrie, &c. (O)
Wiktionnaire
Nom commun - français
déduction \de.dyk.sj??\ féminin
- Action de soustraire une somme d'une autre.
- Il fait une déduction de la somme principal.
- La succession, déduction faite des dettes et legs, monte à cent mille francs.
- Rappelons la règle relative aux déductions : un contribuable peut soustraire de ses revenus les dépenses qui ont servi à générer ces entrées d'argent. J'insiste sur le « peut », il n'y a aucune obligation de le faire. ? (Daniel Germain, La gestion de la PCU, broche à foin jusqu'à la fin, Le journal du Québec, 23 décembre 2020)
-
(Didactique) Action de déduire, de tirer une conséquence, d'inférer une chose d'une autre.
- Les déductions de la science actuelle nous font connaître les véritables principes de l'amélioration, il ne faut que les poser et les écrire. ? (Jean Déhès, Essai sur l'amélioration des races chevalines de la France, École impériale vétérinaire de Toulouse, Thèse de médecine vétérinaire, 1868)
- Vos raisons ne sont pas des raisons, vos déductions ne sont que des hypothèses. ? (Pierre Souvestre et Marcel Allain, Fantômas, L'Agent secret, 1911, Éditions Robert Laffont, Bouquins, tome 1, page 969)
-
(Logique) Procédé par lequel on va de la cause aux effets, du principe aux conséquences, du général au particulier.
- Le syllogisme est la principale forme de déduction.
- La déduction est opposée à l'induction.
- (Antiquité romaine) Déduction de colonie (deducere coloniam) : installation d'une colonie de citoyens romains sur des terres confisquées aux vaincus.
Trésor de la Langue Française informatisé
DÉDUCTION, subst. fém.
Déduction au Scrabble
Le mot déduction vaut 13 points au Scrabble.
Informations sur le mot deduction - 9 lettres, 4 voyelles, 5 consonnes, 8 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot déduction au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
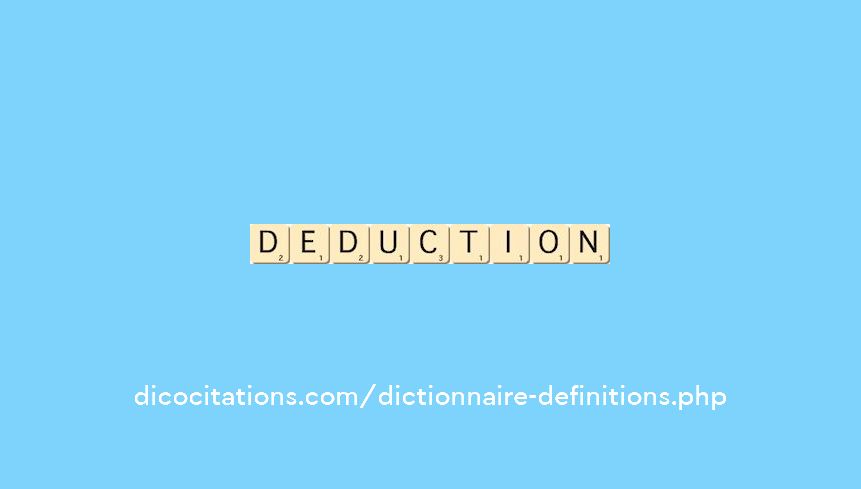
Les mots proches de Déduction
Dédaignable Dédaigné, ée Dédaigner Dédaigneur Dédaigneusement Dédaigneux, euse Dédain Dédale Dedans Dédicace Dédicatoire Dédier Dédieur Dédire Dédit, ite Dédit Dédite Dédommagé, ée Dédommagement Dédommager Dédorer Dédoreur Dédormir Dédoublement Dédoubler Déduction Déduire Déduit, ite Déduit dédaigna dédaignables dédaignaient dédaignais dédaignait dédaignant dédaignât dédaigne dédaigné dédaignée dédaignent dédaigner dédaignes dédaignés dédaigneuse dédaigneuse dédaigneuse dédaigneusement dédaigneuses dédaigneux dédaignez dédain dédains dédale dédales dedans dedans Dédeling dédia dédiaient dédiait dédiant dédicaça dédicaçait dédicace dédicace dédicacé dédicacé dédicacée dédicacée dédicacées dédicacées dédicacer dédicacerai dédicaces dédicaces dédicacés dédicacés dédicacez dédicaciezMots du jour
Enhardé, ée Extraction Brelandier, ière Jaseran Rubrique Stathoudérat Salinier Fertilité Bestial, ale Putrescible
Les citations avec le mot Déduction
- La puissance de vision qui fait le poète, et la puissance de déduction qui fait le savant.Auteur : Honoré de Balzac - Source : La Recherche de l'absolu (1834)
- Trois critères permettent de considérer une affirmation comme valide: la vérification par l'expérience directe, la déduction irréfutable, et le témoignage digne de confiance.Auteur : Jean-François Ricard, dit Jean-François Revel - Source : Le Moine et le Philosophe (1997)
- Lorsqu'un fait semble contredire une longue suite de déductions, c'est qu'on l'interprète mal.Auteur : Arthur Conan Doyle - Source : Sherlock Holmes, Une étude en rouge
- Nulle découverte n'a jamais été faite par déduction logique, aucune oeuvre d'art sans calcul, ni métier; dans l'une comme dans l'autre interviennent les jeux émotifs de l'inconscient.Auteur : Arthur Koestler - Source : Le cri d'Archimède
- Toute science humaine repose sur la déduction, qui est une vision lente par laquelle on descend de la cause à l'effet, par laquelle on remonte de l'effet à la cause.Auteur : Honoré de Balzac - Source : Louis Lambert (1832)
- Tout l'effort du drame est de montrer le système logique qui, de déduction en déduction, va consommer le malheur du héros.Auteur : Albert Camus - Source : Le mythe de Sisyphe (1942)
- Autrefois, par exemple, on disait tout bêtement: Voilà une idée raisonnable; maintenant on dit plus dignement: Voilà une déduction rationnelle.Auteur : Alfred de Musset - Source : Lettres à Dupuis et Cotonet (1837)
- La perception d'un fait, dans une enquête, ne peut consister en un choix contextuel, elle doit être absolument objective. Les choix se font ensuite, à grand-peine et non par la perception, mais par raisonnements, déductions, comparaisons, éliminations. Et il n'est pas dit qu'ils ne comportent pas tout de même un risque d'erreur, au contraire. Auteur : Andrea Camilleri - Source : La première enquête de Montalbano (2004)
Les citations du Littré sur Déduction
- Il y a deux sortes de gages vif et mort. Vif gage est qui s'acquitte des issues [dont le revenu vient en déduction de la dette], mort-gage, qui de rien ne s'acquitte [dont le revenu est absorbé en pure perte pour le débiteur]Auteur : LOYSEL - Source : 483, 484
- Pour l'amour de Dieu, et en deduction de tant moins de peine de purgatoireAuteur : François Rabelais - Source : III, 44
- Si comme il est dit devant en la deduction de la quarte raisonAuteur : ORESME - Source : Eth. 163
- C'est [le livre de Tacite] plustost un jugement que deduction d'histoire ; il y a plus de preceptes que de contes ; ce n'est pas un livre à lire, c'est un livre à estudier et apprendreAuteur : MONT. - Source : IV, 61
- Il est plus rationnel de penser que.... Autrefois, par exemple, on disait tout bêtement : Voilà une idée raisonnable ; maintenant on dit bien plus dignement : Voilà une déduction rationnelleAuteur : A. DE MUSSET - Source : Lett. de Dupuis et Cotonet, 1836
- Il faut faire une déduction équivalente à tout cela comme d'un temps perdu ; en quoi il faut user d'une grande droitureAuteur : VAUBAN. - Source : Dîme, p. 92
- Les deductions [récits] des exploits où ils se sont trouvez en personneAuteur : MONT. - Source : I, 58
- Si le corps y est, aussi par consequent et l'ame et la divinité y sont ensemble avec le corps ; si on leur nie ceste deduction qu'ils appellent concomitance, que feront-ils ?Auteur : CALV. - Source : Instit. 1133
Les mots débutant par Ded Les mots débutant par De
Une suggestion ou précision pour la définition de Déduction ? -
Mise à jour le dimanche 8 février 2026 à 09h02
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur déduction
Poèmes déduction
Proverbes déduction
La définition du mot Déduction est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Déduction sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Déduction présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
