Définition de « substance »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot substance de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur substance pour aider à enrichir la compréhension du mot Substance et répondre à la question quelle est la définition de substance ?
Une définition simple :
Définitions de « substance »
Trésor de la Langue Française informatisé
SUBSTANCE, subst. fém.
Wiktionnaire
Nom commun - ancien français
substance \Prononciation ?\ féminin
-
Essence (qualité d'un être).
-
Deivent en Deu aver fiance
Et honurer de sa substance ? (Wace, La Vie de Saint Nicolas, lignes 19-20)
-
Deivent en Deu aver fiance
- Substance (matière quelconque).
Nom commun - français
substance \syp.st??s\ féminin
-
(Philosophie) Ce qui subsiste par soi-même, indépendamment de tout accident.
- Je lui apprendrai, dit le docteur, les huit parties d'oraison, la dialectique, l'astrologie, la démonomanie, ce que c'est que la substance et l'accident, l'abstrait et le concret, les monades et l'harmonie préétablie. ? (Voltaire, Zadig ou la Destinée, VI. Le ministre, 1748)
- Descartes a donné trois démonstrations de l'existence de Dieu. 1° J'ai en moi l'idée de Dieu. Par le nom de Dieu, j'entends une substance infinie, éternelle, immuable, indépendante, toute-connaissante et toute-puissante. ? (Jules Simon, Introduction de: « ?uvres de Descartes », édition Charpentier à Paris, 1845)
- D'après Spinoza, il n'existe qu'une substance unique, dont tous les êtres sont des modes.
-
(Sciences) Toute sorte de matière.
- Au niveau du siège du dépôt tuberculeux, le périoste se détache de l'os , s'injecte , s'enflamme et fournit de l'exsudation plastique , qui peut s'organiser en substance osseuse. ? (Pierre-J. Haan, Abrégé de pathologie chirurgicale, 1863, page 77)
- Les poils de chèvre diffèrent de la laine du mouton par des cellules de surface externe qui sont un peu moins ou peu saillantes et par des stries de leur substance propre qui, au contraire, sont très apparentes. ? (D. de Prat, Nouveau manuel complet de filature; 1re partie: Fibres animales & minérales, Encyclopédie Roret, 1914)
- Celui qui veut vendre un cheval atteint d'épilepsie n'en peut pas dissimuler les accès à son gré à moins qu'il ne puisse les retarder ou les modérer par la vertu de substances médicamenteuses : le bromure de potassium par exemple. ? (Gabriel Maury, Des ruses employées dans le commerce des solipèdes, Jules Pailhès, 1877)
- Ce qu'il y a de meilleur, de plus succulent, de plus nourrissant en quelque chose.
- Les arbres, les plantes attirent la substance de la terre.
- Il n'y a guère de substance dans ces sortes d'aliments.
- Le bouillon a pris toute la substance de cette viande.
-
(Figuré) Ce qu'il y a d'essentiel dans un discours, dans un écrit, dans une affaire, etc.
- (Acte notarié). La preuve testimoniale n'est pas admissible contre les énonciations d'un acte notarié relatives à sa substance , aux dispositions qu'il contient, aux formes et solennités qu'il constate avoir été observées. ? (« Les codes annotés de Sirey », édition entièrement refondue par P. Gilbert, tome 1 : Code Civil, Paris : chez De Cosse & N. Delamotte, 1847, p. 613)
- Certains « on dit » circulent, s'amplifient, se font écho à eux-mêmes indéfiniment, sans avoir cependant de substance réelle. ? (Ludovic Naudeau, La France se regarde : le Problème de la natalité, Librairie Hachette, Paris, 1931)
-
Il y a beaucoup de paroles et peu de substance dans ce discours, dans ce livre : Il y a beaucoup de verbiage et peu d'idées.
? Je n'ai pu retenir tout ce qu'il a dit, mais je vous en rapporterai, je vous en dirai la substance. - Par conséquent, même dans les rares cas où l'approbation de la cour FISA est nécessaire pour cibler les communications d'un individu, la procédure ressemble plus à une pantomime dénuée de substance qu'à un contrôle véritablement significatif qui s'exercerait sur la NSA. ? (Glenn Greenwald traduit par Johan-Frédérik Hel Guedj, Nulle part où se cacher, JC Lattès, 2014, ISBN 978-2-7096-4615-4)
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
T. de Philosophie. Ce qui subsiste par soi-même, indépendamment de tout accident. Chez les catholiques, c'est un article de foi que, dans le mystère de l'Eucharistie, la substance du pain et du vin se change au corps et au sang de JÉSUS-CHRIST, et que les espèces demeurent. La substance des choses est distincte de leurs qualités. D'après Spinoza, il n'existe qu'une substance unique, dont tous les êtres sont des modes. Il se dit, en termes de Sciences et dans le langage ordinaire, de Toute sorte de matière. Ce fruit est d'une substance molle et aqueuse. Substance solide, liquide. Cette substance est employée en médecine, en pharmacie. Il se dit absolument de Ce qu'il y a de meilleur, de plus succulent, de plus nourrissant en quelque chose. Les arbres, les plantes attirent la substance de la terre. Il n'y a guère de substance dans ces sortes d'aliments. Le bouillon a pris toute la substance de cette viande. Fig., Il y a beaucoup de paroles et peu de substance dans ce discours, dans ce livre, Il y a beaucoup de verbiage et peu d'idées.
SUBSTANCE signifie, au figuré, Ce qu'il y a d'essentiel dans un discours, dans un écrit, dans une affaire, etc. Je n'ai pu retenir tout ce qu'il a dit, mais je vous en rapporterai, je vous en dirai la substance. La substance d'un livre, d'une lettre.
EN SUBSTANCE, loc. adv. Sommairement, en abrégé, en gros. Voici en substance de quoi il s'agit. Je vous dirai en substance ce que son livre contient.
Littré
-
1 Terme de philosophie. Ce qui subsiste par soi-même, à la différence de l'accident qui ne subsiste que dans un sujet.
Toute chose dans laquelle réside immédiatement comme dans un sujet, ou par laquelle existe quelque chose que nous apercevons, c'est-à-dire quelque propriété, qualité ou attribut dont nous avons en nous une réelle idée, s'appelle substance
, Descartes, Rép. aux secondes object. 61.Je soutiens que le temps n'est rien, parce qu'il n'a ni forme, ni substance?; que tout son être n'est que de couler, c'est-à-dire que tout son être n'est que de périr
, Bossuet, Yolande de Monterby.Nous ne connaissons la matière que par quelques phénomènes?; nous la connaissons si peu, que nous l'appelons substance?; or le mot substance veut dire ce qui est dessous?; mais ce dessous nous sera éternellement caché
, Voltaire, Dict. phil. âme.Leibnitz disait que les véritables substances étaient nécessairement actives
, Bonnet, ?uvr. mêlées, t. XVIII, p. 78, dans POUGENS.Si l'on ne veut parler des choses qu'autant qu'on se représente dans chacune un sujet qui en soutient les propriétés et les modes, on n'a besoin que du mot de substance
, Condillac, Conn. hum. v.L'objet de ce philosophe [Spinosa] est de prouver qu'il n'y a qu'une seule substance, dont tous les êtres, que nous prenons pour autant de substances, ne sont que les modifications?; que tout ce qui arrive est une suite également nécessaire de la nature de la substance unique
, Condillac, Traité des syst. 10.Dès que les qualités distinguent les corps, et qu'elles en sont des manières d'être, il y a dans les corps quelque chose que ces qualités modifient, qui en est le soutien ou le sujet, que nous nous représentons dessous, et que, par cette raison, nous appelons substance
, Condillac, Gramm. Préc. des leçons prél art. 1.Quand on a voulu pénétrer plus avant dans la nature de ce qu'on appelle substance, on n'a saisi que des fantômes
, Condillac, Gramm. II, 1. -
2 Par une déduction du sens philosophique, il se dit, avec une épithète ou un complément, des êtres spirituels, par opposition aux êtres matériels.
La substance qui pense y peut être reçue?; Mais nous en bannissons la substance étendue
, Molière, Femm. sav. v, 3.Je me trouve fort bien d'être une substance qui pense et qui lit
, Sévigné, 216.Vous nous direz comme vous vous y trouvez [à Grignan], et comme cette pauvre substance qui pense, et qui pense si vivement, aura pu conserver sa machine si belle et si délicate
, Sévigné, 25 oct. 1688.Il [Théodose] ordonnait que par tout son empire, selon la foi du saint concile de Nicée, on reconnût une seule substance indivisible dans la Trinité
, Fléchier, Hist. de Théodose, II, 32.On doit conclure de tout ceci, que les esprits créés seraient peut-être plus exactement définis, substances qui aperçoivent ce qui les touche ou les modifie, que de dire simplement que ce sont des substances qui pensent
, Malebranche, Recherc. vér. rép. à Régis, ch. 2.Pour de l'esprit, continua-t-il, je ne crois pas qu'une substance céleste puisse en avoir plus que votre cousine?: en un mot, c'est une personne d'un mérite accompli
, Lesage, Gil Bl. IV, 6.Y a-t-il des substances dont l'essence soit de penser, qui pensent toujours, et qui pensent par elles-mêmes??
Voltaire, Phil. ignor. 29.Qu'il y ait des substances immatérielles et intelligentes, c'est de quoi je ne doute pas
, Voltaire, Micromégas, ch. 7.Leur substance [des anges], fluide et pure comme l'air, Comme lui peut braver les atteintes du fer
, Delille, Parad. perdu, VI. -
3Matière dont un corps est formé, et en vertu de laquelle il a des propriétés particulières. Substance liquide, pierreuse, métallique. Substance compacte. Les substances employées en médecine.
Aux plus jeunes guerriers [ils] s'offrent pour aliment, Comme s'ils espéraient, changés en leur substance, être encore de Rome et l'âme et la défense
, Du Ryer, Scévole, II, 3.Si, dans le système de cet univers, il est nécessaire à la conservation du genre humain qu'il y ait une circulation de substance entre les hommes, les animaux et les végétaux, alors le mal particulier d'un individu contribue au bien général
, Rousseau, Lett. à M. de Voltaire, Corresp. t. III, p. 234.Bergman observe qu'il faut considérer comme une substance particulière celle qui a des propriétés qui lui sont spéciales et que l'on peut toujours obtenir d'une manière semblable à elle-même
, Sennebier, Ess. art d'observ. t. III, p. 101, dans POUGENS.On dit qu'un médicament est administré en substance, quand on le donne dans son état naturel et sans aucune préparation chimique ni pharmaceutique.
Terme d'anatomie générale. Substances organiques ou principes immédiats, corps liquides ou solides, qui ne sont ni cristallisables, ni volatils sans décomposition?; brûlant avec peu de flamme en se boursouflant?; dégageant des produits empyreumatiques ammoniacaux, azotés et d'odeur âcre, puis laissant un charbon brillant, volumineux, difficile à incinérer.
Substance fondamentale, voy. FONDAMENTAL.
-
4 Absolument. Ce qu'il y a de nourrissant, de succulent en quelque chose. Les plantes attirent la substance de la terre. Aliments qui ont peu de substance. La substance de la viande bouillie passe dans le bouillon.
Fig.
Qui de nous n'a pas été prodigue?? qui n'a pas dissipé sa substance par une vie déréglée et licencieuse??
Bossuet, 1er panég. St Fr. de Paule, Préamb. -
5 Fig. Ce qui nourrit l'esprit comme la substance nourrit le corps. Il y a beaucoup de paroles et peu de substance dans ce discours.
Il y a plus de substance dans une de ses pages que dans tous les volumes des détracteurs de Sénèque
, Diderot, Claude et Nér. II, 34.Son langage était rapide, entrecoupé, plein de substance et de chaleur
, Marmontel, Contes mor. les Quatre flacons. -
6Ce qu'il y a d'essentiel, d'important dans un écrit, un acte, une affaire, etc.
Laisse-moi de ce mot [billet] méditer la substance
, Rotrou, Bélis. III, 1.Il ne me souvient peut-être pas des propres paroles?; mais je suis assuré que c'en était la substance
, Retz, Mém. t. II, liv. 3, p. 358, dans POUGENS.S'ils [les dominicains] sont conformes aux jésuites par un terme qui n'a pas de sens [grâce suffisante], ils leur sont contraires et conformes aux jansénistes dans la substance de la chose
, Pascal, Prov. II.La substance de presque tous les ordres émanés du trône était contenue dans ces mots?: car tel est notre plaisir?; Louis XVI aurait pu dire?: car telle est notre sagesse et notre bonté
, Voltaire, Pol. et lég. Édits de Louis XVI.Des révolutions qu'elle [la religion chrétienne] a souffertes, non dans la substance des dogmes, mais dans la manière de les enseigner
, D'Alembert, Élog. Fleury. -
7Ce qui est absolument nécessaire pour la subsistance.
Ils consument en douleur leur substance et leurs jours
, Patru, Plaidoyers, I.On dévore la substance du pauvre, on ruine la veuve et l'orphelin
, Bourdaloue, Carême, II, Richesses, 17.Si ceux qui passent leurs jours dans les travaux rustiques, avaient le loisir de murmurer, ils s'élèveraient contre les exactions qui leur enlèvent une partie de leur substance
, Voltaire, Louis XIV, 30.Tous ces vils sénateurs dont l'avarice inique Dévore sans pitié la substance publique
, Chénier M. J. Gracques, I, 2. -
8En substance, loc. adv. En gros, sommairement. Voici en substance de quoi il s'agit.
Elle [une lettre] contenait en substance quelques particularités de la conduite de Dieu sur la vie et sur la maladie que je voudrais vous répéter ici
, Pascal, Lett. à Mme Perier, 17 oct. 1651.Les mémoires [des corporations] disaient tous en substance?: Conserveznous et détruisez toutes les autres
, Voltaire, Babouc.
HISTORIQUE
XIIe s. E la meie substance ensement cume nient devant tei
, Liber psalm. p. 51.
XIIIe s. Feme sens et sustance trait d'home debonaire,
Chastie-musart, dans RUTEB. II, p. 482. Por ce devons nos croire que ces trois personnes [de la Trinité] soient une sustance qui est touz puissanz et tout sachanz et touz bienveillanz
, Latini, Trésor, p. 80. Nuls ne doit affoiblir sa corporel sustance Par boivre jusqu'à yvre?
, J. de Meung, Test. 1747. Solempnité n'est pas de la sustance de mariage
, Liv. de just. 178. Et encraissié d'autrui sustance
, Baudouin de Condé, t. I, p. 215.
XIVe s. Ne te chault s'il perdent chevance, Mais que tu aies leur substance?; Soies tousjours tout prest de prendre
, J. Bruyant, dans Ménagier, t. II, p. 25.
XVe s. Quant le roy eut ouye la substance de la charge de cest ambassadeur?
, Commines, V, 2.
XVIe s. Le mot grec [hypostase] emporte subsistence?: et aucuns ont confondu le mot de substance comme si c'estoit tout un
, Calvin, Instit. 71. Demetrius prononça le decret, lequel avoit esté ordonné par le peuple, dont la substance estoit telle?
, Amyot, Timol. 53. Nostre intention est d'escrire et traitter de la vertu que l'on appelle morale?: quelle substance elle a, et comment elle subsiste
, Amyot, De la vertu morale, 1. Pour l'honneur de Dieu, sustance [maintien] de la reigle et reformation
, Du Cange, Sustinentia. Pourquoy sous le nom de Dieu ne peut-on changer les substances de toutes choses, veu que sous le nom du roy on en a fait et fait-on tous les jours de si estranges metamorphoses et transsubstantiations??
D'Aubigné, Conf. de Sancy, x.
Encyclopédie, 1re édition
SUBSTANCE, (Philos. Log. Métaph.) c'est l'assemblage de plusieurs qualités, dont les unes subsistent toujours entr'elles, & les autres peuvent se séparer pour faire place à de nouvelles. Sous ce point de vûe, rien n'est si simple que l'idée de la substance dont on a tant disputé, & dont on disputera encore, sans pouvoir rien dire de plus clair sur sa nature.
L'on veut donner un nom à cet assemblage de qualités ; pour cela l'on néglige celles qui varient d'un moment à l'autre ; l'on ne porte son attention que sur les plus durables. Elles deviennent pour le commun des hommes essentielles à l'être, ou plutôt à l'assemblage désigné sous le nom général de substance, & l'on les appelle elles-mêmes souvent mal-à-propos les substances, & mieux les attributs essentiels, tandis que les autres qualités qui varient, qui peuvent être ou n'être pas dans cet assemblage, ne sont regardées que comme des manieres d'être que l'on appelle modes. Voyez l'article Modes. Mais les Philosophes, ou ceux qui cherchent à donner un sens plus resserré aux mots, ayant remarqué que parmi ces qualités durables de la substance il y en a de si essentielles, qu'elles ne se séparent jamais, & qu'elles sont même si inhérentes que l'on ne peut en concevoir la séparation, sans comprendre que l'être en seroit non-seulement changé, mais entierement détruit ; ils ont réservé le nom de substance, à désigner l'assemblage de ces qualités premieres, essentiellement inséparables ; & quant aux autres qui sont durables, mais qui cependant peuvent être retranchées sans que les premieres soient anéanties, ils les ont nommées substances modifiées. Un exemple qui indiqueroit toute la gradation des qualités d'une substance, serviroit aussi à expliquer ce que l'on peut dire de plus simple sur ce sujet. Jettons les yeux sur un fleuve ; nous verrons une vaste étendue d'eau qui résiste, mais foiblement, au toucher, qui est pesante, liquide, transparente, sans couleur, sans goût, sans odeur, & en mouvement. Si tout-à-coup ce corps venoit à perdre sa transparence, & à se colorer d'un gris sale, ou d'un gris noir ; pour un si léger changement, nous ne lui donnerions pas un nouveau nom, nous dirions seulement que le fleuve se trouble, qu'il charie ; lors même qu'il acquéreroit quelque goût, quelque odeur, ce seroit toujours un fleuve. Mais s'il venoit à perdre son mouvement, à rester pour toujours en repos, ce changement nous paroîtroit plus considérable, parce qu'alors ce fleuve deviendroit semblable à ces amas d'eau, que l'on nomme lacs ou étangs ; ce ne seroit plus un fleuve, mais seulement de l'eau, un lac. Si ensuite la rigueur du froid agissoit, nous ne savons trop comment, sur cet amas d'eau, & lui faisoit perdre sa liquidité, il perdroit aussi son nom d'eau & deviendroit glace. L'été suivant, exposée aux ardeurs du soleil, cette eau quitteroit, pour ainsi dire, sa pesanteur, elle s'éleveroit dans l'air en vapeur ; on ne la nommeroit plus eau, mais vapeur, brouillard, nuage. Cependant dans tous ces changemens elle a conservé son étendue, cette résistance que les Physiciens appellent impénétrabilité ; aussi a-t-elle toujours été corps. Mais si elle venoit à perdre cette étendue, cette impénétrabilité, que lui resteroit-il ? Rien du tout ; car nous ne concevons ni la pesanteur, ni la fluidité, ni le mouvement sans étendue impénétrable. Aussi cette destruction de l'étendue & de l'impénétrabilité n'arrive point ; ces qualités sont tout autrement durables que les autres, il n'est aucune force dans la nature qui puisse les produire ou les détruire, c'est pourquoi leur assemblage prend le nom propre de la substance. Le corps, c'est-à-dire l'étendue impénétrable est une substance ; mais la vapeur, la glace, l'eau, le fleuve sont ici des substances modifiées.
Remarquons dans cet exemple que la gradation des qualités d'une substance, qui fait que nous les regardons comme plus ou moins essentielles, est toute fondée sur leur dépendance mutuelle. Ici un fleuve c'est de l'eau courante ; le cours de l'eau ne peut se concevoir que l'eau elle-même n'existe, l'eau est donc comme la substance du fleuve dont le mouvement est le mode. L'eau est un corps liquide, pesant. La liquidité, la pesanteur ne peuvent exister sans l'étendue impénétrable. C'est pourquoi le corps est regardé comme faisant la substance qui, modifiée par la pesanteur, par la liquidité, s'appelle eau. Nous ne voyons aucune qualité plus essentielle dont dépendent l'étendue & l'impénétrabilité, ce sont donc elles qui font la substance connue sous le nom de corps.
La raison s'arrête-là, parce qu'elle ne peut aller plus loin, en ne consultant que des idées claires. Mais l'imagination fait bien plus de chemin ; & voici comme elle raisonne chez la plûpart des hommes. Voyant, dans l'exemple dont nous nous servons, de l'eau tantôt froide, tantôt chaude ; jugeant d'ailleurs que l'eau refroidie est la même que l'eau qui étoit chaude peu auparavant, elle regarde l'eau comme un être distinct de ces deux qualités, le froid & le chaud, comme un sujet qui se revêt ou se dépouille alternativement de l'une ou de l'autre de ces qualités, qui, pour ainsi dire, sont des modes appliquées ou mises en usage sur un habit. Découvrant ensuite dans l'eau d'autres qualités, comme le mouvement, la transparence, la fluidité, dont les unes peuvent être séparées sans que l'eau cesse d'être eau, & dont les autres ne se trouvent pas dans tous les corps, l'imagination met toutes ces qualités dans le rang des modes ou des accidens, dont le sujet est revêtu jusqu'aux plus essentielles, telles que l'étendue, l'impénétrabilité ; ensuite elle cherche un sujet qui soit comme le soutien, le n?ud de cet assemblage, & ce sujet est bientôt nommé substance. Puis on vient à l'examiner plus près, & l'on trouve qu'on ne sauroit lui attribuer en propre aucune qualité, puisque l'on a écarté de son idée toutes celles dont l'on s'imaginoit qu'il étoit simplement revêtu : car, dit-on, le sujet de l'eau n'est pas lui même l'étendue, mais il est doué d'étendue ; il n'est pas la fluidité, mais il possede cette qualité. Ne croyez pas que ce soit la pesanteur ou la transparence, mais dites qu'il a de la pesanteur & de la transparence ; ainsi plus on étudie ce prétendu sujet, moins on peut le concevoir, parce qu'en effet il n'est pas possible, après avoir dépouillé une chose de toutes ses qualités, de vouloir qu'il lui reste encore quelque chose. Ce sujet devient donc d'autant plus obscur, qu'on le regarde d'un ?il plus attentif, de sorte que l'on est forcé de conclure que les substances nous sont entierement inconnues, & que nous n'en connoissons que les modes. M. Locke, ce grand méthaphysicien, est allé jusque-là, & fondé sur ce que les vraies causes des qualités sensibles nous étoient cachées, il en a conclu que les essences réelles des êtres ou les substances nous étoient entierement inconnues. Il est vrai que nous ne connoissons pas toujours la liaison qui est entre ces qualités dont nous avons formé un assemblage, que nous ne pouvons pas savoir si cette liaison est nécessaire ou casuelle, parce que nous ne pouvons pénétrer jusqu'à la source d'où ces qualités dérivent, que jugeant par nos sens des êtres extérieurs, & ces sens ne nous montrant que la relation que ces êtres ont avec nous, ou les impressions qu'ils peuvent faire sur nous en agissant sur nos organes, il ne nous est pas facile de juger ni de connoître les qualités originales ou substantielles, qui donnent l'être aux qualités sensibles. Nous éprouvons que le feu est chaud ; mais qu'y a-t-il dans le feu qui ne se trouve pas dans la glace ? & en vertu de quoi cet élément fait-il sur nos organes cette impression d'où naît la sensation de la chaleur ? C'est ce qu'on ignore, & que les Physiciens ne savent guere mieux que les autres. En ce sens, on a raison de dire que les essences réelles ou les substances nous sont inconnues, que les idées que nous en avons fondées sur des qualités sensibles ne sont pas des images vraies, ni des ressemblances exactes des qualités primitives qui constituent la substance, qu'elles sont défectueuses & très-diverses chez la plûpart des hommes, comme étant l'ouvrage de leur esprit. Cependant l'on ne peut pas dire absolument qu'elles soient de pur caprice, puisque ces qualités, a l'assemblage desquelles nous avons donné un nom & formé ainsi une substance, existent réellement ensemble & dans une union intime, si elles n'ont rien de contradictoire, ou qu'elles ne s'excluent pas mutuellement ; & que n'y ayant que les qualités sensibles qui nous trompent, nous connoîtrons du-moins l'essence des substances dans l'idée desquelles il n'entre aucune de ces idées sensibles, telles que l'ame & le corps pris en général & par abstraction ; qu'ainsi leur essence que nous savons consister dans la réunion des qualités primitives, & non sensibles, nous sera fidellement représentée par son idée, c'est-à-dire qu'elle nous sera connue tout comme celle des êtres qui sont purement de notre façon.
Nous pouvons dire que nous connoissons l'essence de l'ame, parce que nous avons une idée juste de ses facultés, l'entendement, l'imagination, la mémoire, la sensation, la volonté, la liberté ; voilà ce que c'est que l'ame & son essence. Nous croyons qu'il ne faut pas y chercher d'autre mystere, ni imaginer un sujet inconnu qui ne se présente jamais à nous, & que nous voudrions supposer être le soutien de ces propriétés qui se font connoître. Qu'est-ce en effet que l'entendement ? sinon l'ame elle-même entant qu'elle conçoit distinctement ; & la volonté de l'ame, n'est-ce pas l'ame elle-même considérée entant qu'elle veut ? Donc celui qui sait ce que c'est que l'entendement, la volonté, connoît l'essence de l'ame. De même celui qui connoît l'étendue, la solidité & la force en général, connoît l'essence du corps. Comment se persuader que le corps soit un être différent de ses propriétés, auquel l'étendue, la force, la solidité soient comme appliquées, qui le couvrent, de maniere qu'elles nous cachent le sujet ? N'est-il pas plus naturel, plus certain que l'étendue du corps n'est autre chose que le corps considéré par abstraction entant qu'étendu, & sans faire attention à la solidité, à la force ? Et peut-on se figurer un être étendu, solide, & capable d'agir, sans concevoir que c'est un corps ? De ces deux substances qu'il nous soit permis de nous élever à la substance infinie, premiere cause de toutes les substances créées, ou de tous les êtres. Comment pouvons-nous la connoître que par ses attributs ? Qu'est-ce que Dieu que l'Etre nécessaire, ayant en lui sa propre existence, éternel, immuable, infiniment parfait ? Cet Etre considéré sous toutes ces qualités, cet assemblage de perfections est la substance à laquelle nous donnons le nom de Dieu, & dont l'essence ne peut être connue, ni l'idée apperçue, qu'autant que nous avons celle de ses attributs ou de ses perfections.
Mettons cependant une réserve à ce que nous avons dit, que l'essence des substances nous étoit connue. Ce n'est pas à dire que nous connoissions à fond des êtres, tels que l'ame & le corps ; car nous pouvons bien connoître les qualités essentielles, & ignorer en même tems les attributs qui en découlent, tout comme nous pouvons très-bien entendre un principe, sans qu'il suive de-là que nous en découvrions toutes les conséquences. Le défaut de pénétration, d'attention, de réflexion, ne permet pas que nous envisagions un objet par toutes les faces qu'il peut avoir, ni que nous le comparions à tous ceux avec lesquels il a des rapports : ainsi de ce que nous connoissons en général l'essence de l'ame & du corps, on ne doit pas en conclure que nous connoissons l'essence de toutes les ames & de tous les corps en particulier. Ce qui fait la différence, ce qui distingue l'une de l'autre, c'est peut-être quelque chose de si fin & de si délicat, qu'il peut nous échapper facilement. Les essences des corps particuliers sont hors de la portée de nos sens, & nous ne les distinguons guere que par des qualités sensibles ; dès-lors l'illusion s'en mêle : nous perdons de vûe l'essence réelle, & nous sommes forcés à nous en tenir à l'essence nominale, qui n'est que l'assemblage des qualités sensibles auquel nous avons donné un nom. Voyez le ch. vj. du III. liv. de l'Essai sur l'entendement humain de M. Locke, & plusieurs autres § §. de cet excellent ouvrage.
Je ne sais si le peu que nous avons dit des substances en général, n'est pas ce qu'il y a de plus simple & de plus vrai sur un sujet que l'on couvre de ténebres à force de vouloir l'analyser. Cela même ne suffiroit-il pas pour faire sentir la fausseté de la définition que l'on a donnée des substances, comme étant ce qui est en soi, & conçu par soi-même, ou dont l'idée n'a pas besoin pour être formée de l'idée d'autre chose ? En connoît-on mieux les substances ? Apperçoit-on ici l'union de l'idée d'être avec celle d'indépendance de toute autre chose ? Est on fondé à ajouter à l'essence de la substance ce qui n'est point renfermé dans son idée, savoir l'existence en soi & indépendante de ses attributs ? Ce qui indique assez que ceux qui veulent bâtir un système sur ce principe, & isoler la substance de ses qualités, n'ont d'autre but que de confondre tout sous l'idée d'une seule substance nécessaire, qui nous est & nous sera toujours inconnue, tant qu'on voudra la considérer comme un simple sujet existant sans ses qualités, & indépendamment de ses déterminations, que l'on ne peut en séparer ni les confondre entr'elles sans absurdité. Voyez sur le système de Spinosa une ample réfutation dans un fort bon ouvrage, qui a paru nouvellement sous le titre d'Examen du Fatalisme.
Substances animales, (Chimie.) je renfermerai sous cette dénomination générale, toutes les diverses parties des animaux que la Chimie a soumises jusqu'à présent à l'analyse ; & principalement leurs parties solides ou organisées, telles que les chairs (Voyez Chair, Anatomie.), les tendons, cartilages, os, cornes, ongles ; les écailles proprement dites ; les poils, les plumes, la soie, &c. & il sera d'autant plus convenable de traiter de toutes ces substances dans un seul article, que les Chimistes n'en ont retiré jusqu'à présent que les mêmes principes, & par conséquent qu'elles ne sont proprement qu'un même & unique sujet chimique. Cette identité de nature, soit réelle, soit relative à l'état présent des connoissances chimiques, est principalement observée sur les animaux les plus parfaits, les quadrupedes, les oiseaux, les poissons, les reptiles. Quelques insectes ont une composition différente, mais plutôt entrevue jusqu'à présent que convenablement établie, excepté cependant sur un petit nombre d'especes, & nommément sur la fourmi, à laquelle nous avons accordé aussi un article particulier. Voyez Fourmi, Chimie.
Certaines parties fluides des animaux ont encore la plus grande analogie chimique avec leurs parties solides, c'est-à-dire que l'analyse vulgaire les résout aussi dans les mêmes principes, à-peu-près. Il est même assez bien connu que l'humeur que j'appelle proprement animale, fondamentale, constituante, savoir la mucosité animale ; & que l'humeur en laquelle celle-ci dégenere immédiatement, savoir la lymphe, que ces humeurs, dis-je, sont au fond une même substance avec les parties solides ou organiques des animaux. Et cette vérité est non-seulement prouvée par l'identité des produits de leur analyse respective, mais encore par l'observation physiologique du changement successif de la mucosité, ou de la lymphe en diverses parties solides ou organisées ; ce changement est sur-tout singulierement remarquable dans la production de la soie, qui est sensiblement dans le ver sous la forme d'une masse uniforme de vraie mucosité, qui a la consistance d'une gelée tendre & légere, se résolvant très-aisément en liqueur, &c. & qui est immédiatement & soudainement changée en filets très-solides, en passant par certaine filiere disposée dans la tête du ver. Ainsi analyser de la soie, analyser un cartilage, un os, un muscle, c'est proprement, & quant au fond, analyser de la mucosité, ou de la lymphe animale. Quelques-unes de ces substances solides ne different réellement de leur matiere primordiale, que par une différente proportion, ou plutôt par une surabondance de terre comme nous l'observerons dans la suite de cet article.
Il s'agit donc ici de la lymphe & des parties solides qui en sont formées. Quant à cette humeur générale, ou plutôt cet assemblage, cet océan (comme les Physiologistes l'appellent) de diverses humeurs animales, connu sous le nom de sang, cette substance animale mérite d'être considérée à part, par cette circonstance même d'être un mêlange très-composé, non-seulement chargé de la véritable matiere animale, c'est-à-dire, de la lymphe, & d'une partie qui lui paroît propre & qui le spécifie, savoir la partie rouge ; mais encore de diverses matieres excrémenticielles, ou étrangeres à la matiere animale proprement dite, savoir divers sels, une eau superflue, ou la partie de la boisson surabondante à la réparation ou à la nutrition, les diverses humeurs excrémenticielles, bile, urine, salive, &c. ou du moins leurs matériaux, &c. Aussi trouvera-t-on dans ce Dictionnaire un article particulier Sang, (Chimie.) Voyez cet article.
On trouvera aussi un article particulier Graisse, (Chimie.) & un article Lait, (Chimie.)
Les divers excrémens des animaux, soit solides, soit fluides, soit généraux, communs, ou du moins très ordinaires, comme la matiere fécale, la bile, la salive, l'urine, soit particuliers à quelques animaux comme castoreum, civette, musc, &c. ayant chacun une composition particuliere, il en est traité dans des articles particuliers. Voyez Bile, Fécale Matiere, Salive, Urine, &c. Civette, Musc.
Les Chimistes n'ont point découvert encore la constitution chimique spéciale de la semence des animaux ; ils ne connoissent dans cette liqueur que les qualités communes de la lymphe.
Les produits pierreux de plusieurs animaux, tels que les coquilles, les taies crustæ, les coquilles d'?uf, les perles, les pierres ou calculs, les bésoards, &c. doivent être rangés absolument dans la classe des pierres, & dans le genre des pierres calcaires. Voyez Pierre & Chaux, (Chimie.) Ces substances ne different des pierres calcaires vulgaires, qu'en ce que les premieres contiennent une plus grande portion de cette colle, gluten, si bien observée par M. Pott dans sa lithogéognosie ; & en ce que le gluten de ces concrétions pierreuses animales, est plus sensiblement la mucosité animale : les os même, & leurs différentes especes, comme les cornes, l'ivoire, les dents, &c. ne different chimiquement (c'est-à-dire sans avoir égard à l'organisation) de ces concrétions pierreuses que du plus au moins. Lorsqu'on a enlevé aux os par la décoction, ou qu'on a détruit dans les os par la calcination la matiere muqueuse qu'ils contiennent abondamment, ils ne sont plus qu'une pierre calcaire, ou de la chaux. Cette matiere muqueuse, dont ils sont naturellement remplis, ne masque même pas tellement leur charpente terreuse, que cette terre ne puisse être enlevée par l'application des acides aux os même récens & inaltérés. C'est à cause de l'enlevement d'une partie de cette terre, que les os ont été ramollis par l'application des acides foibles, que les Anatomistes ont souvent pratiquée en travaillant à découvrir la structure des os ; opération dont ils n'ont pas soupçonné la théorie, qui véritablement n'étoit pas de leur objet. Cette terre osseuse est surabondante à la mixtion muqueuse, ou plutôt lui est étrangere, & est déposée par une vraie secrétion très-analogue à celle qui fournit l'enduit ou la coque aux ?ufs, les coquilles, les tayes des crustacées, &c. L'identité chimique de ces matieres établit principalement cette analogie, qui mérite au moins que les Physiologistes ajoutent à la doctrine des secrétions un chapitre ou un problême de secretione terræ osseæ. On trouvera quelques notions ultérieures sur tout ceci dans quelques articles particuliers. Voyez Pierre ou Calcul humain, voyez Perle, voyez Mere de perle, voyez Huitre, &c.
La pierre ou calcul biliaire doit être distinguée des matieres pierreuses dont nous venons de faire mention. Voyez Pierre ou Calcul humain.
Une substance animale, telle que nous l'avons spécifiée, distinguée, circonscrite, étant soumise à l'analyse ancienne, c'est-à-dire, distillée sans intermede, fournit constamment, premierement, au plus leger degré de chaleur, & au bain-marie pour le plus sûr (voyez Feu, Chimie) une eau ou un phlegme insipide & proprement inodore (voyez Odorant, Principe,) c'est-à-dire, non aromatique ; mais chargé pourtant d'un gas, d'une émanation subtile, qui fait reconnoître, redolet, la matiere qui la fournit, & qui a un certain caractere du regne auquel cette matiere appartient. Cette premiere eau est, s'il est permis de s'exprimer ainsi, la partie la plus surabondante de l'eau naturellement surabondante dans le regne végétal & dans le regne animal, selon la doctrine de Becher. 2°. Au feu tant soit peu supérieur à la chaleur de l'eau bouillante, un phlegme un peu roussâtre, un peu trouble & fétide, c'est-à-dire, déja un peu huileux & un peu chargé d'alkali volatil, quoique si foiblement, que ce sel ne s'y manifeste point encore par ses effets ordinaires ; 3°. de l'huile sensible & distincte, d'abord jaunâtre & assez claire, & qui s'épaissit & devient de plus en plus brune dans les progrès de la distillation, de l'alkali volatil résout, ou esprit volatil, & de l'air ; 4°. de l'huile de plus en plus dense & noire, une liqueur trouble, aqueuse-huileuse ; chargée d'alkali volatil & d'acide, de l'alkali volatil concret & de l'air. 5°. La derniere violence du feu présente souvent quelques traces de phosphore, un produit lumineux incoercible, ou plutôt irramassable par sa paucité ; du moins plusieurs chimistes assurent la réalité de ce produit, dont d'autres nient l'existence : le sentiment des premiers est le plus probable. 6°. Enfin le produit fixe, ou le résidu de cette distillation est un charbon qui étant calciné, donne une cendre qui est une terre calcaire, & de laquelle, selon l'opinion la plus reçue, on ne retire point de sel par la lixiviation.
Cet acide, que nous venons de compter parmi les produits de la distillation des substances animales, a été contesté, nié par la plus grande partie des chimistes. Ils disoient que l'alkali volatil étoit le produit propre & exclusif de l'analyse des substances animales, comme l'acide étoit le produit propre & spécial de l'analyse des végétaux. Ce dogme étoit une double erreur. Voyez, quant à la derniere assertion, l'article Végétal, (Chimie.) & quant à la premiere, savoir à l'exclusion de l'acide obtenu par la violence du feu des substances animales distillées sans intermede, les expériences d'Homberg, Mém. de l'ac. roy. des Scienc. 1712. & celles de M. Pott, Miscell. Berolin. tom. VI. en prouvent incontestablement l'existence. La coexistence d'un acide & d'un alkali dans une même liqueur, sans que ces deux sels y contractent l'union chimique, a été expliquée très naturellement par l'état huileux de l'un & de l'autre sel, & par l'état semblable de la liqueur, dans laquelle ils sont dissous ou résous. Or que ces deux principes y existent ensemble, & tous les deux libres, nuds, ou si l'on veut très-superficiellement unis, cela est prouvé, non pas par le changement de quelques couleurs végétales alléguées par Homberg & par Lemery le fils, mais assez bien par l'effervescence que cette liqueur subit également par l'affusion d'un acide pur & par celle d'un alkali pur ; & enfin très-bien par l'expérience de M. Pott, qui est en même tems le fait majeur & fondamental sur lequel porte son assertion de l'acide animal, assertio acidi animalis, ce sont ses termes. Voici cette expérience : prenez la liqueur saline élevée dans la distillation à la violence du feu d'une substance animale : séparez en exactement l'huile : rectifiez cette liqueur saline jusqu'à ce qu'il ne vous en reste qu'une petite portion : rectifiez de nouveau cette petite portion, selon le procédé d'Homberg, avec le résidu de la premiere distillation calciné, vous obtiendrez de l'acide, mais en petite quantité. L'auteur ne dit pas à quels signes il le reconnoît dans cette premiere voie de recherche ; mais il le cherche encore dans cette petite portion de résidu de la premiere rectification, par la voie de la précipitation : il verse sur cette liqueur de l'alkali, ou de la chaux vive ; aussi-tôt on sent naître, dit M. Pott, une odeur d'alkali volatil, que ne donnoit point auparavant cette liqueur ; preuve sensible de la présence d'un acide, qui s'est uni à l'alkali fixe ou à la chaux vive, & a laissé échapper un alkali volatil auquel il étoit joint. La vérité de cette induction est ultérieurement démontrée, en ce que si on a employé de l'alkali fixe, il se change en sel neutre, capable de crystalliser, &c.
On pourroit sans doute chicaner M. Pott sur tout ceci ; car enfin cette derniere expérience, qui est la seule qui soit énoncée clairement & positivement, ne démontre que du sel ammoniac dans les produits de l'analyse vulgaire des substances animales, ce qui n'est pas ce semble le point contesté. Vainement répondroit-on que le sel ammoniac contenant de l'acide, c'est donner de l'acide, que de donner du sel ammoniac. Ce seroit raisonner d'après une logique très-mauvaise en soi, mais éminemment vicieuse lorsqu'on l'appliqueroit en particulier aux objets chimiques : & pour s'en tenir au cas particulier dont il s'agit, il est si clair que ce n'est pas d'un pareil acide, de celui d'un sel ammoniac dont il s'agit, que le problème de l'acide animal a toujours été agité entre des gens qui admettoient dans les animaux des sels neutres, au-moins du sel marin, & qu'une objection faite long-tems avant le travail de M. Pott, au célebre anatomiste Vieussens, qui avoit retiré de l'acide du sang, c'est qu'il n'avoit obtenu que celui du sel marin contenu naturellement dans cette substance. Toute huile contient de l'acide, j'en suis convaincu avec M. Pott, je crois même, d'après des expériences particulieres, qu'elle est essentiellement composée d'acide comme de soufre. Voyez Huile. Les substances animales donnent de l'huile, & je sais retirer de l'acide de toute huile comme du soufre : si après avoir retiré ce produit d'une huile animale j'en déduisois l'assertion de l'acide animal, je croirois mal conclure, ou du-moins m'exprimer très-inexactement ; en un mot je crois qu'on pourroit me rappeller cette regle générale de logique en méthode chimique, que ce sont les principes immédiats de la composition d'un corps tel, qui sont propres, qui appartiennent à ce corps, & non pas les principes éloignés ou les principes de ses principes. Une substance animale reconnoît-elle l'huile pour un de ses principes ? question utile à la connoissance chimique de cette substance ; cette huile employée à la composition de cette substance est-elle formée d'acide, & cet acide peut-il par les tortures du feu, se manifester dans une analyse vicieuse & presque inutile d'ailleurs en soi en général ? question oiseuse, inutile à la découverte de la nature de cette substance ; vue vaine, pouvant induire à erreur, jettant les plus habiles dans des recherches inutiles, entortillées, dans des parallogismes, des sophismes, &c.
Mais M. Pott paroissant s'être borné à démontrer l'existence simple, absolue, générale de l'acide dans les animaux ; on ne peut disconvenir qu'il n'y ait réussi. Quant à la conclusion que ce célebre chimiste déduit de son travail, lorsqu'il dit, §. XX. que la santé consiste dans l'équilibre de cet acide avec le flegme, la terre, & le phlogistique de nos humeurs, par où il prétend formellement que cet acide est un principe immediat de la mixtion animale : nous ne saurions embrasser ce sentiment, qui évidemment accorde trop à l'analyse par la violence du feu, que les chimistes modernes ont appris à mieux évaluer. Voyez Principes. L'analyse menstruelle démontre que cet acide n'est point un des principes immédiats de la composition des substances animales : mais l'effet du feu, & des diverses réactions qui surviennent dans les distillations à la violence du feu, est trop connu des vrais chimistes pour qu'on fasse, à l'acide de M. Pott, le reproche vague d'être un nouveau produit, ou une créature du feu, dont M. Pott l'a défendu plus sérieusement, ce me semble, qu'une telle objection ne le méritoit ; mais c'est de l'un des vrais principes de la substance animale analysée (je puis démontrer que c'est de l'huile), que cet acide est retiré ; & voilà de quel reproche il falloit l'exempter, ce qui eût été & est encore véritablement fort difficile.
Les Chimistes n'ont encore rien publié sur les substances animales ou sur la substance animale dont il s'agit dans cet article, d'après son examen exécuté par l'analyse menstruelle (voyez Menstruelle, analyse), par conséquent ils n'ont sur cette matiere que des notions analogiques, des inductions, des pressentimens.
Les notions positives & exactes sur cette substance peuvent seules donner la connoissance fondamentale, premiere, vraiment élémentaire, intime, de la formation, de l'accroissement, de la réparation, des altérations spontanées, en un mot de la nature & de toutes les affections purement matérielles, & peut-être même de l'être formel des affections organiques des animaux. (b)
Étymologie de « substance »
Bourg. sustance?; provenç. sustancia?; espagn. substancia?; ital. sostanzia?; du lat. substantia, de substare, de sub, sous, et stare, être debout (voy. STABLE)?: ne connaissant les êtres que par leurs qualités, nous plaçons sous ces qualités un sujet, que nous disons sub-stans, se tenant dessous.
substance au Scrabble
Le mot substance vaut 13 points au Scrabble.
Informations sur le mot substance - 9 lettres, 3 voyelles, 6 consonnes, 8 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot substance au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
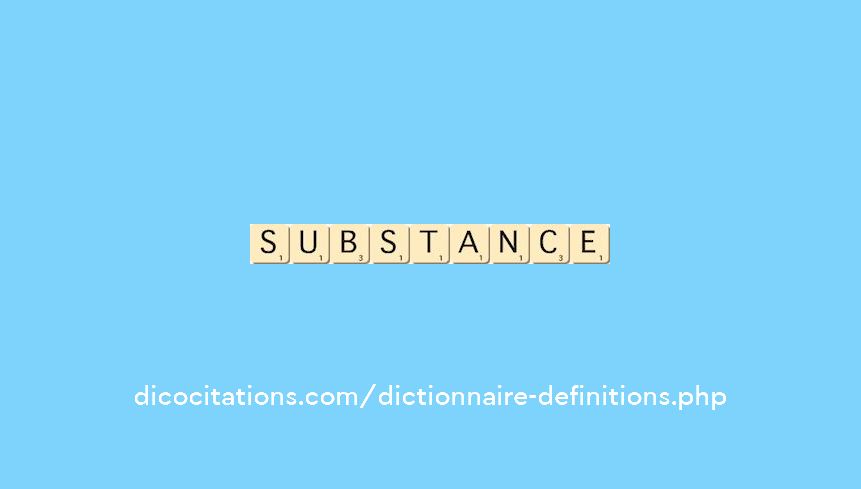
Les rimes de « substance »
On recherche une rime en @S .
Les rimes de substance peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en @s
Rimes de pestilence Rimes de immense Rimes de avalanche Rimes de aisances Rimes de performances Rimes de défiance Rimes de consistances Rimes de carences Rimes de manigancent Rimes de différences Rimes de intransigeance Rimes de inclémences Rimes de attirance Rimes de crédences Rimes de engeance Rimes de interdépendance Rimes de réenclenches Rimes de distances Rimes de circonstance Rimes de défense Rimes de ambiance Rimes de blanche Rimes de complaisance Rimes de avances Rimes de déviances Rimes de insouciance Rimes de conséquences Rimes de invariance Rimes de anse Rimes de insolences Rimes de subsistance Rimes de réticences Rimes de influences Rimes de incompétences Rimes de vraisemblances Rimes de indolence Rimes de essences Rimes de dispense Rimes de semblance Rimes de survivance Rimes de déhanchent Rimes de prépotence Rimes de brillance Rimes de offenses Rimes de manigances Rimes de revanchent Rimes de complaisances Rimes de pansent Rimes de apparence Rimes de mi-renaissanceMots du jour
pestilence immense avalanche aisances performances défiance consistances carences manigancent différences intransigeance inclémences attirance crédences engeance interdépendance réenclenches distances circonstance défense ambiance blanche complaisance avances déviances insouciance conséquences invariance anse insolences subsistance réticences influences incompétences vraisemblances indolence essences dispense semblance survivance déhanchent prépotence brillance offenses manigances revanchent complaisances pansent apparence mi-renaissance
Les citations sur « substance »
- De nouveau nous conduisions la nuit des automobiles auxquelles il manquait toujours quelque chose pour être en règle. De nouveau nous transportions des substances illicites que nous devions désigner par des noms de code et, même si nous ne travaillions plus à la destruction de la société, nous pouvions persister dans l'illusion réconfortante qu'elle-même n'avait pas renoncé à nous détruire, puisque de nouveau il nous fallait craindre les barrages, éviter les contrôles, et mentir avec aplomb lorsque nous étions obligés de nous y soumettre. De nouveau nous étions unis par des liens de circonstance, à la fois artificiels et forts comme tous ceux qu'engendre l'illégalité. Et par surcroît, ce qui cimentait le groupe et le vouait à l'opprobre de la société procurait du plaisir, un plaisir qui remplissait le corps et l'esprit au point de ne laisser de place pour rien d'autre, un plaisir qui dispensait de tout commerce, y compris de l'usage de la parole : jusque-là, rien n'avait eu la force de me faire taire ainsi, même du dedans. Auteur : Jean Rolin - Source : L'Organisation (2000)
- Il y a trois effets secondaires aux substances psychédéliques: le premier est une amélioration de la mémoire à long terme, le deuxième est une perte de mémoire à court terme, et le troisième... je ne me souviens pas du troisième.Auteur : Timothy Leary - Source : Interview, Telegraph Magazine, 1995.
- Le vin est une substance sacramentelle. Il est exalté dans mainte page de la Bible et Notre-Seigneur n'a pas trouvé de plus auguste matière pour la transformer en son sang. Il est donc digne et juste, équitable et salutaire de l'aimer!Auteur : Joris-Karl Huysmans - Source : L'Oblat (1903), XI
- Les antialcooliques sont des malades en proie à ce poison, l'eau, si dissolvant et corrosif qu'on l'a choisi entre autres substances pour les ablutions et lessives, et qu'une goutte versée dans un liquide pur, l'absinthe, par exemple, le trouble.Auteur : Alfred Jarry - Source : Spéculations
- Par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance consistant en une infinité d'attributs, dont chacun exprime une essence éternelle et infinie.Auteur : Baruch Spinoza - Source : L'Ethique (1677)
- J'avoue une grande prédilection pour ces numéros d'antipodistes, car le corps y est objectivé en douceur: il n'est pas objet dur et catapulté comme dans la pure acrobatie, mais plutôt substance molle et dense, docile à de très courts mouvements.Auteur : Roland Barthes - Source : Mythologies (1957)
- La fausse sécurité est plus que l'alliée de l'illusion, elle en constitue la substance même.Auteur : Clément Rosset - Source : Le Réel et son Double (1976)
- Qu'est ce que le changement? Une forme apparaît, une autre disparaît. Pouvons-nous dire que le papillon était une chenille? Une substance dans la chenille prend la forme du papillon.Auteur : Swami Prajnanpad - Source : Sans référence
- La vie, telle du moins qu'elle se manifeste sur la terre, je veux dire, cet état d'activité que présente la substance organisée dans les plantes et dans les animaux.Auteur : Anatole France - Source : Le Mannequin d'osier (1897)
- Ici, lorsque la vie perd du sens, elle garde intacte sa substance, à savoir cette opiniâtreté inflexible qu'ont les Africains de ne jamais renoncer à la moindre minute du temps que la nature leur accorde.Auteur : Mohammed Moulessehoul, dit Yasmina Khadra - Source : L'Equation africaine (2011)
- L'électricité, qui n'était connue que par la propriété de certaines substances, d'attirer les corps légers, après avoir été frottées, devient un des phénomènes généraux de l'univers.Auteur : Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet - Source : Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain (1795)
- Lire, c'est comme prendre de l'alcool ou de l'opium. Au même titre que ces substances, la lecture devrait être reconnue comme une addiction, et faire l'objet d'une nouvelle loi Evin.Auteur : Pierre Ménard - Source : 20 bonnes raisons d'arrêter de lire (2014)
- Qu'est-ce qu'un homme s'il manque de substance ? S'il n'est qu'un regard et non un être ?Auteur : Antoine de Saint-Exupéry - Source : Pilote de guerre (1942)
- Nos contradictions font la substance de notre activité d'esprit.Auteur : Paul Valéry - Source : Sans référence
- L'âme, disait-il, est la substance; le corps, l'apparence. Les mots l'expriment d'eux-mêmes: l'apparence est ce qui se voit, et qui dit substance dit chose cachée.Auteur : Anatole France - Source : Le Petit Pierre (1918)
- Les malheurs avaient assoupli Lily au lieu de la raidir, et la substance qui plie est plus difficile à briser que celle qui résiste.Auteur : Edith Newbold Jones Wharton - Source : Chez les heureux du monde (1908)
- Le Kitsch n'est pas la lie de l'art ni ses scories, mais une substance empoisonnée qui s'y trouve mélangée. Comment s'en débarrasser est la tâche ardue du présent... Dans le Kitsch est peut-être même le vrai progrès de l'art.Auteur : Theodor Wiesengrund Adorno - Source : Sans référence
- Il avait effleuré distraitemement les choses, sans jamais vraiment s'en nourrir, les assimiler, les changer en sa substance.Auteur : Jean-Louis Curtis - Source : Le Roseau pensant (1971)
- L'énergie des esprits est abondante. On la regarde sans la voir. On l'écoute sans l'entendre. Sa substance et sa forme ne peuvent être perçues. Bien que l'on ne puisse la toucher, elle est manifeste, pareille à l'Océan, et sa réalité ne peut être niée.Auteur : Confucius - Source : Sentences
- Les légendes vivent de notre substance. Elles ne tiennent leur vérité que de la complicité de nos coeurs. Dès lors que nous n'y reconnaissons pas notre propre histoire, elles ne sont que bois mort et paille sèche.Auteur : Michel Tournier - Source : Gaspard, Melchior et Balthazar (1980)
- Pour subvenir à tant de frais, il fallut prendre la substance des peuples; il n'y eut point d'extorsion que l'on n'inventât sous le nom de taxe et d'impôt.Auteur : Voltaire - Source : Histoire de Charles XII (1730)
- Est-ce qu'elle ne faisait pas comme la substance de son coeur, le fond même de sa vie ?Auteur : Gustave Flaubert - Source : L'Education sentimentale (1869)
- En prêtant l'oreille à vos propres sentiments, vous dites en substance au petit être sensible qui se cache en vous : « Tu comptes à mes yeux, tu mérites d'être entendu, et je m'intéresse assez à toi pour t'écouter. » Auteur : John Gray - Source : Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus (1992)
- C'est ainsi qu'était mon village hier : on aurait dit que quelqu'un l'avait vidé de cette substance dorée que lui donnait le mois d'août, et qu'il ne restait plus que la grisaille et les mouches.Auteur : Zakhar Prilepine - Source : Des chaussures remplies de vodka chaude (2011)
- L'amour n'est pas un sentiment. C'est la substance même de la création.Auteur : Christiane Singer - Source : Derniers fragments d'un long voyage (2007)
Les mots proches de « substance »
Subalaire Subalterne Subalterne Subalternement Subalternisation Subalternité Subarrondi, ie Subcostal, ale Subdéléguer Subdiviser Subdivisible Subdivision Subdivisionnaire Sub-égal, ale Subéreux, euse Subérification Subhastation Subhaster Subir Subit, ite Subitement Subito Subjacent, ente Subjonctif Subjugation Subjugué, ée Subjuguer Subjugueur Sublimation Sublimatoire Sublime Sublimé, ée Sublimement Sublimer Sublimité Sublingual, ale Sublunaire Submergé, ée Submergement Submerger Submersion Submission Subobscur, re Subordination Subordinément Subordonné, ée Subordonnément Subordonner Subornation SubornementLes mots débutant par sub Les mots débutant par su
sub sub-aquatique sub-atomique sub-atomiques sub-claquant sub-espace sub-normaux sub-nucléaires sub-véhiculaire sub-vocal sub-zéro subaiguë subalterne subalterne subalternes subalternes subaquatique subatomique subatomiques subcarpatique subcellulaire subconsciemment subconscient subconscient subconsciente subconscientes subconscients subconscients subculture subdivisa subdivisaient subdivisait subdivisé subdivisée subdivisent subdivisés subdivision subdivisions Subdray subduction suber subi subie subies subir subira subirai subiraient subirais subirait
Les synonymes de « substance»
Les synonymes de substance :- 1. élément
2. principe
3. milieu
4. matière
5. question
6. matériau
7. moelle
8. essence
9. quintessence
10. corps
11. fond
12. objet
13. sujet
14. contenu
15. substrat
16. support
17. suc
18. jus
19. sève
synonymes de substance
Fréquence et usage du mot substance dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « substance » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot substance dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Substance ?
Citations substance Citation sur substance Poèmes substance Proverbes substance Rime avec substance Définition de substance
Définition de substance présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot substance sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot substance notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 9 lettres.
