Définition de « traduction »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot traduction de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur traduction pour aider à enrichir la compréhension du mot Traduction et répondre à la question quelle est la définition de traduction ?
Une définition simple : (fr-rég|t?a.dyk.sjõ) traduction (f)
Définitions de « traduction »
Trésor de la Langue Française informatisé
TRADUCTION, subst. fém.
Action de traduire; résultat de cette action.Wiktionnaire
Nom commun - ancien français
traduction féminin
-
Livraison.
- Exemple d'utilisation manquant. (Ajouter)
-
Réception.
- Exemple d'utilisation manquant. (Ajouter)
Nom commun - français
traduction \t?a.dyk.sj??\ féminin
- Action de traduire, travail consistant à traduire un texte d'une langue dans une autre langue.
- La traduction est un travail difficile.
- La traduction demande une grande intelligence des deux langues et de la matière dont il s'agit.
- Quelle magie que la traduction ! ? (Dai Sijie, Balzac et la Petite Tailleuse chinoise, Folio, page 71)
- C'est vrai que la traduction est très utile, directement utile, quoiqu'un esprit cynique ? pas le mien : on aura compris que je me tiens loin d'un tel mauvais goût ? pourrait faire valoir qu'elle permet plus souvent à des entreprises d'accéder à de nouveaux marchés qu'à des pays d'éviter des guerres. ? (Thomas Ouellet-St-Pierre, « Laisser une trace », Blogue Edgar, 15 novembre 2017)
-
Résultat de ce travail ; version d'un ouvrage dans une langue différente de celle où il a été écrit.
- Rien n'est plus intéressant que de comparer des traductions en vers ; elles révèlent à la fois le génie de la langue traduite et celui des langues dont se sont servi les traducteurs. ? (Salomon Reinach, Cornélie, ou Le latin sans pleurs, 1912)
- Je me décide à leur parler allemand : pour qu'ils comprennent mieux, j'emploie mon haut allemand le plus clair, la langue officielle des théâtres de Meiningen et de Weimar, le hanovrien saccadé des auteurs juifs qui déclament les traductions de Verlaine. ? (Jean Giraudoux, Retour d'Alsace ? Août 1914, 1916)
- Un texte original peut connaître maintes traductions. ? (Charles Le Blanc, Le complexe d'Hermès, Presses de l'Université d'Ottawa, 2009, page 113)
- [Le Kalevala] est un véritable éblouissement, auquel cette traduction de Gabriel Rebourcet rend sa faconde et son ivresse furibarde. ? (André Clavel, « L'Iliade boréale », dans L'Express n° 3081, 21 juillet 2010)
- (Biologie) Synthèse d'une protéine à partir d'une matrice d'acide ribonucléique.
Littré
-
1Action de traduire.
Il y a vingt ans que je m'occupe à faire des traductions. - Quoi?! monsieur, dit le géomètre, il y a vingt ans que vous ne pensez pas?!
Montesquieu, Lett. pers. 128.À mesure que, dans un ouvrage, le caractère de la pensée tient plus à l'expression, la traduction devient plus épineuse
, Marmontel, ?uv. t. x, p. 270.Croyez-en ceux qui ont consacré beaucoup d'années à la traduction?: si le succès les a quelquefois dédommagés de leurs peines, ils se sont plus souvent sentis vaincus dans cette lutte difficile
, Bitaubé, Instit. Mém. litt. et beaux-arts, t. I, p. 286. -
2Version d'un ouvrage dans une langue différente de celle où il a été écrit.
On a justement comparé le commun des traductions à un revers de tapisserie, qui tout au plus retient les linéaments grossiers des figures finies que le beau côté représente
, Rollin, Traité des Ét. I, 1.Traducteur élégant [d'Ablancourt] et dont on appela chaque traduction la belle infidèle
, Voltaire, Louis XIV, écrivains, d'Ablancourt.Je regarde la traduction des Géorgiques par M. Delille comme un des ouvrages qui font le plus d'honneur à la langue française?; et je ne sais même si Boileau aurait osé traduire les Géorgiques
, Voltaire, Lett. Chabanon, 6 févr. 1771.Qu'on ne croie pas connaître les poëtes par les traductions?; ce serait vouloir apercevoir le coloris d'un tableau dans une estampe
, Voltaire, Ess. poés. Ép. II.S'il est vrai qu'il n'y ait point de traduction exacte qui égale l'original, c'est qu'il n'y a point de langues parallèles, même entre les modernes
, Duclos, ?uv. t. IX, p. 94.Le docte et pesant Dacier, grand ennemi de Lamotte pour l'amour des anciens, qu'il n'a pourtant point traités en ami dans ses traductions
, D'Alembert, Élog. Lamotte.Il n'y a qu'un moyen de rendre fidèlement un auteur d'une langue étrangère dans la nôtre?: c'est d'avoir l'âme bien pénétrée des impressions qu'on en a reçues, et de n'être satisfait de sa traduction que quand elle réveillera les mêmes impressions dans l'âme du lecteur
, Diderot, Mélanges, Térence.On a dit quelquefois que les traductions étaient des trahisons
, Journ. offic. 24 fév. 1872, p. 1317, 3e col.On dit de même?: la traduction d'un passage, d'un vers, etc.
SYNONYME
TRADUCTION, VERSION, Ces deux mots sont synonymes?; cependant, d'habitude, la traduction est en langue moderne, et la version en langue ancienne. Ainsi la Bible française de Saci est une traduction, et les Bibles latines, grecques, arabes, syriaques, sont des versions.
HISTORIQUE
XVIe s. Si les Romains n'ont vaqué à ce labeur de traduction, par quelz moiens donques ont ilz peu ainsi enrichir leur langue??
Du Bellay, J. I, 10, recto. Sçavons nous bien qu'en Basque et en Bretaigne il y ayt des juges assez pour establir cette traduction [de la Bible] faicte en leur langue??
Montaigne, I, 399.
Encyclopédie, 1re édition
TRADUCTION, s. f. VERSION, s. f. (Synonymes.) On entend également par ces deux mots la copie qui se fait dans une langue d'un discours premierement énoncé dans une autre, comme d'hébreu en grec, de grec en latin, de latin en françois, &c. Mais l'usage ordinaire nous indique que ces deux mots different entr'eux par quelques idées accessoires, puisque l'on employe l'un en bien des cas ou l'on ne pourroit pas se servir de l'autre : on dit, en parlant des saintes écritures, la Version des septante, la Version vulgate ; & l'on ne diroit pas de même, la Traduction des septante, la Traduction vulgate : on dit au contraire que Vaugelas a fait une excellente traduction de Quint-Curce, & l'on ne pourroit pas dire qu'il en a fait une excellente version.
Il me semble que la version est plus littérale, plus attachée aux procédés propres de la langue originale, & plus asservie dans ses moyens aux vûes de la construction analytique ; & que la traduction est plus occupée du fond des pensées, plus attentive à les présenter sous la forme qui peut leur convenir dans la langue nouvelle, & plus assujettie dans ses expressions aux tours & aux idiotismes de cette langue.
Delà vient que nous disons la version vulgate, & non la traduction vulgate ; parce que l'auteur a tâché, par respect pour le texte sacré, de le suivre littéralement, & de mettre, en quelque sorte, l'hébreu même à la portée du vulgaire, sous les simples apparences du latin dont il emprunte les mots. Miserunt Judæi ab Jerosolimis sacerdotes & levitas ad eum, ut interrogarent eum : tu quis es ? (Joan. j. 19.) Voilà des mots latins, mais point de latinité, parce que ce n'étoit point l'intention de l'auteur ; c'est l'hébraïsme tout pur qui perce d'une maniere évidente dans cette interrogation directe, tu quis es : les latins auroient préféré le tour oblique quis ou quisnam esset ; mais l'intégrité du texte original seroit compromise. Rendons cela en notre langue, en disant, les juifs lui envoyerent de Jérusalem des prêtres & des lévites, afin qu'ils l'interrogeassent, qui es tu ? Nous aurons une version françoise du même texte : adaptons le tour de notre langue à la même pensée, & disons, les juifs lui envoyerent de Jérusalem des prêtres & des lévites, pour savoir de lui qui il étoit ; & nous aurons une traduction.
L'art de la traduction suppose nécessairement celui de la version ; & delà vient que les translations que l'on fait faire aux jeunes gens dans nos colléges du grec ou du latin en françois, sont très-bien nommées des versions : les premiers essais de traduction ne peuvent & ne doivent être rien autre chose.
La version littérale trouve ses lumieres dans la marche invariable de la construction analytique, qui lui sert à lui faire remarquer les idiotismes de la langue originale, & à lui en donner l'intelligence, en remplissant les vuides de l'ellipse, en supprimant les redondances du pléonasme, en ramenant à la rectitude de l'ordre naturel les écarts de la construction usuelle. Voyez Inversion, Méthode, Supplément, &c.
La traduction ajoûte aux découvertes de la version littérale, le tour propre du génie de la langue dans laquelle elle prétend s'expliquer : elle n'employe les secours analytiques que comme des moyens qui font entendre la pensée ; mais elle doit la rendre cette pensée, comme on la rendroit dans le second idiome, si on l'avoit conçue, sans la puiser dans une langue étrangere. Il n'en faut rien retrancher, il n'y faut rien ajoûter, il n'y faut rien changer ; ce ne seroit plus ni version, ni traduction ; ce seroit un commentaire.
Ne pouvant pas mettre ici un traité développé des principes de la traduction, qu'il me soit permis d'en donner seulement une idée générale, & de commencer par un exemple de traduction, qui, quoique sorti de la main d'un grand maître, me paroît encore repréhensible.
Cicéron, dans son livre intitulé Brutus, ou des orateurs illustres, s'exprime ainsi : (ch. xxxj.) Quis uberior in dicendo Platone ? Quis Aristotele nervosior ? Theophrasto dulcior ? Voici comment ce passage est rendu en françois par M. de la Bruyere, dans son discours sur Théophraste : « Qui est plus fécond & plus abondant que Platon ? plus solide & plus ferme qu'Aristote ? plus agréable & plus doux que Théophraste ? ».
C'est encore ici un commentaire plutôt qu'une traduction, & un commentaire au-moins inutile. Uberior ne signifie pas tout à la fois plus abondant & plus fecond ; la fécondité produit l'abondance, & il y a entre l'un & l'autre la même différence qu'entre la cause & l'effet ; la fécondité étoit dans le génie de Platon, & elle a produit l'abondance qui est encore dans ses écrits.
Nervosus, au sens propre, signifie nerveux ; & l'effet immédiat de cette heureuse constitution est la force, dont les nerfs sont l'instrument & la source : le sens figuré ne peut prendre la place du sens propre que par analogie, & nervosus doit pareillement exprimer ou la force, ou la cause de la force. Nervosior ne veut donc pas dire plus solide & plus ferme ; la force dont il s'agit in dicendo, c'est l'énergie.
Dulcior (plus agréable & plus doux) ; dulcior n'exprime encore que la douceur, & c'est ajouter à l'original que d'y joindre l'agrément : l'agrément peut être un effet de la douceur, mais il peut l'être aussi de toute autre cause. D'ailleurs pourquoi charger l'original ? Ce n'est plus le traduire, c'est le commenter ; ce n'est plus le copier, c'est le défigurer.
Ajoûtez que, dans sa prétendue traduction, M. de la Bruyere ne tient aucun compte de ces mots in dicendo, qui sont pourtant essentiels dans l'original, & qui y déterminent le sens des trois adjectifs uberior, nervosior, dulcior : car la construction analytique, qui est le fondement de la version, & conséquemment de la traduction, suppose la phrase rendue ainsi ; quis suit uberior in dicendo præ Platone ? quis fuit nervosior in dicendo, præ Aristotele ? quis fuit dulcior in dicendo, præ Theophrasto ? Or dès qu'il s'agit d'expression, il est évident que ces adjectifs doivent énoncer les effets qui y ont produit les causes qui existoient dans le génie des grands hommes dont on parle.
Ces réflexions me porteroient donc à traduire ainsi le passage dont il s'agit : Qui a dans son élocution plus d'abondance que Platon ? plus de nerf qu'Aristote ? plus de douceur que Théophraste ? si cette traduction n'a pas encore toute l'exactitude dont elle est peut-être susceptible, je crois du moins avoir indiqué ce qu'il faut tâcher d'y conserver ; l'ordre des idées de l'original, la précision de sa phrase, la propriété de ses termes. (Voyez Synecdoque, §. 11. la critique d'une traduction de M. du Marsais, & au mot Méthode, la version & la traduction d'un passage de Cic.) J'avoue que ce n'est pas toujours une tâche fort aisée ; mais qui ne la remplit pas n'atteint pas le but.
« Quand il s'agit, dit M. Batteux, (Cours de belles-lettres, III. part. jv. sect.) de représenter dans une autre langue les choses, les pensées, les expressions, les tours, les tons d'un ouvrage ; les choses telles qu'elles sont, sans rien ajoûter, ni retrancher, ni déplacer ; les pensées dans leurs couleurs, leurs degrés, leurs nuances ; les tours qui donnent le feu, l'esprit, la vie au discours ; les expressions naturelles, figurées, fortes, riches, gratieuses, délicates, &c. & le tout d'après un modele qui commande durement, & qui veut qu'on lui obéisse d'un air aisé : il faut, sinon autant de génie, du-moins autant de goût, pour bien traduire que pour composer. Peut-être même en faut-il davantage. L'auteur qui compose, conduit seulement par une sorte d'instinct toujours libre, & par sa matiere qui lui présente des idées qu'il peut accepter ou rejetter à son gré, est maître absolu de ses pensées & de ses expressions : si la pensée ne lui convient pas, ou si l'expression ne convient pas à la pensée, il peut rejetter l'une & l'autre : quæ desperat tractata nitescere posse, relinquit. Le traducteur n'est maître de rien ; il est obligé de suivre par-tout son auteur, & de se plier à toutes ses variations avec une souplesse infinie. Qu'on en juge par la variété des tons qui se trouvent nécessairement dans un même sujet, & à plus forte raison dans un même genre? Pour rendre tous ces degrés, il faut d'abord les avoir bien sentis, ensuite maîtriser à un point peu commun la langue que l'on veut enrichir de dépouilles étrangères. Quelle idée donc ne doit-on pas avoir d'une traduction faite avec succès ? »
Rien de plus difficile en effet, & rien de plus rare qu'une excellente traduction, parce que rien n'est ni plus difficile ni plus rare, que de garder un juste milieu entre la licence du commentaire & la servitude de la lettre. Un attachement trop scrupuleux à la lettre, détruit l'esprit, & c'est l'esprit qui donne la vie : trop de liberté détruit les traits caractéristiques de l'original, on en fait une copie infidele.
Qu'il est fâcheux que les révolutions des siecles nous aient dérobé les traductions que Cicéron avoit faites de grec en latin, des fameuses harangues de Démosthene & d'Eschine : elles seroient apparemment pour nous des modeles sûrs ; & il ne s'agiroit que de les consulter avec intelligence, pour traduire ensuite avec succès. Jugeons-en par la méthode qu'il s'étoit prescrite dans ce genre d'ouvrage, & dont il rend compte lui-même dans son traité de optimo genere oratorum. C'est l'abregé le plus précis, mais le plus lumineux & le plus vrai, des regles qu'il convient de suivre dans la traduction ; & il peut tenir lieu des principes les plus développés, pourvû qu'on sache en saisir l'esprit. Converti ex atticis, dit-il, duorum eloquentissimorum nobilissimas orationes inter se contrarias, Eschinis Demosthenisque ; nec converti ut interpres, sed ut orator, sententiis iisdem, & earum formis tanquam figuris ; verbis ad nostram consuetudinem aptis, in quibus non verbum pro verbo necesse habui reddere, fed genus omnium verborum vimque servavi. Non enim ea me annumerare lectori putavi oportere, sed tanquam appendere. (B. E. R. M.)
Étymologie de « traduction »
Prov. traductio?; esp. traduccion?; ital. traduzione?; du latin traductionem, qui n'a que le sens de faire passer d'un lieu à un autre, et qui vient de traducere (voy. TRADUIRE).
- Du latin traductio. Son sens actuel, remplaçant translation et interprétation, utilisés jusque-là, lui a été donné par l'imprimeur et traducteur Étienne Dolet (1509-1546).
traduction au Scrabble
Le mot traduction vaut 13 points au Scrabble.
Informations sur le mot traduction - 10 lettres, 4 voyelles, 6 consonnes, 9 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot traduction au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
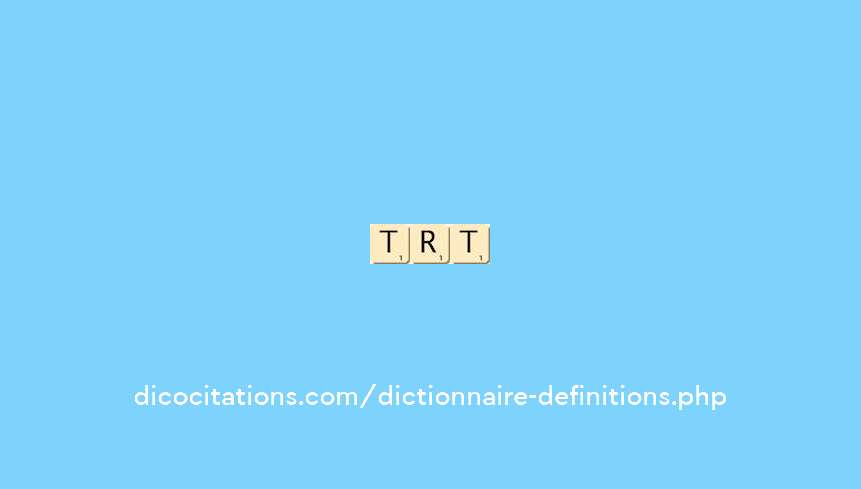
Les rimes de « traduction »
On recherche une rime en J§ .
Les rimes de traduction peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en j§
Rimes de taurillons Rimes de porte-avion Rimes de exagérations Rimes de discernions Rimes de nommions Rimes de diffamation Rimes de déjections Rimes de rétraction Rimes de anti-corruption Rimes de déconsidération Rimes de caractérisation Rimes de rejoignions Rimes de Erpion Rimes de convulsions Rimes de gabions Rimes de imitions Rimes de frappions Rimes de décoction Rimes de transplantation Rimes de attrape-couillon Rimes de dédions Rimes de proférions Rimes de fixations Rimes de blâmerions Rimes de introversions Rimes de carillons Rimes de démoralisation Rimes de rétention Rimes de tuions Rimes de ralentissions Rimes de errions Rimes de redéfinition Rimes de replantation Rimes de remorquions Rimes de indentification Rimes de alluvion Rimes de dégourdissions Rimes de récapitulation Rimes de remercions Rimes de La Réunion Rimes de exclamations Rimes de salvation Rimes de fustigations Rimes de substitution Rimes de oppression Rimes de contradictions Rimes de insertion Rimes de entrevoyons Rimes de réfraction Rimes de sanctionsMots du jour
taurillons porte-avion exagérations discernions nommions diffamation déjections rétraction anti-corruption déconsidération caractérisation rejoignions Erpion convulsions gabions imitions frappions décoction transplantation attrape-couillon dédions proférions fixations blâmerions introversions carillons démoralisation rétention tuions ralentissions errions redéfinition replantation remorquions indentification alluvion dégourdissions récapitulation remercions La Réunion exclamations salvation fustigations substitution oppression contradictions insertion entrevoyons réfraction sanctions
Les citations sur « traduction »
- Les traductions sont des domestiques qui vont porter un message de la part de leur maître et qui disent tout le contraire de ce qu'on leur a ordonné.Auteur : Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné - Source : Lettres (1646-1696)
- Je recommande vivement de lire aussi souvent que possible les livres de Tchekhov (même dans les traductions qu'ils ont subies) et de rêver au fil de leurs pages, car c'est pour cela qu'ils ont été écrits.Auteur : Vladimir Nabokov - Source : Littératures (1980)
- Ce fut par ces traductions arabes des ouvrages de science et de philosophie grecque que l'Europe reçut le ferment de tradition antique nécessaire à l'éclosion de son génie.Auteur : Ernest Renan - Source : Conférence prononcée à la Sorbonne en 1883.
- ... La traduction est pour nous tous, gens de lettres, avec la juste proportion de plaisir et de peines qu'elle comporte... une belle et constante école de vertu.Auteur : Valéry Larbaud - Source : Sous l'invocation de saint Jérôme
- Le Qaddish est une géographie du deuil, une traduction de la peine qui dépasse toute les peines.Cette prière comble le gouffre entre ce qui était et ce qui n'est plus, le proche devenu lointain.C'est ce fossé insupportable que le Kaddish répare en sept mots, vingt-huit lettres, ni plus ni moins. Auteur : Sébastien Spitzer - Source : Ces rêves qu'on piétine (2017)
- Chant, non cantique. Il faut désembourber le poème de cette boue d'exégèses, d'utilisations saintes, où l'on ne dit presque plus le texte. Les traductions étaient des actes pieux, ou une version scolaire.Auteur : Henri Meschonnic - Source : Les Cinq Rouleaux (1970)
- La traduction qu'il (l'abbé Delille) a entreprise de l'Enéide, prépare un nouveau tourment à l'envie, et de nouvelles sottises aux mauvais critiques.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Eloges, Segrais
- Une tâche qui nous incombe fréquemment est l'interprétation de rêves, c'est-à-dire la traduction du contenu du rêve remémoré en son sens caché.Auteur : Sigmund Freud - Source : L'inquiétante étrangeté et autres essais (1919)
- Si j'ai par ceste traduction mienne aucunement enrichy ou ploy vostre langue, honoré vostre regne...Auteur : Jacques Amyot - Source : Morales
- L'écriture est toujours la traduction d'un manque, d'une fêlure, une façon de déplacer les atomes de la réalité.Auteur : Philippe Delerm - Source : Ecrire est une enfance (2011)
- L'hystérie est le nom ordinaire de la simulation, qui dans son sens clinique n'est ni feinte ni artifice, mais la traduction d'un état psychique en symptôme physique.Auteur : Edgar Morin - Source : La Méthode, L'Humanité de l'humanité (2001)
- Le film s'était déjà montré plus ambitieux que le théâtre adapté, lorsqu'il était muet. Dès qu'il parla, commença l'aventure de sa traduction des chefs-d'oeuvre.Auteur : André Malraux - Source : L'Homme précaire et la Littérature (1977)
- La langue de l'Europe, c'est la traduction.Auteur : Umberto Eco - Source : Dire presque la même chose
- La logique est évidemment un simple cadre sans contenu spécifique, la traduction formelle de normes de pensée.Auteur : Ian Watson - Source : Le Modèle Jonas (1975)
- Une traduction, c'est un empaillage.Auteur : Antoine-Auguste Preault - Source : L'esprit de Préault
- ... toute littérature est traduction. Et traduction à son tour, la lecture que l'on en fait... D'où cet autre sentiment selon lequel on n'en aura jamais fini avec les textes que l'on aime, car ils rebondissent d'interprétation en interprétation...Auteur : Hubert Nyssen - Source : Eloge de la lecture
- En voulant donner une traduction plus fidèle, il craint de gâter un ouvrage qui a eu du succès.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Lettre au roi de Prusse, 10 décembre 1773
- On n'est pas habitué à des traductions aussi simples et aussi sincères de la réalité.Auteur : Emile Zola - Source : A propos du tableau d'Edouard Manet "Le déjeuner sur l'herbe"
- Tout cela est dû à la difficulté d'exprimer le réel et l'inaptitude du langage à se prêter à la traduction adéquate des choses.Auteur : Ibn Khaldoun - Source : Discours sur l'histoire universelle
- Dans les belles traductions il faut, comme dans les empreintes d'un cachet, quand elles sont fidèles, le relief en creux, le creux en relief.Auteur : Joseph Joubert - Source : Carnets tome 2
- Les traductions élargissent l'horizon de l'homme et, en même temps, le monde. Elles t'aident à comprendre les peuples lointains.Auteur : Jón Kalman Stefánsson - Source : Le Coeur de l'homme (2011)
- Le mariage est la traduction en prose du poème de l'amour.Auteur : Alfred Bougeard - Source : Sans référence
- La traduction, sous tous ses aspects, est l'opération la plus vitale pour l'homme.Auteur : Pier Paolo Pasolini - Source : Les Anges distraits (1995)
- Chaque pays nouveau – qu’on le veuille ou non – éclaire et transforme un peu le voyageur perméable aux impressions imprévues, sensible au chant secret d’une langue et d’un paysage des âmes qu’il ne connaissait pas, sinon par intermédiaires qui trahissent toujours la vérité, ce qu’elle a de plus fin, ou de plus fragile, de plus elle-même, de plus irréductible à toute traduction, à toute vulgarisation...
Auteur : Joséphine Baker - Source : « Les mémoires » de Joséphine Baker, recueillis par Marcel Sauvage (1949)
- Une traduction est mauvaise quand elle est plus claire, plus intelligible que l'original. Cela prouve qu'elle n'a pas su en conserver les ambiguïtés, et que le traducteur a tranché : ce qui est un crime.Auteur : Emil Cioran - Source : Cahiers, 1957-1972 (1997)
Les mots proches de « traduction »
Trabac Traban Trac Tracas Tracassement Tracasser Tracasserie Tracassier, ière Trace Tracé, ée Tracelet Tracement Tracer Traceur Trachée Trachée-artère Tractarianisme Tractation Tractativement Traction Tractoire Tradition Traditionalisme Traditionnel, elle Traditive Traducteur Traductif, ive Traduction Traduire Traduit, ite Trafic Trafiquant Trafiquer Trafiqueur Tragédie Tragédien, ienne Tragi-comédie Tragique Tragiquement Trahi, ie Trahir Trahison Traille Train Traînant, ante Traînard Traînasser Traîne Traîné, ée TraîneauLes mots débutant par tra Les mots débutant par tr
trabans traboules trabuco trac traça traçabilité traçage traçai traçaient traçais traçait traçant traçante traçantes tracas tracassa tracassaient tracassait tracassant tracasse tracassé tracassée tracassées tracassent tracasser tracassera tracasserais tracasserait tracasserie tracasseries tracasserons tracasses tracassez tracassier tracassière tracassières tracassin traçât trace trace tracé tracé tracée tracées tracent tracer tracera tracèrent tracerez tracerons
Les synonymes de « traduction»
Les synonymes de traduction :- 1. interprétation
2. transposition
3. translation
4. transcription
5. version
6. thème
7. transfert
8. variante
synonymes de traduction
Fréquence et usage du mot traduction dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « traduction » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot traduction dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Traduction ?
Citations traduction Citation sur traduction Poèmes traduction Proverbes traduction Rime avec traduction Définition de traduction
Définition de traduction présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot traduction sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot traduction notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 10 lettres.
