Définition de « oriental »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot oriental de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur oriental pour aider à enrichir la compréhension du mot Oriental et répondre à la question quelle est la définition de oriental ?
Une définition simple : (fr-accord-al|orient|?.?j??.t)
Définitions de « oriental »
Trésor de la Langue Française informatisé
ORIENTAL, -ALE, -AUX, adj. et subst.
Anton. occidental.Wiktionnaire
Adjectif - français
oriental \?.?j??.tal\
- Qui est situé à l'est.
- Cette ville, située à une altitude de mille toises sur le revers oriental des Rocheuses, au bord d'un torrent tributaire du Missouri, forme un vaste entrepôt pour les produits miniers de la région, et compte de quatorze à quinze mille habitants. ? (Jules Verne, Le Testament d'un excentrique, 1899, livre 2, chap. 12)
- De l'autre côté de l'Arabie, il y a encore des terres conquises à l'Islam, puis des régions habitées par des idolâtres, l'Inde et la Chine, qui atteignent le limbe oriental du disque terrestre. ? (Frédéric Weisgerber, Trois mois de campagne au Maroc : étude géographique de la région parcourue, Paris : Ernest Leroux, 1904, page 123)
- La grande forêt des Ardennes est une des plus chargée de mystères. Dans sa partie orientale, elle couvre un plateau accidenté coupé de vallées et de ravins profonds. ? (Georges Blond, L'Agonie de l'Allemagne 1944?1945, Fayard, 1952, page 130)
-
(Géographie) Qui appartient à l'Orient ; qui vient d'Orient.
- Pays oriental. ? Régions orientales. ? Peuples orientaux.
- Les plantes orientales. ? Des perles orientales. ? Une topaze orientale.
-
(Christianisme) Relatif aux églises de l'Orient.
- Il commença par résumer l'Évangile en douze scènes, conformément à une pratique orientale alors assez récente. ? (Émile Mâle, Rome et ses vieilles églises, Éditions Flammarion, 1965, chapitre 8, § 2)
- Qualifie les langues, ou mortes ou vivantes, des peuples de l'Orient, telles que l'hébreu, le syriaque, le chaldéen, l'arabe, le persan, le chinois, le japonais, etc.
- Qualifie un style métaphorique et hyperbolique dont, à ce que l'on prétend, les peuples de l'Asie feraient usage.
- Qui est digne de l'idée que les occidentaux se faisaient de l'Orient.
- Luxe oriental, pompe orientale.
-
(Par extension) Qui partage les traditions des pays orientaux.
- Le Maroc est le plus occidental des pays orientaux.
-
(En particulier) Qualifie les aspects des personnes originaires de l'Orient.
- Devant moi, un type tout différent et qui n'a rien d'oriental : trente-deux à trente-cinq ans, figure à barbiche roussâtre, regard très vif, [?]. ? (Jules Verne, Claudius Bombarnac, chapitre II, J. Hetzel et Cie, Paris, 1892)
Nom commun - français
Orientale \?.?j??.tal\ féminin (pour un homme, on dit : Oriental)
- Féminin singulier de Oriental.
Nom commun - français
oriental \?.?j??.tal\ masculin
- Race de chat, originaire de Thaïlande, à tête triangulaire, aux longues oreilles, à queue longue et fine, et à poil court, dérivée du siamois.
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Qui est du côté de l'orient, qui appartient à l'Orient. Pays oriental. Régions orientales. Peuples orientaux. Langues orientales, Les langues ou mortes ou vivantes des peuples de l'Orient, telles que l'hébreu, le syriaque, le chaldéen, l'arabe, le persan, le chinois, le japonais, etc. Style oriental, Style métaphorique et hyperbolique dont les peuples de l'Asie font usage. Luxe oriental, pompe orientale, Luxe, pompe digne de l'Orient.
ORIENTAL signifie aussi Qui croît en Orient, qui vient d'Orient. Les plantes orientales. Des perles orientales. Une topaze orientale.
ORIENTAL s'emploie substantivement pour désigner les Habitants de l'Asie les plus voisins de nous, et plus communément les Turcs, les Persans, les Arabes. Les coutumes des Orientaux.
Littré
- 1 Terme d'astronomie. Planète orientale, celle qui se lève avant le soleil.
-
2Qui est du côté de l'orient, qui appartient à l'orient. Région orientale. Les peuples orientaux.
Dans les terres orientales de cette partie du monde [l'Afrique], inconnues des anciens, les éléphants se sont trouvés aussi grands et peut-être même plus grands qu'aux Indes
, Buffon, Quadrup. t. IV, p. 254.Son éclat [de l'aube] blanchissait la rive orientale
, Masson, Helvét. III.Les Indes orientales, par opposition à Indes occidentales, qui est une dénomination abusive de l'Amérique.
Langues orientales, langues mortes ou vivantes de l'Asie.
Style oriental, style métaphorique en usage chez les peuples de l'Asie, particulièrement chez les Hébreux, les Arabes et les Persans.
Les couleurs orientales sont venues comme d'elles-mêmes empreindre toutes ses pensées, toutes ses rêveries?; et ses rêveries et ses pensées se sont trouvées tour à tour et presque sans l'avoir voulu, hébraïques, turques, persanes, arabes?
, Hugo, Orientales, préface.Luxe oriental, pompe orientale, luxe, pompe digne de l'Orient.
- 3Qui croît en Orient, qui vient d'Orient. Plantes orientales.
-
4
Pierres orientales, qualification qui, donnée aux rubis, aux saphirs et à la topaze, n'indique pas toujours le gisement originaire de ces gemmes, mais seulement qu'elles sont de qualité supérieure relativement à d'autres échantillons auxquels on les compare?; en sorte qu'une pierre dite orientale peut provenir de contrées tout opposées à notre orient,
Legoarant ?Les naturalistes récents ont donné, avec les joailliers, la dénomination de pierres orientales à celles qui ont une belle transparence, qui en même temps sont assez dures pour recevoir un poli vif,
Buffon, Min. t. VI, p. 213.Fig.
Je ne me mêlerai point de vous en envoyer [un cuisinier], à moins que ce ne fût une perle si orientale, que l'on fût assuré de n'en avoir aucun reproche
, Sévigné, 19 août 1675. -
5 S. f. Sorte de fleur?; il y avait une variété d'anémone et une de tulipe qui portaient ce nom.
Il quitte cette fleur pour l'orientale
, La Bruyère, XIII. -
6Les Orientales, recueil de poésies de V. Hugo qui ont la plupart pour objet les scènes de l'Orient.
Si aujourd'hui quelqu'un lui demande à quoi bon ces Orientales?? qui a pu lui inspirer de s'aller promener en Orient pendant tout un volume?? que signifie ce livre inutile de pure poésie?
, Hugo, Orientales, Préface.? Au milieu d'eux [les enfants qui jouent autour du poëte] L'Orientale d'or plus riche épanouit Ses fleurs peintes et ciselées?; La ballade est plus fraîche?
, Hugo, F. d'aut. 15.Oui, monsieur, tel que vous me voyez, j'ai été une victime du sonnet, ce qui ne m'a pas empêché de donner dans la ballade, dans l'orientale, dans l'ïambe, dans la méditation, dans le poëme en prose et autres délassements modernes
, Reybaud, Jérôme Paturot, I, 1. -
7 S. m. pl. Les Orientaux, les peuples de l'Asie (avec une majuscule).
Abraham, quoique né vers l'Euphrate, fait une grande époque pour les Occidentaux, et n'en fait point une pour les Orientaux, chez lesquels il est pourtant aussi respecté que parmi nous
, Voltaire, Dict. phil. Abraham.
HISTORIQUE
XIVe s. La mer orientel ou meridionel
, H. de Mondeville, f° 88, verso.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
ORIENTAL. - HIST. Ajoutez?: XIIe s. En icels leus orientals
, Benoit de Sainte-Maure, Roman de Troie, V. 23185. En ceste oriental partie
, Benoit de Sainte-Maure, ib. V. 23209.
Encyclopédie, 1re édition
ORIENTAL, adj. (Ast. & Géog.) se dit proprement de quelque chose qui est située à l'est ou au levant par rapport à nous ; il est opposé à occidental ; mais on dit plus généralement oriental de tout ce qui a rapport aux pays situés à l'orient par rapport à nous. Voyez Est, Levant & Occidental.
C'est dans ce sens qu'on dit, perles orientales, lorsqu'on parle des perles qui se trouvent dans les Indes orientales. Voyez Perle. On dit encore langues orientales, en parlant de l'hébreu, du syriaque, du chaldéen, & du cophte. Voyez Langue.
Dans l'Astronomie on dit qu'une planete est orientale lorsqu'elle paroît précéder le soleil vers le levant. Voyez Levant, voyez Lucifer. Chambers. (O)
Orientale, Philosophie, (Hist. de la Philosoph.) peu de tems après la naissance de Jesus-Christ, il se forma une secte de philosophes assez singuliere dans les contrées les plus connues de l'Asie & de l'Afrique. Ils se piquoient d'une intelligence extraordinaire dans les choses divines, ou celles sur lesquelles on croit le plus parce qu'on y entend le moins, & où il ne faut pas raisonner, mais soumettre sa raison, faire des actes de foi & non des systèmes ou des syllogismes. Ils donnoient leur doctrine pour celle des plus anciens philosophes, qu'ils prétendoient leur avoir été transmise dans sa pureté ; & plusieurs d'entre eux ayant embrassé la religion chrétienne, & travaillé à concilier leurs idées avec ses préceptes, on vit tout-à-coup éclore cet essaim d'hérésies dont il est parlé dans l'histoire de l'Eglise sous le nom fastueux de Gnostiques. Ces Gnostiques corrompirent la simplicité de l'Evangile par les inepties les plus frivoles ; se répandirent parmi les juifs & les Gentils, & défigurerent de la maniere la plus ridicule leur philosophie, imaginerent les opinions les plus monstrueuses, fortifierent le fanatisme dominant, supposerent une foule de livres sous les noms les plus respectables, & remplirent une partie du monde de leur misérable & détestable science.
Il seroit à souhaiter qu'on approfondît l'origine & les progrès des sectes : les découvertes qu'on feroit sur ce point éclaireroient l'histoire sacrée & philosophique des deux premiers siecles de l'Eglise ; période qui ne sera sans obscurité, que quand quelque homme d'une érudition & d'une pénétration peu commune aura achevé ce travail.
Nous n'avons plus les livres de ces sectaires, il ne nous en reste qu'un petit nombre de fragmens peu considérables. En supprimant leurs ouvrages, les premiers peres de l'Eglise, par un zele plus ardent qu'éclairé, nous ont privé de la lumiere dont nous avons besoin, & presque coupé le fil de notre histoire.
On ne peut révoquer en doute l'existence de ces philosophes. Porphyre en fait mention, il dit dans la vie de Plotin : ???????? ?? ???? ????? ??? ?????????? ?????? ??? ??? ????? ????????? ?? ?? ??? ??????? ?????????? ?????????, ?? ???? ??? ???????? ??? ????????, ?. ?. ?.. Il y avoit alors plusieurs chrétiens, hérétiques, & autres professant une doctrine émanée de l'ancienne philosophie, & marchant à la suite d'Adelphius & d'Aquilinus, &c. Ils méprisoient Platon ; ils ne parloient que de Zoroastre, de Zostrian, de Nicothée, & de Melus, & ils se regardoient comme les restaurateurs de la sagesse orientale : nous pourrions ajouter au témoignage de Porphyre, celui de Théodote & d'Eunape.
Ces philosophes prirent le nom de Gnostiques, parce qu'ils s'attribuoient une connoissance plus sublime & plus étendue de Dieu, & de ses puissances ou émanations, qui faisoient le fond de leur doctrine.
Ils avoient pris ce nom long-tems avant que d'entrer dans l'Eglise. Les Gnostiques furent d'abord certains philosophes spéculatifs ; on étendit ensuite cette dénomination à une foule d'hérétiques dont les sentimens avoient quelque affinité avec leur doctrine. Irenée dit que Ménandre disciple de Simon, fut un gnostique ; Basilide fut un gnostique selon Jerôme ; Epiphane met Saturnin au nombre des Gnostiques ; Philastrius appelle Nicolas chef des Gnostiques.
Ce titre de gnostique a donc passé des écoles de la philosophie des Gentils dans l'Eglise de J. C. & il est très-vraissemblable que c'est de cette doctrine trompeuse que Paul a parlé dans son épître à Timothée, & qu'il désigne par les mots de ?????????? ??????? ; d'où l'on peut conclure que le gnosisme n'a pas pris naissance parmi les Chrétiens.
Le terme de gnosis est grec ; il étoit en usage dans l'école de Pithagore & de Platon, & il se prenoit pour la contemplation des choses immatérielles & intellectuelles.
On peut donc conjecturer que les philosophes orientaux prirent le nom de Gnostiques, lorsque la philosophie pithagorico-platonicienne passa de la Grece dans leur contrée, ce qui arriva peu de tems avant la naissance de Jesus-Christ ; alors la Chaldée, la Perse, la Syrie, la Phénicie, & la Palestine étoient pleines de Gnostiques. Cette secte pénétra en Europe. L'Egypte en fut infectée ; mais elle s'enracina particulierement dans la Chaldée & dans la Perse. Ces contrées furent le centre du gnosisme ; c'est-là que les idées des Gnostiques se mêlerent avec les visions des peuples, & que leur doctrine s'amalgama avec celle de Zoroastre.
Les Perses qui étoient imbus du platonisme, trompés par l'affinité qu'ils remarquerent entre les dogmes de cette école dont ils sortoient & la doctrine des gnostiques orientaux, qui n'étoit qu'un pithagorico-platonisme défiguré par des chimeres chaldéennes & zoroastriques, se méprirent sur l'origine de cette secte. Bien-loin de se dire Platoniciens, les gnostiques orientaux reprochoient à Platon de n'avoir rien entendu à ce qu'il y a de secret & de profond sur la nature divine, Platonem in profonditatem intelligibilis essentiæ non penetrasse. Porphire Ennéad. II. l. IX. c. vj. Plotin indigné de ce jugement des Gnostiques, leur dit : quasi ipsi quidem intelligibilem naturam cognoscendo attingentes, Plato autem reliquique beati viri minimè ? « Comme si vous saviez de la nature intelligible ce que Platon & les autres hommes de sa trempe céleste ont ignoré », Plot. ibid. Il revient encore aux Gnostiques en d'autres endroits, & toujours avec la même véhémence. « Vous vous faites un mérite, ajoute-t-il, de ce qui doit vous être reproché sans cesse ; vous vous croyez plus instruits, parce qu'en ajoutant vos extravagances aux choses sensées que vous avez empruntées, vous avez tout corrompu ».
D'où il s'ensuit qu'à-travers le système de la philosophie orientale, quel qu'il fût, on reconnoissoit des vestiges de pithagorico-platonisme. Ils avoient changé les dénominations. Ils admettoient la transmigration des ames d'un corps dans un autre. Ils professoient la Trinité de Platon, l'être, l'entendement, & un troisieme architecte ; & ces conformités, quoique moins marquées peut être qu'elles ne le paroissoient à Plotin, n'étoient pas les seules qu'il y eût entre le gnosisme & le platonico-pithagorisme.
Le platonico-pithagorisme passa de la Grece à Alexandrie. Les Egyptiens avides de tout ce qui concernoit la divinité, accoururent dans cette ville fameuse par ses philosophes. Ils brouillerent leur doctrine avec celle qu'ils y puiserent. Ce mélange passa dans la Chaldée, où il s'accrut encore des chimeres de Zoroastre, & c'est ce cahos d'opinions qu'il faut regarder comme la philosophie orientale, ou le gnosisme, qui introduit avec ses sectateurs dans l'Eglise de Jesus-Christ, s'empara de ses dogmes, les corrompit, & y produisit une multitude incroyable d'hérésies qui retinrent le nom de gnosisme.
Leur système de théologie consistoit à supposer des émanations, & à appliquer ces émanations aux phénomenes du monde visible. C'étoit une espece d'échelle où des puissances moins parfaites placées les unes au-dessous des autres, formoient autant de degrés depuis Dieu jusqu'à l'homme, où commençoit le mal moral. Toute la portion de la chaîne comprise entre le grand abyme incompréhensible ou Dieu jusqu'au monde étoit bonne, d'une bonté qui alloit à la vérité en dégénérant ; le reste étoit mauvais, d'une dépravation qui alloit toujours en augmentant. De Dieu au monde visible, la bonté étoit en raison inverse de la distance ; du monde au dernier degré de la chaîne, la méchanceté étoit en raison directe de la distance.
Il y avoit aussi beaucoup de rapport entre cette théorie & celle de la cabale judaïque.
Les principes de Zoroastre ; les sephiroths des Juifs ; les éons des Gnostiques ne sont qu'une même doctrine d'émanations, sous des expressions différentes. Il y a dans ces systèmes des sexes différens de principes, de sephiroths, d'éons, parce qu'il y falloit expliquer la génération d'une émanation, & la propagation successive de toutes.
Les principes de Zoroastre, les sephirots de la cabale, les éons perdent de leur perfection à mesure qu'ils s'éloignent de Dieu dans tous ces systèmes, parce qu'il y falloit expliquer l'origine du bien & du mal physique & moral.
Quels moyens l'homme avoit-il de sortir de sa place, de changer sa condition misérable, & de s'approcher du principe premier des émanations ? C'étoit de prendre son corps en aversion ; d'affoiblir en lui les passions ; d'y fortifier la raison ; de méditer ; d'exercer des ?uvres de pénitence ; de se purger ; de faire le bien ; d'éviter le mal, &c.
Mais il n'acquéroit qu'à la longue, & après de longues transmigrations de son ame dans une longue succession de corps, cette perfection qui l'élevoit au-dessus de la chaîne de ce monde visible. Parvenu à ce degré, il étoit encore loin de la source divine ; mais en s'attachant constamment à ses devoirs, enfin il y arrivoit ; c'étoit-là qu'il jouissoit de la félicité complette.
Plus une doctrine est imaginaire, plus il est facile de l'altérer ; aussi les Gnostiques se diviserent-ils en une infinité de sectes différentes.
L'éclat des miracles & la sainteté de la morale du christianisme les frapperent ; ils embrasserent notre religion, mais sans renoncer à leur philosophie, & bien-tôt Jesus-Christ ne fut pour eux qu'un bon très-parfait, & le Saint-Esprit un autre.
Comme ils avoient une langue toute particuliere, on les entendoit peu. On voyoit en gros qu'ils s'écartoient de la simplicité du dogme, & on les condamnoit sous une infinité de faces diverses.
On peut voir à l'article Cabale, ce qu'il y a de commun entre la philosophie orientale & la philosophie judaïque ; à l'article Pithagore, ce que ces sectaires avoient emprunté de ce philosophe ; à l'article Platonisme, ce qu'ils devoient à Platon ; à l'article Jesus-Christ & Gnostique, ce qu'ils avoient reçu du christianisme ; & l'extrait abrégé qui va suivre de la doctrine de Zoroastre, montrera la conformité de leurs idées avec celle de cet homme célebre dans l'antiquité.
Selon Zoroastre, il y a un principe premier, infini & éternel.
De ce premier principe éternel & infini, il en est émané deux autres.
Cette premiere émanation est pure, active & parfaite.
Son origine, ou son principe, est le feu intellectuel.
Ce feu est très-parfait & très-pur.
Il est la source de tous les êtres, immatériels & matériels.
Les êtres immateriels forment un monde. Les matériels en forment un autre.
Le premier a conservé la lumiere pure de son origine ; le second l'a perdue. Il est dans les ténèbres, & les ténebres s'accroissent à mesure que la distance du premier principe est plus grande.
Les dieux & les esprits voisins du principe lumineux, sont ignés & lumineux.
Le feu & la lumiere vont toujours en s'affoiblissant ; où cessent la chaleur & la lumiere, commencent la matiere, les ténèbres & le mal, qu'il faut attribuer à Arimane & non à Orosmade.
La lumiere est d'Orosmade ; les ténèbres sont d'Arimane : ces principes & leurs effets sont incompatibles.
La matiere dans une agitation perpétuelle tend sans cesse à se spiritualiser, à devenir lucide & active.
Spiritualisée, active & lucide, elle retourne à sa source, au feu pur, à mithras, où son imperfection finit, & où elle jouit de la suprème félicité.
On voit que dans ce système, l'homme confondu avec tous les êtres du monde visible, est compris sous le nom commun de matiere.
Ce que nous venons d'exposer de la philosophie orientale y laisse encore beaucoup d'obscurité. Nous connoîtrions mieux l'histoire des hérésies comprises sous le nom de gnosisme ; nous aurions les livres des Gnostiques ; ceux qu'on attribue à Zoroastre, Zostrian, Mesus, Allogene ne seroient pas supposés, que nous ne serions pas encore fort instruits. Comment se tirer de leur nomenclature ? comment apprécier la juste valeur de leurs métaphores ? comment interpreter leurs symboles ? comment suivre le fil de leurs abstractions ? comment exalter son imagination au point d'atteindre à la leur ? comment s'enivrer & se rendre fou assez pour les entendre ? comment débrouiller le cahos de leurs opinions ? Contentons-nous donc du peu que nous en savons, & jugeons assez sainement de ce que nous avons, pour ne pas regretter ce qui nous manque.
Oriental, (Commerce & Hist. nat.) nom donné par la plûpart des joailliers à des pierres précieuses. Cette épithete est fondée sur la dureté de ces pierres, qui est beaucoup plus grande, dit-on, que celle des mêmes pierres trouvées en occident ; mais cette regle n'est point sûre, & il se trouve en Europe quelques pierres qui ont tout autant de dureté & de pureté que celles d'orient. On prétend aussi que les pierres qui viennent d'orient, ont des couleurs plus vives & plus belles que celles qu'on trouve en occident. Voyez Pierres précieuses. (?)
Étymologie de « oriental »
- (Adjectif) Du latin orientalis venant de oriens (« orient »).
- (Nom) (XXe siècle) Car venu en Europe d'Orient.
Prov. et esp. oriental?; ital. orientale?; du lat. orientalis, de oriens, orient.
oriental au Scrabble
Le mot oriental vaut 8 points au Scrabble.
Informations sur le mot oriental - 8 lettres, 4 voyelles, 4 consonnes, 8 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot oriental au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
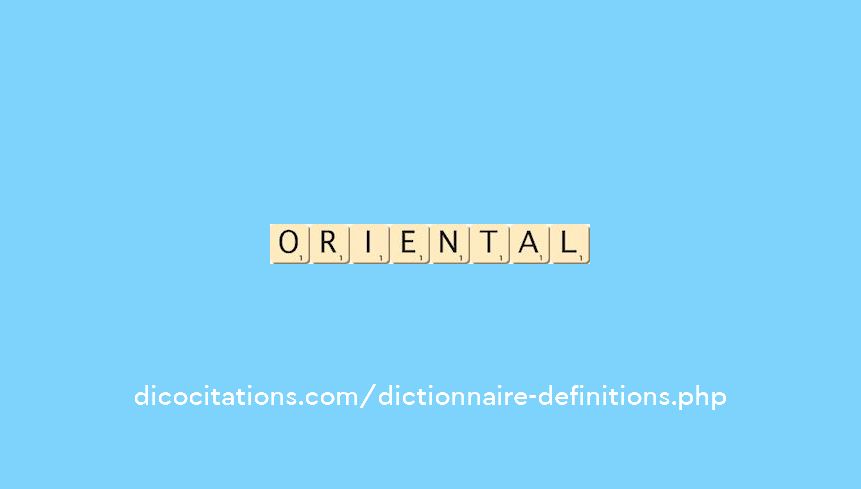
Les rimes de « oriental »
On recherche une rime en AL .
Les rimes de oriental peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en al
Rimes de virale Rimes de capitale Rimes de cérémonial Rimes de libidinale Rimes de thermale Rimes de royales Rimes de multinationale Rimes de philosophale Rimes de horizontales Rimes de rectal Rimes de negro spirituals Rimes de salles Rimes de transcendantal Rimes de intercontinental Rimes de cordiales Rimes de inguinal Rimes de détale Rimes de sénatoriales Rimes de foetal Rimes de oral Rimes de hâles Rimes de régionales Rimes de dictatorial Rimes de essential Rimes de curiales Rimes de étale Rimes de allobarbital Rimes de régional Rimes de national Rimes de maximales Rimes de passepoil Rimes de abbatiale Rimes de littérale Rimes de capitales Rimes de papal Rimes de centrale Rimes de dentales Rimes de lustral Rimes de verbal Rimes de épiscopale Rimes de arousal Rimes de cale Rimes de seigneurial Rimes de patriarcale Rimes de sénatoriales Rimes de syncopal Rimes de Flémalle Rimes de variétal Rimes de occidentale Rimes de primordialeMots du jour
virale capitale cérémonial libidinale thermale royales multinationale philosophale horizontales rectal negro spirituals salles transcendantal intercontinental cordiales inguinal détale sénatoriales foetal oral hâles régionales dictatorial essential curiales étale allobarbital régional national maximales passepoil abbatiale littérale capitales papal centrale dentales lustral verbal épiscopale arousal cale seigneurial patriarcale sénatoriales syncopal Flémalle variétal occidentale primordiale
Les citations sur « oriental »
- Et moi qui pensais que vous deviez avoir vécu comme un roi de Norvège ou du monde oriental !Auteur : John Millington Synge - Source : Le Baladin du monde occidental (1907), I, Pegeen
- Ce que j'emportais de plus précieux ne pouvait s'enfermer dans une malle. « La culture, - a dit un moraliste oriental - c'est ce qui reste dans l'esprit quand on a tout oublié.» J'avais acquis à l'École Normale [supérieure] une méthode pour le travail et le goût de cet ordre, qui impose la discipline de l'esprit à la confusion des choses. Aucun besoin d'agir. L'action, dont on dit communément qu'elle est une affirmation, est, en vérité, la négation de tous les possibles moins un.Auteur : Edouard Herriot - Source : Jadis, D'une guerre à l'autre 1914-1936
- Non vraiment la religion ne m'intéresse pas. Et si je devais avoir des préoccupations de ce côté-là, mes sympathies iraient plutôt vers certaines religions extrême-orientales.Auteur : Claude Lévi-Strauss - Source : Le quotidien de Paris, 2 octobre 1989.
- La steppe orientale où les sonorités s'étouffent dans l'illimité des distances et le feutrage de la neige.Auteur : Marcel Proust - Source : A la recherche du temps perdu, La Prisonnière (1923)
- L'Occidental, surtout l'Occidental moderne, apparaît comme essentiellement changeant et inconstant, n'aspirant qu'au mouvement et à l'agitation, au lieu que l'Oriental présente le caractère opposé.Auteur : René Guénon - Source : Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues (1921)
- Nous allions quitter Jérusalem et continuer notre route à travers la Galilée, vers Damas la ville sarrasine, pour au moins nous distraire et nous étourdir au charme de mort des choses orientales.Auteur : Louis Marie Julien Viaud, dit Pierre Loti - Source : Jérusalem (1894)
- M. Garnier était un savant orientaliste et l'homme le plus versé de France dans l'exégèse biblique, telle qu'elle s'enseignait chez les catholiques il y a une centaine d'années.Auteur : Ernest Renan - Source : Souvenirs d'enfance et de jeunesse (1883), V, le Séminaire St-Sulpice
- Aujourd'hui que la conquête d'Afrique a fait de l'arabe une langue à la mode et courante, il faut espérer que cette riche mine sera fouillée dans tous les sens par nos jeunes orientalistes; ...Auteur : Théophile Gautier - Source : Voyage en Espagne (1843)
- Salami Loukoum : Spécialité orientale mélangeant charcuterie et friandise, servie aux visiteurs en signe de bienvenueAuteur : Marc Escayrol - Source : Mots et Grumots (2003)
- Ce que j'emportais de plus précieux ne pouvait s'enfermer dans une malle. La culture - a dit un moraliste oriental - c'est ce qui reste dans l'esprit quand on a tout oublié.Auteur : Edouard Herriot - Source : Jadis, D'une guerre à l'autre 1914-1936
- L'idée commune que l'humanité se fait de Dieu ne dépasse point celle d'un monarque oriental entouré de sa cour ; la pensée religieuse est donc en retard de plusieurs siècles, nous sommes toujours à brouter l'herbe, malgré les ballons.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Notes de voyages
- Une chambre au décor vaguement oriental, à peine éclairée par de petites lampes dont les abat-jour diffusent çà et là une lumière rousse.Auteur : Alain Robbe-Grillet - Source : La Maison de rendez-vous (1965)
- Le poète Mallarmé (l'auteur du Faune) m'a cadeauté d'un livre qu'il édite: Vatek, conte oriental.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Correspondance, 25 juin 1876
- Ils iraient alors grossir cette acrimonieuse catégorie des citoyens sur éduqués et sous-employés, qui comprenait tout et ne pouvait rien. Ils seraient déçus, en colère, progressivement émoussés dans leurs ambitions, puis se trouveraient des dérivatifs, comme la constitution d'une cave à vins ou la conversion à une religion orientale. Auteur : Nicolas Mathieu - Source : Leurs enfants après eux
- « La culture, - a dit un moraliste oriental - c'est ce qui reste dans l'esprit quand on a tout oublié.» Auteur : Edouard Herriot - Source : Jadis, D'une guerre à l'autre 1914-1936
- La plus grande caractéristique de la civilisation orientale est de connaître le contentement; alors que celle de l'Occident est de ne le pas connaître.Auteur : Hu-Shih - Source : Pensées
- Djinn: Nom d'une danse orientale.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Dictionnaire des idées reçues (1913)
- Bague: Il est très distingué de la porter au doigt indicateur. La mettre au pouce est trop oriental. Porter des bagues déforme les doigts.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Dictionnaire des idées reçues (1913)
- Tous les matins, dans tous les bistrots du monde, des prairies d'Islande aux confins de la Terre de Feu, de la Sibérie la plus orientale à Manosque, le football embrase le coeur de milliards d'hommes qui s'éveillent.Auteur : René Frégni - Source : La fiancée des corbeaux (2011)
- Aux lueurs colorées que laissent filtrer les vitraux, toute cette magnificence de conte oriental chatoie, miroite, étincelle dans la pénombre.Auteur : Louis Marie Julien Viaud, dit Pierre Loti - Source : Jérusalem (1894)
- L'Algérie était pour moi cette amante insupportable, de celle qu'on aimerait quitter, mais sans laquelle on ne peut vivre. On fantasme son mystère, elle est orientale l'Algérie, elle a la noblesse de la Rome antique et le sang des barbares, le rire des Andalouses, la musique des Touaregs. Elle a la nostalgie facile, cette manière de regarder le passé, pour ne pas s’inquiéter de l'avenir. C'est peut-être en cela qu'elle ressemble tant à la France. Les enfants d’exilés portent en eux l'exil et l'ancrage. On les a perfusés à la mélancolie. Auteur : Lilia Hassaine - Source : Soleil amer (2021)
- Et voici qu'il avait la révélation que la Prusse-Orientale était tout entière une constellation d'allégories, et qu'il lui appartenait de se glisser en chacune d'elles, non seulement comme une clé dans une serrure, mais comme une flamme dans un lampion.Auteur : Michel Tournier - Source : Le Roi des Aulnes (1970)
- Orientaliste: Homme qui a beaucoup voyagé.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Dictionnaire des idées reçues (1913)
Les mots proches de « oriental »
Oribus Orient Oriental, ale Orientalement Orientalisé, ée Orientaliser Orientaliste Orienté, ée Orienter Orière Orifice Oriflamme Origan Originaire Originairement Original, ale Originalement Originalité Origine Originel, elle Originellement Orignal Orillon OripeauLes mots débutant par ori Les mots débutant par or
oriane orianne oribus Oricourt orient orienta orientable orientai orientaient orientais orientait oriental oriental orientale orientale orientales orientales orientalisme orientaliste orientaliste orientalistes orientant orientateurs orientation orientations orientaux orientaux oriente orienté orienté orientée orientée orientées orientées orientent orienter orienterai orienterait orientèrent orienterez orientés orientés orienteur orienteur orienteurs orienteuse orientez orients Orieux orifice
Les synonymes de « oriental»
Les synonymes de oriental :- 1. levantin
synonymes de oriental
Fréquence et usage du mot oriental dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « oriental » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot oriental dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Oriental ?
Citations oriental Citation sur oriental Poèmes oriental Proverbes oriental Rime avec oriental Définition de oriental
Définition de oriental présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot oriental sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot oriental notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 8 lettres.
