Définition de « paradé »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot parade de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur paradé pour aider à enrichir la compréhension du mot Paradé et répondre à la question quelle est la définition de parade ?
Une définition simple : (fr-verbe-flexion |pp=oui)
Définitions de « parade »
Trésor de la Langue Française informatisé
PARADE1, subst. fém.
PARADE2, subst. fém.
PARADE3, subst. fém.
ÉQUIT., vieilli. Action d'arrêter brusquement un cheval, le cavalier déplaçant son assiette vers l'arrière-main; résultat de cette action. Ce cheval est sûr à la parade (Ac.1798-1935).Wiktionnaire
Nom commun 3 - français
parade \pa.?ad\ féminin
-
(Manège) Arrêt d'un cheval qu'on manie.
- La parade consiste à arrêter son cheval court sur place, tout en lui faisant rapprocher les pieds postérieurs près du centre de gravité et affaisser la croupe, de manière à recevoir sur l'arrière main la plus grande partie du poids de tout le corps ; et en le forçant immédiatement après à faire le lever du devant, c'est-à-dire à quitter un instant le sol des pieds antérieurs, environ quinze à trente centimètres, pendant que la croupe est affaissée. ? (Félix van der Meer, Connaissances complètes du cavalier, de l'écuyer et de l'homme de cheval, page 246, Lebègue & Cie à Bruxelles & Dumaine à Paris, 1865)
Nom commun 2 - français
parade \pa.?ad\ féminin
-
(Escrime) Action de parer un coup.
- D'un coup de parade, il brisa une épée, d'un coup de pointe il troua une poitrine. ? (Michel Zévaco, Le Capitan, 1906, Arthème Fayard, collection « Le Livre populaire » no 31, 1907)
- Se mettre à la parade.
- Manquer à la parade.
- S'attendant à la paire de claques, prélude de la raclée, l'avant-bras déjà presque levé pour la parade habituelle, Camus en demeura un instant muet de stupéfaction. ? (Louis Pergaud, L'Argument décisif, dans Les Rustiques, nouvelles villageoises, 1921)
-
Riposte.
- Ne pas être heureux à la parade, ne pas savoir riposter à une plaisanterie, à une raillerie, à un reproche.
- Il ne trouva point de parade. ? (Joseph Kessel, L'équipage, Gallimard, 1969, page 101)
Nom commun 1 - français
parade \pa.?ad\ féminin
-
Montre, étalage de quelque chose.
- Cela n'est mis là que pour la parade.
- Faire parade, faire montre, montrer avec ostentation, tirer vanité d'une chose.
-
(En particulier) Ce qui est plus pour l'ornement que pour l'usage.
- Une chambre, un meuble de parade.
- Un habit de parade.
-
(Militaire) Revue des troupes allant monter la garde.
- La magnifique parade commandée par l'empereur devait être la dernière de celles qui excitèrent si long-temps l'admiration des Parisiens. ? (Honoré de Balzac, La Femme de trente ans, Paris, 1832)
-
Ensemble de scènes burlesques que les bateleurs donnent au peuple à la porte de leur théâtre pour engager à y entrer.
- Si j'étais pas faignante je me mettrais à faire les boîtes de nuit, sérieusement, la noce sans m'amuser, j'y parviendrais : tendre ma joue à embrasser, comme un paillasse à la parade tend sa joue à claquer. ? (Léon Frapié, La divinisée: roman d'une femme, éd. E. Flammarion, 1927, p. 225)
-
(Par extension) Vain semblant, étalage plein de fausseté.
- Ses larmes n'étaient qu'une parade.
- Il jouait une parade.
- Cette cérémonie ne fut qu'une parade.
- (En particulier) Démonstrations qui ne sont qu'une comédie.
-
(Québec) Défilé. Note : Cette acception d'inspiration anglaise est critiquée par le Bureau de la traduction du gouvernement du Canada, qui recommande d'y substituer défilé.
- Parade de la fierté gaie à Montréal.
- Écrasée par un conducteur néonazi, une manifestante a pourtant payé de sa vie son opposition à la parade de Charlottesville, qui rassemblait, le week-end dernier, suprémacistes blancs, sudistes nostalgiques de l'esclavage et du général Lee, militants de l'« alt-right » (extrême droite) et autres humanistes du Ku Klux Klan, tous unis, bras tendu, batte de base-ball en main, slogans antisémites et anti-« nègres » aux lèvres, pour hurler leur « fierté d'être blancs ». ? (Frédéric Pagès, Tirs à blancs, Le Canard Enchaîné, 16 août 2017, page 1)
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Montre, étalage de quelque chose. Cela n'est mis là que pour la parade. Il se dit, particulièrement, de Tout ce qui est moins pour l'usage ordinaire que pour l'ornement. Une chambre, un meuble de parade. Un habit de parade. Lit de parade se dit particulièrement d'un Grand lit sur lequel on expose après leur mort les personnages de grande distinction. Fig., Faire parade d'une chose, En faire ostentation, en tirer vanité. Il fait parade de son esprit, de son savoir. Faire parade de beaux sentiments.
PARADE s'est dit, en termes militaires, de la Revue des troupes allant monter la garde. Pas de parade, Sorte de marche cadencée en usage dans certaines cérémonies militaires.
PARADE se dit aussi des Scènes burlesques que les bateleurs donnent au peuple à la porte de leur théâtre pour engager à y entrer. La parade avait attiré un public nombreux. Il se dit, par extension, d'une Imitation ridicule, d'un vain semblant, d'un étalage plein de fausseté. Cette cérémonie ne fut qu'une parade.
PARADE se dit encore du Lieu où ceux qui vendent des chevaux viennent habituellement les montrer aux acheteurs. Voyez MONTRE.
Littré
-
1 Terme de manége. Arrêt d'un cheval qu'on manie (c'est le sens du mot espagnol parada, et c'est ce sens qui s'est introduit le premier). Un cheval sûr à la parade est un cheval qu'on arrête facilement dans sa course.
Parade manquée, se dit lorsque le cheval qu'on veut arrêter s'arme de la bride, en haussant le dos.
Lieu où ceux qui vendent des chevaux viennent habituellement les montrer aux acheteurs.
-
2De ce sens dans les manéges et les carrousels est venu le sens d'exhibition pompeuse, qui se liait d'ailleurs à parer, orner.
Lit de parade, lit élevé sur lequel on expose, après leur mort, les personnages de grande distinction.
?Des Mazarins l'insolente bravade Qui font voir d'Emery [surintendant des finances] en son lit de parade, Lui qu'on ne devait voir qu'en parade au gibet
, Patin, t. II, p. 19.Son corps [de Newton] fut exposé sur un lit de parade dans la chambre de Jérusalem, endroit d'où l'on porte au lieu de leur sépulture les personnes du plus haut rang et quelquefois les têtes couronnées
, Fontenelle, Newton.Il a été un temps où les rois et les reines, les princes et princesses étaient exposés après leur mort pendant quelques jours sur un lit de parade, dans une chapelle ardente
, Legrand D'Aussy, Inst. Mém. sc. mor. et polit. t. II, p. 258.Lit de parade, se disait aussi d'un lit paré sur lequel les nouvelles mariées recevaient pendant quelques jours les visites de leurs connaissances.
On verra la jeune princesse de Guémené [nouvellement mariée] aujourd'hui en parade à l'hôtel de Guémené? elle y recevra ses visites quatre jours de suite
, Sévigné, 8 déc. 1679. -
3 Terme de guerre. Revue qu'on fait passer aux troupes qui vont monter la garde.
Les douze cent mille hommes armés qui font la parade en Europe, pourront bien ne faire longtemps que la parade
, Voltaire, Lett. Levenhaupt, 13 fév. 1768.L'esprit de Bonaparte n'est pas à Sainte-Hélène, il est ici dans les hautes classes?; on rêve, non des conquêtes, mais la grande parade?; on donne le mot d'ordre, on passe des revues, on est fort satisfait
, Courier, Lettre au censeur, x.Populairement et fig. Défiler la parade, mourir.
Marche que les chevaliers faisaient en bel ordre dans la lice avant de commencer les carrousels.
-
4Étalage, montre.
L'armée des Macédoniens néglige cette vaine parade [les belles armures], et elle n'a soin que de se conserver inébranlable
, Vaugelas, Q. C. III, 2.Fer, jadis tant à craindre, et, qui, dans cette offense, M'a servi de parade et non pas de défense
, Corneille, Cid, I, 7.Paraître avec éclat mère dénaturée? C'est mettre avec trop d'art la douleur en parade
, Corneille, Perth. III, 3.On fait parade du luxe jusque dans l'église, et on le mène en triomphe aux yeux de Dieu même
, Bossuet, Sermons, Nécess. de la vie, 2.Que? au milieu de l'argent et des diamants il mit en parade des sacs et des boisseaux
, Boileau, Du subl. XXXIV.Jene compte pour rien la parade des carrosses et des laquais
, Hamilton, Gramm. VII.Ayant su d'ailleurs qu'ils avaient fait parade, dans plusieurs maisons, du premier volume de l'Émile que j'avais eu l'imprudence de leur prêter
, Rousseau, Confess. X.Terme de marine. Faire parade, orner un vaisseau de tous ses pavillons.
De parade, se dit de ce qui est moins pour l'usage que pour l'ornement. Un meuble, un habit de parade.
Fig.
Il faut composer un homme en lui-même, avant que de méditer quel rang on lui donnera parmi les autres?; et, si l'on ne travaille sur ce fonds, toutes les autres vertus, si éclatantes qu'elles puissent être, ne seront que des vertus de parade
, Bossuet, 2e panég. saint Joseph, préambule.Distinguons deux hommes en un, L'homme secret et l'homme de parade
, Lamotte, Fabl. II, 19.Chez certaines femmes, les m?urs de parade et les m?urs négligées sont aussi différentes que la coiffure du jour et la coiffure de nuit
, Dufresny, Double veuvage, I, 10.Il plaint ces voluptueux de parade, qui livrent leur vie entière à l'ennui pour paraître avoir du plaisir
, Rousseau, Ém. IV.Quiconque a le courage de paraître toujours ce qu'il est, deviendra tôt ou tard ce qu'il doit être?; mais il n'y a plus rien à espérer de ceux qui se font un caractère de parade
, Rousseau, Lett. à Sophie, Corresp. t. v, p. 26, dans POUGENS.Fig. Faire parade d'une chose, en tirer vanité.
Ébloui du nouvel éclat Dont sa vanité fait parade
, Boursault, Lett. nouv. t. II, p. 307, dans POUGENS.Et il me semble qu'on m'avait voulu récompenser par là de ce que je n'avais point fait parade de ma vertu
, Fontenelle, Lucrèce, Barbe.On dit en un sens analogue?: par parade.
La plupart de leurs belles sentences [des sages du monde] ne sont dites que par parade et par une gravité affectée
, Bossuet, Sermons, Rosaire, préambule. -
5Scènes burlesques données par les bateleurs à la porte de leur théâtre pour piquer la curiosité des passants et s'attirer des spectateurs.
Il ne dédaignait pas même de se prêter à ce genre de farce appelé parade, genre que le bon goût a enfin remis à sa place et relégué sur les balcons de la foire
, D'Alembert, Éloges, Moncrif.Il est allé à cinq heures du soir à Versailles, où on lui prépare opéras, comédies, ballets, parades, etc.
D'Alembert, Lett. au roi de Pr. 30 juillet 1781.Par extension.
M. de Maurepas était le premier homme du monde pour les parades?; il était célèbre pour ses bons mots
, Voltaire, Lett. Delisle, 10 juill. 1774.Par une autre extension, mauvaises pièces de théâtre.
Je ne crois pas qu'il y ait une ville de province dans laquelle on pût achever la représentation de ces parades qui ont été applaudies à Paris
, Voltaire, Lett. d'Argental, 2 sept. 1767.Fig.
Il [Diderot] a dit?: Tu [Voltaire] as reçu les honneurs du triomphe dans la capitale la plus éclairée de l'univers? et les critiques ont ajouté avec une hardiesse qui ne se dément pas?: parade burlesque?!
Diderot, Claude et Nér. II, 109. -
6 Fig. Vain semblant, étalage plein de fausseté. Ses larmes n'étaient qu'une parade. Il jouait une parade. Cette cérémonie ne fut qu'une parade.
Parade politique, démonstrations politiques qui ne sont qu'une comédie.
Ménager ou menacer la cour, accroître sa puissance sous les règnes faibles, reculer ou composer avec les gouvernements absolus, voilà quel était [dans le parlement] le cercle de ces évolutions, de ces parades politiques, de ces intrigues souterraines
, Mirabeau, Collection, t. III, p. 71. -
7 Terme d'escrime. Action de parer un coup. Parade prompte, ferme.
Chaque botte doit avoir sa parade, ou moyen de la parer, même les bottes secrètes,
Dict. des arts et mét. Maître d'armes.Fig.
Allant toujours à la parade, elle leur fit prendre le parti de?
, Saint-Simon, 130, 188.Fig. Il n'est pas heureux à la parade, c'est-à-dire il ne sait pas écarter une plaisanterie, un reproche.
HISTORIQUE
XVIe s. Et fut environ quinze jours le corps de Henri II en parade mortuaire en un grande salle dressée dans les Tournelles
, Condé, Mémoires, p. 546. Les pilleurs, les emprunteurs mettent en parade leurs bastiments, leurs achapts, non ce qu'ils tirent d'aultruy
, Montaigne, I, 162. Sans pompe ny parade de suite
, Sat. Mén. p. 3. Les plagiaires, lesquels faisans parade du sçavoir d'autrui?
, Paré, Au lect. [Dames et demoiselles, dans un ballet] après avoir fait le tour de la salle pour la parade comme dans un camp, et après s'estre bien fait voir?
, Brantôme, Dames ill. p. 80, dans LACURNE. Feu M. de Guise comparut ainsi en sa parade [habillement] et entrée de camp en un combat à cheval qui se fit un jour au Louvre aux nopces de M. de Joyeuse
, Brantôme, Cap. estr. t. I, p. 87. La cavallerie estoit mieux en ordre que le reste?; mais, après avoir fait montre et parade en l'armée du duc, elle se defit incontinent, et ne servit quasi de rien
, Villeroy, Mém. t. I, p. 288, dans LACURNE. Si le cas est que ilz donnent argent pour distribution, vulgairement appelée parade [à l'offertoire, en un enterrement]
, Du Cange, parata.
Encyclopédie, 1re édition
PARADE, s. f. (Grammaire.) vue ou exposition d'une chose vue dans tous ses avantages, & dans ce qu'elle a de plus beau. Voyez Spectacle.
Un lit de parade, est celui sur lequel on expose le corps d'un grand ou d'un prince après sa mort.
On appelloit parade dans les tournois, la marche que faisoient, en bel ordre, les chevaliers dans la lice avant que de commencer le combat.
On a donné aussi le nom de parade à ce que nous appellons aujourd'hui revue d'une troupe, d'un régiment : on disoit alors faire la parade, & montrer la parade, comme nous disons aujourd'hui faire l'exercice, & monter la garde.
Parade, faire la, (Art milit.) les officiers font la parade, lorsque leur bataillon, leur régiment, ou leur compagnie, ayant ordre de se mettre sous les armes, ils s'y rendent en meilleur état qu'il leur est possible, pour prendre le poste, & tenir le rang qui leur est dû, soit sur le terrein où le bataillon se forme, soit dans la place où l'on s'assemble pour monter la garde, soit devant le corps-de-garde, quand il faut relever la garde, ou bien lorsqu'une personne de qualité est prête à passer. Dict. milit. (D. J.)
Parade, (Marine.) faire la parade ; tous les vaisseaux firent parade, & chacun déploya tous ses pavillons : c'est orner un vaisseau de tous les pavillons qui sont à son bord, & de tous ses parois. On dit aussi parer, les vaisseaux seront parés de flâmes. (Z)
Parade, (Maréchalerie.) on appelle cheval de parade, celui dont on ne se sert que dans les occasions de cérémonie, & plus pour la beauté que pour le service qu'on en attend.
On appelle la parade, un endroit que le maquignon a désigné pour faire monter le cheval qu'il veut vendre.
La parade, en terme de manege, est la même chose que le parer. Voyez Parer.
Parade, terme d'escrime, action par laquelle on pare une estocade. Voyez Parer.
Il y a autant de parades différentes, qu'il y a de différentes façons de terminer une estocade, voyez Estocade. Il y a donc cinq parades, qu'on appelle en terme d'escrime, quarte, tierce, seconde, quarte basse & quinte.
Parade, espece de farce, originairement préparée pour amuser le peuple, & qui souvent fait rire, pour un moment, la meilleure compagnie.
Ce spectacle tient également des anciennes comédies nommées platariæ, composées de simples dialogues presque sans action, & de celles dont les personnages étoient pris dans le bas peuple, dont les scenes se passoient dans les cabarets, & qui pour cette raison furent nommées tabernariæ. Voyez Comédie.
Les personnages ordinaires des parades d'aujourd'hui, sont le bon-homme Cassandre, pere, tuteur, ou amant surané d'Isabelle : le vrai caractere de la charmante Isabelle est d'être également foible, fausse & précieuse ; celui du beau Léandre son amant, est d'allier le ton grivois d'un soldat, à la fatuité d'un petit-maître : un pierrot, quelquefois un arlequin & un moucheur de chandelle, achevent de remplir tous les rôles de la parade, dont le vrai ton est toujours le plus bas comique.
La parade est ancienne en France ; elle est née des moralités, des mysteres & des faceties que les éleves de la basoche, les confreres de la passion, & la troupe du prince des sots jouoient dans les carrefours, dans les marchés, & souvent même dans les cérémonies les plus augustes, telles que les entrées, & le couronnement de nos rois.
La parade subsistoit encore sur le théâtre françois, du tems de la minorité de Louis le Grand ; & lorsque Scarron, dans son roman comique, fait le portrait du vieux comédien la Rancune, & de mademoiselle de la Caverne, il donne une idée du jeu ridicule des acteurs, & du ton platement bouffon de la plupart des petites pieces de ce tems.
La comédie ayant enfin reçu des lois de la décence & du goût, la parade cependant ne fut point absolument anéantie : elle ne pouvoit l'être, parce qu'elle porte un caractere de vérité, & qu'elle peint vivement les m?urs du peuple qui s'en amuse ; elle fut seulement abandonnée à la populace, & releguée dans les foires & sur les théâtres des charlatans qui jouent souvent des scenes bouffones, pour attirer un plus grand nombre d'acheteurs.
Quelques auteurs célebres, & plusieurs personnes pleines d'esprit, s'amusent encore quelquefois à composer de petites pieces dans ce même goût. A force d'imagination & de gayeté, elles saisissent ce ton ridicule ; c'est en philosophes qu'elles ont travaillé à connoître les m?urs & la tournure de l'esprit du peuple, c'est avec vivacité qu'elles les peignent. Malgré le ton qu'il faut toujours affecter dans ces parades, l'invention y décele souvent les talens de l'auteur ; une fine plaisanterie se fait sentir au milieu des équivoques & des quolibets, & les graces parent toujours de quelques fleurs le langage de Thalie, & le ridicule déguisement sous lequel elles s'amusent à l'envelopper.
On pourroit reprocher, avec raison aux Italiens, &beaucoup plus encore aux Anglois, d'avoir conservé dans leurs meilleures comédies trop de scenes de parades ; on y voit souvent regner la licence grossiere & révoltante des anciennes comédies nommées tabernariæ.
On peut s'étonner que le vrai caractere de la bonne comédie ait été si long-tems inconnu parmi nous ; les Grecs & les Latins nous ont laissé d'excellens modeles, & dans tous les âges, les auteurs ont eu la nature sous les yeux, par quelle espece de barbarie ne l'ont-ils si long-tems imitée que dans ce qu'elle a de plus abject & de plus désagréable ?
Le génie perça cependant quelquefois dans ces siecles dont il nous reste si peu d'ouvrages dignes d'estime ; la farce de Pathelin feroit honneur à Moliere. Nous avons peu de comédies qui rassemblent des peintures plus vraies, plus d'imagination & de gayeté.
Quelques auteurs attribuent cette piece à Jean de Meun ; mais Jean de Meun cite lui-même des passages de Pathelin, dans sa continuation du roman de la Rose : & d'ailleurs nous avons des raisons bien fortes pour rendre cette piece à Guillaume de Loris.
On accorderoit sans peine à Guillaume de Loris, inventeur du roman de la Rose, le titre de pere de l'éloquence françoise, que son continuateur obtint sous le regne de Philippe le Bel. On reconnoit dans les premiers chants de ce poëme, l'imagination la plus belle & la plus riante, une grande connoissance des anciens, un beau choix dans les traits qu'il en imite ; mais dès que Jean de Meun prend la plume, de froides allégories, des dissertations frivoles, appesantissent l'ouvrage ; le mauvais ton de l'école, qui dominoit alors, reparoit : un goût juste & éclairé ne peut y reconnoitre l'auteur de la farce de Pathelin, & la rend à Guillaume de Loris.
Si nous sommes étonnés, avec raison, que la farce de Pathelin n'ait point eu d'imitateurs pendant plusieurs siecles, nous devons l'être encore plus que le mauvais goût de ces siecles d'ignorance regne encore quelquefois sur notre théâtre : nous serions bien tentés de croire que l'on a peut-être montré trop d'indulgence pour ces especes de recueils de scenes isolées, qu'on nomme comédies à tiroirs. Momus Fabuliste mérita sans doute son succès par l'invention & l'esprit qui y regnent ; mais cette piece ne devoit point former un nouveau genre, & n'a eu que de très-foibles imitateurs.
Quel abus ne fait-on pas tous les jours de la facilité qu'on trouve à rassembler quelques dialogues, sous le nom de comédie ? Souvent sans invention, & toujours sans intérêt, ces especes de parades ne renferment qu'une fausse métaphysique, un jargon précieux, des caricatures, ou de petites esquisses mal dessinées, des m?urs & des ridicules ; quelquefois même on y voit regner une licence grossiere ; les jeux de Thalie n'y sont plus animés par une critique fine & judicieuse, ils sont deshonorés par les traits les plus odieux de la satyre.
Pourra-t-on croire un jour que dans le siecle le plus ressemblant à celui d'Auguste, dans la fête la plus solemnelle, sous les yeux d'un des meilleurs rois qui soient nés pour le bonheur des hommes, pourra-t-on croire que le manque de goût, l'ignorance ou la malignité, aient fait admettre & représenter une parade, de l'espece de celles que nous venons de définir ?
Un citoyen, qui jouissoit de la réputation d'honnête homme (M. Rousseau de Geneve), y fut traduit sur la scene, avec des traits extérieurs qui pouvoient le caractériser. L'auteur de la piece, pour achever de l'avilir, osa lui prêter son langage. C'est ainsi que la populace de Londres traine quelquefois dans le quartier de Drurylane, une figure contrefaite, avec une bourse, un plumet & une cocarde blanche, croyant insulter notre nation.
Un murmure général s'éleva dans la salle, il fut à peine contenu par la présence d'un maître adoré ; l'indignation publique, la voix de l'estime & de l'amitié, demanderent la punition de cet attentat : un arrêt flétrissant fut signé par une main qui tient & qui honore également le sceptre des rois, & la plume des gens de lettres. Mais le philosophe fidele à ses principes, demanda la grace du coupable, & le monarque crut rendre un plus digne hommage à la vertu en accordant le pardon de cette odieuse licence, qu'en punissant l'auteur avec sévérité. La piece rentra dans le néant avec son auteur ; mais la justice du prince & la générosité du philosophe passeront à la postérité, & nous ont paru mériter une place dans l'Encyclopédie.
Rien ne corrige les méchans : l'auteur de cette premiere parade en a fait une seconde, où il a embrassé le même citoyen, qui avoit obtenu son pardon, avec un grand nombre de gens de bien, parmi lesquels on nomme un de ses bienfaiteurs. Le bienfaiteur indignement travesti, est l'honnête & célebre M. H? & l'ingrat, est un certain P? de M.....
Tel est le sort de ces especes de parades satyriques, elles ne peuvent troubler ou séduire qu'un moment la société ; & la punition ou le mépris suit toujours de près les traits odieux & sans effet, lancés par l'envie contre ceux qui enrichissent la littérature, & qui l'éclairent. Si la libéralité des personnes d'un certain ordre, fait vivre des auteurs qui seroient ignorés sans le murmure qu'ils excitent ; nous n'imaginons pas que cette bienfaisance puisse s'étendre jusqu'à les protéger. Lisez l'article Eclectisme, p. 284. t. V. seconde col.
Cet article est de M. le comte de Tressan, lieutenant général des armées du Roi, grand maréchal-des-logis du roi de Pologne, duc de Lorraine & membre des académies des Sciences de France, de Prusse, d'Angleterre, &c.
Étymologie de « parade »
- (Nom 1) (XVe siècle) De l'espagnol parada (« arrêt ») dérivé de parar, avec le suffixe -ada, le sens étymologique est celui d'un arrêt (du cheval, du cavalier) pour un passage en revue (voir infra), puis il prend celui de « exhibition des forces militaires en face de l'ennemi », pour ensuite avoir celui, plus général de « exhibition, montre, étalage ».
- (Nom 2) (XVIIe siècle) Mot dérivé de parer, avec le suffixe -ade.
- (Nom 3) (XVIe siècle) De l'espagnol parada (« arrêt ») (voir supra).
Espagn. parada, lieu de station, le temps d'arrêt d'un cheval de manége (voy. PARER). L'écuyer brillait et faisait briller son cheval à la parade?; le mot parade s'introduisit en France sous François Ier, mais avec sa signification espagnole. Parade restait dans les carrousels, les manéges et les cérémonies?; ce fut sous le règne de Charles IX que certaine figure des carrousels, nommée jusqu'alors comparsa, prit le nom de parade. De là l'expression passa dans les troupes avec sa signification présente?; mais ce fut seulement pendant le règne de Louis XIV, à l'ordonnance du 25 juillet 1665, qu'il fut ordonné aux gardes françaises de faire parade.
paradé au Scrabble
Le mot paradé vaut 9 points au Scrabble.
Informations sur le mot parade - 6 lettres, 3 voyelles, 3 consonnes, 5 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot paradé au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
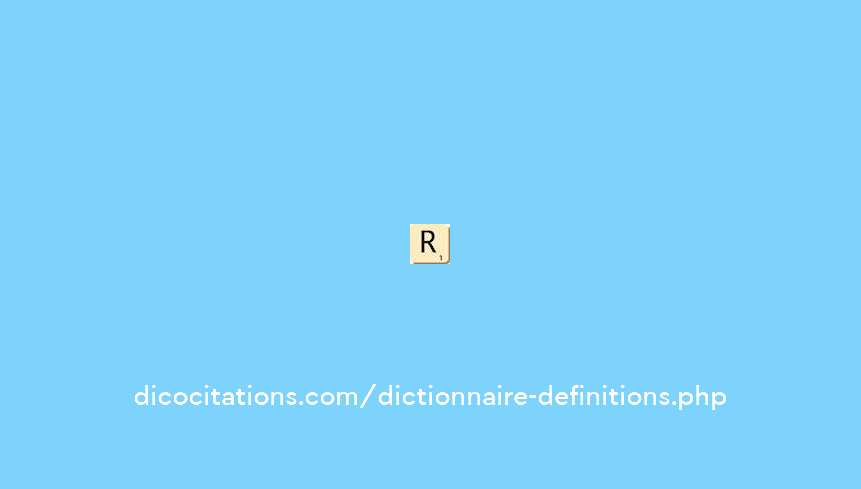
Les rimes de « paradé »
On recherche une rime en DE .
Les rimes de paradé peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en de
Rimes de enguirlandés Rimes de appréhender Rimes de gardé Rimes de fadé Rimes de raccordait Rimes de d Rimes de pendez Rimes de guidait Rimes de bondées Rimes de bardés Rimes de bordée Rimes de lézardées Rimes de pédé Rimes de tarauder Rimes de érodés Rimes de vidait Rimes de gonder Rimes de recommandée Rimes de recommandé Rimes de télécommandées Rimes de commandait Rimes de exsudé Rimes de posséder Rimes de démerdé Rimes de mollarder Rimes de embardée Rimes de dessoudé Rimes de élucidai Rimes de dévergondé Rimes de demandai Rimes de décidée Rimes de guidai Rimes de plaidait Rimes de hollandais Rimes de regardée Rimes de accordaient Rimes de goder Rimes de enguirlandaient Rimes de saccadé Rimes de cordées Rimes de paradais Rimes de commandé Rimes de raccommodez Rimes de validé Rimes de minauder Rimes de rader Rimes de pyramidé Rimes de évidé Rimes de vagabonder Rimes de barricaderMots du jour
enguirlandés appréhender gardé fadé raccordait d pendez guidait bondées bardés bordée lézardées pédé tarauder érodés vidait gonder recommandée recommandé télécommandées commandait exsudé posséder démerdé mollarder embardée dessoudé élucidai dévergondé demandai décidée guidai plaidait hollandais regardée accordaient goder enguirlandaient saccadé cordées paradais commandé raccommodez validé minauder rader pyramidé évidé vagabonder barricader
Les citations sur « paradé »
- Les hommes ne mettent guère en pratique les beaux sentiments dont ils font si volontiers parade.Auteur : Léon Tolstoï - Source : Anna Karénine (1873-1877)
- La parade perpétuelle des allégories chasse pour un temps la pensée.Auteur : Michel Vézina - Source : Parti pour Croatan (2014)
- L'avantage du livre sur le disque doit résider dans le fait que le premier, même sans intérêt, n'abîme jamais la vue alors que le second, même classé au hit-parade, casse souvent les oreilles.Auteur : Philippe Bouvard - Source : Mille et une pensées (2005)
- La délation est l'une des choses les plus répandues dans l'humanité ! Moins tout de même que la bêtise, en tête du hit parade...Auteur : Michel Rigaud, dit Paul-Jean Hérault - Source : Criminels de guerre (2006)
- Il vaut mieux employer son temps à acquérir du savoir que de le perdre à faire parade de celui qu'on a.Auteur : Jean Antoine Petit, dit John Petit-Senn - Source : Bluettes et boutades (1846)
- On s'était fait une langue de convention, un style académique, une mythologie de parade, une versification factice, un vocabulaire vérifié, approuvé, extrait des bons auteurs.Auteur : Hippolyte Taine - Source : Philosophie de l'art (1865)
- Le coeur, dérisoire métaphore d'un sentiment diffus, empêché, parce que, quelque interprétation que l'on en fasse, le coeur n'est pas d'or, il sert à peu de choses, pour ne pas dire à rien. Le coeur, dans le meilleur des cas, il parade les jours de fête, le temps du premier baiser, mais après la disette s'étend, épouse, s'incruste sur les flancs malingres du destin, et il n'y a plus que le sang qui parle et se déverse. Un sang noir.Auteur : Franck Bouysse - Source : Né d'aucune femme (2019)
- Mot hideux : hit-parade dont la fortune est à la mesure du ratatinement cérébral affectant des populations entières d'abrutis de tous âges, béant devant le succès et le fric rapides.
Auteur : Georges Picard - Source : De la connerie (1994)
- C'est facile d'être bonne, et souriante, et douce. Quand on est belle et riche ! Mais être bonne quand on est une bonne ! On se contente de parader pendant qu'on fait le ménage ou la vaisselle. On brandit un plumeau comme un éventail.Auteur : Jean Genet - Source : Les Bonnes (1947)
- Stoïcisme de parade : être un passionné du «Nil admirari», un hystérique de l'ataraxie.Auteur : Emil Cioran - Source : Syllogismes de l'amertume (1952)
- Virus inconnu signifiait deux choses : pas de parade possible du système immunitaire et, surtout pas de vaccin. Elle se rappelait le chaos créé pendant la pandémie Influenza H1N1 - la fameuse grippe mexicaine - de 2009. Là aussi, souche inconnue, jaillie du fin fond du Mexique, qui avait en quelques semaines fait le tour du monde. Auteur : Franck Thilliez - Source : Pandemia (2015)
- Et c'est pourquoi ma Terre maternelle, j'ai pleuré sur toi intérieurement à cet instant de l'immense parade qu'on nomme le Temps: les clowns défilent et chacun sait qu'au fond d'eux ils ont le coeur brisé.Auteur : Roger Zelazny - Source : L'île des morts
- La philosophie, l'art et la religion existent parce que la mort oblige les hommes à inventer des parades pour ne pas avoir à succomber et à trembler d'effroi devant elle.Auteur : Michel Onfray - Source : Journal hédoniste IV, La Lueur des orages désirés (2007)
- Doit-on dire monsieur ou mondamoiseau ? - Pardon ? - Je dis : doit-on vous appeler monsieur Laparade ou mondamoiseau Laparade ?Auteur : Lucille Durand, dite Louky Bersianik - Source : Euguélionne (1976)
- Sous l'affublement des grands mots, des panaches, des parades de théâtre ...Auteur : Romain Rolland - Source : Jean-Christophe (1904-1912)
- José Bové et sa Pecnoparade? Laissez-moi me marrer! Les paysans français, il faudra bien qu'un jour quelqu'un prenne le temps de leur expliquer pourquoi les gens boulottent des hamburgers à 17 balles plutôt que de se taper du foie gras à 300 balles!Auteur : Jean Gouyé, dit Jean Yanne - Source : J'me marre (2003)
- L'exagération dans les discours révèle la faiblesse, comme le charlatanisme décèle l'ignorance. Celui qui fait parade de ses forces, s'en défie.Auteur : Jean-Baptiste Say - Source : Petit volume contenant quelques aperçus des hommes et de la société (1817)
- Oui, on peut faire la guerre en ce monde, singer l'amour, torturer son semblable, parader dans les journaux, ou simplement dire du mal de son voisin en tricotant. Mais, dans certains cas, continuer, seulement continuer, voilà ce qui est surhumain.Auteur : Albert Camus - Source : La Chute (1956)
- Je veux une grande parade
Un défilé de chars
Des serpentins, des fleurs
Du bruit, une fanfare
Je veux une mascarade
Un verre et un cigare.Auteur : Henri Salvador - Source : Un tour de manège (2000) - Impossible de sortir on dirait, dit-il. Puis il ajoute : Mais on sortira.
Au nord, entourée de lacs grands comme des océans, la forêt s’étend jusqu’au pied d’une chaîne de montagnes. Au milieu de la forêt, il y a un puits. Le puits fait environ sept mètres de profondeur et ses parois irrégulières forment une muraille de terre humide et de racines, son embouchure est étroite et sa base plus large, comme une pyramide vide et émoussée. De veines lointaines en galeries affluentes de la rivière, une eau sombre s’écoule au fond du lit, le tapissant d’un dépôt terreux et d’une boue piquée de bulles qui, en éclatant, restituent à l’atmosphère son parfum d’eucalyptus. Peut-être à cause du mouvement des plaques tectoniques, ou de la continuelle brise tourbillonnante, les petites racines s’agitent, se retournent et paradent en une danse lente et angoissante qui évoque les entrailles des forêts dirigeant lentement le monde.Auteur : Ivan Repila - Source : Le Puits (2013)
- C'est bizarre, je me serais volontiers proclamé libertin, avant de savoir ce que c'était que le libertinage. Je croyais que Don Juan et Valmont étaient des cyniques, des libres-penseurs, des types à la coule, quoi, comme disait mon grand-père Gérard. Mais ils ne sont que des spécialistes de la parade nuptiale, qui ont élevé la danse du dindon au rand d'art. Auteur : Anne Percin - Source : Comment (bien) rater ses vacances (2010)
- Catherine Tasca, nouvelle ministre de la Culture, rêve d'une seule chose: après la journée des Monuments historiques, la fête de la Musique, le mois de la Poésie, la Techno-parade... ce serait d'instituer «la journée sans Jack Lang».Auteur : Laurent Ruquier - Source : Vu à la radio (2001)
- Il me semble bien souvent, dit-elle en guise de réponse, que les hommes ne mettent guère en pratique les beaux sentiments dont ils font si volontiers parade.Auteur : Léon Tolstoï - Source : Anna Karénine (1873-1877)
- La vie n'est qu'une ombre qui passe, un pauvre acteur
Qui s'agite et parade une heure, sur la scène,
Puis on ne l'entend plus. C'est un récit
Plein de bruit, de fureur, qu'un idiot raconte
Et qui n'a pas de sens.Auteur : William Shakespeare - Source : Macbeth (1605) - Toute oeuvre vivante comporte sa propre parade.Auteur : Jean Cocteau - Source : Les Mariés de la Tour Eiffel, Préface
Les mots proches de « parade »
Par Par (de) Par- ou para- Parabolain Parabole Parabole Parabolique Parabolique Paracel Paracelsiser Paracelsisme Paracentèse Paracentral, ale Parachevable Parachèvement Parachever Parachronisme Parachute Paraclet Paracmastique Parade Parader Paradis Paradisier Paradoxal, ale Paradoxalement Paradoxe Paradoxer Paradoxologie Parafe ou paraphe Parafé, ée, ou paraphé, ée Parafer ou parapher Paraffinage Paraffine Paraffiné, ée Paraffiner Parage Parage Parage Paragraisse Paragraphe Paraguante Paraiso Paraison Paraître Parajour Paralipomènes Parallactiquement Parallaxe ParallèleLes mots débutant par par Les mots débutant par pa
par par par mégarde par-ci par-dedans par-delà par-derrière par-dessous par-dessus par-devant par-devers para para para-humain parabellum parabellums parabole paraboles parabolique paraboliquement paraboliques paraboloïde paracétamol parachevaient parachevait parachevant parachevé parachèvement parachèvent parachever parachèvera parachèveraient parachevèrent parachutage parachutages parachute parachute parachuté parachutée parachutées parachutent parachuter parachuterais parachutèrent parachuterons parachutes parachutes parachutés parachutez parachutisme
Les synonymes de « parade»
Les synonymes de paradé :- 1. box
- 1. frime
2. esbroufe
3. tromperie
4. vantardise
5. bluffe
6. bonimente
7. crâne
8. fanfaronne
9. ostentation
10. étalage
11. montre
12. apparat
13. gloriole
synonymes de paradé
Fréquence et usage du mot paradé dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « parade » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot paradé dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Paradé ?
Citations paradé Citation sur paradé Poèmes paradé Proverbes paradé Rime avec paradé Définition de paradé
Définition de paradé présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot paradé sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot paradé notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 6 lettres.
