Définition de « temporel »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot temporel de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur temporel pour aider à enrichir la compréhension du mot Temporel et répondre à la question quelle est la définition de temporel ?
Une définition simple : (fr-accord-el|t??.p?.?) temporel
Expression : pouvoir temporel : pouvoir des papes comme souverains de Rome et des états pontificaux.
Approchant : intemporel, temporiser, temporellement, temps
Définitions de « temporel »
Trésor de la Langue Française informatisé
TEMPOREL, -ELLE, adj.
Wiktionnaire
Nom commun - français
temporel \t??.p?.??l\ masculin
-
(Religion) (Vieilli) Revenu qu'un ecclésiastique tirait de son bénéfice, de ses fonctions.
- Rambervillers dépendait du temporel de l'évêché de Metz, et les évêques en étaient les suzerains. ? (Gustave Fraipont, Les Vosges, 1923)
-
(Vieilli) Puissance des rois.
- [?]; il n'est que trop vrai que mille autres docteurs et religieux ont enseigné la doctrine du pouvoir de l'Église sur le temporel des rois ; [?]. ? (Jean le Rond d'Alembert, La Suppression des jésuites (éd. populaire abrégée), Édouard Cornély, 1888)
- Ce qui concerne les choses pratiques de la vie.
- Ce nouvel enseignement me semble d'autant plus grave qu'il s'adresse à une humanité qui, de son propre chef, se pose aujourd'hui dans le temporel avec une décision inconnue jusqu'à ce jour. ? (Julien Benda, La trahison des clercs : Avant-propos de la première édition, 1927, édition 1946)
- Ce qui ne relève pas de la religion, voire de la spiritualité, dans la société.
- Depuis 1950, dans Cité libre, Blain s'est fait le dénonciateur du cléricalisme, de la « confusion capitale » du spirituel et du temporel. ? (Yvan Lamonde, Émonder et sauver l'arbre, Montréal, Leméac, 2021, p. 71)
Adjectif - français
temporel \t??.p?.??l\
- Relatif au temps.
- De même les infortunés chrononautes de Temps mort (G. Langelaan) vieillissent en quelques minutes de plusieurs dizaines d'années : tel est le risque d'accident temporel qui attend les pionniers de l'espace-temps. ? (Temps libre, vol. 7 & 8, Éditions Denoël, 1983, page 27)
- Qui passe avec le temps, périssable.
- Les biens temporels ne doivent pas être comparés à ceux de l'éternité.
- Il ne faut pas préférer les biens temporels aux spirituels.
-
(Religion) Qui est séculier ; qui concerne les choses matérielles.
- Il y a encore un moyen de satisfaire à Dieu, qui consiste à gagner les indulgences. Les indulgences sont instituées pour relâcher la rigueur des peines temporelles dues au péché. ? (M. Gousset, Instructions sur le rituel, V.2, 3e édition, 1839, page 337)
- Les personnes vraiment pieuses doivent se faire un devoir de prier pour l'Église et d'honorer leur évêque ; elles doivent aussi prier pour l'avantage spirituel et temporel de l'État, et honorer leur Souverain. ? (Vies des saints pour tous les jours de l'année, note de bas de page 526, 1846)
- Toute différente était la situation dans le bled es-siba dont les tribus reconnaissaient généralement le sultan comme chef spirituel, mais ils n'admettaient pas sa souveraineté temporelle et ne toléraient chez elles aucun des rouages de l'administration chérifienne. ? (Frédéric Weisgerber, Au seuil du Maroc Moderne, Institut des Hautes Études Marocaines, Rabat : Les éditions de la porte, 1947, page 41)
- Les musulmans, guidés par leurs ulémas, rejetaient purement et simplement comme illégitime un pouvoir temporel très présent pour eux. ? (Panayiotis Jerasimof Vatikiotis, L'Islam et l'État, 1987, traduction d'Odette Guitard, 1992, page 43)
- Peu de chefs religieux bénéficient d'une réputation aussi enviable que celle de Tenzin Gyasto, chef spirituel et temporel du Tibet bouddhiste, qui se fait aussi appeler Sa Sainteté le dalaï-lama. ? (Louis Dubé, La sagesse du dalaï-lama : Préceptes et pratique du bouddhisme tibétain, dans Le Québec sceptique, n° 66, été 2008, page 5)
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Qui passe avec le temps, périssable; il est opposé à Éternel et à Spirituel. Les biens temporels ne doivent pas être comparés à ceux de l'éternité. Il ne faut pas préférer les biens temporels aux spirituels. Il signifie aussi Qui est séculier, qui concerne les choses matérielles; il se dit par opposition à Ecclésiastique et à Spirituel. Puissance, juridiction temporelle. Le pouvoir temporel s'est dit du Pouvoir des Papes comme souverains de Rome et des États pontificaux.
TEMPOREL est aussi nom masculin et se disait du Revenu qu'un ecclésiastique tirait de son bénéfice, de ses fonctions. Il fut contraint par saisie de son temporel. Il se dit encore de la Puissance des rois. Les rois, quant au temporel, sont indépendants de la puissance spirituelle.
Littré
-
1Qui passe avec le temps, par opposition à éternel.
Les choses visibles sont temporelles, mais les invisibles sont éternelles
, Sacy, Bible, St Paul, 2e épît. aux Corinth. IV, 18.L'amour qui nous attache aux beautés éternelles N'étouffe pas en nous l'amour des temporelles
, Molière, Tart. III, 3.Les afflictions temporelles couvrent les biens éternels où elles conduisent?; les joies temporelles couvrent les maux éternels qu'elles causent
, Pascal, Lett. à Mlle de Roannez, 2.Il a renversé votre fortune temporelle, je le veux?; et, en le haïssant, vous renversez le fondement de votre salut éternel
, Massillon, Carême, Pardon.Les dévots n'aiment jamais tant Dieu que lorsqu'ils en ont obtenu leurs petites satisfactions temporelles
, Marivaux, Pays. parv. 5e partie.Il se dit aussi par opposition à spirituel.
Il [le sens spirituel des Écritures] a été couvert sous le temporel en la foule des passages, et a été découvert clairement en quelques-uns
, Pascal, Pens. XV, 7, édit. HAVET.Si ce peuple [les Juifs] encore infirme avait besoin d'être attiré par des promesses temporelles
, Bossuet, Hist. II, 4.Ce monde, c'est un royaume temporel où l'on ne connaît pas Jésus-Christ
, Massillon, Carême, Élus. -
2Séculier, par opposition à ecclésiastique.
Autrefois et les canons et les lois et les évêques et les empereurs concouraient ensemble à empêcher les ministres des autels de paraître, pour les affaires même temporelles, devant les juges de la terre
, Bossuet, le Tellier.On se venge sur elle [l'Eglise] de quelques-uns de ses ministres, trop hardis usurpateurs des droits temporels?; à son tour, la puissance temporelle a semblé vouloir tenir l'Église captive, et se récompenser de ses pertes sur Jésus-Christ même
, Bossuet, ib.Pepin délivre Rome, assiége Pavie, se rend maître de l'exarchat, et le donne, dit-on, au pape?; c'est le premier titre de la puissance temporelle du Saint-siége
, Voltaire, Ann. emp. Charlemagne, 755.Le pouvoir temporel, s'entend du pouvoir temporel du pape.
Père temporel, se disait, chez les capucins, d'une personne séculière que déléguait le pape pour administrer le produit des aumônes recueillies par ces moines mendiants et avoir soin de toutes leurs affaires.
-
3 S. m. Le temporel, les biens, l'avoir.
Le temporel ouvre la voie au spirituel, et c'est un des préparatifs les plus efficaces
, Bourdaloue, Exhort. Char. env. les nouv. cathol. t. I, p. 131.Ainsi, jouissant, pour le peu de jours qu'il me reste, des secours nécessaires pour le temporel
, Rousseau, Mém. au gouv. de Savoie. -
4Particulièrement, revenu qu'un ecclésiastique tire de son bénéfice.
Le roi lui saisit son temporel [au cardinal de Bouillon], et par famine l'obligea de revenir en France
, Saint-Simon, 279, 25.Philippe Auguste avait saisi le temporel de tout évêque assez mauvais Français pour obéir au pape
, Voltaire, M?urs, 50. -
5Autorité temporelle, séculière.
Son autorité spirituelle [du gouvernement romain] toujours un peu mêlée de temporel
, Voltaire, Louis XIV, 2.
HISTORIQUE
XIIe s. Par les biens temporaus
, Th. le mart. 85.
XIIIe s. Les unes [choses] qui sont temporels, lesqueles commencent et finissent
, Latini, Trésor, p. 21. Sainte eglise doit estre gardée des malfeteurs par l'espée temporel
, Beaumanoir, I, 38.
XIVe s. Homme est temporel, et, par soy, homme ou celle ydée est perpetuel
, Oresme, Éth. VI, 11.
XVe s. Il vit du labeur temporel
, Deschamps, Miroir de mariage, p. 125.
XVIe s. Nous voyons que tout ce qui est terrien et du monde, est temporel et mesme caduque
, Calvin, Instit. 381. Comme une ville estoit superieure à l'autre ou inferieure quant au temporel, aussi on lui assignoit son degré de preeminence quant au regime spirituel
, Calvin, ib. 971.
Encyclopédie, 1re édition
TEMPOREL, adj. & subst. se dit des biens & des possessions de la terre par opposition aux biens spirituels.
En certaines occasions on oblige les évêques & les autres bénéficiers à exécuter les lois du prince, sous peine de saisie de leur temporel.
Temporel des rois, en Théologie, signifie tant les terres ou possessions qui appartiennent aux souverains, que l'autorité avec laquelle ils gouvernent leurs peuples.
C'est une question vivement agitée dans les écoles que de savoir si le pape ou même l'Eglise ont un pouvoir, soit direct, soit indirect sur le temporel des rois, ou si ni l'un ni l'autre ne leur appartiennent en aucune maniere.
Tous les ultramontains prétendent que la puissance ecclésiastique a pour objet non-seulement le spirituel des états, & en conséquence ils accordent au pape, qu'ils regardent comme le seul principe & l'unique source de la jurisdiction spirituelle, le pouvoir de disposer de tous les biens terrestres, des royaumes-mêmes & des couronnes. Mais ils se partagent sur la nature de cette autorité. Les uns soutiennent qu'elle est directe, les autres se contentent d'enseigner qu'elle est indirecte.
Dire que l'Eglise & le pape ont un pouvoir direct sur le temporel des rois, c'est reconnoître qu'ils peuvent immédiatement l'un & l'autre, par la nature-même de la puissance dont Jesus-Christ leur a confié l'administration, dépouiller les hommes, même les rois de leurs dignités, de leurs charges & de leurs biens quand ils manquent à leur devoir, & que cette sévérité est nécessaire pour la tranquillité des royaumes. Bellarmin lui-même, quoique très-zélé pour les droits & pour les privileges des souverains pontifes, rejette cette doctrine & la combat avec force. Voyez son traité de roman. pontif. lib. V. c. j.
Avancer que l'Eglise & le pape en sa personne ont un pouvoir indirect sur le temporel des rois, c'est prétendre qu'ils sont l'un & l'autre en droit d'en disposer lorsqu'ils ne peuvent par des peines spirituelles ramener les pécheurs, & qu'ils jugent que l'infliction des peines corporelles est absolument nécessaire pour le bien de l'Eglise & pour le salut des ames. Telle est l'idée que Bellarmin lui-même donne de ce pouvoir indirect, dont il prend la défense avec vivacité dans l'ouvrage que nous venons de citer, liv. V. ch. vj.
Avant que de rapporter les raisons sur lesquelles Bellarmin fonde cette opinion, nous remarquerons qu'on en fixe ordinairement l'origine à Gregoire VII. qui vivoit dans le xj. siecle. « Ce pape, dit M. Fleury, né avec un grand courage, & élevé dans la discipline monastique la plus reguliere, avoit un zele ardent de purger l'Eglise des vices dont il la voyoit infectée ; mais dans un siecle si peu éclairé il n'avoit pas toutes les lumieres nécessaires pour régler son zele ; & prenant quelquefois de fausses lueurs pour des vérités solides, il en tiroit sans hésiter les plus dangereuses conséquences. Le plus grand mal, c'est qu'il voulut soutenir les peines spirituelles par les temporelles qui n'étoient pas de sa compétence..... Les papes avoient commencé plus de 200 ans auparavant à vouloir régler par autorité les droits des couronnes. Gregoire VII. suivit ces nouvelles maximes, & les poussa encore plus loin, prétendant que comme pape, il étoit en droit de déposer les souverains rebelles à l'Eglise. Il fonda cette prétention principalement sur l'excommunication. On doit éviter les excommuniés, n'avoir aucun commerce avec eux, ne pas même leur dire bon jour, suivant l'apôtre S. Jean. Donc un prince excommunié doit être abandonné de tout le monde ; il n'est plus permis de lui obéir, de recevoir ses ordres, de l'approcher ; il est exclu de toute société avec les chrétiens. Il est vrai que Grégoire VII. n'a jamais fait aucune décision sur ce point, Dieu ne l'a pas permis. Il n'a pas prononcé formellement dans aucun concile, ni par aucune décrétale, que le pape a droit de déposer les rois ; mais il l'a supposé pour constant, comme d'autres maximes aussi peu fondées qu'il croyoit certaines ; par exemple, que l'Eglise ayant droit de juger des choses spirituelles, elle avoit droit à plus forte raison de juger des temporelles ; que le moindre exorciste est au-dessus des empereurs, puisqu'il commande aux démons ; que la royauté est l'ouvrage du démon, fondé sur l'orgueil humain ; au-lieu que le sacerdoce est l'ouvrage de Dieu ; enfin, que le moindre chrétien vertueux est plus véritablement roi, qu'un roi criminel, parce que ce prince n'est plus un roi, mais un tyran. Maxime que Nicolas I. avoit avancée avant Gregoire VII. & qui semble avoir été tirée du livre apocryphe des constitutions apostoliques où elle se trouve expressément..... C'est sur ces fondemens que Gregoire VII. prétendoit en général que, suivant le bon ordre, c'étoit l'Eglise qui devoit distribuer les couronnes, & juger les souverains ; & en particulier il prétendoit que tous les princes chrétiens lui devoient prêter serment de fidélité, & lui payer tribut ». Discours sur l'histoire ecclésiastique, depuis l'an 600 jusqu'à l'an 1100, n°. xvij. & xviij.
Ces prétentions ont paru trop excessives aux théologiens ultramontains eux-mêmes ; ils se sont contentés de soutenir la puissance indirecte du pape sur le temporel des rois. Bellarmin appuie cette opinion de raisonnemens & de faits. Les principaux raisonnemens qu'il emploie se réduisent à ceux-ci. 1°. Que la puissance civile est soumise à la puissance temporelle, quand l'une & l'autre font partie de la république chrétienne ; & par conséquent que le prince spirituel doit dominer sur le prince temporel, & disposer de ses états pour le bien spirituel, par la raison que tout supérieur peut commander à son inférieur. 2°. Que la fin de la puissance temporelle est subordonnée à la fin de la puissance spirituelle, la fin de l'une étant la félicité temporelle des peuples, & l'autre ayant pour fin leur félicité éternelle ; d'où il conclut que la premiere doit être soumise & céder à la seconde. 3°. Que les rois & les pontifes, les clercs & les laïques ne font pas deux républiques ; mais une seule, un seul corps qui est l'Eglise. Or, ajoute-t-il, dans quelque corps que ce soit, les membres dépendent de quelque chef principal ; on convient que la puissance spirituelle ne dépend pas de la temporelle ; c'est donc celle-ci qui dépend de l'autre. 4°. Si l'administration temporelle empêche le bien spirituel, le prince est tenu de la changer, & l'Eglise a droit de l'y contraindre ; car elle doit avoir toute la puissance nécessaire pour procurer ce bien spirituel : or la puissance de disposer du temporel des rois est quelquefois nécessaire pour cet effet, autrement les princes impies pourroient impunément favoriser les hérétiques, renverser la religion, &c. 5°. Il n'est pas permis aux Chrétiens de tolerer un roi infidele ou hérétique, s'il s'efforce de pervertir ses sujets. Or, il n'appartient qu'au pape ou à l'Eglise de juger s'il abuse ainsi de sa puissance ; & par conséquent c'est au pape ou à l'Eglise à décider s'il doit être déposé ou reconnu pour légitime souverain. 6°. Quand les princes ou les rois se convertissent au christianisme, on ne les reçoit que sous la condition expresse ou tacite de se soumettre à Jesus-Christ, & de défendre sa religion ; on peut donc les priver de leurs états, s'ils manquent à la remplir. 7°. Quand Jesus-Christ a confié à S. Pierre & à ses successeurs le soin de son troupeau, il lui a accordé le pouvoir de le défendre contre les loups, c'est-à-dire les hérétiques & les infideles ; or la puissance temporelle est nécessaire à cet effet. 8°. Les princes séculiers exercent leur pouvoir sur des choses spirituelles en faisant des lois sur ce qui concerne le culte de Dieu, l'administration des sacremens, la décence du service divin ; l'Eglise peut donc également exercer sa puissance sur les choses temporelles lorsqu'elle le juge nécessaire pour la défense & la conservation de la religion.
Tous ces raisonnemens de Bellarmin, ou sont de purs sophismes qui supposent ce qui est en question, ou partent de principes évidemment faux. Car 1°. de ce que l'Eglise peut exercer sa jurisdiction spirituelle sur la personne des rois en tant que fideles, s'ensuit-il qu'elle ait quelqu'autorité sur eux en tant qu'ils sont rois ? Est-ce en cette qualité qu'ils lui sont inférieurs ? 2°. La fin que se propose chaque puissance est bien différente l'une de l'autre, leurs limites sont distinguées, & elles sont parfaitement indépendantes chacune dans son genre. 3°. L'Eglise n'est qu'un seul corps, mais auquel la puissance temporelle n'appartient pas ; le pouvoir que lui a confié Jesus-Christ est purement spirituel ; & comme l'empire ne doit point empiéter sur les droits du sacerdoce, le sacerdoce ne doit point usurper ceux de l'empire. 4°. L'Eglise a droit de contraindre les princes à procurer le bien de la religion, en employant les conseils, les exhortations, même les peines spirituelles si elles sont absolument nécessaires ; mais s'ensuit-il de-là qu'elle puisse les déposer & les priver de leurs états ? Sont-ce-là les armes qu'elle a employées contre les persécutions des empereurs payens ? 5°. On convient qu'il n'est pas permis de tolérer un prince impie & hérétique, c'est-à-dire de servir son impiété, de soutenir son erreur ; mais ces vices ne lui ôtent point sa souveraineté, & ne dispensent point ses sujets de l'obéissance qui lui est due quant au temporel ; les premiers fideles toléroient en ce sens les Nérons & les Dioclétiens ; non par foiblesse, comme le prétend Bellarmin, mais par principe de conscience, parce qu'ils étoient persuadés qu'en aucun cas la révolte n'est permise à des sujets. 6°. La condition que suppose Bellarmin dans la soumission des princes à l'Eglise, est une pure chimere : ils se soumettent aux peines spirituelles que l'Eglise peut décerner contre tous ses enfans, du nombre desquels sont les princes ; mais ils tiennent leur puissance temporelle immédiatement de Dieu ; c'est à lui seul qu'ils en sont comptables. 7°. Jesus-Christ n'a donné à S. Pierre & à ses successeurs, en qualité de chef de l'Eglise, que la puissance spirituelle pour préserver leur troupeau de la contagion de l'erreur. 8°. Les princes sont les protecteurs de l'Eglise & ses défenseurs ; mais ils n'ont pas pour cela de pouvoir sur le spirituel ; l'Eglise n'en a donc pas davantage sur leur temporel, quoiqu'elle fasse des lois contre ceux qui refusent d'obéir à leurs légitimes souverains.
Le même auteur accumule différens faits, tels que la conduite de S. Ambroise à l'égard de Théodose ; le privilege accordé par S. Grégoire le grand au monastere de S. Médard de Soissons ; l'exemple de Grégoire II. qui défendit aux peuples d'Italie de payer les tributs accoutumés à l'empereur Léon, surnommé Brise-images, que ce pontife avoit excommunié ; la déposition de Childeric, de Wamba roi des Goths, des empereurs Louis le Débonnaire & Henri IV. Frédéric II. & Louis de Baviere, &c. mais tous ces faits ne concluent rien, parce que ce sont autant d'usurpations manifestes de la puissance pontificale sur l'autorité temporelle ; d'ailleurs Bellarmin les rapporte souvent d'une maniere infidele, contraire à la narration des auteurs contemporains ; il les tourne à l'avantage de sa cause d'une maniere qui toute subtile qu'elle est, fait peu d'honneur ou à son jugement, ou à sa bonne foi. Consultez sur ces faits la défense de la déclaration du clergé par M. Bossuet, & imprimée en 1728.
L'église gallicane qui dans tous les siecles ne s'est pas moins distinguée par sa vénération envers le saint-siege, que par sa fidélité pour les souverains, s'est constamment opposée à cette doctrine des ultramontains ; ses théologiens établissent le sentiment contraire sur les autorités les plus respectables, & sur les raisonnemens les plus solides. Les premier principe dont ils partent, est que la puissance que Jesus-Christ a donnée à ses apôtres & à leurs successeurs, est une puissance purement spirituelle, & qui ne se rapporte qu'au salut éternel. En effet, les ministres de la religion n'ont, en vertu de l'institution divine, d'autre autorité que celle dont Jesus-Christ-même étoit dépositaire en qualité de médiateur : Comme mon Pere m'a envoyé, leur dit-il, je vous envoie aussi de même. Joan. xx. 21. Or le Sauveur du monde, considéré comme médiateur, n'avoit aucun pouvoir sur le temporel des princes. Ses discours & ses actions concourent à le démontrer. Interrogé par Pilate s'il est vrai qu'il se croit roi des Juifs, il proteste qu'il n'a aucun pouvoir sur le temporel des rois, qu'il ne vient pas pour détruire les états des princes de la terre : mon royaume, répond-il, n'est point de ce monde ; si mon royaume étoit de ce monde, mes sujets combattroient pour empêcher qu'on ne me livrât aux Juifs : mais mon royaume n'est point d'ici, ibid. 36. Le magistrat romain insiste, vous êtes donc roi, ibid. 87. oui, lui dit Jesus-Christ, vous le dites, je suis roi, c'est pour cela que je suis nè, & que je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Pouvoit-il marquer plus précisément que sa royauté ne s'étendoit que sur des choses spirituelles, qu'il étoit roi d'un royaume tout divin & tout céleste que son Pere alloit former par sa prédication & par celle de ses apôtres dans tout l'univers. Lui-même pendant sa vie mortelle se soumet à l'empire des Césars, & leur paye le tribut. Si le peuple, épris de ses miracles, veut le faire roi, il prend la fuite pour se soustraire à leurs sollicitations. Un homme lui propose d'être arbitre entre son frere & lui au sujet d'une succession qui lui étoit échue, il lui répond que ce n'est point à lui à juger des choses temporelles, qu'il s'adresse à ceux qui ont ce pouvoir : O homme, qui m'a établi pour vous juger, & pour faire vos partages ? Luc. xij. 14. Il recommande également l'obéissance qu'on doit aux Césars, comme celle qu'on doit à Dieu.
Mais, dira-t-on, si Jesus-Christ n'a pas lui-même exercé cette puissance, peut-être l'a-t-il accordée à ses apôtres, c'est ce dont on ne trouve nulle trace dans l'Ecriture ; toute la puissance que Jesus-Christ accorde à ses apôtres, se réduit au pouvoir d'annoncer l'Evangile, de baptiser, de lier ou de délier les péchés, de consacrer l'Eucharistie, d'ordonner les ministres ; en un mot, de conférer tous les sacremens, de lancer l'excommunication, ou d'infliger d'autres peines canoniques contre ceux qui se révolteroient contre les lois de l'Eglise ; enfin il leur déclare expressément que leur ministere est un ministere de paix, de charité, de douceur, de persuasion, qu'il n'a rien de commun avec la domination que les princes temporels exercent sur leurs sujets. Reges gentium dominantur eorum, vos autem non sic. Luc. xvij. 25.
Leur second principe est que l'Eglise ne peut changer ni détruire ce qui est de droit divin. Or telle est d'une part la puissance des souverains sur leurs peuples, & d'une autre l'obeissance que les peuples doivent à leurs souverains. Ces deux vérités se trouvent également établies par ces paroles de S. Paul : toute personne vivante doit être soumise aux puissances souveraines ; car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, & celles qui sont, sont ordonnées de Dieu ; ainsi qui résiste à la puissance, résiste à l'ordre de Dieu. Rom. xiij. 1. La seconde ne l'est pas moins évidemment par ce que dit S. Pierre : soyez soumis à toute créature humaine à cause de Dieu, soit au roi comme au plus excellent, soit aux chefs comme envoyés par ses ordres, & dépositaires de son autorité. Epît. I. c. ij. 13. C'étoit de Néron & des empereurs payens que les apôtres parloient de la sorte. Si la révolte eût jamais pû être colorée de quelque prétexte, c'eût été sans doute de celui de défendre la religion contre ses persécuteurs ; mais les premiers fideles ne surent jamais qu'obéir & mourir.
La tradition n'est pas moins formelle sur ce point que l'Ecriture. Tous les docteurs de l'Eglise enseignent 1°. que la puissance séculiere vient immédiament de Dieu, & ne dépend que de lui seul. Christianus, disoit Tertullien, nullius est hostis nedum imperatoris quem sciens à Deo suo constitui, necesse est ut & ipsum diligat & revereatur & honoret & salvum velit. Colimus ergo imperatorem sic quomodo & nobis licet, & ipsi expedit ut hominem à Deo secundum, & quidquid est à Deo consecutum & solo Deo minorem, lib. ad scapul. c. ij. Optat. l. III. contr. Parmenian. super imperatorem non est uni solus Deus qui fecit imperatorem ; & S. Augustin, lib. V. de civit. Dei, cap. xxj. non tribuamus dandi regni atque imperii potestatem, nisi Deo vero.
2°. Qu'on doit obéir aux princes, même quand ils abusent visiblement de leur puissance, & qu'il n'est jamais permis à leurs sujets de prendre les armes contre eux : Neque tunc, dit S. Augustin en parlant des persécutions des empereurs païens, civitas Christi adversus impios persecutores pro salute temporali pugnavit. Ligabantur, cedebantur, includebantur, urebantur, torquebantur..... non erat eis pro salute pugnare nisi salutem pro salvatore contemnere. de civit Dei, lib. II. cap. v. & sur le Ps. cxxiv. le même pere s'exprime ainsi : Julianus extitit infidelis imperator..... milites christiani servierunt imperatori infideli. Ubi veniebatur ad causam Christi non agnoscebant nisi illum qui in c?lo erat. Si quando volebat ut idola colerent, ut thurificarent, præponebant illi Deum : quando autem dicebat, producito aciem, ite contra illam gentem, statim obtemperabant. Distinguebant Dominum æternum à domino temporali, & tamen subditi erant propter Dominum æternum etiam domino temporali. S. Jérôme, S. Ambroise, S. Athanase, S. Grégoire de Nazianze, Tertullien & les autres apologistes de la religion tiennent le même langage.
3°. Que comme les princes ont reçu de Dieu le glaive matériel pour exercer la justice vindicative, & contenir les méchans ; l'Eglise n'a reçu qu'un glaive spirituel, pour exercer sa puissance sur les ames. Pacificos vult Christus esse suos discipulos, dit Origenes sur le chap. xvj. de S. Matthieu, ut bellicum gladium deponentes, alterum pacificum accipiant gladium quem dicit scriptura gladium spiritus : & S. Chrysostôme, rex habet arma sensibilia, sacerdos arma spiritualia.
Mais n'est-il pas permis au-moins à l'Eglise de se servir du glaive matériel, quand la religion est en péril & pour sa défense ? Voici ce qu'en pensoit Lactance : Non est opus vi & injuriâ, quia religio cogi non potest..... defendenda est non occidendo sed moriendo, non sævitiâ sed patientiâ, non scelere sed fide, lib. V. divin. institut.
Il est presqu'inconcevable qu'après une doctrine si fondée & si publique, il ait pû se trouver des théologiens qui ayent soutenu les prétentions des papes ou même de l'Eglise sur le temporel des rois : l'indépendance des deux puissances & leurs limites n'étoient-elles pas assez marquées ?
Les souverains pontifes eux-mêmes avoient reconnu cette vérité. « Il y a deux puissances, dit le pape Gélase I. écrivant à l'empereur Anastase, qui gouvernent le monde ; l'autorité des pontifes & la puissance royale.... sachez que quoique vous présidiez au genre humain dans les choses temporelles, vous devez cependant être soumis aux ministres de Dieu dans tout ce qui concerne la religion : car si les évêques se soumettent aux lois que vous faites touchant le temporel, parce qu'ils reconnoissent que vous avez reçu de Dieu le gouvernement de l'empire, avec quelle affection ne devez-vous pas obéir à ceux qui sont préposés pour l'administration des saints mysteres ? tome IV. des concil. ». Innocent III. cap. per venerabilem, dit expressément, que le roi de France ne reconnoît point de supérieur pour le temporel : & Clément V. déclare que la bulle unam sanctam de Boniface VIII. ne donne à l'Eglise romaine aucun nouveau droit sur le roi, ni sur le royaume de France. Dira-t-on que ces pontifes si éclairés ignoroient ou négligeoient leurs droits ?
La doctrine des ultramontains est donc diamétralement opposée à celle de l'Ecriture, des peres & des papes mêmes ; il y a plus, elle choque manifestement la raison en réduisant même leurs prétentions au pouvoir indirect. Car pour que ce pouvoir fût quelque chose de réel, il faudroit ou que le pouvoir des clés eût par lui-même la force de dépouiller immédiatement dans le cas de besoin non-seulement des biens célestes, mais encore des biens temporels ; ou que la privation des biens spirituels, effet immédiat & naturel du pouvoir des clés, emportât par sa nature, dans le cas de nécessité, la privation même des biens temporels. Or ni l'une ni l'autre de ces suppositions ne peut être admise. 1°. L'effet propre & unique du pouvoir des clés, même dans les circonstances les plus pressantes, se borne au dépouillement des biens spirituels. Si votre frere n'écoute pas l'Eglise, dit Jesus-Christ, Matth. xviij. vers. 17. qu'il soit à votre égard comme un païen & un publicain ; c'est-à-dire, ne le regardez plus comme une personne qui puisse vivre en société de religion avec vous, ne l'admettez ni aux prieres communes, ni à la participation des sacremens, ni à l'entrée de l'église, ni à la sépulture chrétienne. Voilà précisément à quoi se réduisent les effets les plus rigoureux de la puissance ecclésiastique. Les saints docteurs n'en ont jamais reconnu d'autres, & toutes les fois que cette séverité n'a point produit ce qu'on en espéroit, l'Eglise n'a eu recours qu'aux larmes, aux prieres & aux gémissemens. 2°. Il est faux que la privation juridique des biens spirituels emporte par sa propre efficace, dans le cas d'une nécessité pressante, le dépouillement des biens temporels. L'Eglise n'a jamais admis ce principe, & il est même impossible de le recevoir. Car la séverité plus rigoureuse de la puissance ecclésiastique ne peut s'étendre qu'au dépouillement des biens que l'on a comme fidele, & il est constant d'ailleurs qu'on ne possede pas les biens terrestres à titre de chrétien, mais à titre de citoyen, qualité qui ne donne aucun lieu à la jurisdiction ecclésiastique.
Enfin on regarde avec raison cette doctrine comme dangereuse, capable de troubler la tranquillité des états, & de renverser les fondemens de la société. En effet les conséquences de ces principes sont affreuses ; en les suivant, « un roi déposé n'est plus un roi, dit M. l'abbé Fleury ; donc s'il continue à se porter pour roi, c'est un tyran, c'est-à-dire un ennemi public, à qui tout homme doit courir sus. Qu'il se trouve un fanatique qui ayant lu dans Plutarque la vie de Timoléon ou de Brutus, se persuade que rien n'est plus glorieux que de délivrer sa patrie ; ou qui prenant de travers les exemples de l'Ecriture, se croye suscité comme Aod ou comme Judith, pour affranchir le peuple de Dieu. Voilà la vie de ce prétendu tyran exposée au caprice de ce visionnaire, qui croira faire une action héroïque & gagner la couronne du martyre Il n'y en a par malheur, continue cet écrivain, que trop d'exemples dans l'histoire des derniers siecles ». Dict. sur l'hist. ecclésiast. depuis l'an 600 jusqu'à l'an 1100, n°. 18.
C'est donc à juste titre que les plus célebres universités, & entre autres la faculté de Paris, & les églises les plus florissantes, telles que celle d'Allemagne, d'Angleterre & d'Espagne, ont proscrit cette doctrine comme dangereuse. De tout tems l'église gallicane l'a rejettée ou combattue, mais sur-tout par la fameuse déclaration du clergé en 1682, sur laquelle on peut consulter l'ouvrage de M. Dupin, & celui de M. Bossuet dont nous avons déja parlé.
Étymologie de « temporel »
Provenç. et espagn. temporal?; ital. temporale?; du lat. temporalis, de tempus, temps.
Mise à jour de la notice étymologique par le programme de recherche TLF-Étym :
Histoire :
A. 1. a./A. 2. a. adj. « qui concerne le monde matériel, aussi sous le point de vue de son caractère passager ». Attesté depuis ca 1174 (BenDucF, volume 2, page 113, vers 25860 : Noble vassal e conneü, Malement estes deceü, Qu'en teu dolor e en teu gerre E en teu paine estes d'aquerre Vivres et trespassables biens, Faus, temporaus e terriens, Por qu'os perdez les eternaus). Première attestation présentant le phonétisme moderne : fin du 12e siècle (SBernAn1F, page 6 = FEW : Certes li planteiz et li habondance des choses temporels avoit ameneit l'obliement et la besoigne des permenanz). -
A. 1. b./A. 2. b. ?./A. 2. b. ?./A. 2. b. ?. subst. masc. « ce qui concerne le monde matériel, aussi sous le point de vue de son caractère passager ». Attesté depuis ca 1350 (GilMuisK, volume 1, page 25, vers 24 : Vray Diex, je me suy delités Et mis me coer ou temporel [?] Car jou ay lonc temps travilliét, Par jour penét, par nuit villiét, Entendut a coses mundaines Qui sont, voir, et fausses et vaines, Au siecle qui ne vault pas maille, Ou quel on se piert et travaille). -
A. 2. b. ?. subst. masc. « revenu d'un bénéfice ecclésiastique ». Attesté depuis 1330 (TerroineFossier, volume 3, page 26 = FEW : et eussent promis chascun de eulz pour tant comme il li touchoit, c'est assavoir ledit escuier seur l'obligacion de tous ses biens meubles et nommeubles, et ledit curé sus l'obligacion de tout son temporel). -
B. adj. « qui a rapport au temps naturel ou aux temps verbaux » (grammaire). Attesté depuis 2e moitié 14e siècle (AalmaR, page 448, n° 13453 : umquam : aucune foiz. adverbez temporel). Première attestation lexicographique : 1680 (Richelet 1680 : Augment, s.m. Terme de Grammaire Gréque. Augmentation de quantité, ou de lettres qui se fait au commencement du verbe en certains tems. [Augment sillabique, augment temporel.]). Les attestations connues entre le 14e et le 17e siècle sont très peu nombreuses (1540 [Dolet, Maniere, page 27, in Frantext] ; 1550 [Meigret, Traité, page 26, § 21]), mais elles ne donnent pas l'impression d'une rupture de tradition. -
D. adj. « qui est relatif au concept du temps opposé à celui de l'espace » (philosophie). Attesté depuis av. 1888 (Guyau, Genèse, page 11 = Larousse3 : La représentation des événements dans leur ordre temporel, nous venons de le voir, est une acquisition plus tardive que la représentation des objets dans leur ordre spatial). -
C. adj. « qui concerne la durée » (musique, métrique). Attesté depuis 1891 [et non pas 1889 comme il est dit supra] (Paléographie musicale tome 2, page 50). -
Origine :
A. 1. a./A. 2. a./B. Transfert linguistique : emprunt au latin temporalis adj. « qui relève du monde matériel, de la finitude de la vie humaine » (attesté depuis Apulée, OLD) (ci?dessus A. 1. a. et A. 2. a.) ; « qui a rapport au temps » (attesté depuis Varron, OLD) (ci?dessus B.). Cf. von Wartburg in FEW 13/1, 181a, temporalis II ; Städtler, Grammatiksprache 290.
A. 1. b./A. 2. b. ?./A. 2. b. ?./A. 2. b. ?. Formations françaises : transcatégorisation de l'adjectif ci?dessus.
A. 2. b. ?. Transfert linguistique : emprunt au latin médiéval temporalia subst. neutre plur. « biens ou revenus matériels affectés à la dotation d'un bénéfice ecclésiastique » (attesté depuis 1112, Niermeyer2).
C./D. Formations françaises : issu par évolution sémantique de l'adjectif ci?dessus.
Rédaction TLF 1994 : Évelyne Bourion. - Mise à jour 2008 : Melanie Lang ; Thomas Städtler.. - Relecture mise à jour 2008 : Gilles Roques ; Éva Buchi ; Nadine Steinfeld ; Gilles Petrequin.
temporel au Scrabble
Le mot temporel vaut 11 points au Scrabble.
Informations sur le mot temporel - 8 lettres, 3 voyelles, 5 consonnes, 7 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot temporel au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
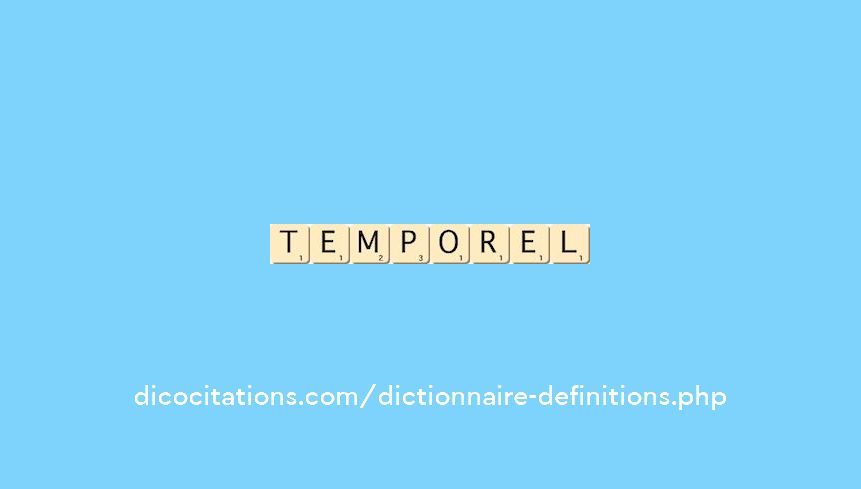
Les rimes de « temporel »
On recherche une rime en EL .
Les rimes de temporel peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en El
Rimes de marcel Rimes de ridelles Rimes de personnelles Rimes de bagatelle Rimes de artificiels Rimes de potentiel Rimes de officiel Rimes de l Rimes de duquel Rimes de nivellent Rimes de radicelles Rimes de pétrel Rimes de officielles Rimes de antisexuel Rimes de conventionnel Rimes de démantèlent Rimes de Nouvelles Rimes de Poppel Rimes de traditionnelle Rimes de Duffel Rimes de top-modèle Rimes de homosexuels Rimes de zèle Rimes de interministériels Rimes de noel Rimes de citadelles Rimes de Lommel Rimes de javel Rimes de Dudzele Rimes de bretelle Rimes de télévisuelle Rimes de personnelle Rimes de Oudekapelle Rimes de consubstantielle Rimes de logiciel Rimes de telle Rimes de rondelles Rimes de marelles Rimes de celle Rimes de violoncelles Rimes de adèle Rimes de sempiternels Rimes de ruissellent Rimes de traditionnelles Rimes de tarentelles Rimes de abel Rimes de grêlent Rimes de christelle Rimes de confidentiels Rimes de bêlentMots du jour
marcel ridelles personnelles bagatelle artificiels potentiel officiel l duquel nivellent radicelles pétrel officielles antisexuel conventionnel démantèlent Nouvelles Poppel traditionnelle Duffel top-modèle homosexuels zèle interministériels noel citadelles Lommel javel Dudzele bretelle télévisuelle personnelle Oudekapelle consubstantielle logiciel telle rondelles marelles celle violoncelles adèle sempiternels ruissellent traditionnelles tarentelles abel grêlent christelle confidentiels bêlent
Les citations sur « temporel »
- A peine peuvent-ils souffrir que l'Eglise soit dans l'éclat où elle est maintenant; ils voudraient qu'elle fût aussi dépendante des puissances temporelles, aussi pauvre et aussi abjecte qu'elle l'était du temps des premiers Césars.Auteur : Louis Bourdaloue - Source : Sermons pour les dimanches, tome IV
- Qui n'a la paix temporelle,
A peine a la spirituelle.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe - Bip est un personnage intemporel, tout en étant proche de mes rêves d'enfants. Il se cogne à la vie qui est à la fois un grand cirque et un grand mystère, et j'aime à dire qu'il finit toujours vaincu, mais toujours vainqueur... Auteur : Marcel Marceau - Source : Entretien avec François-Brice Hincker, « Marcel Marceau : L'humaniste du silence », Saisons d'Alsace, 2003
- Il laissa peu de terre et d'or en héritage
Et point d'enfants non plus luttant pour le partage,
Mais ce qui vaut cent fois quelque bien temporel,
Il laissa de sa vie un renom immortel.Auteur : János Arany - Source : Toldi (1846, 1848 et 1879), Chant XII - « Il faut que tu partes, maintenant », dit-elle, et elle se leva, se dirigea vers la salle de bains puis ferma la porte derrière elle.
Coeur brisé, Ô merveille intemporelle Quel petit espace où être.Auteur : Michael Ondaatje - Source : La Table des autres (2012) - Le propre de la pensée sauvage est d'être intemporelle.Auteur : Claude Lévi-Strauss - Source : La Pensée sauvage
- C'est cela le travail du cinéma, de nous montrer l'inachevé dans le temporel, l'infini dans l'éphémère.Auteur : J. M. G. Le Clézio - Source : Ballaciner (2007)
- La mort est l'aspect temporel de l'éternité.Auteur : Gustave Thibon - Source : L'ignorance étoilée (1974)
- Nous serons temporels jusqu'aux os.Auteur : Paul Nizan - Source : Les Chiens de garde
- Je n'ai plus mes yeux d'enfant, mais c'est toujours avec l'innocente naïveté de l'enfance que je perçois la magie des couleurs au football, le vert immémorial du gazon et les maillots des joueurs, les couleurs intemporelles des équipes nationales, le bleu de la France ou de l'Italie, le rouge de l'Espagne, l'orange des Pays-Bas, sans compter le maillot rayé bleu ciel et blanc de l'Argentine. Auteur : Jean-Philippe Toussaint - Source : Football (2015)
- Bip est un personnage intemporel, tout en étant proche de mes rêves d'enfants. Il se cogne à la vie qui est à la fois un grand cirque et un grand mystère, et j'aime à dire qu'il finit toujours vaincu, mais toujours vainqueur... Il est tout ensemble l'homme de la rue, un vagabond du quotidien et l'homme universel affrontant le tragi-comique de l'existence… Il est l'homme tout simplement, se montrant dans la nudité et la fragilité de son être. Auteur : Marcel Marceau - Source : Entretien avec François-Brice Hincker, « Marcel Marceau : L'humaniste du silence », Saisons d'Alsace, 2003
- La malchance est le produit du hasard; c'est l'expression de la volonté du sort - sur laquelle, nous-mêmes issus du hasard et misérables prétextes d'un échec temporel, nous n'avons aucune prise.Auteur : Emil Cioran - Source : Bréviaire des vaincus II (2011)
- C’est un spectacle admirable que (celui que) donnent tant de professeurs de l’enseignement secondaire, (…) exposés à tout, sacrifiant tout, luttant contre tout, résistant à tout pour défendre leurs classes. Luttant contre tous les pouvoirs, les autorités temporelles, les puissances constituées. Contre les familles, ces électeurs, contre l’opinion ; contre le proviseur, qui suit les familles, qui suivent l’opinion ; contre les parents des élèves ; contre le proviseur, le censeur, l’inspecteur d’académie, le recteur de l’académie, l’inspecteur général, le directeur de l’enseignement secondaire, le ministre, les députés, toute la machine, toute la hiérarchie, contre les hommes politiques, contre leur avenir, contre leur carrière, contre leur (propre) avancement ; littéralement contre leur pain. Contre leurs chefs, contre leurs maîtres, contre l’administration, la grande Administration, contre leurs supérieurs hiérarchiques, contre leurs défenseurs naturels, contre ceux qui naturellement devraient les défendre. Et qui les abandonnent au contraire. Quand ils ne les trahissent pas. Contre tous leurs propres intérêts. Contre tout le gouvernement, notamment contre le plus redoutable de tous, le gouvernement de l’opinion.Auteur : Charles Péguy - Source : Notre jeunesse (1910)
- La sainteté est le fait de l'individu solitaire et sans pouvoir temporel.Auteur : Michel Tournier - Source : Le Roi des Aulnes (1970)
- La civilisation, c'est la culture de tout ce que le christianisme appelle vice, frivolité, plaisirs, jeux, affaires et choses temporelles, biens de ce monde, etc.Auteur : Remy de Gourmont - Source : Promenades philosophiques (1904-1928)
- La tragédie de l'amour tient à ce qu'il n'échappe pas à la dimension temporelle. Quand on partage la vie d'un être aimé, il y a une cruauté toute spéciale à constater combien nos anciennes amours nous sont devenues indifférentes.Auteur : Alain de Botton - Source : Petite philosophie de l'amour (1994)
- Je suis persuadé que les écrivains du futur assureront la relève comme l'a fait chaque génération depuis Homère car, l'écrivain exprime toujours dans ses oeuvres quelque chose d'intemporel.Auteur : Patrick Modiano - Source : Discours de réception du prix Nobel de littérature, 7 décembre 2014
- Ici et maintenant délimitent l'instance spatiale et temporelle coextensive et contemporaine de la présente instance du discours contenant je.Auteur : Emile Benveniste - Source : Problèmes de linguistique générale (1966)
- Les débats entre la puissance temporelle et la puissance spirituelle, finissent par une guerre à mort.Auteur : Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes - Source : Pensées et Maximes
- Un des premiers symptômes du déphasage temporel est une propension à un sentimentalisme larmoyant digne d'un irlandais ivre ou d'un poète victorien à jeun.Auteur : Connie Willis - Source : Sans parler du chien (2000)
- Un écrivain, quelle que soit la manière dont il écrit, est universel et intemporel quand il réussit à toucher notre humanité : peu importe alors l'époque où il a vécu !Auteur : Frank Andriat - Source : Je voudrais que tu... (2011)
- Il me semblait que ma vie entière se composait de ces fractions temporelles disjointes à traîner dans un endroit public après l'autre, comme si j'attendais des trains qui n'arriveraient jamais. Auteur : Donna Tartt - Source : Le Maître des illusions (1991)
- La science a été longue à prendre en compte des explications de type historique - et les interprétations formulées jusqu'ici ont souffert de cette omission. Elle a aussi tendu à dénigrer l'histoire lorsqu'elle y a été confrontée, considérant toute invocation de la contingence comme moins élégantes basées directement sur des "lois de la nature" intemporelles.Auteur : Stephen Jay Gould - Source : La vie est belle (1989), Stephen Jay Gould, éd. Points, 1998
- L'intemporel non plus n'est pas éternel.Auteur : André Malraux - Source : Sans référence
- Ceux qui me lisent savent ma conviction que le monde, le monde temporel, repose qur quelques idées très simples : si simples qu'elles doivent être vieilles comme le monde. Il repose notamment sur l'idée de Fidélité.Auteur : Joseph Conrad - Source : Souvenirs personnels (1912), Préface
Les mots proches de « temporel »
Tembo Téménos Téméraire Témérairement Témérité Témoignage Témoigner Témoin Tempe Tempé Tempérament Tempérance Tempérant, ante Tempérantisme Température Tempéré, ée Tempérément Tempérer Tempête Tempêtement Tempêter Tempêteur Tempêtueusement Tempêtueux, euse Temple Templier Temporaire Temporal, ale Temporalité Temporel, elle Temporellement Temporisateur, trice Temporisement Temporiser Temporiseur TempsLes mots débutant par tem Les mots débutant par te
tem téméraire témérairement téméraires témérité témérités témoigna témoignage témoignages témoignaient témoignais témoignait témoignant témoignât témoigne témoigné témoignée témoignées témoignent témoigner témoignera témoignerai témoigneraient témoignerais témoignerait témoigneras témoignèrent témoignerez témoigneront témoignes témoignés témoignez témoigniez témoin témoin-clé témoin-vedette témoins témoins-clés tempe tempera tempéra tempéraient tempérait tempérament tempéraments tempérance température températures tempère tempéré
Les synonymes de « temporel»
Les synonymes de temporel :- 1. temporel
2. séculier
- 1. profane
2. laïque
3. novice
4. ignorant
5. séculier
6. laïc
7. spatio
synonymes de temporel
Fréquence et usage du mot temporel dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « temporel » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot temporel dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Temporel ?
Citations temporel Citation sur temporel Poèmes temporel Proverbes temporel Rime avec temporel Définition de temporel
Définition de temporel présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot temporel sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot temporel notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 8 lettres.
