Définition de « tempérament »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot temperament de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur tempérament pour aider à enrichir la compréhension du mot Tempérament et répondre à la question quelle est la définition de temperament ?
Une définition simple : tempérament (m)
Définitions de « tempérament »
Trésor de la Langue Française informatisé
TEMPÉRAMENT subst. masc.
Wiktionnaire
Nom commun - français
tempérament \t??.pe.?a.m??\ masculin
-
Complexion, constitution du corps, en parlant des personnes, voire des animaux.
- Quoique La Brière fût alors mince, il appartient à ce genre de tempéraments qui, formés tard, prennent à trente ans un embonpoint inattendu. ? (Honoré de Balzac, Modeste Mignon, 1844)
- Quelle différence, en effet, entre le cheval arabe léger, vif, sanguin, et les gros chevaux du Danemarck, du Hanovre, de la Hollande et de la Normandie aux formes lourdes et empâtées et au tempérament essentiellement lymphatique. ? (Jean Déhès, Essai sur l'amélioration des races chevalines de la France, École impériale vétérinaire de Toulouse, Thèse de médecine vétérinaire, 1868)
- Tempérament bilieux, sanguin, lymphatique, nerveux.
-
Caractère ; disposition mentale. ? Note : On y joint une épithète qui qualifie ce caractère.
- [?]; sans doute, ils ont, eux aussi, certains du moins, des ascendants névrosiques, mais la mysophobie atteint le plus souvent des gens minutieux ou méticuleux par tempérament, par exemple, des vieilles filles ou des garçons âgés, célibataires. ? (Édouard Gélineau, Des peurs maladives ou phobies, Paris : Société d'éditions scientifiques, 1894, p. 92)
- Là encore mes amis, vous avez fait de l'excellente besogne et vous l'avez faite sans bruit, sans flafla, comme toujours, avec cette application silencieuse qui est dans le tempérament marin, très réservé de sa nature. ? (Charles Le Goffic, Bourguignottes et pompons rouges, 1916, p.75)
- Se venger, les tuer?! La violence naturelle à son tempérament sanguin lui dicta les pires conseils. ? (Louis Pergaud, La Vengeance du père Jourgeot, dans Les Rustiques, nouvelles villageoises, 1921)
- L'allégresse qu'ils semaient le long de la route affectait diversement, et selon leurs tempéraments, les autres excursionnistes. ? (H. G. Wells, La Guerre dans les airs, 1908, traduction d'Henry-D. Davray et B. Kozakiewicz, Mercure de France, Paris, 1910, page 55 de l'édition de 1921)
- Il y avait de quoi désespérer ou attaquer ces misogynes qui niaient aux femmes le droit d'écrire et de défendre leurs talents selon leur propre tempérament. ? (Michel Peyramaure, L'ange de la paix: Le roman d'Olympe de Gouges, éd. Robert Laffont, 2008)
- Action de tempérer, adoucissement qu'on propose pour concilier les esprits et pour accommoder les affaires.
- Proposer divers tempéraments pour concilier des intérêts opposés.
- Il faut essayer de trouver un tempérament à cela.
- Pour le duc de La Rochefoucauld..., qui ne connaît pas de tempérament à la perversité humaine, il n'existe pas de véritable amitié. Aussi écoutons-le : "Ce que les hommes ont nommé « amitié » n'est qu'une société, qu'un mesnagement réciproque d'interests et qu'un eschange de bons offices". ? (Madame de Sablé, Maximes, préface de l'éditeur Damase Jouaust, 1870)
- Dans leur désir de conserver leur privilège d'amodiateurs des chaumes, les habitants du Val Saint-Grégoire accédèrent ensuite à de successifs tempéraments. ? (Pierre Boyé, Les Hautes-Chaumes des Vosges, Rencontres transvosgiennes, 2019, ISBN 978-2-9568226-0-8)
- (Droit) Limitation, atténuation ou assouplissement d'une loi ou d'une norme.
-
(Musique) Altération légère qu'on fait subir aux demi-tons chromatiques et aux demi-tons diatoniques pour les unifier et pour qu'ils puissent être rendus par la même corde, par la même touche d'un instrument.
- Au moyen du tempérament, le ré dièse et le mi bémol sont rendus par la même corde du piano.
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Complexion, constitution du corps; il ne se dit guère qu'en parlant des Personnes. Être d'un tempérament fort et robuste, d'un tempérament faible et délicat. Tempérament bilieux, sanguin, lymphatique, nerveux. Absolument, Avoir du tempérament, Être très porté à l'amour physique. Fig., Avoir le tempérament oratoire, Avoir des dispositions naturelles à l'éloquence.
TEMPÉRAMENT se dit aussi du Caractère, en y joignant une épithète. Un tempérament violent. Il se dit encore des Expédients et des adoucissements qu'on propose pour concilier les esprits et pour accommoder les affaires. Proposer divers tempéraments pour concilier des intérêts opposés. Il faut essayer de trouver un tempérament à cela. En termes de Commerce, Acheter à tempérament, Acheter avec la facilité de payer par acomptes, à des époques déterminées.
TEMPÉRAMENT, en termes de Musique, se dit d'une Altération légère qu'on fait subir aux demi-tons chromatiques et aux demi-tons diatoniques pour les unifier et pour qu'ils puissent être rendus par la même corde, par la même touche d'un instrument. Au moyen du tempérament, le ré dièse et le mi bémol sont rendus par la même corde du piano.
Littré
-
1Mode de composition et de mélange.
On ne saurait répondre précisément à cette question?: à quelle hauteur les pompes élèvent l'eau à Paris, si l'on ne détermine aussi le tempérament de l'air [s'il est chargé de vapeurs ou non]
, Pascal, Pesant. de l'air, VII.Absolument. Juste mélange.
La santé du corps consiste dans le tempérament des humeurs
, Bourdaloue, Pensées, t. I, p. 383. -
2 Particulièrement. Constitution physique du corps humain, ou, en langage technique, résultat général, pour l'organisme, de la prédominance d'action d'un organe ou d'un système. Tempérament bilieux. Tempérament sanguin. Tempérament lymphatique. Tempérament nerveux.
La vanité, la honte, et surtout le tempérament font souvent la valeur des hommes et la vertu des femmes
, La Rochefoucauld, Max. 220.Quelle journée?! quelle amertume?! quelle séparation?! vous pleurâtes, ma très chère, et c'est une affaire pour vous?; ce n'est pas la même chose pour moi, c'est mon tempérament
, Sévigné, 11 juin 1677.Elle [la mère de M. de Montausier] ne souffrit pas en lui ces délicatesses qui affaiblissent le tempérament et la vigueur du corps et de l'âme
, Fléchier, Duc de Mont.Bon?! ce sont de plaisants sages que ceux qui le sont par tempérament
, Fontenelle, Sén. et Scarr.Que sais-je si la disposition même de votre tempérament ne vous laisse rien à craindre là-dessus?; si vous ne portez pas déjà la mort dans le sein??
Massillon, Carême, Impén.Il n'y a guère à compter que sur les vertus du tempérament?; confiez votre vin plutôt à celui qui ne l'aime pas naturellement, qu'à celui qui forme tous les jours de nouvelles résolutions de ne pas s'enivrer
, Dumarsais, ?uv. t. VI, p. 33.Pierre le Grand avait une taille haute, dégagée, bien formée, le visage noble, des yeux animés, un tempérament robuste, propre à tous les exercices et à tous les travaux
, Voltaire, Russie, I, 6.Le tempérament du roi [Philippe V] lui rendait une femme nécessaire, et sa dévotion ne lui permettait aucune infidélité
, Duclos, ?uv. t. VI, p. 108.La différence des tempéraments dépend surtout de celle des centres de sensibilité, des rapports de force ou de faiblesse et des communications sympathiques des divers organes
, Cabanis, Instit. Mém. sc. mor. et pol. t. I, p. 80.Fig.
L'État romain, constitué de la manière que nous avons vue, était, pour ainsi parler, du tempérament qui devait être le plus fécond en héros
, Bossuet, Hist. III, 6.Il peut se dire des animaux.
Chez les animaux, le tempérament règle tout?; chez l'homme, la raison règle le tempérament, et le tempérament réglé facilite, à son tour, l'exercice de la raison
, Bonnet, Contempl. nat. v, 5.La Fontaine l'a dit d'un arbre, transformé en personnage parlant?:
Que ne l'émondait-on, sans prendre la cognée [pour l'abattre]?? De son tempérament il eût encore vécu
, La Fontaine, Fabl. x, 1.Absolument. Avoir du tempérament, être porté au plaisir physique de l'amour.
Les neuf bégueules savantes Avec leurs têtes de pédantes Avaient peu de tempérament
, Voltaire, Ép. 29.Les femmes qui ont beaucoup de tempérament sont peu fécondes
, Buffon, Hist. anim. ch. 8. -
3Caractère.
Les Anglais pensent profondément?; Leur esprit en cela suit leur tempérament?; Creusant dans les sujets et forts d'expériences, Ils étendent partout l'empire des sciences
, La Fontaine, Fabl. XII, 23.? Mais, quoi qu'on fasse, Propos, conseil, enseignement, Rien ne change un tempérament
, La Fontaine, ib. VIII, 16.M. de Tournefort était d'un tempérament vif, laborieux, robuste
, Fontenelle, Tournefort.Ce malheureux tempérament que vous nous alléguez si souvent, ne vous trouvez-vous pas tous les jours dans des situations où il faut le gêner, le contraindre??
Massillon, Carême, Samarit.Il y a un zèle d'humeur et de tempérament qui n'est jamais loin de l'imprudence
, Massillon, Confér. Zèle pour le salut des âmes.L'heureux tempérament?! ma joie en est extrême, Gai, vif, aimant à rire?; enfin toujours le même
, Piron, Métrom. II, 1.Quoi que l'art humain puisse faire, le tempérament précède toujours la raison
, Rousseau, Ém. IV. -
4 Fig. Manière de tempérer, de régler, de conduire.
Qui doute que ce tempérament de tout cet univers ne se fasse par les révolutions et vicissitudes du soleil et de la lune??
Malherbe, le Traité des bienf. de Sénèque, IV, 23.Vous me deviez dire pour tempérament à ma vanité, qu'il ne faut que je rapporte à ma suffisance [capacité] une faveur que je dois à vos bons offices
, Guez de Balzac, liv. VI, lett. 25.Il [Charlemagne] mit un tel tempérament dans les ordres de l'État, qu'ils furent contrebalancés et qu'il resta le maître
, Montesquieu, XXXI, 18. -
5 Fig. Expédient, biais, adoucissement, ménagement, pour concilier les esprits, pour accommoder les affaires.
Nous lui fîmes voir qu'après ce qui s'était passé, il n'y avait plus de sûreté pour lui dans le tempérament
, Retz, Mém. t. II, liv. III, p. 284, dans POUGENS.Cette mauvaise délicatesse qui oblige ceux qui sont dans la nécessité de reprendre les autres, de choisir tant de détours et de tempéraments pour éviter de les choquer
, Pascal, Pens. II, 8, édit. HAVET.Il proposa cinq ou six tempéraments qui auraient été reçus, si le roi ne s'était fait une loi de ne les point recevoir
, Sévigné, 135.Le tranquille ministre, qui connaissait les sages tempéraments des conseils des rois
, Bossuet, le Tellier.Il est beau de découvrir les secrets d'une sublime politique, ou les sages tempéraments d'une négociation importante, ou les succès glorieux de quelque entreprise militaire
, Bossuet, Bourgoing.Le peuple ne put être ramené que par les paisibles remontrances de Menenius Agrippa?; mais il fallut trouver des tempéraments, et donner au peuple des tribuns pour le défendre contre les consuls
, Bossuet, Hist. I, 8.Bien que, rougissant de ces excès, il [Jurieu] ait tâché d'apporter ailleurs de faibles tempéraments à ses séditieuses maximes
, Bossuet, 5e avert. 31.Il [l'empereur Eugène] crut avoir trouvé un tempérament plausible, et ménagé par ses vaines distinctions une religion à laquelle il n'était pas fort attaché, et qu'il ne lui convenait pas pourtant d'abandonner
, Fléchier, Hist. de Théodose, IV, 39.M. le Tellier fut choisi pour chercher ces difficiles tempéraments de menace qui étonne, de remontrance qui corrige, de douceur qui apaise, de sévérité qui châtie
, Fléchier, le Tellier.Nous trouvons toujours des tempéraments entre le monde et Jésus-Christ
, Massillon, Panégyr. St Étienne.Ce n'est pas que je condamne le tempérament d'une sage prudence
, Massillon, Avent, Épiphan.Tous les tempéraments en matière de devoir sont à craindre
, Massillon, Carême, Passion.Dans ces circonstances, les gens qui ont de la sagesse et de l'autorité s'entremettent?; on prend des tempéraments, on s'arrange, on se corrige
, Montesquieu, Esp. v, 11. -
6Dans un sens analogue, mesure, modération.
Je ne vois point de créature Se comporter modérément?; Il est certain tempérament Que le maître de la nature Veut que l'on garde en tout
, La Fontaine, Fabl. IX, 11.J'avais besoin d'un caractère nouveau [le style], et qui fût mêlé de tous ceux-là [familier, élégant, héroïque]?; il me le fallait réduire dans un juste tempérament?; j'ai cherché ce tempérament avec un grand soin
, La Fontaine, Psyché, Préf.Vous ne gardez en rien les doux tempéraments
, Molière, Tart. v, 1.Ce style enchanteur qui, dans un juste tempérament entre la bassesse et l'élévation, est presque toujours élégant et clair
, Barthélemy, Anach. ch. 69. -
7 Terme de musique. Altération légère que l'on fait subir à de très petits intervalles, de manière à éviter une dissonance choquante. Il y a deux espèces de tempéraments?: le tempérament employé par les instruments à sons fixes des orchestres, et qui consiste à confondre le dièze et le bémol en prenant pour leur valeur commune le milieu de l'intervalle qui les sépare?; le tempérament employé pour le piano, pour l'orgue, etc. et qui consiste à diviser la gamme entière ou l'intervalle d'octave en 12 intervalles égaux appelés demi-tons moyens. Il existe aussi deux gammes tempérées distinctes?: 1° la gamme dite?: gamme tempérée de l'orchestre?; 2° la gamme appelée?: gamme du tempérament égal, laquelle, comme on voit, s'écarte encore plus de la gamme naturelle que la gamme tempérée de l'orchestre?; car non seulement le dièze et le bémol y sont confondus, mais même tous les sons de la gamme naturelle y sont plus ou moins altérés. Ces deux tempéraments ont été imaginés pour ne pas multiplier trop les trous des instruments à vent, les touches des pianos, etc.
Le tempérament est un vrai défaut?; c'est une altération que l'art a causée à l'harmonie, faute d'avoir pu mieux faire
, Rousseau, Dissert. sur la mus. mod.
HISTORIQUE
XVIe s. De telle mixtion des substances et qualités des elemens, viennent les temperamens et complexions de corps
, Paré, Introd. 4. L'on divise le temperament en deux premieres differences?: car ou il est temperé ou intemperé
, Paré, ib. 5.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
TEMPÉRAMENT. Ajoutez?:Il avait l'air si malheureux, que j'ai fini par lui acheter un irrigateur à tempérament, Gaz. des Trib. 26-27 avril 1875, p. 409, 2e col.
Encyclopédie, 1re édition
TEMPÉRAMENT, s. m. (Philosop.) est cette habitude ou disposition du corps, qui résulte de la proportion des quatre qualités primitives & élémentaires dont il est composé. Voyez Qualité & Élément.
L'idée de tempérament vient de celle de mélange, c'est-à-dire du mélange de différens élémens, comme la terre, l'eau, l'air & le feu, ou pour parler plus juste, à la maniere des Péripatéticiens, du mélange du chaud, du froid, du sec & de l'humide. Ces élémens ou qualités, par leur opposition, tendent à s'affoiblir mutuellement, & à dominer les unes sur les autres, & de toutes ensemble, résulte une sorte de température ou de mélange en telle ou telle proportion ; en conséquence de quoi, selon la qualité qui prédomine, nous disons un tempérament chaud, ou froid, sec ou humide. Voyez Mélange, Crase, &c.
On dispute dans les écoles, si le tempérament comprend proprement les quatre premieres qualités, ou si l'altération que souffrent ces qualités, par l'action réciproque qu'elles ont les unes sur les autres, ne les détruit pas entierement, en sorte qu'il en résulte une cinquieme qualité simple.
Les auteurs distinguent deux sortes de tempérament, l'un qu'ils appellent uniforme, & l'autre qu'ils appellent difforme. Le premier est celui où toutes les qualités sont mêlées dans un degré égal. Le second est celui où elles sont mêlées dans un degré inégal.
Il ne peut y avoir qu'un seul tempérament uniforme. Le tempérament difforme admet huit sortes de combinaisons, puisqu'une seule qualité, ou deux qualités à la fois peuvent dominer ; de-là le tempérament chaud & humide, le tempérament froid & humide, &c. De plus, quelques-uns considérant que les qualités qui dominent, peuvent n'être pas en degré égal, & de même celles qui ne dominent pas ; ils font plusieurs autres nouvelles combinaisons de tempéramens, & en ajoutent jusqu'à douze au nombre ordinaire. En effet, comme il y a une infinité de degrés entre le plus haut point & le plus bas point de chacun des élémens, on peut dire aussi qu'il y a un nombre infini de différentes températures. Voyez Degré.
Tempérament, en Médecine, s'entend plus particulierement de la constitution naturelle du corps de l'homme, ou de l'état des humeurs dans chaque sujet. Voyez Constitution & Humeur.
L'idée de tempérament vient de ce que le sang qui coule dans les veines & les arteres, ne se conçoit pas comme une liqueur simple, mais comme une sorte de mixte imparfait, ou un assemblage de plusieurs autres liquides ; car il n'est pas composé seulement des quatre qualités simples ou primitives, mais encore de quatre autres humeurs secondaires qui en sont aussi composées, & dans lesquelles on suppose qu'il peut se résoudre ; savoir la bile, le phlegme, la mélancolie & le sang proprement dit. Voyez Bile, Phlegme, Mélancolie, Sang
De-là, suivant que telle ou telle de ces humeurs domine dans un sujet, on dit qu'il est d'un tempérament bilieux, phlegmatique, mélancolique, sanguin, &c. Voy. Sanguin, Mélancolie, Bilieux, &c.
Les anciens médecins prétendoient que le tempérament animal répondoit au tempérament universel décrit ci-dessus. Ainsi on croyoit que le tempérament sanguin répondoit au tempérament chaud & humide, le tempérament flegmatique au tempérament froid & humide, le tempérament mélancolique au tempérament froid & sec, &c.
Galien introduisit dans la médecine la doctrine des tempéramens qu'il avoit tirée des Péripatéticiens, & il en fit comme la base de toute la Medecine. L'art de guérir les maladies ne consistoit, selon lui, qu'à tempérer les degrés des qualités des humeurs, &c. Voyez Galenique, Degré, &c.
Dans la médecine d'aujourd'hui on considere beaucoup moins les tempéramens. Le docteur Quincy, & d'autres auteurs méchaniciens, retranchent la plus grande partie de la doctrine de Galien, comme inutile & incertaine, & regardent seulement les tempéramens comme des diversités dans le sang de différentes personnes, qui rendent ce liquide plus capable dans un corps que dans un autre, à de certaines combinaisons, c'est-à-dire de tourner vers la bile, le phlegme, &c. D'où, suivant ces auteurs, les gens sont nommés bilieux, phlegmatiques, &c. Voyez Sang.
Les anciens distinguoient deux sortes de tempéramens dans un même corps ; l'un qu'ils nommoient ad pondus, l'autre qu'ils nommoient ad justitiam.
Le tempérament ad pondus est celui où les qualités élémentaires se trouvent en quantités & en proportions égales : c'est ainsi qu'on les supposoit dans la peau des doigts, sans quoi ces parties ne pourroient pas distinguer assez exactement les objets.
Le tempérament ad justitiam est celui où les qualités élémentaires ne sont pas en proportions égales, mais seulement autant qu'il est nécessaire pour la fonction propre à une partie. Tel est le temperament dans nos os, qui contient plus de parties terreuses que d'aqueuses, afin d'être plus dur & plus solide pour remplir sa fonction de soutenir.
Galien observe que le tempérament ad pondus n'est qu'imaginaire ; & quand il seroit réel, il ne pourroit subsister qu'un moment.
Le docteur Pitcairn regarde les tempéramens comme autant de maladies naturelles. Selon cet auteur, une personne de quelque tempérament qu'elle soit, a en elle-même les semences d'une maladie réelle ; un tempérament particulier supposant toujours que certaines sécrétions sont en plus grande proportion qu'il ne convient pour une longue vie.
Comme les différences des tempéramens ne sont autre chose que des différences de proportions dans la quantité des liquides, lesquelles proportions peuvent varier à l'infini ; il peut y avoir par conséquent une infinité de tempéramens, quoique les auteurs n'en aient supposé que quatre. Ce qu'on appelle d'ordinaire tempérament sanguin, Pitcairn dit que ce n'est qu'une pléthore. Voyez Pléthore.
Tempérament, s. m. en Musique, est la maniere de modifier tellement les sons, qu'au moyen d'une légere altération dans la juste proportion des intervalles, on puisse employer les mêmes cordes à former divers intervalles, & à moduler en différens tons, sans déplaire à l'oreille.
Pythagore, qui trouva le premier les rapports des intervalles harmoniques, prétendoit que ces rapports fussent observés dans toute la rigueur mathématique ; sans rien accorder à la tolérance de l'oreille. Cette sévérité pouvoit être bonne pour son tems, où toute l'étendue du système se bornoit encore à un si petit nombre de cordes. Mais comme la plûpart des instrumens des anciens étoient composés de cordes qui se touchoient à vuide, & qu'il leur falloit, par conséquent, une corde pour chaque son ; à mesure que le système s'étendit, ils ne tarderent pas à s'appercevoir que la regle de Pythagore eût trop multiplié les cordes, & empêché d'en tirer tous les usages dont elles étoient susceptibles. Aristoxene, disciple d'Aristote, voyant combien l'exactitude des calculs de Pythagore étoit nuisible au progrès de la Musique, & à la facilité de l'exécution, prit l'autre extrémité ; & abandonnant presque entierement ces calculs, il s'en rapporta uniquement au jugement de l'oreille, & rejetta comme inutile tout ce que Pythagore avoit établi.
Cela forma dans la Musique deux sectes qui ont long-tems subsisté chez les Grecs ; l'une, des Aristoxéniens, qui étoient les musiciens de pratique ; & l'autre, des Pythagoriciens, qui étoient les philosophes.
Dans la suite, Ptolomée & Dydime trouvant, avec raison, que Pythagore & Aristoxene avoient donné dans des extrémités également insoutenables ; & consultant à la-fois le sens & la raison, travaillerent chacun de leur côté à la réforme de l'ancien système diatonique. Mais comme ils ne s'éloignerent pas des principes établis pour la division des tétracordes, & que reconnoissant la différence du ton majeur au ton mineur, ils n'oserent toucher à celui-ci pour le partager comme l'autre par une corde chromatique en deux parties égales, le système général demeura encore long-tems dans un état d'imperfection qui ne permettoit pas d'appercevoir le vrai principe du tempérament.
Enfin Guy d'Arezze vint, qui refondit en quelque maniere la Musique, & qui inventa, dit-on, le clavecin. Or il est certain que cet instrument n'a pu subsister, non plus que l'orgue, du-moins tels ou à-peu-près que nous les connoissons aujourd'hui, que l'on n'ait en même tems trouvé le tempérament, sans lequel il est impossible de les accorder. Ces diverses inventions, dans quelque tems qu'elles aient été trouvées, n'ont donc pu être sort éloignées l'une de l'autre ; c'est tout ce que nous en savons.
Mais quoique la regle du tempérament soit connue depuis long-tems, il n'en est pas de même du principe sur lequel elle est établie. Le siecle dernier qui fut le siecle des découvertes en tout genre, est le premier qui nous ait donné des lumieres bien nettes sur cette pratique. Le pere Mersenne & M. Loullié se sont exercés à en nous en donner des regles. M. Sauveur a trouvé des divisions de l'octave qui fournissent tous les tempéramens possibles. Enfin M. Rameau, après tous les autres, a cru developper tout de nouveau la véritable théorie du tempérament, & a même prétendu sur cette théorie établir sous son nom une pratique très-ancienne dont nous parlerons bientôt. En voilà assez sur l'histoire du tempérament ; passons à la chose même.
Si l'on accorde bien juste quatre quintes de suite, comme ut, sol, ré, la, mi, on trouvera que cette quatrieme quinte mi, fera avec l'ut une tierce majeure discordante, & de beaucoup trop forte ; c'est que ce mi engendré comme quinte de la, n'est pas le même son qui doit faire la tierce majeure de l'ut. En voici la raison. Le rapport de la quinte est de 2 à 3, ou, si l'on veut, d'1 à 3 ; car c'est ici la même chose, 2 & 1 étant l'octave l'un de l'autre ; ainsi la succèssion des quintes formant une progression triple, on aura ut 1, sol 3, ré 9, la 27, & mi 81.
Considerons maintenant ce mi comme tierce majeure d'ut. Son rapport est 4, 5, ou 1, 5 ; car 4 n'est que la double octave d'1. Si nous rapprochons d'octave en octave ce mi du précédent, nous trouverons mi 5, mi 10, mi 20, mi 40 & mi 80 ; ainsi la quinte de la étant mi 81, la tierce majeure d'ut est mi 80 ; ces deux mi ne sont donc pas le même ; leur rapport est : ce qui fait précisément le comma majeur.
D'un autre côté, si nous procédons de quinte en quinte jusqu'à la douzieme puissance d'ut qui est le si dièse, nous trouverons que ce si excede l'ut dont il devroit faire l'unisson, & qu'il est avec lui en rapport de 531441 à 524288, rapport qui donne le comma de Pythagore. De sorte que par le calcul précédent le si dièse devroit exceder l'ut de trois comma majeurs, & par celui-ci, il doit seulement l'excéder du comma de Pythagore.
Mais il faut que le même son mi qui fait la quinte du la, serve encore à faire la tierce majeure de l'ut : il faut que le même si dièse, qui forme la treizieme quinte de ce même ut, en fasse en même tems l'octave, & il faut enfin que ces deux différentes regles se combinent de maniere qu'elles concourent à la constitution générale de tout le système. C'est la maniere d'exécuter tout cela qu'on appelle tempérament.
Si l'on accorde toutes les quintes justes, toutes les tierces majeures seront trop fortes, par conséquent les tierces mineures trop foibles, & la partition, au-lieu de se trouver juste, voyez Partition, donnera à la treizieme quinte une octave de beaucoup trop forte.
Si l'on diminue chaque quinte de la quatrieme partie du comma majeur, les tierces majeures seront très-justes, mais les tierces mineures seront encore trop foibles ; & quand on sera au bout de la partition, on trouvera l'octave fausse, & trop foible de beaucoup.
Que si l'on diminue proportionnellement chaque quinte (c'est le système de M. Rameau), seulement de la douzieme partie du comma de Pythagore, ce sera la distribution la plus égale qu'on puisse imaginer, & la partition se trouvera juste ; mais toutes les tierces majeures seront trop fortes.
Tout ceci n'est que des conséquences nécessaires de ce que nous venons d'établir, & l'on peut voir par-là qu'il est impossible d'éviter tous les inconvéniens. On ne sauroit gagner d'un côté qu'on ne perde de l'autre. Voyons de quelle maniere on combine tout cela, & comment par le tempérament ordinaire on met cette perte même à profit.
Il faut d'abord remarquer ces trois choses : 1°. que l'oreille qui souffre & demande même quelque affoiblissement dans la quinte, est blessée de la moindre altération dans la justesse de la tierce majeure. 2°. Qu'en tempérant les quintes, comme on voudra, il est impossible d'avoir jamais toutes les tierces justes. 3°. Qu'il y a des tons beaucoup moins usités que d'autres, & qu'on n'emploie guere ces premiers que pour les morceaux d'expression.
Relativement à ces observations, les regles du tempérament doivent donc être 1°. de rendre autant qu'il est possible les tierces justes, même aux dépens des quintes, & de rejetter dans les tons qu'on emploie le moins celles qu'on est contraint d'altérer ; car par cette méthode on fait entendre ces tierces le plus rarement qu'il se peut, & l'on les reserve pour les morceaux d'expression qui demandent une harmonie plus extraordinaire. Or c'est ce qu'on observe parfaitement par la regle commune du tempérament.
Pour cela 1°. on commence par l'ut du milieu du clavier, & l'on affoiblit les quatre premieres quintes en montant, jusqu'à ce que la quatrieme mi fasse la tierce majeure bien juste avec le premier son ut, ce qu'on appelle la preuve. 2°. En continuant d'accorder par quintes, dès qu'on est arrivé sur les dièses, on renforce les quintes, quoique les tierces en souffrent, & l'on s'arrête quand on est arrivé au sol dièse. 3°. On reprend l'ut, & l'on accorde les quintes en descendant, savoir, fa, si bémol, &c. en les renforçant toujours, jusqu'à ce qu'on soit parvenu au ré bémol, lequel, pris comme ut dièse, doit se trouver d'accord, & faire la quinte avec le sol dièse auquel on s'étoit arrêté. Les dernieres quintes se trouveront un peu fortes, de même que les tierces. Mais cette dureté sera supportable, si la partition est bien faite, & d'ailleurs ces quintes par leur situation sont rarement dans le cas d'être employées.
Les musiciens & les facteurs regardent cette maniere de tempérament comme la plus parfaite que l'on puisse pratiquer ; en effet, les tons naturels jouissent par cette méthode de toute la pureté de l'harmonie, & les tons transposés qui forment des modulations peu usitées, offrent encore des ressources au musicien quand il a besoin d'expressions dures & marquées. Car il est bon d'observer, dit M. Rameau, que nous recevons des impressions différentes des intervalles à proportion de leurs différentes altérations. Par exemple, la tierce majeure qui nous excite naturellement à la joie, nous imprime jusqu'à des idées de fureur lorsqu'elle est trop forte, & la tierce mineure qui nous porte naturellement à la douceur & à la tendresse, nous attriste lorsqu'elle est trop foible.
Les habiles musiciens, continue le même auteur, savent profiter à-propos de ces différens effets des intervalles, & font valoir par l'expression qu'ils en tirent, l'altération qu'on pourroit y condamner.
Mais dans sa génération harmonique, M. Rameau parle bien un autre langage. Il se reproche sa condescendance pour l'usage actuel ; & détruisant en un moment tout ce qu'il avoit établi auparavant, il donne une formule d'onze moyennes proportionnelles entre les deux termes de l'octave, sur laquelle il veut qu'on regle toute la succession du système chromatique ; de sorte que ce système résultant de douze semi-tons parfaitement égaux, c'est une nécessité que tous les intervalles semblables qui en seront formés soient aussi parfaitement égaux entre eux.
Pour la pratique, prenez, dit-il, telle touche du clavecin qu'il vous plaira ; accordez-en d'abord la quinte juste, puis diminuez-la si peu que rien, procédez ainsi d'une quinte à l'autre toujours en montant, c'est-à-dire du grave à l'aigu, jusqu'à la derniere dont le son aigu aura été le grave de la premiere, vous pouvez être certain que le clavecin sera bien d'accord, &c.
Il ne paroît pas que ce système ait été goûté des musiciens, ni des facteurs. Le premier ne peut se resoudre à se priver de la variété qu'il trouve dans les différentes impressions qu'occasionne le tempérament. M. Rameau a beau lui dire qu'il se trompe, & que le goût de variété se prend dans l'entrelacement des modes, & nullement dans l'altération des intervalles ; le musicien répond que l'un n'exclut pas l'autre, & ne se tient pas convaincu par une assertion.
A l'égard des facteurs, ils trouvent qu'un clavecin accordé de cette maniere n'est point aussi bien d'accord que l'assure M. Rameau ; les tierces majeures leur paroissent dures & choquantes ; & quand on leur répond qu'ils n'ont qu'à s'accoutumer à l'altération des tierces, comme ils l'étoient ci-devant à celles des quintes, ils repliquent qu'ils ne conçoivent pas comment l'orgue pourra s'accoutumer à ne plus faire les battemens désagréables qu'on y entend par cette maniere de l'accorder. Le pere Mersenne remarque que de son tems plusieurs pensoient que les premiers qui pratiquerent sur le clavecin les semi-tons, qu'il appelle feintes, accorderent d'abord toutes les quintes à-peu-près justes, selon l'accord égal que nous propose aujourd'hui M. Rameau ; mais que leur oreille ne pouvant souffrir la dissonance des tierces majeures nécessairement trop fortes, ils tempérerent l'accord en affoiblissant les quintes pour baisser les tierces majeures. Voilà ce que dit le pere Mersenne.
Je ne dois point finir cet article sans avertir ceux qui voudront lire le chapitre de la génération harmonique, où M. Rameau traite la théorie du tempérament, de ne pas être surpris s'ils ne viennent pas à bout de l'entendre, puisqu'il est aisé de voir que ce chapitre a été fait par deux hommes qui ne s'entendoient pas même l'un l'autre, savoir un mathématicien & un musicien.
La théorie du tempérament offre une petite difficulté de physique, de laquelle il ne paroît pas qu'on se soit beaucoup mis en peine jusqu'à présent.
Le plaisir musical, disent les physiciens, dépend de la perception des rapports des sons. Ces rapports sont-ils simples ? les intervalles sont consonans, les sons plaisent à l'oreille. Mais dès que ces rapports deviennent trop composés, l'ame ne les apperçoit plus, & cela forme la dissonance. Si l'unisson nous plait, c'est qu'il y a rapport d'égalité qui est le plus simple de tous ; dans l'octave, le rapport est d'un à deux, c'est un rapport simple, toutes ses puissances sont dans le même cas ; c'est toujours par la simplicité des rapports que notre oreille saisit avec plaisir les tierces, les quintes, & toutes les consonnances ; dès que le rapport devient plus composé seulement comme de 8 à 9, ou de 9 à 10, l'oreille est choquée ; elle est écorchée quand il est de 15 à 16.
Cela étant, je dis qu'un clavecin parfaitement d'accord, devroit, étant bien joué, produire la plus affreuse cacophonie que l'on puisse jamais entendre ; prenons la quinte ut, sol, son rapport est , rapport simple & facile à appercevoir ; mais il a fallu diminuer cette quinte ; & cette diminution qui est d'un quart de comma, formant une nouvelle raison, le rapport de la quinte ut, sol, ainsi tempérée, est justement de , à 240. Je demande donc en vertu de quoi, un intervalle dont les termes sont en telle raison, n'écorche pas les oreilles.
Si l'on chicane, & qu'on soutienne qu'une telle quinte n'est pas harmonieuse ; je dis en premier lieu que si l'on est instruit, ou qu'on ait de l'oreille, c'est parler de mauvaise foi ; car tous les musiciens savent bien le contraire : de plus, si l'on n'admet pas cette quinte ainsi altérée, on ne sauroit nier, du-moins, qu'une quinte parfaitement juste ne soit susceptible de quelque altération sans être moins agréable à l'oreille. Or il faut remarquer que, plus cette altération sera petite, & plus le rapport qui en résultera sera composé ; d'où il s'ensuit, qu'une quinte peu altérée devroit déplaire encore plus que celle qui le seroit davantage.
Dira-t-on que dans une petite altération, l'oreille supplée à ce qui manque à la justesse de l'accord, & suppose cet accord dans toute son exactitude ? qu'on essaye donc d'écouter une octave fausse ; qu'on y supplée ; qu'on y suppose tout ce qu'on voudra, & qu'on tâche de la trouver agréable. (S)
Étymologie de « tempérament »
Provenç. temperamen?; anc. esp. templamiento?; ital. temperamento?; du lat. temperamentum, de temperare, tempérer.
- (1522) Emprunté au latin temperamentum?[1].
tempérament au Scrabble
Le mot tempérament vaut 15 points au Scrabble.
Informations sur le mot temperament - 11 lettres, 4 voyelles, 7 consonnes, 7 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot tempérament au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
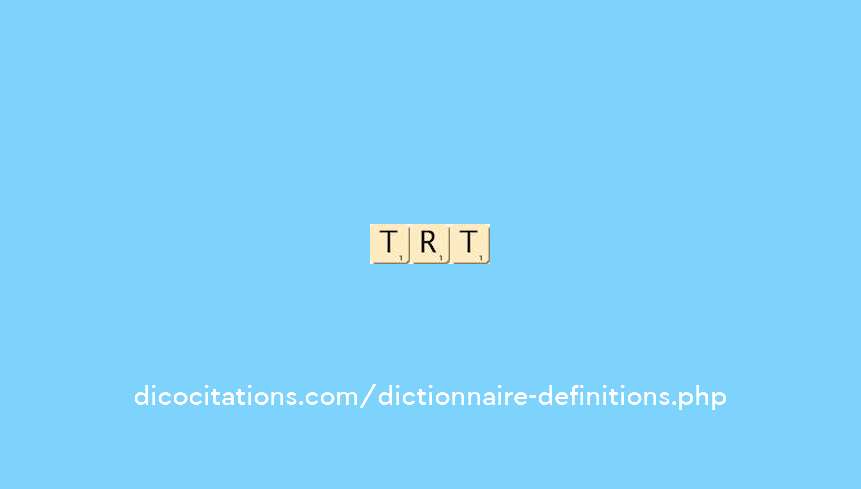
Les rimes de « tempérament »
On recherche une rime en M@ .
Les rimes de tempérament peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en m@
Rimes de embrasement Rimes de placements Rimes de effleurements Rimes de expertement Rimes de raffinements Rimes de nigaudement Rimes de cérébralement Rimes de croisements Rimes de grandiosement Rimes de fantasmatiquement Rimes de épouvantement Rimes de surentraînement Rimes de clairement Rimes de abominablement Rimes de pénardement Rimes de enterrements Rimes de châtiment Rimes de alitement Rimes de ignoblement Rimes de séquentiellement Rimes de intelligiblement Rimes de évidemment Rimes de ciment Rimes de essoufflements Rimes de justement Rimes de arrangement Rimes de relancement Rimes de subitement Rimes de antiallemands Rimes de démantèlements Rimes de jaillissement Rimes de phénoménalement Rimes de renflement Rimes de amoncellements Rimes de dévotieusement Rimes de entrebâillement Rimes de fourniments Rimes de rajeunissement Rimes de empiriquement Rimes de impeccablement Rimes de fatalement Rimes de volontairement Rimes de musulman Rimes de mandatement Rimes de vraisemblablement Rimes de financements Rimes de commencements Rimes de bannissement Rimes de bombardement Rimes de mamanMots du jour
embrasement placements effleurements expertement raffinements nigaudement cérébralement croisements grandiosement fantasmatiquement épouvantement surentraînement clairement abominablement pénardement enterrements châtiment alitement ignoblement séquentiellement intelligiblement évidemment ciment essoufflements justement arrangement relancement subitement antiallemands démantèlements jaillissement phénoménalement renflement amoncellements dévotieusement entrebâillement fourniments rajeunissement empiriquement impeccablement fatalement volontairement musulman mandatement vraisemblablement financements commencements bannissement bombardement maman
Les citations sur « tempérament »
- Homme de caractère: Un homme paraît avoir du caractère beaucoup plus souvent parce qu'il suit toujours son tempérament que parce qu'il suit toujours ses principes.Auteur : Friedrich Wilhelm Nietzsche - Source : Humain, trop humain (1878-1879), 485
- L'individu sombre dans la sauvagerie par accident plus que par tempérament.Auteur : Patrick Meney - Source : Même les tueurs ont une mère (1986)
- Pour agir, il faut une forte dose de défauts. Un homme sans défauts n'est bon à rien. Nos goûts, nos jugements viennent du tempérament; donc du germe. Nos idées sont les produits du sang. La sérénité, c'est l'indifférence.Auteur : Jacques Chardonne - Source : Propos comme ça (1966)
- Une oeuvre d'art est un coin de la création vu à travers un tempérament.Auteur : Emile Zola - Source : Mes Haines (1866)
- La vanité, la honte, et surtout le tempérament, font souvent la valeur des hommes, et la vertu des femmes.Auteur : François de La Rochefoucauld - Source : Réflexions ou Sentences et Maximes morales (1664), 220
- En définitive, j’ai dit oui parce que je pensais que Barack pourrait être un grand président. Il était sûr de lui comme peu de gens le sont. Il avait l’intelligence et la discipline nécessaires pour assumer cette charge, le tempérament pour encaisser les coups, et ce rare degré d’empathie qui lui permettrait d’être entièrement à l’écoute des besoins du pays. Il était entouré de gens bien, de gens intelligents, prêts à l’aider. Auteur : Michelle Obama - Source : Devenir (2018)
- On sait ce qu'est le monde des parieurs en Angleterre, monde plus intelligent, plus relevé que celui des joueurs. Parier est dans le tempérament anglais.Auteur : Jules Verne - Source : Le Tour du monde en quatre-vingts jours (1873)
- Voyez-vous, je crois que je suis né grammairien… Cela signifie que j'ai depuis toujours une sorte de tempérament qui me porte à aimer ce qui est précis, ce qui est juste, dans l'expression comme dans la pensée, d'ailleurs.Auteur : Maurice Grevisse - Source : Interview à la RTB.
- Chaque pays a son ange gardien. C'est lui qui préside au climat, au paysage, au tempérament des habitants, à leur santé, à leur beauté, à leurs bonnes moeurs, à leur bonne administration. C'est l'ange géographique.Auteur : Valéry Larbaud - Source : Jaune, bleu, blanc (1927)
- Le style et le sentiment dans la couleur viennent du choix, et le choix vient du tempérament. Il y a des tons gais et folâtres, folâtres et tristes, riches et gais, riches et tristes, de communs et d'originaux.Auteur : Charles Baudelaire - Source : Curiosités esthétiques (1868), Salon de 1846
- Une loi naturelle veut que l'on désire son contraire, mais que l'on s'entende avec son semblable. L'amour suppose des différences. L'amitié suppose une égalité, une similitude de goûts, de force et de tempérament.Auteur : Françoise Parturier - Source : Sans référence
- Plus il a affaire à l’informatique, plus cela lui semble être comme un jeu d’échecs : un petit monde bien clos défini par des règles fabriquées, un monde dans lequel des garçons prédisposés par un type de tempérament se laissent prendre et deviennent à moitié fous, tout comme il est lui-même à demi-fou, de sorte que qu’ils se leurrent en croyant qu’ils jouent à ce jeu, alors que c’est le jeu qui se joue d’eux. Auteur : J. M. Coetzee - Source : Vers l'âge d'homme (2003)
- L'âge n'a rien à voir dans l'émancipation des enfants. Le tempérament des parents fait tout. Y'en a qui ne veulent jamais lâcher prise...Auteur : Romain Sardou - Source : Personne n'y échappera (2006)
- On est acteur d'instinct ou pas. On peut gommer certains défauts, enrichir des qualités, mais on ne peut s'acheter une personnalité, un caractère, un tempérament. Dans ce sens, j'ai l'honneur de déclarer que les cours d'art dramatique sont d'inutilité publique. Tu veux être une star ? Compte sur toi même, fais-toi une personnalité et envoie chier les profs !Auteur : Jean-Pierre Mocky - Source : Cette fois je flingue de Jean-Pierre Mocky (2006)
- La population de la Californie du Sud se compose pour la plus grande part de fermiers retirés du Middle West, qui sont venus y finir leurs jours parmi le soleil et les fleurs. Naturellement, ils veulent les finir en paix, avec l'assurance de retrouver dans l'autre monde des fleurs et du soleil. Aussi Angel City est-elle la terre promise des doctrines et des cultes les plus extravagants. Il est impossible de s'en faire une idée si on ne l'a vu de ses yeux. Si l'on parcourt la liste des services dominicaux que l'on trouve aux pages d'annonces des journaux du dimanche, il y a de quoi éclater de rire ou se mettre à pleurer, suivant votre tempérament. Partout où plus de trois personnes sont réunies au nom de Jésus, de Bouddha, de Zoroastre, de la Vérité, de la Lumière, de l'Amour, de la Nouvelle Pensée, du Spiritualisme ou de la Science Psychique, c'est l'avènement d'une nouvelle révélation aux mystiques béatitudes et aux ésotériques moyens de salut. Auteur : Upton Sinclair - Source : Pétrole ! (1926)
- Elle avait un cou de cygne, des yeux de chatte, un regard d'aigle, une taille de guêpe, des jambes de gazelle, un tempérament de lion, un caractère de chien. Pourtant, ce n'était qu'une femme.Auteur : Louis Calaferte - Source : Choses dites (1997)
- Mon coeur même à l'amour quelquefois s'abandonne:
J'ai bien peu de tempérament;
Mais ma maîtresse me pardonne,
Et je l'aime plus tendrement.Auteur : Voltaire - Source : Correspondance, A M. de Cideville, 14 octobre 1733 - Très instruit, très pratique, «très débrouillard» pour employer un mot de la langue militaire française, c'était un tempérament superbe.Auteur : Jules Verne - Source : L'Ile mystérieuse (1873-1875)
- Je sais que j’ai un tempérament virulent. Je suis comme ça. Auteur : Audrey Pulvar - Source : Les Inrockuptibles par Beaugedurand, 30 mars 2012
- La raison ne peut tenir contre le tempérament, elle se laisse mener en triomphe ou en qualité de captive, ou en qualité de flatteuse.Auteur : Pierre Bayle - Source : Réponse aux questions d'un provincial
- On est ferme par principes, on est têtu par caractère ou plutôt par tempérament. Le têtu est celui dont les organes, quand ils ont une fois pris un pli, n'en peuvent plus ou n'en peuvent de longtemps reprendre un autre.Auteur : Joseph Joubert - Source : Carnets tome 1, 21 juin 1797
- Dire aux gens ce qu'il faut lire est en général inutile ou nuisible, car la véritable appréciation de la littérature est une question de tempérament et ne s'enseigne pas.Auteur : Oscar Wilde - Source : Dans le Pall Mall Gazette.
- Ma définition d'une oeuvre d'art serait, si je la formulais : Une oeuvre d'art est un coin de la création vu à travers un tempérament.Auteur : Emile Zola - Source : Mes haines, causeries littéraires et artistiques (1866)
- Bien que des circonstances extérieures m'aient empêché d'observer un régime strictement végétarien, j'adhère depuis longtemps à la cause par principe. En plus d'être d'accord avec les objectifs du végétarisme pour des raisons esthétiques et morales, je pense qu'une manière vivre par son effet purement physique sur le tempérament humain influencerait le plus avantageusement le sort de l'humanité.Auteur : Albert Einstein - Source : Lettre à Hermann Huth, 27 décembre 1930
- L'art d'aimer? C'est savoir joindre à un tempérament de vampire la discrétion d'une anémone.Auteur : Emil Cioran - Source : Syllogismes de l'amertume (1952)
Les mots proches de « temperament »
Tembo Téménos Téméraire Témérairement Témérité Témoignage Témoigner Témoin Tempe Tempé Tempérament Tempérance Tempérant, ante Tempérantisme Température Tempéré, ée Tempérément Tempérer Tempête Tempêtement Tempêter Tempêteur Tempêtueusement Tempêtueux, euse Temple Templier Temporaire Temporal, ale Temporalité Temporel, elle Temporellement Temporisateur, trice Temporisement Temporiser Temporiseur TempsLes mots débutant par tem Les mots débutant par te
tem téméraire témérairement téméraires témérité témérités témoigna témoignage témoignages témoignaient témoignais témoignait témoignant témoignât témoigne témoigné témoignée témoignées témoignent témoigner témoignera témoignerai témoigneraient témoignerais témoignerait témoigneras témoignèrent témoignerez témoigneront témoignes témoignés témoignez témoigniez témoin témoin-clé témoin-vedette témoins témoins-clés tempe tempera tempéra tempéraient tempérait tempérament tempéraments tempérance température températures tempère tempéré
Les synonymes de « temperament»
Les synonymes de tempérament :- 1. complexion
2. constitution
3. nature
4. caractère
5. humeur
6. tendances
7. naturel
8. univers
9. personnalité
10. esprit
11. disposition
12. santé
13. trempe
14. vitalité
15. sensualité
16. trempage
17. mouille
synonymes de tempérament
Fréquence et usage du mot tempérament dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « temperament » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot tempérament dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Tempérament ?
Citations tempérament Citation sur tempérament Poèmes tempérament Proverbes tempérament Rime avec tempérament Définition de tempérament
Définition de tempérament présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot tempérament sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot tempérament notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 11 lettres.



![{\displaystyle \scriptstyle 2{\overline {{\sqrt[{4}]{80}}^{3}\times {\sqrt[{4}]{81}}}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/64618b2cd6d5144c0b52fdb61643da7359503aa5)