Définition de « conjugaison »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot conjugaison de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur conjugaison pour aider à enrichir la compréhension du mot Conjugaison et répondre à la question quelle est la définition de conjugaison ?
Une définition simple : (fr-rég|k??.?y.??.z??)
Définitions de « conjugaison »
Trésor de la Langue Française informatisé
CONJUGAISON, subst. fém.
Wiktionnaire
Nom commun - français
conjugaison \k??.?y.??.z??\ féminin
- Action de conjuguer, réunir, unir.
- La conjugaison de leurs efforts.
- Action de conjuguer un verbe.
- La caractéristique du langage schtroumpf est que les noms propres et les noms communs, les verbes et les adverbes y sont remplacés, et chaque fois que possible, par des conjugaisons et déclinaisons du mot schtroumpf. ? (Umberto Eco, Kant et l'ornithorynque, traduit de l'italien par Julien Gayrard, Éditions Grasset, 1999)
- Ensemble des formes verbales.
- Parmi les principaux verbes de la quatrième conjugaison, il est inutile de citer foutre, je fous, je foutais, je foutrai, que je foutisse, foutant, foutu. La conjugaison de ce verbe est intéressante mais on vous grondera plutôt de la connaître que de l'ignorer. ? (Pierre Louÿs, Manuel de civilité pour les petites filles à l'usage des maisons d'éducation, 1926)
- De tout ce vague ravissement, il lui restait, en effet, une griserie légère qui se dissipait assez vite malgré ses efforts pour en retenir quelque chose, car elle était agréable, mais un quart d'heure plus tard, absorbé par un exercice de grammaire grecque, il ne songeait plus qu'à la conjugaison des verbes en ??. ? (Julien Green, Moïra, 1950, réédition Le Livre de Poche, page 168)
-
(Biologie) Mode de reproduction sexuée de certains organismes.
- En juillet survint une période de conjugaison : beaucoup d'infusoires se conjuguèrent même avant, d'avoir entièrement digéré leur nourriture. Dans les cultures à inanition presque tous les individus se conjuguèrent; [?]. ? (« Hertwig (R.). ? La conjugaison chez Dileptus gigas », dans L'Année biologique, volume 9, Paris : chez Masson, 1907, page 53)
- (Génétique) Transfert naturel d'ADN plasmidique ou chromosomique d'une cellule bactérienne à une autre par l'intermédiaire d'un pont cytoplasmique.
- (Physique) Transformation d'une particule en son antiparticule.
- (Chimie) Délocalisation d'électrons de type ?, par exemple dans une séquence de liaisons simples et multiples alternées.
- (Mathématiques) Application qui à un nombre complexe associe son conjugué.
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
T. de Grammaire. Action de conjuguer un verbe. Conjugaison régulière. Conjugaison irrégulière. Conjugaison active, passive, pronominale. Apprendre ses conjugaisons. En termes d'Anatomie, Conjugaison des nerfs, La conjonction de certaines paires de nerfs. Il est peu usité. Trous de conjugaison, Ouvertures sur les côtés de la colonne vertébrale, qui donnent passage aux nerfs de la moelle épinière et à certains vaisseaux.
Littré
-
1 Terme de grammaire. On appelle ainsi la suite bien ordonnée des formes d'un verbe aux trois personnes du singulier et du pluriel dans tous les temps et dans tous les modes.
Conjugaison simple, c'est celle de nos verbes ordinaires, y compris les temps composés où entrent les auxiliaires être ou avoir.
Conjugaison composée, celle où les temps ne sont jamais exprimés en un seul mot. On l'appelle selon le cas passive, réfléchie, interrogative, négative, etc.
Conjugaison passive, celle qui se forme avec le verbe être et le participe.
Conjugaison réfléchie, celle où le verbe est précédé d'un pronom complément, comme je me plains.
Classes où l'on fait rentrer les verbes dont les terminaisons paraissent avoir beaucoup d'analogie. Il y a en latin quatre conjugaisons. On dit aussi qu'il y a en français quatre conjugaisons que l'on distingue par la terminaison des infinitifs?: en er, en oir, en re et en ir.
-
2 Terme d'anatomie. Conjugaison de nerfs, paire de nerfs. Peu usité présentement en ce sens.
Trous de conjugaison, ouvertures arrondies que forment, en se réunissant deux à deux, les échancrures des apophyses transverses des vertèbres, et qui donnent passage aux nerfs spinaux.
REMARQUE
La première conjugaison en er reproduit la finale latine are?: amare, aimer. La seconde en oir reproduit la finale ?re, hab?re, avoir, dol?re, douloir, et, par changement d'accent, recip?re au lieu de recip?re, recevoir (l'ancienne forme correcte était reçoivre). La troisième en re reproduit la finale latine ?re, prend?re, prendre. La quatrième en ir reproduit la finale latine ?re, aud?re, ouir, ment?ri, mentir, part?re, partir?; mais elle tient aussi la place de la finale escere dans florescere, fleurir?; ce qui établit une très grande différence dans la conjugaison?; car la plupart des verbes qui appartiennent à la finale ire sont dits irréguliers, mais ils ne font pas autre chose que se conjuguer d'après l'accent latin, méntior, je ments, pártior, je pars, etc.?; ceux qui appartiennent à la finale escere, soit réellement comme fleurir, soit par assimilation fautive comme finir, sont dits réguliers, mais ils ne font non plus que se conjuguer d'après l'accent latin qui, naturellement, est placé d'autre façon?: florésco, je fleuris, gemísco, je gémis, etc. Les grammairiens français, faute de faire attention à l'accent latin, n'ont pas conçu la distinction de ces deux finales ou conjugaisons, et ont dit réguliers les verbes de la seconde catégorie et irréguliers les verbes de la première.
HISTORIQUE
XVIe s. Le gouster est fait à la langue bien disposée, par le benefice du nerf venant de la troisiesme et quatriesme conjugation des nerfs du cerveau
, Paré, Introd. 9. Des nerfs de la 3e et 4e conjugaison
, Paré, I, 14. Des sept conjugaisons, paires ou couples de nerfs du cerveau, ainsi appelés pour ce qu'ils sont tousjours deux à deux
, Paré, III, 8. La conjugaison est divisée vulgairement en quatre especes par les terminaisons du present infini
, Ramus, dans LIVET, Gramm. au XVIe siècle, p. 206.
Encyclopédie, 1re édition
CONJUGAISON, s. f. terme de Grammaire, conjugatio : ce mot signifie jonction, assemblage. R. conjungere. La conjugaison est un arrangement suivi de toutes les terminaisons d'un verbe, selon les voix, les modes, les tems, les nombres, & les personnes ; termes de Grammaire qu'il faut d'abord expliquer.
Le mot voix est pris ici dans un sens figuré : on personnifie le verbe, on lui donne une voix, comme si le verbe parloit ; car les hommes pensent de toutes choses par ressemblance à eux-mêmes ; ainsi la voix est comme le ton du verbe. On range toutes les terminaisons des verbes en deux classes différentes ; 1°. les terminaisons, qui font connoître que le sujet de la proposition fait une action, sont dites être de la voix active, c'est-à-dire que le sujet est considéré alors comme agent ; c'est le sens actif : 2°. toutes celles qui sont destinées à indiquer que le sujet de la proposition est le terme de l'action qu'un autre fait, qu'il en est le patient, comme disent les Philosophes, ces terminaisons sont dites être de la voix passive, c'est-à-dire que le verbe énonce alors un sens passif. Car il faut observer que les Philosophes & les Grammairiens se servent du mot pâtir, pour exprimer qu'un objet est le terme ou le but d'une action agréable ou desagréable qu'un autre fait, ou du sentiment qu'un autre a : aimer ses parens, parens sont le terme ou l'objet du sentiment d'aimer. Amo, j'aime, amavi, j'ai aimé, amabo, j'aimerai, sont de la voix active ; au lieu que amor, je suis aimé, amabar, j'étois aimé, amabor, je serai aimé, sont de la voix passive. Amans, celui qui aime, est de la voix active ; mais amatus, aimé, est de la voix passive. Ainsi de tous les termes dont on se sert dans la conjugaison, le mot voix est celui qui a le plus d'étendue ; car il se dit de chaque mot, en quelque mode, tems, nombre, ou personne que ce puisse être.
Les Grecs ont encore la voix moyenne. Les Grammairiens disent que le verbe moyen a la signification active & la passive, & qu'il tient une espece de milieu entre l'actif & le passif : mais comme la langue Greque est une langue morte, peut-être ne connoît-on pas aussi-bien qu'on le croit la voix moyenne.
Par modes on entend les différentes manieres d'exprimer l'action. Il y a quatre principaux modes, l'indicatif, le subjonctif, l'impératif, & l'infinitif, auxquels en certaines langues on ajoûte l'optatif.
L'indicatif énonce l'action d'une maniere absolue, comme j'aime, j'ai aimé, j'avois aimé, j'aimerai ; c'est le seul mode qui forme des propositions, c'est-à-dire qui énonce des jugemens ; les autres modes ne font que des énonciations. Voyez ce que nous disons à ce sujet au mot Construction, ou nous faisons voir la différence qu'il y a entre une proposition & une simple énonciation.
Le subjonctif exprime l'action d'une maniere dépendante, subordonnée, incertaine, conditionnelle, en un mot d'une maniere qui n'est pas absolue, & qui suppose toûjours un indicatif : quand j'aimerois, afin que j'aimasse ; ce qui ne dit pas que j'aime, ni que j'aye aimé.
L'optatif, que quelques Grammairiens ajoûtent aux modes que nous avons nommés, exprime l'action avec la forme de desir & de souhait : plût-à-Dieu qu'il vienne. Les Grecs ont des terminaisons particulieres pour l'optatif. Les Latins n'en ont point ; mais quand ils veulent énoncer le sens de l'optatif, ils empruntent les terminaisons du subjonctif, auxquelles ils ajoûtent la particule de desir utinam, plût-à-Dieu que. Dans les langues où l'optatif n'a point de terminaisons qui lui soient propres, il est inutile d'en faire un mode séparé du subjonctif.
L'impératif marque l'action avec la forme de commandement, ou d'exhortation, ou de priere ; prens, viens, va donc.
L'infinitif énonce l'action dans un sens abstrait, & n'en fait par lui-même aucune application singuliere, & adaptée à un sujet ; aimer, donner, venir ; ainsi il a besoin, comme les prépositions, les adjectifs, &c. d'être joint à quelqu'autre mot, afin qu'il puisse faire un sens singulier & adapté.
A l'égard des tems, il faut observer que toute action est relative à un tems, puisqu'elle se passe dans le tems. Ces rapports de l'action au tems sont marqués en quelques langues par des particules ajoûtées au verbe. Ces particules sont les signes du tems ; mais il est plus ordinaire que les tems soient désignés par des terminaisons particulieres, au moins dans les tems simples : tel est l'usage en Grec, en Latin, en François, &c.
Il y a trois tems principaux ; 1°. le présent, comme amo, j'aime ; 2°. le passé ou prétérit, comme amavi, j'ai aimé ; 3°. l'avenir ou futur, comme amabo, j'aimerai.
Ces trois tems sont des tems simples & absolus, auxquels on ajoûte les tems relatifs & combinés, comme je lisois quand vous êtes venu, &c. Voyez Tems, terme de Grammaire.
Les nombres. Ce mot, en termes de Grammaire, se dit de la propriété qu'ont les terminaisons des noms & celles des verbes, de marquer si le mot doit être entendu d'une seule personne, ou si on doit l'entendre de plusieurs. Amo, amas, amat, j'aime, tu aimes, il aime ; chacun de ces trois mots est au singulier : amamus, amatis, amant, nous aimons, vous aimez, ils aiment ; ces trois derniers mots sont au pluriel, du moins selon leur premiere destination ; car dans l'usage ordinaire on les employe aussi au singulier : c'est ce qu'un de nos Grammairiens appelle le singulier de politesse. Il y aussi un singulier d'autorité ou d'emphase ; nous voulons, nous ordonnons.
A ce, deux nombres les Grecs en ajoûtent encore un troisieme, qu'ils appellent duel : les terminaisons du duel sont destinées à marquer qu'on ne parle que de deux.
Enfin il faut savoir ce qu'on entend par les personnes grammaticales ; & pour cela il faut observer que tous les objets qui peuvent faire la matiere du discours sont 1°. ou la personne qui parle d'elle-même ; amo, j'aime.
2°. Ou la personne à qui l'on adresse la parole ; amas, vous aimez.
3°. Ou enfin quelqu'autre objet qui n'est ni la personne qui parle, ni celle à qui l'on parle ; rex amat populum, le roi aime le peuple.
Cette considération des mots selon quelqu'une de ces trois vûes de l'esprit, a donné lieu aux Grammairiens de faire un usage particulier du mot de personne par rapport au discours.
Ils appellent premiere personne celle qui parle, parce que c'est d'elle que vient le discours.
La personne à qui le discours s'adresse est appellée la seconde personne.
Enfin la troisieme personne, c'est tout ce qui est considéré comme étant l'objet dont la premiere personne parle à la seconde.
Voyez combien de sortes de vûes de l'esprit sont énoncées en même tems par une seule terminaison ajoûtée aux lettres radicales du verbe : par exemple, dans amare, ces deux lettres a, m, sont les radicales ou immuables ; si à ces deux lettres j'ajoûte o, je forme amo. Or en disant amo, je fais connoître que je juge de moi, je m'attribue le sentiment d'aimer ; je marque donc en même tems la voix, le mode, le tems, le nombre, la personne.
Je fais ici en passant cette observation, pour faire voir qu'outre la propriété de marquer la voix, le mode, la personne, &c. & outre la valeur particuliere de chaque verbe, qui énonce ou l'essence, ou l'existence, ou quelqu'action, ou quelque sentiment, &c. le verbe marque encore l'action de l'esprit qui applique cette valeur à un sujet, soit dans les propositions, soit dans les simples énonciations ; & c'est ce qui distingue le verbe des autres mots, qui ne sont que de simples dénominations. Mais revenons au mot conjugaison.
On peut aussi regarder ce mot comme un terme métaphorique tiré de l'action d'atteler les animaux sous le joug, au même char & à la même charrue ; ce qui emporte toûjours l'idée d'assemblage, de liaison, & de jonction. Les anciens Grammairiens se sont servi indifféremment du mot de conjugaison, & de celui de déclinaison, soit en parlant d'un verbe, soit en parlant d'un nom : mais aujourd'hui on employe declinatio & declinare, quand il s'agit des noms ; & on se sert de conjugatio & de conjugare, quand il est question des verbes.
Les Grammairiens de chaque langue ont observé qu'il y avoit des verbes qui énonçoient les modes, les tems, les nombres, & les personnes, par certaines terminaisons, & que d'autres verbes de la même langue avoient des terminaisons toutes différentes, pour marquer les mêmes modes, les mêmes tems, les mêmes nombres, & les mêmes personnes : alors les Grammairiens ont fait autant de classes différentes de ces verbes, qu'il y a de variétés entre leurs terminaisons, qui malgré leurs différences, ont cependant une égale destination par rapport au tems, au nombre, & à la personne. Par exemple, amo, amavi, amatum, amare ; j'aime, j'ai aimé, aimé, aimer ; moneo, monui, monitum, monere, avertir ; lego, legi, lectum, legere, lire ; audio, audivi, auditum, audire, entendre. Ces quatre sortes de terminaisons différentes entr elles, énoncent également des vûes de l'esprit de même espece : amavi, j'ai aimé ; monui, j'ai averti ; legi, j'ai lû ; audivi, j'ai entendu : vous voyez que ces différentes terminaisons marquent également la premiere personne au singulier & au tems passé de l'indicatif ; il n'y a de différence que dans l'action que l'on attribue à chacune de ces premieres personnes, & cette action est marquée par les lettres radicales du verbe, am, mon, leg, aud.
Parmi les verbes latins, les uns ont leurs terminaisons semblables à celles d'amo, les autres à celles de moneo, d'autres à celles d'audio. Ce sont ces classes différentes que les grammairiens ont appellées conjugaisons. Ils ont donné un paradigme, ??????????, exemplar, c'est-à-dire, un modele à chacune de ces différentes classes ; ainsi amare est le paradigme de vocare, de nuntiare, & de tous les autres verbes terminés en are : c'est la premiere conjugaison.
Monere doit être le paradigme de la seconde conjugaison, selon les rudimens de la méthode de P. R. à cause de son supin monitum ; parce qu'en effet, il y a dans cette conjugaison un plus grand nombre de verbes qui ont leur supin terminé en itum, qu'il n'y en a qui le terminent comme doctum.
Legere est le paradigme de la troisieme conjugaison ; & enfin audire l'est de la quatrieme.
A ces quatre conjugaisons des verbes latins, quelques grammairiens pratiques en ajoutent une cinquieme qu'ils appellent mixte, parce qu'elle est composée de la troisieme & de la quatrieme ; c'est celle des verbes en ere, io ; ils lui donnent accipere, accipio pour paradigme ; il y a en effet dans ces verbes des terminaisons qui suivent legere, & d'autres audire. On dit audior, audiris, au lieu qu'on dit accipior, acciperis, comme legeris, & l'on dit, accipiuntur, comme audiuntur, &c.
Ceux des verbes latins qui suivent quelqu'un de ces paradigmes sont dits être réguliers, & ceux qui ont des terminaisons particulieres, sont appellés anomaux, c'est-à-dire, irréguliers, (R. ? privatif, & ?????, regle.) comme fero, fers, fert ; volo, vis, vult, &c. on en fait des listes particulieres dans les rudimens ; d'autres sont seulement défectifs, c'est-à-dire, qu'ils manquent ou de prétérit ou de supin, ou de quelque mode, ou de quelque tems, ou de quelque personne, comme oportet, p?nitet, pluit, &c.
Un très-grand nombre de verbes s'écartent de leur paradigme, ou à leur prétérit, ou à leur supin ; mais ils conservent toujours l'analogie latine ; par exemple, sonare fait au prétérit sonui, plutôt que sonavi ; dare fait dedi, & non pas davi, &c. On se contente d'observer ces différences, sans pour cela regarder ces verbes comme des verbes anomaux. Au reste ces irrégularités apparentes viennent de ce que les Grammairiens n'ont pas rapporté ces prétérits à leur véritable origine ; car sonui vient de sonere, de la troisieme conjugaison, & non de sonare : dedi est une syncope de dedidi prétérit de dedere. Tuli, latum, ne viennent point de fero. Tuli qu'on prononçoit touli, vient de tollo ; sustuli vient de sustulo ; & latum vient de ???? par syncope de ????? suffero, sustineo.
L'auteur du Novitius dit, que latum vient du prétendu verbe inusité, lare, lo ; mais il n'en rapporte aucune autorité. Voyez Vossius, de art. gramm. t. II. p. 150.
C'est ainsi que sui ne vient point du verbe sum : nous avons de pareilles pratiques en François : je vas, j'ai été, j'irai, ne viennent point d'aller. Le premier vient de vadere, le second de l'italien stato, & le troisieme du latin ire.
S'il eût été possible que les langues eussent été le résultat d'une assemblée générale de la nation, & qu'après bien des discussions & des raisonnemens, les philosophes y eussent été écoutés, & eussent eu voix délibérative ; il est vraissemblable qu'il y auroit eu plus d'uniformité dans les langues. Il n'y auroit eu par exemple, qu'une seule conjugaison, & un seul paradigme, pour tous les verbes d'une langue. Mais comme les langues n'ont été formées que par une sorte de métaphysique d'instinct & de sentiment, s'il est permis de parler ainsi ; il n'est pas étonnant qu'on n'y trouve pas une analogie bien exacte, & qu'il y ait des irrégularités : par exemple, nous désignons la même vûe de l'esprit par plus d'une maniere ; soit que la nature des lettres radicales qui forment le mot, amene cette différence, ou par la seule raison du caprice & d'un usage aveugle ; ainsi nous marquons la premiere personne au singulier, quand nous disons j'aime ; nous désignons aussi cette premiere personne en disant ; je finis, ou bien je reçois, ou je prends, &c. Ce sont ces différentes sortes de terminaisons auxquelles les verbes sont assujettis dans une langue, qui font les différentes conjugaisons, comme nous l'avons déja observé. Il y a des langues où les différentes vûes de l'esprit sont marquées par des particules, dont les unes précedent & d'autres suivent les radicales : qu'importe comment, pourvû ; que les vûes de l'esprit soient distinguées avec netteté, & que l'on apprenne par usage à connoître les signes de ces distinctions ?
Parmi les auteurs qui ont composé des grammaires pour la langue hébraïque, les uns comptent sept conjugaisons, d'autres huit : Masclef n'en veut que cinq, & il ajoûte qu'à parler exactement ces cinq devroient être réduites à trois. Quinque illæ, accurate loquendo, ad tres essent reducendæ. Gramm. Hebraïc. ch. iv. n. 4. p. 79. édit. 2.
Nous nous contenterons d'observer ici que les verbes hébreux ont voix active & voix passive. Ils ont deux nombres, le singulier & le pluriel ; ils ont trois personnes, & en conjugant, on commence par la troisieme personne, parce que les deux autres sont formées de celle-là, par l'addition de quelques lettres.
En Hébreu, les verbes ont trois genres, comme les noms, le genre masculin, le féminin, & le genre commun ; ensorte que l'on connoît par la terminaison du verbe, si l'on parle d'un nom masculin, ou d'un nom féminin ; mais dans tous les tems la premiere personne est toujours du genre commun. Au reste les Hébreux n'ont point de genre neutre ; mais lorsque la même terminaison sert également pour le masculin, ou pour le feminin, on dit que le mot est du genre commun ; c'est ainsi que l'on dit en latin, hic adolescens, ce jeune homme, & hæc adolescens, cette jeune fille ; civis bonus, bon citoyen, & civis bona, bonne citoyenne ; & c'est ainsi que nous disons, sage, utile, fidele, tant au masculin qu'au feminin ; on pourroit dire aussi que dans les autres langues telles que le Grec, le Latin, le François, &c. toutes les terminaisons des verbes dans les tems énoncés par un seul mot sont du genre commun ; ce qui ne signifieroit autre chose sinon qu'on se sert également de chacune de ces terminaisons, soit qu'on parle d'un nom masculin ou d'un nom féminin.
Les Grecs ont trois especes de verbes par rapport à la conjugaison ; chaque verbe est rapporté à son espece suivant la terminaison du thême. On appelle thême, en termes de grammaire greque, la premiere personne du présent de l'indicatif. Ce mot vient de ?????? pono, parce que c'est de cette premiere personne que l'on forme les autres tems ; ainsi l'on pose d'abord, pour ainsi dire ce présent, afin de parvenir aux formations régulieres des autres tems.
La premiere espece de conjugaison est celle des verbes qu'on appelle barytons, de ????? grave, & de ????? ton, accent, parce que ces verbes étoient prononcés avec l'accent grave sur la derniere syllabe ; & quoique aujourd'hui cet accent ne se marque point, on les appelle pourtant toujours barytons, ????? tendo ; ????? verbero, sont des verbes barytons.
2. La seconde sorte de conjugaison, est celle des verbes circonflexes : ce sont des verbes barytons qui souffrent contraction en quelques-unes de leurs terminaisons, & alors ils sont marqués d'un accent circonflexe ; par exemple ?????? amo, est le baryton, & ????? le circonflexe.
Les barytons & les circonflexes sont également terminés en ? à la premiere personne du présent de l'indicatif.
3. La troisieme espece de verbes grecs, est celle des verbes en ??, parce qu'en effet ils sont terminés en ??, ???? sum.
Il y a six conjugaisons des verbes barytons ; elles ne sont distinguées entr'elles que par les lettres qui précedent la terminaison.
On distingue trois conjugaisons de verbes circonflexes : la premiere est des barytons en ?? ; la seconde de ceux en ??, & la troisieme de ceux en ?? : ces trois sortes de verbes deviennent circonflexes par la contraction en ?.
On distingue quatre conjugaisons des verbes en ?? ; & ces quatre jointes à celles des verbes barytons, & à celles des circonflexes, cela fait treize conjugaisons dans les verbes grecs.
Tel est le systême commun des Grammairiens ; mais la méthode de P. R. réduit ces treize conjugaisons à deux : l'une des verbes en ? qu'elle divise en deux especes : 1. celle des verbes qui se conjuguent sans contraction, & ce sont les barytons : 2. celle de ceux qui sont conjugués avec contraction, & alors ils sont appellés circonflexes. L'autre conjugaison des verbes grecs est celle des verbes en ??.
Il y a quatre observations à faire pour bien conjuguer les verbes grecs : 1. il faut observer la terminaison. Cette terminaison est marquée ou par une simple lettre, ou par plus d'une lettre.
2. La figurative, c'est-à-dire, la lettre qui précede la terminaison : on l'appelle aussi caractéristique, ou lettre de marque. On doit faire une attention particuliere à cette lettre, 1. au présent, 2. au prétérit parfait, 3. & au futur de l'indicatif actif ; parce que c'est de ces trois tems que les autres sont formés. La subdivision des conjugaisons, & la distinction des tems des verbes, se tire de cette lettre figurative, ou caractéristique.
3. La voyelle, ou la diphtongue qui précedent la terminaison.
4. Enfin, il faut observer l'augment. Les lettres que l'on ajoûte avant la premiere syllable du thême du verbe, ou le changement qui se fait au commencement du verbe, lorsqu'on change une breve en une longue, est ce qu'on appelle augment ; ainsi il y a deux sortes d'augments. 1. L'augment syllabique qui se fait en certains tems des verbes qui commencent par une consonne, par exemple, ????? verbero, est le thême sans augment ; mais dans ???????, verberabam, ? est l'augment syllabique, qui ajoûte une syllabe de plus à ?????.
2. L'augment temporel se fait dans les verbes qui commencent par une voyelle breve, que l'on change en une longue, par exemple, ???? traho, ????? trahebam.
Ainsi non seulement les verbes grecs ont des terminaisons différentes, comme les verbes latins ; mais de plus, ils ont l'augment qui se fait en certains tems, & au commencement du mot.
Voilà une premiere différence entre les verbes grecs, & les verbes latins.
2. Les Grecs ont un mot de plus ; c'est l'optatif qui en grec a des terminaisons particulieres, différentes de celles du subjonctif ; ce qui n'est pas en latin.
3. Les verbes grecs ont le duel, au lieu qu'en latin ce nombre est confondu avec le pluriel. Les grecs ont un plus grand nombre de tems ; ils ont deux aoristes, deux futurs, & un paulò-post futur dans le sens passif, à quoi les latins suppléent par des adverbes.
5. Enfin les Grecs n'ont ni supins, ni gérondifs proprement dits ; mais ils en sont bien dédommagés par les différentes terminaisons de l'infinitif, & par les différens participes. Il y a un infinitif pour le tems présent, un autre pour le futur premier, un autre pour le futur second, un pour le premier aoriste, un pour le second, un pour le prétérit parfait ; enfin il y en a un pour le paulò-post futur, & de plus il y a autant de participes particuliers pour chacun de ces tems-là.
Dans la langue Allemande, tous les verbes sont terminés, en en à l'infinitif, si vous en exceptez seyn, être, dont l'e se confond avec l'y. Cette uniformité de terminaison des verbes à l'infinitif, a fait dire aux Grammairiens, qu'il n'y avoit qu'une seule conjugaison en Allemand ; ainsi il suffit de bien savoir le paradigme ou modele sur lequel on conjugue à la voix active, tous les verbes réguliers, & ce paradigme, c'est lieben, aimer ; car telle est la destination des verbes qui expriment ce sentiment, de servir de paradigme en presque toutes les langues : on doit ensuite avoir des listes de tous les verbes irréguliers.
J'ai dit que lieben, étoit le modele des verbes à la voix active ; car les Allemands n'ont point de verbes passifs en un seul mot, tel est aussi notre usage, & celui de nos voisins ; on se sert d'un verbe auxiliaire auquel on joint, ou le supin qui est indéclinable, ou le participe qui se décline.
Les Allemands ont trois verbes auxiliaires ; haben, avoir ; seyn, être ; werden, devenir. Ce dernier sert à former le futur de tous les verbes actifs ; il sert aussi à former tous les tems des verbes passifs, conjointement avec le participe du verbe ; surquoi il faut observer qu'en Allemand, ce participe ne change jamais, ni pour la différence des genres, ni pour celle des nombres ; il garde toujours la même terminaison.
A l'égard de l'Anglois, la maniere de conjuguer les verbes de cette langue n'est point analogue à celle des autres langues : je ne sçai si elle est aussi facile qu'on le dit, pour un étranger qui ne se contente pas d'une simple routine, & qui veut avoir une connoissance raisonnée de cette maniere de conjuguer. Wallis, qui étoit Anglois, dit que comme les verbes anglois ne varient point leur terminaison, la conjugaison qui fait, dit-il, une si grande difficulté dans les autres langues, est dans la sienne une affaire très-aisée, & qu'on en vient fort aisément à bout, avec le secours de quelques mots ou verbes auxiliaires. Verborum flexio seu conjugatio, quæ in reliquis linguis maximam sortitur difficultatem, apud anglos levissimo negotio peragitur? verborum aliquot auxiliarium adjumento ferè totum opus perficitur. Wallis, Gramm. ling. Angl. ch. viij. de verbo.
C'est à ceux qui étudient cette langue à décider cette question par eux-mêmes.
Chaque verbe anglois semble faire une classe à part ; la particule prépositive to, est comme une espece d'article destiné à marquer l'infinitif ; desorte qu'un nom substantif devient verbe, s'il est précédé de cette particule, par exemple, murder, veut dire meurtre, homicide ; mais to murder, signifie tuer : lift, effort, to lift, enlever ; love, amour, amitié, affection, to love, aimer, &c. Ces noms substantifs qui deviennent ainsi verbes, sont la cause de la grande différence qui se trouve dans la terminaison des infinitifs ; on peut observer presque autant de terminaisons différentes à l'infinitif, qu'il y a de lettres à l'Alphabet, a, b, c, d, e, f, g, &c. to flea, écorcher ; to rob, voler, dérober ; to find, trouver ; to love, aimer ; to quaff, boire à longs traits ; to jog, secouer, pousser ; to cath, prendre, saisir ; to thank, remercier ; to call, appeller ; to lam, battre, frapper ; to run, courir ; to help, aider ; to wear, porter ; to toss, agiter ; to rest, se reposer ; to know, savoir ; to box, battre à coups de poing ; to marry, marier, se marier.
Ces infinitifs ne se conjuguent pas par des changemens de terminaison, comme les verbes des autres langues ; la terminaison de ces infinitifs ne change que très-rarement. Ils ont deux participes ; un participe présent toûjours terminé en ing, having, ayant, being, étant ; & un participe passé terminé ordinairement en ed ou 'd, loved, aimé : mais ces participes n'ont guere d'analogie avec les nôtres, ils sont indéclinables, & sont plûtôt des noms verbaux qui se prennent tantôt substantivement & tantôt adjectivement : ils énoncent l'action dans un sens abstrait, par exemple, your marrying signifie votre marier, l'action de vous marier plûtôt que votre mariant. Coming est le participe présent de to come, arriver, & signifie l'action d'arriver, de venir, ce que notre participe arrivant ne rend point. Les Anglois disent his coming, son arrivée, sa venue, son action d'arriver ; & l'idée qu'ils ont alors dans l'esprit, n'a pas la même forme que celle de la pensée que nous avons quand nous disons venant, arrivant. C'est de la différence du tour, de l'imagination, ou de la différente maniere dont l'esprit est affecté, que l'on doit tirer la différence des idiotismes & du génie des langues.
C'est avec l'infinitif & avec les deux noms verbaux ou participes dont nous venons de parler, que l'on conjugue les verbes Anglois, par le secours de certains mots & de quelques verbes auxiliaires. Ces verbes sont proprement les seuls verbes. Ces auxiliaires sont to have, avoir ; to be, être ; to do, faire, & quelques autres. Les personnes se marquent par les pronoms personnels i, je ; thou, tu ; he, il ; she, elle : & au pluriel, we, nous ; you, vous ; they, ils ou elles, sans que cette différence de pronoms apporte quelque changement dans la terminaison du nom verbal que l'on regarde communément comme verbe.
Les grammaires que l'on a faites jusqu'ici pour nous apprendre l'Anglois, du-moins celles dont j'ai en connoissance, ne m'ont pas paru propres pour nous donner une idée juste de la maniere de conjuguer des Anglois. On rend l'Anglois par un équivalent François, qui ne donne pas l'idée juste du tour littéral Anglois, ce qui est pourtant le point que cherchent ceux qui veulent apprendre une langue étrangere ; par exemple, i do dine, on traduit je dîne ; thou dost dine, tu dînes ; he does dine, il dîne. i, marque la premiere personne, do, veut dire faire, & dine, dîner : il faudroit donc traduire, je ou moi faire dîner, tu fais dîner, il ou lui fait diner. Et de même there is, on traduit au singulier, il y a ; there, est un adverbe qui veut dire là, & is est la troisieme personne du singulier du présent du verbe irrégulier to be, être, & are sert pour les trois personnes du pluriel ; ainsi il falloit traduire there is, là est, & there are, là sont, & observer que nous disons en François, il y a.
Le sens passif s'exprime en Anglois, comme en Allemand & en François, par le verbe substantif, avec le participe du verbe dont il s'agit, i am loved, je suis aimé.
Pour se familiariser avec la langue Angloise, on doit lire souvent les listes des verbes irréguliers qui se trouvent dans les grammaires, & regarder chaque mot d'un verbe comme un mot particulier, qui a une signification propre ; par exemple, i am, je suis ; thou art, tu es ; he is, il est : we are, nous sommes ; ye are, vous êtes ; they are, ils sont, &c. Je regarde chacun de ces mots-là avec la signification particuliere, & non comme venant d'un même verbe. Am, signifie suis, comme sun signifie soleil, ainsi des autres.
Les Espagnols ont trois conjugaisons, qu'ils distinguent par la terminaison de l'infinitif. Les verbes dont l'infinitif est terminé en ar, font la premiere conjugaison : ceux de la seconde se terminent en er : enfin ceux de la troisieme en ir.
Ils ont quatre auxiliaires, haver, tener, ser & estar. Les deux premiers servent à conjuguer les verbes actifs, les neutres & les réciproques : ser & estar sont destinés pour la conjugaison des verbes passifs.
La maniere de conjuguer des Espagnols, est plus analogue que la nôtre à la maniere des Latins. Leurs verbes ne sont précédés des pronoms personnels, que dans les cas où ces pronoms seroient exprimés en Latin par la raison de l'énergie ou de l'opposition. Cette suppression des pronoms vient de ce que les terminaisons Espagnoles font assez connoître les personnes.
| I. CONJUGAISON. |
|
II. CONJUGAISON. |
|
III. CONJUGAISON. | |||
| Amar, | aimer. | Comer, | manger. | Subir, | monter. | ||
| Indicatif présent. | Indicatif présent. | Indicatif présent. | |||||
| Singulier. | Singulier. | Singulier. | |||||
| Amo, | j'aime. | Como, | je mange. | Subo, | je monte. | ||
| Amas, | tu aimes. | Comes, | tu manges. | Subes, | tu montes. | ||
| Amat, | il aime. | Come, | il mange. | Sube, | il monte. | ||
| Pluriel. | Pluriel. | Pluriel. | |||||
| Amamos, | nous aimons. | Comemos, | nous mangeons. | Subimos, | nous montons. | ||
| Amais, | vous aimez. | Comeis, | vous mangez. | Subis, | vous montez. | ||
| Aman, | ils aiment. | Comen, | ils mangent. | Suben, | ils montent. | ||
Ce n'est pas ici le lieu de suivre toute la conjugaison, ce détail ne convient qu'aux grammaires particulieres ; je n'ai voulu que donner ici une idée du génie de chacune des langues dont je parle par rapport à la conjugaison.
Les Italiens, dont tous les mots, si l'on en excepte quelques prépositions ou monosyllabes, finissent par une voyelle, n'ont que trois conjugaisons comme les Espagnols. La premiere est en are, la seconde en ére long ou en ére bref, & la troisieme en ire.
On doit avoir des listes particulieres de toutes les terminaisons de chaque conjugaison réguliere, rangées par modes, tems, nombres & personnes, en sorte qu'en mettant les lettres radicales devant les terminaisons, on conjugue facilement tout verbe régulier. On a ensuite des listes pour les irréguliers, sur quoi on peut consulter la méthode Italienne de Veneroni, in 4°. 1688.
A l'égard du François, il faut d'abord observer que tous nos verbes sont terminés à l'infinitif ou en er, ou en ir ou en oir, ou en re, ainsi ce seul mot technique er-ir-oir-re, énonce par chacune de ces syllabes chacune de nos quatre conjugaisons générales.
Ces quatre conjugaisons générales sont ensuite subdivisées en d'autres à cause des voyelles, ou des diphtongues, ou des consonnes qui précedent la terminaison générale ; par exemple, er est une terminaison générale, mais si er est précédé du son mouillé foible, comme dans envo-yer, ennu-yer, ce son apporte quelques différences dans la conjugaison ; il en est de même dans re, ces deux lettres sont quelquefois précédées de consonnes, comme dans vaincre, rendre, battre, &c.
Je crois que plûtôt que de fatiguer l'esprit & la mémoire de regles, il vaut mieux donner un paradigme de chacune de ces quatre conjugaisons générales, & mettre ensuite au-dessus une liste alphabetique des verbes que l'usage a exceptés de la regle.
Je crois aussi que l'on peut s'épargner la peine de se fatiguer après les observations que les Grammairiens ont faites sur les formations des tems ; la seule inspection du paradigme donne lieu à chacun de faire ses remarques sur ce point.
D'ailleurs les Grammairiens ne s'accordent point sur ces formations. Les uns commencent par l'infinitif : il y en a qui tirent les formations de la premiere personne du présent de l'indicatif : d'autres de la seconde, &c. l'essentiel est de bien connoître la signification, l'usage & le service d'un mot. Amusez-vous ensuite tant qu'il vous plaira à observer les rapports de filiation ou de paternité que ce mot peur avoir avec d'autres. Nous croyons pouvoir nous dispenser ici de ce détail, que l'on trouvera dans les grammaires Françoises. (F)
Conjugaison, en Anatomie, s'entend d'une paire de nerfs ou de deux nerfs, ayant la même origine & servant à la même opération de sentiment ou de mouvement, n'y ayant presqu'aucun nerf qui n'ait son semblable. Voyez Nerf.
Les anciens Medecins ne connoissoient que sept paires ou conjugaisons de nerfs, les modernes en ont découvert quarante. Voyez Nerf. Chambers. (L)
France Terme
Transfert naturel d'ADN plasmidique ou chromosomique d'une cellule bactérienne à une autre par l'intermédiaire d'un pont cytoplasmique.
Étymologie de « conjugaison »
Provenç. conjugatio, conjugazo?; espagn. conjugacion?; ital. conjugazione?; du latin conjugationem, de conjugare (voy. CONJUGUER).
- Du latin coniugatio (union, union charnelle).
conjugaison au Scrabble
Le mot conjugaison vaut 21 points au Scrabble.
Informations sur le mot conjugaison - 11 lettres, 5 voyelles, 6 consonnes, 9 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot conjugaison au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
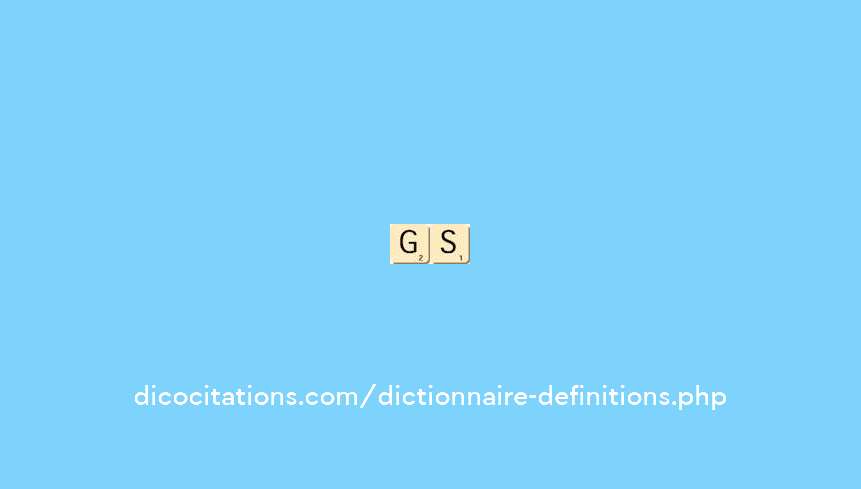
Les rimes de « conjugaison »
On recherche une rime en Z§ .
Les rimes de conjugaison peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en z§
Rimes de proposons Rimes de crevaisons Rimes de flottaisons Rimes de épuisons Rimes de protégeons Rimes de refaisons Rimes de reproduisons Rimes de péroraisons Rimes de longeons Rimes de inclinaison Rimes de corrigeons Rimes de bisons Rimes de gorgeon Rimes de rédigeons Rimes de frison Rimes de éternisons Rimes de floraisons Rimes de terminaison Rimes de scandalisons Rimes de mobilisons Rimes de montaison Rimes de poison Rimes de exhalaisons Rimes de puisons Rimes de oraisons Rimes de artison Rimes de attisons Rimes de visons Rimes de scazons Rimes de trahisons Rimes de recombinaison Rimes de trahison Rimes de engrangeons Rimes de obligeons Rimes de tison Rimes de pâmoison Rimes de vengeons Rimes de nationalisons Rimes de méson Rimes de Hingeon Rimes de construisons Rimes de traduisons Rimes de réduisons Rimes de floraison Rimes de misons Rimes de cuisons Rimes de demi-saison Rimes de inclinaisons Rimes de anti-bison Rimes de convergeonsMots du jour
proposons crevaisons flottaisons épuisons protégeons refaisons reproduisons péroraisons longeons inclinaison corrigeons bisons gorgeon rédigeons frison éternisons floraisons terminaison scandalisons mobilisons montaison poison exhalaisons puisons oraisons artison attisons visons scazons trahisons recombinaison trahison engrangeons obligeons tison pâmoison vengeons nationalisons méson Hingeon construisons traduisons réduisons floraison misons cuisons demi-saison inclinaisons anti-bison convergeons
Les citations sur « conjugaison »
- Je t'aimais. Je t'aime. Je t'aimerai. La conjugaison du bonheur !Auteur : Catel Muller, dite Catel - Source : Olympe de Gouges (2012)
- Quand on ne parvient pas à retenir une conjugaison, c'est que le verbe n'existe pratiquement pas.Auteur : Jean-Philippe Blondel - Source : Le Baby-sitter (2010)
- Le passé-présent... c'est le temps qui manque à la conjugaison des verbes.Auteur : Martine Vergne - Source : Tentatives (1978)
- Au primaire, il y a des gamins qui apprennent leurs tables et leurs conjugaisons. Moi, j'ai appris des choses plus utiles: les plus forts aiment bien marcher sur la gueule des autres, et s'essuyer les pieds au passage, comme on fait sur les paillassons.Auteur : Marie-Sabine Roger - Source : La tête en friche (2009)
- Les ruptures difficiles avec les femmes, c'est souvent à cause de la conjugaison. A chaque fois qu'on leur a dit je t'aime, on aurait du préciser que c'était du présent.Auteur : Jean Gouyé, dit Jean Yanne - Source : Sans référence
- Le désert est un creuset où se mêlent le temps et l'espace.
De cette conjugaison silencieuse naît une autre conception de la personne humaine, invitée sur la Terre et qui ne saurait rien posséder. Auteur : Gérald Tenenbaum - Source : L'Affinité des traces (2012)
- La conjugaison, c'est comme les femmes : il est impératif de leur faire des présents, pour être plus que parfait !Auteur : Kathy Dorl - Source : Déconfitures et pas de pot (2015)
- Etre... à l'imparfait. Cette conjugaison frappa Andrew avec la force d'un boulet de canon qui percute l'enceinte d'une forteresse. Avoir été, et ne plus être qu'un corps en décomposition.Auteur : Marc Lévy - Source : Un sentiment plus fort que la peur (2013)
- Je t'aime, tu m'aimais : le problème des couples, c'est la conjugaison.Auteur : Frédéric Martinez - Source : Petit éloge des vacances (2013)
- Quand elle me faisait réciter mes conjugaisons, à l'école primaire, elle choisissait toujours des verbes joyeux, nous les appelions les joyaux de la couronne, récite-moi un joyeux joyau du troisième groupe Jeanne, et détache bien les lettres que je voie si c'est su ; nous avions des favoris, revivre, comprendre, résoudre, elle détestait conquérir et moudre ou traire, mais rire était notre préféréAuteur : Marie-Hélène Lafon - Source : Nos vies
- La beauté est la conjugaison du hasard et du malheur.Auteur : Umar Timol - Source : Les Affreurismes (2005)
- Quand il racontait quelque chose, il parlait au passé simple et la musique de sa conjugaison m'envoûtait.Auteur : Grégoire Delacourt - Source : La Liste de mes envies (2012)
- Conclusion: le conditionnel est la plus jolie conjugaison du monde et il va sans dire, la plus confortable « J'aimerais, j'aurais aimé ...» Auteur : Paule Saint-Onge - Source : La Saison de l'inconfort
- Le verbe aimer était responsable du mariage de mes parents. Ma soeur et moi étions un effet, une des étranges conséquences de la conjugaison.Auteur : Erri De Luca - Source : Les poissons ne ferment pas les yeux (2013)
- Le conditionnel est la plus jolie conjugaison du monde et il va sans dire, la plus confortable Auteur : Paule Saint-Onge - Source : La Saison de l'inconfort
- C'est curieux le nombre de conjugaisons qu'on passe son temps à faire, dans la langue française. Je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons.Auteur : Jean Anouilh - Source : Le Boulanger, la Boulangère et le Petit Mitron (1968)
- En 1530 Robert Estienne utilise l'accent aigu pour distinguer les participes passés de la première conjugaison, de la première personne de l'indicatif présent.Auteur : Pascal Quignard - Source : Petits traités, tome III (1984)
- Nos enfants sont perturbés, ils ont dans la tête plus de marques et de logos que de théorèmes et de conjugaisons.Auteur : Régis Jauffret - Source : Microfictions (2007)
- Partir, appartenir à la beauté, la beauté hors de toute conjugaison, réinventer le voyage, bouteille à la mer, au bout de la nuit, ballottée vers soi-même, un ailleurs sans nom, sans trêve, s'extirper de sa léthargie, sa chrysalide, l'inaccessible enfance.Auteur : Makenzy Orcel - Source : L'ombre animale (2016)
Les mots proches de « conjugaison »
Conaq Conarium Concasser Concave Concavité Concéder Concentration Concentré, ée Concentrement Concentrer Concentrique Concept Conception Concerner Concert Concertant, ante Concertant, ante Concerté, ée Concerter Concesseur Concession Concessionnaire Concetti Concevabilité Concevable Concevoir Conche Conchite Conchoïde Concierge Conciergerie Concile Conciliabilité Conciliabule Conciliateur, trice Concilier Concion Concis, ise Concitoyen, enne Concitoyenneté Conclave Conclaviste Conclu, ue Concluant, ante Conclure Conclusion Concoction Concombre Concomitamment ConcomitanceLes mots débutant par con Les mots débutant par co
con con con Conan Conand conard conard conarde conarde conards conasse conasses Conat Conc?ur-et-Corboin Conca Conca Concarneau concassage concassait concassant concasse concassé concassée concassées concassent concasser concassés concasseur concasseurs concaténation concave concaves concavité concéda concédai concédaient concédais concédait concédant concédât concède concédé concédée concéder concéderait concèdes concédés concédez concédons concélèbrent
Les synonymes de « conjugaison»
Les synonymes de conjugaison :- 1. combinaison
2. conjonction
3. association
4. réunion
synonymes de conjugaison
Fréquence et usage du mot conjugaison dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « conjugaison » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot conjugaison dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Conjugaison ?
Citations conjugaison Citation sur conjugaison Poèmes conjugaison Proverbes conjugaison Rime avec conjugaison Définition de conjugaison
Définition de conjugaison présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot conjugaison sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot conjugaison notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 11 lettres.
