La définition de Ortie du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Ortie
Nature : s. f.
Prononciation : or-tie
Etymologie : Génev. ourtie ; wallon, ourtèie ; namur. ôrtîe ; Hainaut, ortile ; bourguig. ôtie ; picard, ortile ; Berry, ortruge ; provenç. urtica, ortiga ; espagn. ortiga ; ital. ortica ; du lat. urtica, qui se rattache à urere, brûler.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de ortie de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec ortie pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Ortie ?
La définition de Ortie
Genre de plantes sauvages, où l'on distingue l'ortie dioïque, urtica dioïca, Linné, ou grande ortie, l'ortie brûlante, urtica urens, Linné, ou petite ortie, ou ortie grièche, dont la feuille et la tige sont piquantes, et l'ortie romaine, urtica pilulifera, Linné ; genre qui est le type de la famille des urticées.
Toutes les définitions de « ortie »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Plante sauvage et fort commune, du genre des Urticacées, dont la tige et les feuilles sont piquantes. Graine, racine d'ortie. Ortie brûlante. Ortie grièche. Fig. et fam., Jeter le froc aux orties. Voyez FROC. Par analogie, Ortie blanche, ortie jaune, ortie puante, Plantes labiées, qui ne sont point du même genre que l'ortie mais qui ont avec elle une certaine ressemblance. Ortie de mer, Nom vulgaire sous lequel on désigne les Méduses, les actinies et d'autres cœlentérés, qui sécrètent un liquide produisant sur la peau l'effet de l'ortie.
Littré
-
1Genre de plantes sauvages, où l'on distingue l'ortie dioïque, urtica dioïca, Linné, ou grande ortie, l'ortie brûlante, urtica urens, Linné, ou petite ortie, ou ortie grièche, dont la feuille et la tige sont piquantes, et l'ortie romaine, urtica pilulifera, Linné?; genre qui est le type de la famille des urticées.
Leur argent, qu'ils aimaient avec tant d'ardeur, sera caché sous les orties, et l'on verra croître les épines dans leurs maisons
, Sacy, Bible, Osée, IX, 6.J'aime l'araignée et j'aime l'ortie, Parce qu'on les hait
, Hugo, Contempl. III, 27.Fig. et familièrement. Jeter le froc aux orties, renoncer à la profession monacale.
Un compère qui avait jeté le froc aux orties, ne devait pas être de trop bonnes m?urs
, Sévigné, 237.Par extension, renoncer à une profession quelconque.
Il y a bon moyen pour cela?: c'est de jeter tous les deux aux orties, vous ce rabat, elle ce collet rond
, Marmontel, Mém. II. -
2Nom de plantes diverses qui ont pour caractère commun d'avoir des feuilles d'aspect analogue à celles de l'ortie proprement dite.
Ortie jaune, nom vulgaire du galéobdolon jaune (labiées).
Ortie rouge, nom vulgaire du galéopsis ladanum (labiées) ou galéopsis versicolore, et du lamier pourpre (labiées).
Ortie blanche, le lamier blanc (labiées), appelé parfois simplement le lamier.
Ortie puante, nom vulgaire de la stachyde des forêts, dite encore ortie des crapauds et ortie morte des bois?; c'est l'épiaire des bois de certains auteurs.
Ortie bleue, la campanule trachélion (campanulacées).
Ortie morte, ou ortie royale, le galéopsis tétrahit, le lamier blanc, la stachyde palustre et la mercuriale annuelle.
Ortie grimpante, nom que porte, aux Antilles, la tragie volubile (euphorbiacées), dite aussi liane brûlante.
-
3Ortie de mer, nom vulgaire sous lequel on désigne plusieurs espèces du genre actinie?; plusieurs sécrètent une humeur âcre, irritante pour la peau de l'homme qui les a touchées, d'où le nom d'orties de mer donné à ces animaux.
Le nom d'ortie est très impropre, et ne réveille l'idée d'aucun des caractères par lesquels l'animal est connu?; le nom de cul de cheval qu'il porte sur quelques côtes de France réveille au moins l'idée de sa figure
, Bonnet, Contempl. nat. XII, 21.Ortie coralline, le madrépore murique.
- 4En art vétérinaire, sorte de séton (voy. SÉTON).
HISTORIQUE
XIIe s. Car feme à prendre, c'est grant chose?; Cil prent l'ortie, et cil la rose
, Gautier D'Arras, Éracle, V. 1263.
XIIIe s. Sa vie doit paroir necte et pure et sans fronce?; Ses euvres doivent estre sans ortie et sans ronce
, J. de Meung, Test. 734.
XIVe s. Pour assaut, pour estour, ne pour nulle envaïe, N'i avoient conquis une foeille d'ortie, Et s'avoient perdut de cheulz [ceux] de leur partie
, Baud. de Seb. IX, 830.
XVIe s. Comme une fleur qui a langui longtemps dans un hallier d'horties et de serpens
, D'Aubigné, Hist. Préf. VI. Vous sortirez des bois et de devotion, Et jetterez bien-tost vostre froc aux orties
, Desportes, Diane, II, 9. Quand on voit les orties de mer nager sur l'eau, c'est signe de tempeste?; ils sont de couleur de cristal reluisant, avec du pers meslé, de substance si fragile qu'à peine en peut-on tirer d'entiere de la mer
, Paré, Anim. II. Il cognoist tost l'ortie qui ortier doit
, Leroux de Lincy, Prov. t. I, p. 81.
Encyclopédie, 1re édition
ORTIE, urtica, s. f. (Hist. nat. Bot.) genre de plante à fleur sans pétales, & composée d'étamines, soutenues par un calice ; cette fleur est stérile. Les embryons naissent sur des individus qui ne portent point de fleurs, & ils deviennent dans la suite chacun une capsule composée de deux pieces qui renferme une semence. Dans quelques especes les capsules sont réunies en forme de boucle ; enfin il y en a d'autres dont les embryons deviennent un fruit qui ressemble à une pince entre les branches, de laquelle on trouve une semence. Tournefort, inst. rei herb. Voyez Plante. (I)
Ortie-morte, lamium. Genre de plante à fleur monopétale, labiée, dont la levre supérieure est en forme de cuilliere, & l'inférieure en forme de c?ur, & divisée en deux parties ; elles aboutissent toutes les deux à une sorte de gorge frangée. Le pistil sort du calice qui est fait en tuyau & partagé en cinq parties. Il est attaché comme un clou à la partie postérieure de la fleur, & entouré de quatre embryons. Ils deviennent dans la suite autant de semences triangulaires, renfermées dans une capsule qui a servi de calice à la fleur. Tournefort, inst. rei herb. Voyez Plante.
Entre les orties mortes connues des Botanistes sous le nom de lamium, il y en a quatre especes employées dans les boutiques ; savoir, la blanche, la rouge, la jaune & la puante.
L'ortie morté à fleur blanche, lanium vulgare album, sive archangelica flore albo, J. R. H. 183, a ses racines nombreuses & fibreuses. Elle s'étend beaucoup par un grand nombre de rejettons qui rampent obliquement sur terre, presque comme la mente. Ses tiges sont hautes d'un pied ou d'une coudée, quarrées, grosses, cependant foibles, creuses, un peu vélues, branchues, & entrecoupées de quelques n?uds, purpurins vers la terre dans les lieux exposés au soleil.
Ses feuilles sont deux à deux & opposées, semblables à celles de l'ortie commune ; mais celles du haut des tiges sont couvertes d'un duvet court, & non piquant.
Ses fleurs naissent des n?uds & par anneaux autour des tiges ; elles sont assez grandes, d'une seule piece, en gueule, blanches, & plus pâles en dehors que jaunes. La levre supérieure ou le casque est creusé en maniere de cuillere garnie de poils, renfermant en dedans quatre petites étamines, deux plus longues, & deux plus courtes. La levre inférieure est échancrée en c?ur ; elles sont terminées l'une & l'autre en maniere de gorge, bordée d'un feuillet.
Les sommets des étamines sont bordés de noir, & représentent en quelque sorte un 8 de chiffre. Leur pistil est un filet fourchu placé entre les étamines ; il s'éleve du fond du calice, & est attaché à la partie postérieure en maniere de clou. Le calice est ample, évasé en tuyau, cannelé, partagé en cinq segmens, oblongs, étroits, terminés par cinq petites épines pointues, mais qui ne font point de mal. Le pistil est accompagné au fond du calice de quatre embryons, qui se changent ensuite en autant de graines angulaires, unies ensemble, cachées dans une capsule qui servoit de calice à la fleur.
L'odeur de cette plante est un peu forte ; on la trouve le long des haies, des chemins, des murailles, dans les décombres, les buissons, & assez dans les jardins qui ne sont pas bien cultivés.
L'ortie morte à fleur rouge, ou à fleur purpurine, lamium folio oblongo, flore purpureo, J. R. H. 183, ne differe de la précédente que par sa couleur purpurine.
L'ortie morte à fleur jaune, lamium luteum, folio oblongo, C. B. P. 231. Galeopsis, sive urtica iners flore luteo, I. R. H. 185, a ses fleurs d'une seule piece en gueule & jaunes.
L'ortie morte puante, est nommée par Tournefort, lamium purpureum, f?tidum, folio subrotundo, sive galeopsis dioscoridis, J. R. H. 183. Sa racine est menue, fibreuse, non rempante ; ses tiges sont nombreuses, quarrées, creuses, presque lisses, assez hautes, branchues près la terre, ensuite garnies d'une ou de deux paires de feuilles, presques nues vers le sommet, & hautes d'un demi-pié. Ses fleurs sont au sommet des branches en grand nombre, & par anneaux, d'une seule piece en gueule, petites, purpurines, ayant la levre inférieure marquée de taches d'un noir fonce.
Les calices des fleurs sont courts, évasés, cannelés, sans pédicules, partagés en cinq parties ; ils contiennent dans leur fond quatre graines oblongues, triangulaires, brunes & luisantes quand elles sont mûres. Ses feuilles ressemblent à celles de l'ortie, mais elles sont plus petites & plus courtes, molles, crénelées à leur bord, portées sur des queues d'un demi pouce. Toute cette plante a une odeur fétide & désagréable ; elle vient dans les haies & sur les masures, dans les décombres & dans les lieux incultes des jardins. (D. J.)
Ortie morte, (Mat. méd.) ortie blanche, ortie qui ne pique point. Les Médecins modernes recommandent cette plante pour les fleurs blanches, les maladies du poumon, les tumeurs & les duretés de la rate, & sur-tout pour arrêter les hémorrhagies de la matrice, & pour consolider les playes. L'expérience journaliere fait voir que ces vertus sont en effet très-réelles, quant aux fleurs blanches & aux pertes des femmes. On fait macérer ses sommités fleuries dans de l'eau bouillante en guise de thé, & on donne un ou deux verres de cette infusion deux ou trois fois le jour. On en fait des bouillons, ou bien on fait une conserve de ses feuilles, dont on prend une once tous les jours.
L'ortie morte à fleurs rouges ne differe de la précédente que par la couleur de ses fleurs. On dit qn'elle est utile comme la précédente, mais elle est moins employée. L'ortie morte puante est aussi quelquefois substituée aux deux autres, mais rarement. On en recommande d'ailleurs la décoction contre la dissenterie. On dit encore qu'étant pilée & appliquée extérieurement, elle est propre à dissiper toutes sortes de tumeurs, & même à appaiser les inflammations, déterger les ulceres putrides, & faire cicatriser les playes. Geoffroi, mat. méd. C'est encore ici une des mille plantes exaltées par tous les Botanistes, & que personne n'emploie. (b)
Ortie piquante, (Botan.) Entre les neuf especes d'ortie piquante que distingue M. de Tournefort, il nous convient de décrire ici la grande, la petite, & la romaine ou la grecque.
La grande ortie piquante ou l'ortie commune, en anglois the common stinging-nettle, est nommée urtica urens maxima, C. B. P. 232. J. R. H. 534. Urtica vulgaris major. J. B. 3. 445. Raii hist. 160.
Sa racine est menue, fibrée, serpentante au loin, de couleur jaunâtre. Elle pousse des tiges à la hauteur de trois piés, quarrées, cannelées, trouées, couvertes d'un poil piquant, creuses, rameuses, revêtues de feuilles opposées deux à deux, oblongues, larges, pointues, dentelées en leurs bords, garnies de poils fort piquans & brûlans, attachées à des queues un peu longues. Ses fleurs naissent aux sommités des tiges & des rameaux dans les aisselles des feuilles, disposées en grappes branchues, composées chacune de plusieurs étamines soutenues par un calice à quatre feuilles de couleur herbeuse ; ces fleurs ne laissant aucune graine après elles.
Ainsi l'on distingue comme dans le chanvre, les orties en mâle & en femelle. L'ortie mâle porte sur des piés qui ne fleurissent point, des capsules pointues, formées en fer de pique, brulantes au toucher, qui contiennent chacune une semence ovale applatie, luisante. L'ortie femelle ne porte que des fleurs, & ne produit aucun fruit ; ce qui est une maniere de parler usitée seulement chez le vulgaire : car les Botanistes appellent proprement fleurs mâles celles qui ne sont point suivies de graines, & leurs semelles celles qui en sont suivies.
Cette plante croit presque par tout en abondance, particulierement aux lieux incultes & sabloneux, dans les hayes, dans les fossés, contre les murailles, dans les bois mêmes & dans les jardins ; elle fleurit en Juin, & la graine mûrit en Juillet & Août. Ses feuilles se flétrissent ordinairement tous les ans en hiver ; mais sa racine ne périt point, & repousse de nouvelles feuilles dès le premier printems. On fait usage en médecine de ses racines, de ses feuilles & de ses semences. On peut aussi faire de la toile de ses tiges, comme l'on en fait de celles de chanvre. L'ortie commune varie quelquefois pour la couleur de ses tiges, de ses racines & de ses feuilles ; on l'appelle alors ortie rouge, ortie jaune ou panachée.
La petite ortie, ou l'ortie griesche, est nommée urtica urens minor, par C. B. P. 232, & par Tournefort. Inst. R. H. 535. Sa racine est simple, assez grosse, blanche, garnie de petites fibres, annuelle. Elle pousse des tiges hautes d'un demi pié, assez grosses, quarrées, dures, cannelées, rameuses, piquantes, moins droites que celle de la précédente. Ses feuilles naissent opposées deux à deux, plus courtes & plus obtuses que celles de la grande ortie, profondément dentelées le long des bords, fort brulantes au toucher, d'un verd-brun enfoncé, attachées à de longues queues. Ses fleurs sont à étamines disposées par petites grappes en forme de croix dans les aisselles des feuilles, de couleur herbeuse, les unes mâles ou stériles, les autres femelles ou stériles, toutes sur le même pied. Lorsque ces dernieres sont passées, il leur succede de petites capsules formées à deux feuillets appliqués l'un contre l'autre, qui enveloppent chacune une semence menue, oblongue, applatie, luisante, roussâtre. Cette plante croît fréquemment le long des maisons, parmi les décombres des bâtimens, dans les jardins potagers, où elle se renouvelle tous les ans de graine, ne pouvant endurer la rigueur de l'hiver. L'herbe est sur tout d'usage en Médecine.
L'ortie romaine, autrement l'ortie grecque, ou l'ortie mâle, est nommée urtica urens, pilulas ferens, prima Dioscoridis, semine lini, par C. B. P. 232, & par Tournefort, I. R. H. 535. Ses feuilles sont larges, pointues, profondément dentelées en leur bord, couvertes d'un poil rude, brillant & brûlant. Ses fleurs naissent des aisselles des feuilles vers les sommités de la tige & des branches, semblables à celles des deux especes précédentes. Quand ces fleurs sont passées, il leur succede des globules ou pilules vertes, qui sont autant de petits fruits ronds gros comme des pois, tout hérissés de piquans, attachés à de longs pédicules, composés de plusieurs capsules qui s'ouvrent en deux parties, & renferment chacune une semence ovale, pointues, applatie, lisse, glissante & douce au toucher comme de la graine de lin. Cette plante croît aux pays froids, comme aux pays chauds, dans les hayes, dans les prés, dans les bois taillis & ombrageux, est plus rare que les deux autres, & on la seme pour le plaisir dans les jardins ; elle fleurit en été, & sa graine mûrit en Juillet & Août ; elle ne soutient point l'hiver, & périt tous les ans. Sa semence est sur-tout en usage.
J'ai répété continuellement, que les feuilles d'orties piquantes sont chargées de pointes aiguës qui penetrent la peau quand on les touche, & causent de la chaleur, de la douleur & de l'enflure. On croyoit autrefois que ces symptômes devoient s'attribuer aux piquans qui restoient dans la blessure qu'ils faisoient, mais le microscope a découvert quelque chose de bien plus étonnant dans cette plante. Il montre que ces piquans sont formés pour agir de la même maniere que les aiguillons des animaux. En effet chacun de ces piquans est un corps roide, creux, & terminé dans une pointe très-aiguë, avec une ouverture à son extrémité. Au fond de cette pointe est une vésicule pellucide contenant une liqueur limpide, qui lors qu'on touche le moins du monde, coule à l'extrémité ; & si cette liqueur entre dans la peau, elle produit les accidens ci-dessus mentionnés par la pointe de ses sels, de-là vient que les feuilles d'ortie, quand elles ont été un peu séches au soleil, ne piquent presque point du tout. (D. J.)
Ortie, (Méd.) On emploie indifféremment en médecine trois especes d'ortie ; la grande ortie piquante, ou ortie commune ; la petite ortie ou ortie grieche ; & l'ortie romaine, ortie grecque, ou ortie mâle.
On croit que l'ortie en latin urtica, a été ainsi nommée du mot latin urere, bruler, parce que cette plante est courte, d'un poil fin, aigu & roide, qui étant appliquée à la peau fait éprouver un sentiment de brulure, & excite en effet de la chaleur, de la rougeur, de la démangeaison & des pustules. Ces accidens sont passagers, & on peut les adoucir chez ceux qui sont très-délicats ou très-impatiens, en frottant legerement la partie avec de l'huile d'olive, d'autres disent le suc de tabac, une feuille d'ortie pilée, ou le suc exprimé de la même plante : mais ce dernier secours a quelque chose de mystérieux, d'occulte, capable d'ébranler la confiance des personnes raisonnables, & celles qui sont versées dans ces matieres peuvent conjecturer avec vraissemblance qu'un suc purement extractif quelconque, feroit ici tout aussi-bien que le suc d'ortie. Au reste cet effet de l'ortie appliquée à la peau, a été procuré à dessein par les anciens Médecins & par quelques modernes, & mis au rang des ressources thérapeutiques ou des remedes. Ce secours est connu dans l'art sous le nom d'urtication. Voyez Urtication.
Les feuilles & les racines d'ortie ont un goût fade, gluant & legérement stiptique. Le suc de ces parties dépuré par le repos ou à l'aide d'une courte ébullition, est employé fort communément à la dose de deux jusqu'à quatre onces dans le crachement de sang, l'hémorragie habituelle du nez, & le flux trop abondant des hémorrhoïdes. On le donne aussi pour les fleurs blanches, mais ordinairement avec beaucoup moins de succès.
L'infusion théïforme des feuilles d'ortie est d'ailleurs recommandée contre le rhumatisme, la goutte, la gravelle, &c. & sa décoction pour boisson ordinaire pour les fievres malignes, la petite-verole & la rougeole ; ses feuilles pilées & réduites en cataplasme, & appliquées sur le côté contre la plurésie, &c. mais tous ces éloges sont peu confirmés par l'expérience, & l'ortie est peu employée dans tous ces cas.
On emploie aussi quelquefois cette plante réduite sous forme de cataplasme pour les affections inflammatoires extérieures, & c'est encore-là un secours peu usité.
La semence d'ortie qui est peu ou point employée dans les prescriptions magistrales, entre dans quelques compositions officinales, telles que le sirop de guimauve composé, l'onguent martiatum, &c.
Ortie puante, (Botan.) genre de plante nommée par Tournefort galeopsis. Voyez ce mot.
Les deux principales especes de ce genre de plante, sont la grande & la petite ortie puante.
La grande ortie puante, galeops procerior, f?tida, sulcata, J. R. H. 185, pousse une racine qui rampe sur terre, & donne quelques fibres grêles qui sortent de ses n?uds. Ses tiges sont hautes d'une coudée ou d'une coudée & demie, quarrées, velues, creuses, branchues. Ses feuilles sont deux-à-deux, opposées, un peu plus larges que celles de la grande ortie ordinaire, pointues, couvertes d'un duvet mol, dentelées à leur bord, portées sur de longues queues, mêmes celles qui naissent des tiges. Ses fleurs naissent à l'extrémité des tiges & des rameaux, disposées par anneaux écartés, & forment des épis longs & grêles : elles sont d'une seule piece, en gueule, purpurines ; la levre supérieure est creusée en cuilleron, & marquée en-dessus de lignes blanches ; & l'inférieure est partagée en trois, dont le segment du milieu est obtus, long, large, réfléchi des deux côtés, & les deux autres sont petits & courts. Les étamines sont purpurines, & répandent une odeur fétide & forte. Le calice est découpé en cinq parties, court, évasé ; il en sort un pistil attaché à la partie postérieure de la fleur en maniere de clou, & comme accompagné de quatre embryons qui se changent en autant de graines oblongues, d'une grandeur médiocre, noires quand elles sont mûres, cachées dans le fond du calice. Toute cette plante a une odeur fétide & fort désagréable : elle est d'usage. Elle vient communément aux environs de Paris. Cette ortie a une odeur fétide de bitume, avec un goût d'herbe un peu salé & astringent. On met cette plante au rang des vulnéraires, & on emploie l'huile dans laquelle on a macéré ses feuilles & ses fleurs pour la brûlure.
La petite ortie puante, galeopsis palustris betonicæ folio, flore variegato, J. R. H. 185, jette une racine noueuse, rampante, inégale & bosselée. Ses tiges sont hautes de deux ou trois coudées, un peu rougeâtres, velues, rudes, quarrées, creuses. Ses feuilles naissent des n?uds, opposées, étroites, pointues, velues, molles, traversées en-dessous par une côte rougeâtre, un peu rudes, dentelées à leurs bords, d'une odeur forte, d'une saveur un peu amere. Ses fleurs sont disposées en épi & par anneaux, d'une seule piece, en gueule, purpurines, ayant les lévres panachées : leur calice est court, partagé en cinq quartiers : les graines sont au nombre de quatre, noires, luisantes, presque triangulaires. Cette plante vient naturellement dans les forêts humides, & sur le bord des ruisseaux.
Les feuilles de petite ortie puante sont ameres & fétides ; leur suc ne change presque point le papier bleu : elle paroissent contenir un sel essentiel ammonical, enveloppé dans beaucoup d'huile. On donne à cette plante les mêmes vertus qu'à la précédente. (D. J.)
Orties de mer, poissons-fleurs, urticæ, (Hist. nat. Ichtiolog.) insectes de mer dont il y a un grand nombre d'especes qui different entr'elles par la forme, par la couleur & par la nature de leur substance. Les anciens auteurs, tels qu'Aristote, Pline, &c. prétendoient que la plûpart des orties de mer restoient toujours attachées aux rochers, comme les plantes marines. M. de Réaumur a reconnu qu'elles avoient toutes un mouvement progressif. Il les a divisées en deux classes ; la premiere comprend toutes les especes d'orties qui restent toujours appliquées contre les rochers ; la seconde classe renferme les orties errantes, c'est-à-dire, celles que l'on trouve flottantes. M. de Réaumur a donné a celles-ci le nom de gelée de mer. La plûpart des orties de la premiere classe, se mouvent avec une telle lenteur, qu'on ne peut reconnoître leur mouvement progressif, qu'en marquant l'endroit où la partie de l'ortie la plus alongée est à une certaine heure, & celui où cette même partie se trouve quelque tems après ; elles parcourent à peine la longueur d'un pouce en une heure. Rondelet dit qu'on a donné à ces corps marins le nom d'orties, parce qu'ils causent une démangeaison cuisante, & semblable à celle que l'on ressent quand on touche la plante qui porte le même nom. M. de Réaumur n'a pas éprouvé cet effet dans les especes d'orties de mer qu'il a eu occasion de voir sur les côtes du Poitou & d'Aunis.
Il n'est guere possible de déterminer la figure de ces orties de mer, parce qu'elles changent très-souvent de forme ; la figure extérieure de leur corps approche de celle d'un cône tronqué, dont la base est appliquée contre les rochers : cette base qui paroît souvent circulaire, est aussi elliptique, ou de figure irréguliere ; quelquefois le cône est perpendiculaire à sa base, & d'autresfois oblique. Sa hauteur diminue ou augmente à mesure que la base a plus ou moins d'étendue ; la surface supérieure est ordinairement convexe ; il y a au milieu de cette surface une ouverture que l'ortie rend plus ou moins grande à sa volonté : pour prendre une idée plus juste de ce méchanisme, on peut comparer l'ortie à une bourse à jettons ; elle se ferme de même ; mais l'extérieur ne forme point de plis comme la bourse. Plus l'ouverture est grande, & plus on voit de parties intérieures. Si l'ortie replie en-dehors la partie qui correspond au contour d'une bourse, la surface intérieure se trouve alors à l'extérieur, & l'on voit toutes les cornes de cet insecte, qui ressemble dans cet état à une fleur épanouie, ce qui lui a fait donner le nom de poisson-fleur. Les contours varient non seulement dans les différentes especes d'orties de mer, mais encore dans les individus de la même espece. Il y en a de verdâtres, de blanchâtres, d'autres de couleur de rose, ou d'un brun de différentes teintes. Il y a quelques orties dont toute la surface est d'une seule couleur ; d'autres ont plusieurs couleurs par taches ou par raies qui sont distribuées ou régulierement, ou irrégulierement. Les orties vertes ont ordinairement une bande bleue qui a une ligne de largeur, & qui s'étend tout autour de leur base. Les orties de mer paroissent sensibles lorsqu'on les touche. Elles se nourrissent de la chair de petits poissons & de différens coquillages qu'elles font entrer tout entier dans l'ouverture dont nous avons parlé plus haut, & qu'elles élargissent à mesure de la grosseur du coquillage ; alors elles rétrecissent cette ouverture, & sucent l'animal de la coquille bivalve ou autre ; ensuite elles rejettent la coquille par la même ouverture. Les orties sont des animaux vivipares ; car les petites sortent du corps de leur mere aussi-bien formées qu'elle.
Les orties que M. de Réaumur appelle gelée de mer, différent à tous égards de celles dont nous venons de parler ; elles sont d'une substance très-molle, qui a ordinairement la couleur & toujours la consistance d'une vraie gelée : si on en prend un morceau avec les doigts, la chaleur seule de la main suffit pour dissoudre cette substance, comme une gelée de bouillon qu'on mettroit sur le feu. Ces gelées sont de vrais animaux dont il y a plusieurs especes très-différentes les unes des autres par leur conformation. Les individus de la même espece ont exactement la même figure : il y a de ces gelées qui sont d'une couleur verdâtre, semblable à celle de la mer ; d'autres ont tout-au-tour de leur circonférence une bande de deux ou trois lignes de largeur & de couleur de pourpre ; enfin on en voit aussi qui sont verdâtres, & qui ont des taches brunes éparses.
Les orties errantes ont l'une des faces convexe, & l'autre concave à-peu-près comme un champignon. On distingue sur la surface convexe une infinité de grains ou de petits mamelons qui sont de la même couleur que le reste de l'ortie, & on voit sur l'autre surface des parties organisées. Il y a un peu au-delà de son bord, qui est mince & découpé, des cercles concentriques, qui ne regnent cependant pas tout-au-tour de la circonférence. Les plus près du centre sont divisés en seize arcs, & les extérieurs seulement en huit. Ces séparations sont des especes de canaux, ou reservoirs toujours pleins d'eau. M. de Reaumur a fait bouillir dans de l'eau une gelée de mer dont la base avoit plus de deux piés de diametre ; elle a conservé sa figure, mais son diametre n'étoit plus que d'un demi-pié ; sa substance étoit devenue plus solide.
Les gelées de mer jettées par les vagues sur la côte, n'ont plus de mouvement : les chocs qu'elles éprouvent contre les pierres & le sable suffisent sans doute pour leur ôter la vie ; alors elles vont au fond de l'eau. Celles qui sont vivantes se soutiennent sur l'eau par un espece de mouvement de contraction & de dilatation de leur corps. Elles battent l'eau de tems en tems par le moyen de ces deux mouvemens répétés alternativement, qui suffit pour les empêcher d'aller au fond de l'eau. Mém. de l'acad. royale des Sciences, année 1710. par M. de Réaumur.
Ortif toile d', (Comm.) on appelle toile d'ortie, la toile qui est faite de la filasse qui se tire de cette plante : elle est un peu grisâtre, & l'on s'en sert le plus souvent en écru.
Wiktionnaire
Nom commun - français
ortie \??.ti\ féminin
-
(Botanique) Plante aux feuilles pointues, très dentées et garnies, comme les tiges, de poils urticants.
- La grande ortie (Urtica dioica) est une plante sauvage et fort commune, de la famille des Urticacées, dont la tige et les feuilles sont piquantes.
- La petite ortie, ou ortie brûlante (Urtica urens), est plus petite.
- Tout ce qui n'était pas terre retournée était herbe, chardons ou orties. ? (Alexandre Dumas, Les Mille et Un Fantômes)
- Tout se découvrit, les vols anciens et le dernier, et elle reçut une fessée d'orties, qui lui couvrit le derrière de camboules. ? (Edmond et Jules de Goncourt, Journal, 1864, p. 57)
- Nourris de lait sûri, d'orties, puis de grenailles de pommes de terre, finalement poussés au seigle jusqu'à frôler le coup de sang, les cochons vagabondent tout le jour dans le pachis ? le clos ? autour de la maison [?] ? (Jean Rogissart, Passantes d'Octobre, Librairie Arthème Fayard, Paris, 1958)
-
(Par analogie) Plante, généralement de la famille des Lamiacées, ne faisant pas partie des Urticacées, mais présentant avec elles une certaine ressemblance.
- Ortie blanche, ortie jaune, ortie rouge, ortie puante, ortie royale.
- ? Hier vous vous êtes plainte d'avoir des volailles qui ne pondent plus. Je me suis renseigné auprès d'un spécialiste. Donnez ces orties blanches à manger à vos poules. Et elles auront des ?ufs superbes... ? (Germaine Acremant, Ces dames aux chapeaux verts, Plon, 1922, collection Le Livre de Poche, pages 294-295.)
Trésor de la Langue Française informatisé
ORTIE, subst. fém.
BOT. Plante herbacée dont les feuilles sont couvertes de poils fins renfermant un liquide qui produit sur la peau une irritation douloureuse. Infusions, shampooing, soupe à l'ortie. L'ortie, qui croît si vigoureusement le long des murs de métairies, plaît aux poules d'Inde au point que, lorsqu'elle est hachée, elle est la meilleure nourriture que l'on puisse donner à leurs poussins (Bern. de St-P., Harm. nat., 1814, p.91):Ortie au Scrabble
Le mot ortie vaut 5 points au Scrabble.
Informations sur le mot ortie - 5 lettres, 3 voyelles, 2 consonnes, 5 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot ortie au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
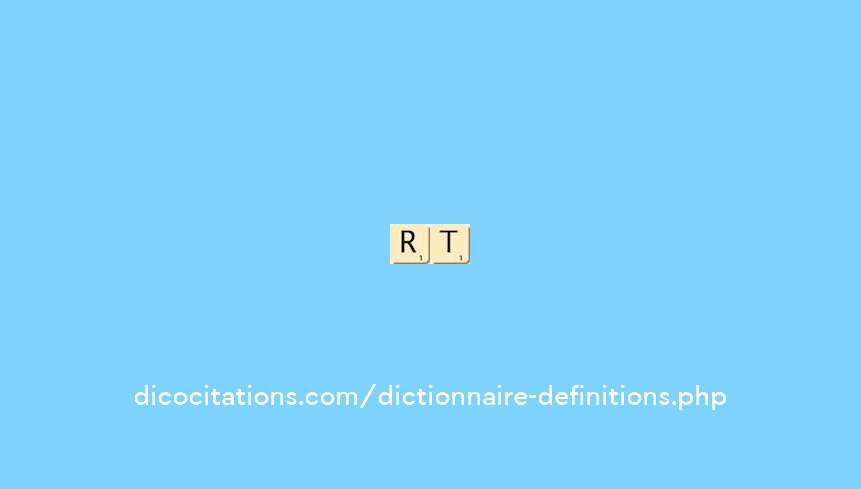
Les mots proches de Ortie
Ort Orteil Orthodoxe Orthodoxement Orthodoxie Orthodoxissime Orthognathisme Orthographe Orthographie Orthographié, ée Orthographier Orthographique Orthopédie Orthophonie Orthopnoïque Ortie Ortier Ortolan ort Ortaffa Ortale Ortale ortédrine orteil orteils Orthevielle Orthez ortho Ortho orthodontie orthodontique orthodontiste orthodontistes orthodoxe orthodoxe orthodoxes orthodoxes orthodoxie orthogonal orthogonaux orthographe orthographiait orthographie orthographié orthographiées orthographier orthographique orthographiques orthopédie orthopédique orthopédiques orthopédiste orthophonie orthophoniste orthophonistes orthoptère orthoptères orthostatique Orthoux-Sérignac-Quilhan ortie orties Ortillon Ortiporio Ortiporio Orto Orto ortolan ortolansMots du jour
Commerce Falun Moment Forclore Pareur Murage Micmac Triqueur Inustion Relancé, ée
Les citations avec le mot Ortie
- Aujourd'hui, si un homme tient la porte pour une femme, il y a de fortes chances pour que ce soit le portier.Auteur : Mae West - Source : Sans référence
- La sortie de l'euro, de l'Union européenne, ce serait une sortie de route une sortie de l'histoire. C'est le village d'Astérix sans la potion magique.Auteur : François Hollande - Source : Discours, à Crolles, 18 mars 2017.
- Il faut que vous me sortiez de la tête. Vous ne pouvez pas être ma première et ma dernière pensée de la journée pour le restant de mes jours. C'est malsain.Auteur : Daniel Glattauer - Source : Quand souffle le vent du nord (2010)
- La sortie de l'euro proposée par Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, on a vu ce que ça donnait en Grande-Bretagne. Auteur : Valérie Pécresse - Source : « Valérie Pécresse s'est un peu égarée à propos de l'euro et du Royaume-Uni », Ambre Lefèvre, The Huffington Post, 20 février 2017
- Qui donc ignore que la plupart des médecins de notre temps ont failli à leur mission de la manière la plus honteuse, en faisant courir les plus grands risques à leurs malades ? Ils se sont attachés, avec un pédantisme extrême, aux sentences d’Hippocrate, de Galien et d’Avicenne, comme si celles-ci étaient sorties du trépied d'Apollon comme autant d'oracles, et comme si on n'avait pas le droit de s'en écarter d'un iota. C'est en s'appuyant sur ces autorités que l'on crée, lorsque cela plaît aux dieux, des docteurs en médecine imbus de leur titre, mais non pas des médecins ! Auteur : Paracelse - Source : Intimatio
- La vérité était que la vie nous avait jetés aux orties, l'un et l'autre, et c'est toujours ce qu'on appelle une rencontre.Auteur : Romain Gary - Source : Clair de femme (1977)
- Ce qui m'a constamment fasciné dans le travail photographique, c'est l'instant où l'on voit apparaître sur le papier exposé, sorties du néant pour ainsi dire, les ombres de la réalité, exactement comme les souvenirs, dit Austerlitz, qui surgissent aussi en nous au milieu de la nuit et, dès qu'on veut les retenir, s'assombrissent soudain et nous échappent, à l'instar de l'épreuve laissée trop longtemps dans le bain de développement.Auteur : W. G. Sebald - Source : Austerlitz (2001)
- Je voulais être «bottier». Je devins alors une machine à gagner du temps. Le matin, au réveil, j'étais le premier habillé et descendais en salle aussitôt. J'ignorais les récréations. Les jours de sortie, je restais de même à l'Ecole devant mon pupitre.Auteur : Georges Soulès, dit Raymond Abellio - Source : Ma dernière mémoire (1971-1980)
- Quand je serais un fantôme, je reviendrai vous hanter dans votre sommeil ! je vous enlèverai votre couverture devant tout le monde ! je vous planterai un bouquet d'orties dans le cul et vous vous gratterez pour l'éternité !Auteur : Mathias Malzieu - Source : Métamorphose en bord de ciel (2011)
- Le 23 octobre, à une heure et demie du matin, l'air avait été ébranlé par une effrayante explosion; Mortier avait obéi, le Kremlin n'existait plus.Auteur : Philippe-Paul de Ségur - Source : Histoire de Napoléon et de la Grande Armée en 1812 (1824)
- Ne sautillez pas comme un peu de riz au fond du mortier. Dominez-vous, soyez maître de vous-même.Auteur : Proverbes gabonais - Source : Proverbe
- L'aristocratie a trois âges successifs: l'âge des supériorités, l'âge des privilèges, l'âge des vanités; sortie du premier, elle dégénère dans le second et s'éteint dans le dernier.Auteur : François-René de Chateaubriand - Source : Mémoires d'outre-tombe (1848), Partie 1, Livre 1, Chapitre 1
- Il arrangeait les bourgeois qu'il peignait en portiers songeurs, travaillait à les poétiser, tâchait de mettre une lueur de rêverie dans un ancien député du juste-milieu.Auteur : Les frères Goncourt - Source : Manette Salomon (1867)
- La lâcheté est de chercher à tuer des enfants et des personnes âgées avec des voitures piégées, de couper la gorge d'un captif attaché et de viser les croyants à la sortie d'une mosquée. Mais le courage est de libérer plus de 50 millions de personnes.Auteur : George W. Bush - Source : Discours devant la Fondation nationale pour la démocratie, 6 octobre 2005.
- Le suicide n'est qu'une sortie de secours.Auteur : André Birabeau - Source : Sans référence
- Toutes ces envies, toutes ces haines et detractions à l'encontre de Marius, furent bien tost après esteinctes et amorties par le grand danger qui survint à toute l'Italie du costé du ponent.Auteur : Jacques Amyot - Source : Marius, 16
- On l'a vu pour François Santoni, cet été: en Corse, ce n'est pas avec des grains de riz qu'on vous mitraille à la sortie de la cérémonie...Auteur : Laurent Ruquier - Source : C'est chronique (2002)
- Le mortier sent toujours l'ail.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe
- La peur. Voilà bien une preuve de la faiblesse de l'Angleterre. Si on a peur de ses propres pauvres, de ses propres enfants, c'est qu'on est très affaibli soi-même, qu'on se sent très vulnérable, pareil à une petite mammy toute frêle, recourbée sur sa canne, sur un bout de trottoir, au moment de la sortie des écoles comme au milieu d'un ouragan. Auteur : Thomas B. Reverdy - Source : L'hiver du mécontentement
- Il faut s'emparer des vins à leur descente de cuve, comme l'on s'emparait autrefois d'une jeune fille à la sortie d'un couvent, lorsqu'on voulait être sûr d'avoir une épouse sans tache.Auteur : Alexandre Grimod de La Reynière - Source : Sans référence
- À quatorze ans, on n'est pas censée être attendue par un homme de 50 ans à la sortie de son collège, on n'est pas supposée vivre à l'hôtel avec lui, ni se retrouver dans son lit [...]Auteur : Vanessa Springora - Source : Le consentement (2020)
- La honte ne cessait pas de menacer les filles. Leur façon de s’habiller et de se maquiller, toujours guettée par le trop : court, long, décolleté, étroit, voyant, etc., la hauteur des talons, leurs fréquentations, leurs sorties et leurs rentrées à la maison, le fond de leur culotte chaque mois, tout d’elles était l’objet d’une surveillance généralisée de la société. Auteur : Annie Ernaux - Source : Les Années (2008)
- Vent qui souffle à la sortie de la messe de minuit, dominera l'an qui suit.Auteur : Dictons français - Source : Dicton
- Une phrase percutante sortie de son contexte : plus qu'une philosophie en concentré, une invitation à philosopher.Auteur : Vincent Cespedes - Source : Tous philosophes ! 40 invitations à philosopher (2008)
- La haine est la plus scélérate des concubines : elle drape ton lit d'orties, bourre tes oreillers d'insomnies, profite de ta somnolence pour s'emparer de ton esprit ; le temps de te ressaisir, et déjà tu es au purgatoire.Auteur : Mohammed Moulessehoul, dit Yasmina Khadra - Source : L'Ecrivain (2001)
Les citations du Littré sur Ortie
- Que d'un art délicat les pièces assorties N'y forment qu'un seul tout de diverses partiesAuteur : BOILEAU - Source : Art p. I
- Ce temple [de Janus] demoura fermé 43 ans, tant estoient toutes occasions de guerres et par tout esteintes et amortiesAuteur : AMYOT - Source : Numa, 32
- J'ai su là-bas que pour quelques emplettes Éliante est sortie et Celimène aussiAuteur : Molière - Source : Mis. I, 2
- Tout cet ouvrage [les murs de Derbent] paraît d'une seule pièce, il est bâti de grès et de coquillages broyés qui ont servi de mortier, et le tout forme une masse plus dure que le marbreAuteur : Voltaire - Source : Russie, II, 16
- Le joug que vous portiez si délibérément et avec tant de courageAuteur : BOURD. - Source : Pensées, t. II, p. 442
- Elles commencent à bastir en leurs ruches, en voute, d'un artifice merveilleux, depuis le bas jusques en haut du plancher, laissans deux limites, l'une pour l'entrée et l'autre pour la sortieAuteur : PARÉ - Source : Animaux, 7
- Je trouve mon portier bien impertinent d'entendre ainsi les raisons de tout le monde ; oh ! je vois bien qu'il faut que je prenne un suisseAuteur : LEGRAND - Source : Usurier gentilhomme, sc. 10
- Dans un mortier, de l'eau ne pileAuteur : LEROUX DE LINCY - Source : ib.
- Nous étions assiégés par un océan de flammes [dans l'incendie de Moscou] : elles bloquaient toutes les portes de la citadelle [le Kremlin], et repoussèrent les premières sorties qui furent tentéesAuteur : SÉGUR - Source : Hist. de Nap. VIII, 7
- Qui me donnera le burin que Job désirait pour graver sur l'airain et sur le marbre cette parole sortie de sa bouche en ses derniers jours, que....Auteur : BOSSUET - Source : le Tellier.
- Un carrosse à trente-six portieres [une charrette]Auteur : OUDIN - Source :
- Ô vous, pauvres, quelque nom que vous portiez, vous que la reine servait avec tant de foiAuteur : BOSSUET - Source : Mar.-Thér.
- Melon, pommette, quand l'uvée est tellement grosse et sortie, qu'elle represente, suspendue, une pommetteAuteur : PARÉ - Source : XV, 5
- Votre tante n'est encore qu'éveillée ; et, entre le réveil et la sortie d'une demi-vieille, il y a bien des cérémonies de toiletteAuteur : DUFRESNY - Source : le Double veuvage, I, 2
- [La honte et la crainte] sorties du maudit et clandestin mariage de l'esprit humain avec la persuasion diaboliqueAuteur : CHARRON - Source : Sagesse, I, 34
- Il est [le thème chanté par Charon, dans l'Alceste de Gluck] toujours précédé et suivi de trois sons de cors donnant la même note que la voix, mais d'un caractère mystérieux, rauque, caverneux.... les deux cors à l'unisson, avec leurs notes toniques et dominantes, et par conséquent leurs sons ouverts, ne produisaient point du tout ce qu'il [Gluck] cherchait ; enfin il s'avisa de faire aboucher les cors, pavillon contre pavillon ; les deux instruments se servant ainsi mutuellement de sourdine, et les sons s'entre-choquant à leur sortie, le timbre extraordinaire fut trouvéAuteur : H. BERLIOZ - Source : à travers chants, p. 184
- Nous avons appris qu'à votre sortie d'Égypte, le Seigneur sécha les eaux de la mer RougeAuteur : SACI - Source : Josué, II, 10
- Jamais un de ces moments de vivacité qui ait pu marquer que sa grande âme était sortie de son assietteAuteur : MASS. - Source : Conti.
- Le lendemain sous couleur de parlementer les Refformez dessignerent une sortie vers le parcAuteur : D'AUB. - Source : ib. II, 150
- Tous menus officiers du roy, jusques aux valets de pied, portiers, huissiers de salle, valets de fouriere, serdeleau, y estoient à souhaict abrevezAuteur : CARLOIX - Source : III, 26
- La dépense que la plus brillante partie de la nation fait en fine farine pour poudrer ses têtes, soit que vous soyez coiffés à l'oiseau royal, soit que vous portiez vos cheveux étalés comme Clodion et les conseillers de la courAuteur : Voltaire - Source : Facéties, Disc. aux Velches.
- Piler l'eau en un mortierAuteur : COTGRAVE - Source :
- Ce fut là qu'il nomma le maréchal Mortier gouverneur de cette capitale : Surtout, lui dit-il, point de pillage ; vous m'en répondez sur votre tête ; défendez Moscou envers et contre tousAuteur : SÉGUR - Source : ib. VIII, 6
- Sa raide soutane a été exécutée sur lui par quelque mauvais sculpteur en bois ; elle n'est jamais sortie d'aucun métier d'ourdissageAuteur : DIDER. - Source : Salon de 1767, Oeuv. t. XV, p. 9
- Le mortier et la pairie se disputent le pasAuteur : LA BRUY. - Source : XIV
Les mots débutant par Ort Les mots débutant par Or
Une suggestion ou précision pour la définition de Ortie ? -
Mise à jour le samedi 7 février 2026 à 00h37

- Oasis - Obéir - Obeissance - Obligation - Obscurite - Occasion - Occident - Odeur - Oeuvre - Offenser - Oil - Oisivete - Olympique - Ombre - Opinion - Opportuniste - Optimisme - Ordinateur - Ordre - Organisation - Orgasme - Orgueil - Orgueil - Originalite - Origine - Orthographe - Oubli - Oublier - Ouvrage
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur ortie
Poèmes ortie
Proverbes ortie
La définition du mot Ortie est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Ortie sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Ortie présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
