La définition de Baliveau du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Baliveau
Nature : s. m.
Prononciation : ba-li-vô
Etymologie : Bas-lat. baivarius, bayvellus. Prenant en considération la forme française baliveau, le bas-latin ballivus, bailli, l'emploi de bajulus pour pieu, échalas, on est porté à penser (mais ce n'est qu'une conjecture) que baliveau dérive de bajulus, ce qui porte ou soutient, par l'intermédiaire d'une forme telle que, par exemple, bajulivellus (voy. et ).
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de baliveau de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec baliveau pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Baliveau ?
La définition de Baliveau
Tout arbre réservé lors de la coupe d'un bois et destiné à devenir arbre de haute futaie. D'après l'époque de leur réserve ou balivage, les baliveaux sont dits : de l'âge, modernes ou anciens, selon qu'ils ont été réservés une première, une deuxième, une troisième fois, etc.
Toutes les définitions de « baliveau »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
T. d'Eaux et Forêts. Arbre réservé, lors de la coupe d'un taillis, afin qu'il puisse devenir arbre de haute futaie. Réserver tant de baliveaux par hectare. Jeunes baliveaux. Baliveaux de l'âge du taillis. Baliveaux modernes. Baliveaux anciens. Voyez ANCIEN.
Littré
-
1Tout arbre réservé lors de la coupe d'un bois et destiné à devenir arbre de haute futaie. D'après l'époque de leur réserve ou balivage, les baliveaux sont dits?: de l'âge, modernes ou anciens, selon qu'ils ont été réservés une première, une deuxième, une troisième fois, etc.
Les baliveaux que l'ordonnance oblige de laisser dans les bois
, Buffon, Exp. sur les végétaux, 2e mém.Les arbres qui poussent vigoureusement en bois produisent rarement beaucoup de fruit?; les baliveaux se chargent d'une grande quantité de glands et annoncent par là leur faiblesse
, Buffon, ib.Les baliveaux font plus de tort à l'accroissement des taillis, plus de perte au propriétaire, qu'ils ne donnent de bénéfice
, Buffon, ib.Adjectivement.
On coupa et enleva, dans ma forêt de Larçai, quatre gros chênes baliveaux de quatre-vingts ans
, Courier, I, 141. - 2 Terme de jardinage. Jeune arbre non taillé, et qui file droit avec toutes ses branches.
- 3 Terme de maçonnerie. Grande perche pour faire des échafaudages.
HISTORIQUE
XIIIe s. Item il demora à l'empereor, au parc de Pifons, cent arpens de bois de huit ans et les boiviaus qui demeurerent au parc
, Du Cange, Villeh. Append. p. 26.
XIVe s. Baivariis, gallice dictis les baiviaus
, Du Cange, baivarius. Faire retenue de bavieaulx ou d'estallons pour repoupler la forest
, Ordonn. des Rois, t. VII, p. 774.
Encyclopédie, 1re édition
BALIVEAU, s. m. (terme d'Eaux & Forêts.) signifie un jeune chêne, hêtre ou châtaignier au dessous de quarante ans, reservé lors de la coupe d'un taillis. Les ordonnances enjoignent d'en laisser croître en haute-futaie seize par chaque arpent, afin de repeupler les ventes. (H)
* On peut considérer les baliveaux par rapport aux bois de haute-futaie, & par rapport aux taillis. Par rapport au premier point, M. de Reaumur prétend dans un mémoire sur l'état des bois du royaume, imprimé dans le recueil de l'Académie, Année 1721, que les baliveaux sont une mauvaise ressource pour repeupler le royaume de bois de haute-futaie, parce qu'une très-grande partie périt ; car n'ayant pas pris dans les taillis qui les couvroient toute la force nécessaire pour résister aux injures de l'air, on ne peut leur ôter cet abri sans inconvénient. Des lisieres entieres de jeunes futaies ont péri dans un hyver froid, mais non excessivement rude, après qu'on eut coupé pendant l'été d'autres lisieres qui les couvroient. Il en arrive autant aux arbres réservés au milieu de forêts abattues. Des baliveaux qui ont échappé aux injures de l'air, peu échappent à la coignée du bucheron ; il en abbat au moins une partie dans la coupe suivante du taillis : les morts lui donnent occasion d'attaquer les vifs ; & il est de notoriété que dans la plûpart des taillis, on ne trouve que des baliveaux de deux à trois coupes. Mais indépendamment de cela, dit M. de Reaumur, ces baliveaux ne seront pas des arbres d'une grande ressource ; ils ont peu de vigueur & sont tous rabougris. S'ils n'ont pas péri, ils sont restés malades ; & quelque bon qu'ait été le terrein, jamais baliveau ne parviendra peut-être & n'est parvenu à devenir un arbre propre à fournir une longue poutre, un arbre de pressoir, ni quelqu'autre semblable piece de bois. Cela est sûr au moins par rapport aux baliveaux réservés dans les taillis qu'on coupe de dix ans en dix ans au plûtôt. Ils ne sont jamais hauts de tige, & croissent toûjours en pommiers.
Ces inconvéniens des baliveaux seront d'autant moindres, que le taillis sera coupé dans un âge plus avancé ; mais à quelqu'âge qu'on le coupe, on ne peut pas espérer que les baliveaux réparent les futaies qui s'abbattent journellement.
Quant au second point, la conservation des taillis par les baliveaux ; il ne faut, dit le même auteur, que parcourir les taillis où les baliveaux ont été le mieux conservés ; on trouvera qu'au-dessous & tout autour du baliveau, sur-tout quand il est parvenu à âge d'arbre, la place est nette, & que les souches sont péries, parce qu'elles se sont trouvées trop à l'ombre : aussi, bien des particuliers qui souhaitent abattre leurs baliveaux, ne le souhaitent que pour conserver leurs taillis. Si les baliveaux donnent quelques glands aux taillis, ils les leur font donc payer cher ; d'ailleurs ces glands tombant au hasard sur la surface de la terre, & la plûpart sous l'arbre même, ne réussissent guere.
M. de Buffon s'accorde en ceci avec M. de Reaumur. « On sait, dit cet académicien, dans un mémoire sur la conservation & le rétablissement des forêts, année 1739, que le bois des baliveaux n'est pas de bonne qualité, & que d'ailleurs ces baliveaux font tort aux taillis. J'ai observé fort souvent les effets de la gelée du printems dans deux cantons voisins des bois taillis. On avoit conservé dans l'un tous les baliveaux de quatre coupes successives ; dans l'autre on n'avoit réservé que les baliveaux de la coupe actuelle. J'ai reconnu que la gelée avoit fait un si grand tort au taillis surchargé de baliveaux, que l'autre taillis l'a devancé de près de cinq ans sur douze. L'exposition étoit la même : j'ai sondé le terrein en différens endroits, il étoit semblable. Ainsi, continue M. de Buffon, j'attribue cette différence à l'ombre & à l'humidité que les baliveaux jettoient sur le taillis, & à l'obstacle qu'ils formoient au desséchement de cette humidité en interrompant l'action du vent & du soleil. Il seroit donc à propos de recourir à des moyens plus efficaces que les baliveaux, pour la restauration de nos forêts de haute-futaie, & celle de nos bois taillis ». Voyez Forêts, Taillis.
Wiktionnaire
Nom commun - français
baliveau \ba.li.vo\ masculin
-
(Sylviculture) Jeune arbre réservé, lors de la coupe d'un taillis, afin qu'il puisse devenir un arbre de haute futaie.
- On n'apercevait qu'une vaste clairière dans laquelle on avait fait une coupe au printemps précédent, et dont les jeunes baliveaux aux tiges flexibles se courbaient sous le poids de la neige. ? (Hector Malot, Sans famille, 1878)
- La méthode du taillis sous futaie fait participer à la fois des avantages du taillis et d'une partie de ceux de la futaie, [?]. Dans ce but on conserve à chaque coupe du taillis un certain nombre d'arbres appelés baliveaux auxquels on laisse parcourir plusieurs révolutions. ? (Edmond Nivoit, Notions élémentaires sur l'industrie dans le département des Ardennes, E. Jolly, Charleville, 1869, page 161)
- La strate arborescente est constituée essentiellement par le Chêne pédonculé, le Chêne sessile en baliveaux sensiblement codominants. ? (Gustave Malcuit, Contributions à l'étude phytosociologique des Vosges méridionales saônoises : les associations végétales de la vallée de la Lanterne, thèse de doctorat, Société d'édition du Nord, 1929, p. 167)
- C'est un long vieillard, mince comme un baliveau, un peu courbé par une bonne septantaine d'ans. ? (Jean Rogissart, Passantes d'Octobre, Librairie Arthème Fayard, Paris, 1958)
-
(Botanique) Arbre de pépinière ayant un tronc bien vertical et des branches latérales.
- Le chêne rouvre, planté dernièrement au Vallon du Salut par la classe de grande section de l'école Clair-Vallon, n'est à ce jour qu'un jeune plant d'à peine quelques dizaines de centimètres. Autant dire que les petits écoliers devront être patients avant de pouvoir profiter de son ombre. Mais leur enthousiasme pourrait bien favoriser la pousse de ce joli baliveau ainsi que des autres plants d'arbre qu'ils s'apprêtent à planter à divers endroits sur le territoire. ? (La Dépêche, 28 avril 2015)
-
(Échafaudage) Grande perche verticale qui supporte les échafauds.
- La surface inférieure du hourdis est nécessairement irrégulière. Aussi, plus tard, quand il s'agit de procéder au plafonnage, la première opération consiste-t-elle à couper les baliveaux correspondant aux joints des planches sur lesquelles a été coulé le hourdis et à dresser la surface. ? (« Marché de Nangis (Seine-et-Marne) » par M. Cottin, architecte, & M. Nicaise, constructeur, dans les Nouvelles annales de la construction, 3e série - tome 7, février 1882, en recueil vol. 28, Paris : chez Baudry, 1882, page 25)
Trésor de la Langue Française informatisé
BALIVEAU, subst. masc.
Baliveau au Scrabble
Le mot baliveau vaut 13 points au Scrabble.
Informations sur le mot baliveau - 8 lettres, 5 voyelles, 3 consonnes, 7 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot baliveau au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
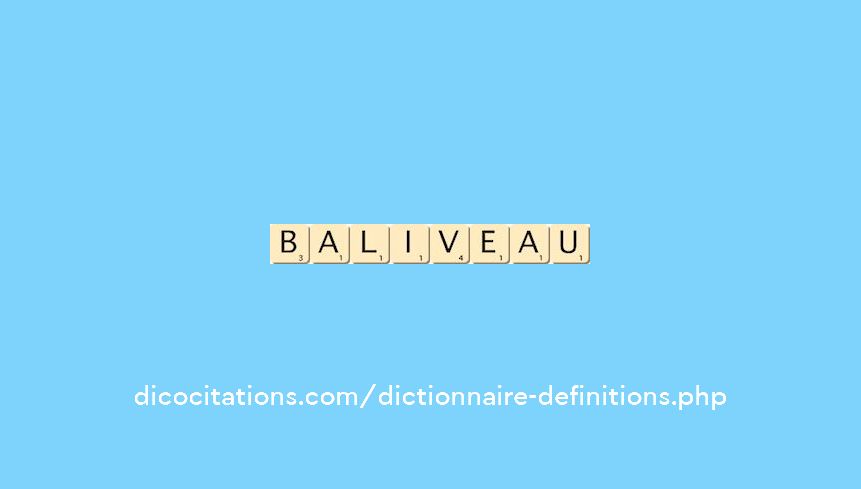
Les mots proches de Baliveau
Bal Baladin, ine Baladinage Balafre Balafrer Balai Balais Balance Balancé, ée Balancement Balancer Balancier Balançoire Balandran ou balandras Balandre Balantine Balata Balauste Balayer Balayeur, euse Balayure Balbutie Balbutiement Balbutier Balbutieur Balcon Balconier Baleine Baleinier Balénide Balèvre Baline Balique Balise Balisement Baliser Baliveau Baliverne Baliverner Ballade Ballant, ante Balle Balle Balle ou bale ou bâle Baller Baller Ballet Balletant Ballon Ballon bal Balacet balada baladai baladaient baladais baladait baladant balade balade baladé baladée baladées baladent balader baladera baladerai baladerais baladerait baladèrent baladerez balades balades baladés baladeur baladeur baladeurs baladeurs baladeuse baladeuse baladeuses baladez baladiez baladin baladins Baladou balafon balafons balafra balafraient balafrait balafrât balafre balafre balafré balafré balafrée balafrée balafrée balafréesMots du jour
Reculade Inconsidérable Scarronesque Présenté, ée Éprendre (s') Fesseur, euse Houblon Banlieue Phénomène Invulnérable
Les citations avec le mot Baliveau
Les citations du Littré sur Baliveau
- Pour les hommes il faudrait faire comme les bûcherons font tous les ans dans les grandes forêts ; ils y entrent pour les visiter, pour reconnaître le mort bois ou le bois vert, et effemeller la forêt, retranchant tout ce qui est superflu ou dommageable, pour retenir seulement les bons arbres ou les jeunes baliveaux d'espéranceAuteur : GARASSE - Source : dans BAYLE, Dict. au mot Déjotarus, note F
- Les arbres qui poussent vigoureusement en bois produisent rarement beaucoup de fruit ; les baliveaux se chargent d'une grande quantité de glands et annoncent par là leur faiblesseAuteur : BUFF. - Source : ib.
- À charge qu'ils seront tenus estalonner les dits bos [bois] de cent estalons [baliveaux] en chascun journel bons et souffisansAuteur : DU CANGE - Source : estallus.
- Ne parlez pas à un grand nombre de bourgeois, ni de guérets, ni de baliveaux, ni de provins, ni de regains, si vous voulez être entendu ; ces termes pour eux ne sont pas françaisAuteur : LA BRUY. - Source : VII
- Les baliveaux font plus de tort à l'accroissement des taillis, plus de perte au propriétaire, qu'ils ne donnent de bénéficeAuteur : BUFF. - Source : ib.
- Les baliveaux que l'ordonnance oblige de laisser dans les boisAuteur : BUFF. - Source : Exp. sur les végétaux, 2e mém.
Les mots débutant par Bal Les mots débutant par Ba
Une suggestion ou précision pour la définition de Baliveau ? -
Mise à jour le dimanche 8 février 2026 à 10h05
Dictionnaire des citations en B +
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur baliveau
Poèmes baliveau
Proverbes baliveau
La définition du mot Baliveau est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Baliveau sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Baliveau présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
