Définition de « prieur »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot prieur de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur prieur pour aider à enrichir la compréhension du mot Prieur et répondre à la question quelle est la définition de prieur ?
Une définition simple : prieur (m)
Définitions de « prieur »
Trésor de la Langue Française informatisé
PRIEUR, -EURE, subst.
Wiktionnaire
Nom commun 2 - français
prieur \p?i.j??\ masculin (pour une femme, on dit : prieuse)
- Personne qui prie.
- Brahim prend le parti d'étendre le verset qui parle "d'Allah qui prie pour Mahomet" vers une communication ... ça sous-entend qu'il y aura un prieur et un prié.
Nom commun 1 - français
prieur \p?i.j??\ masculin (pour une femme, on dit : prieure)
-
(Religion) Supérieur dans certains monastères.
- Quant au moine, Gurth le reconnut à l'instant même pour le prieur de l'abbaye de Jorvaulx. ? (Walter Scott, Ivanhoé, traduit de l'anglais par Alexandre Dumas, 1820)
- Wary de Dommartin la rebâtit ; d'abord bénédictin au monastère de Saint-Epvre à Toul, puis prieur de Varangéville, il céda ensuite son prieuré, moyennant redevance, à Jean de Nicolinis. ? (Gustave Fraipont; Les Vosges, 1923)
-
(Vieilli) Titre de dignité dans quelques sociétés.
- Prieur de Sorbonne, de la maison de Sorbonne.
Littré
-
1Prieur conventuel régulier, ou, simplement, prieur, celui qui régit des religieux en communauté?; il est opposé à prieur conventuel séculier et commendataire?; il ne diffère de l'abbé que de nom?; il en a toute l'autorité.
Je [moi, la Mollesse] croyais? Que l'Église du moins m'assurait un asile?; Mais en vain j'espérais y régner sans effroi?; Moines, abbés, prieurs, tout s'arme contre moi
, Boileau, Lutr. II.Prieur claustral, celui qui gouverne les religieux sous un abbé régulier, ou dans les abbayes et les prieurés qui sont en commende.
Dans l'abbaye de Cluny, on appellait grand prieur un religieux qui avait la première dignité après l'abbé.
Prieur commendataire, bénéficier qui jouissait, en tout ou en partie, des revenus d'un prieuré, et qui en portait le titre, sans avoir aucune autorité sur les religieux.
Prieur séculier, celui qui, n'étant soumis à aucune règle, possède un prieuré à titre de bénéfice simple.
Prieur-curé, religieux qui possédait une cure dans l'ordre des chanoines réguliers.
- 2Titre de dignité dans quelques sociétés. Prieur de Sorbonne, bachelier qui présidait pendant un an aux assemblées de la maison de Sorbonne
- 3Grand prieur, titre qui se donnait à un chevalier de Malte revêtu d'un bénéfice de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, appelé grand prieuré Grand prieur de France. Grand prieur de Champagne.
-
4Titre de magistrats suprêmes dans quelques républiques italiennes.
De trois en trois mois, elle [Florence] se choisit, pour son administration, des magistrats qu'elle appelle prieurs, et qui sont pris dans diverses professions
, Legrand D'Aussy, Instit. Mém. scienc. mor. et pol. t. v, p. 471.Le prieur du peuple romain, officier de Rome qui répond à nos maires et que le pape nomme tous les trois mois.
PROVERBE
Il faut toujours dire du bien de M. le prieur, c'est-à-dire il faut ménager dans ses discours les personnes de qui on dépend.
HISTORIQUE
XIIe s. Dunc [il] ad fait le priur tresqu'al covent aler?
, Th. le mart. 160.
XIIIe s. Et ge les voi, les jengleors, Plus cras [gras] qu'abbés ne que priors
, la Rose, 2568.
XVe s. Et ainsi instituerent les Florentins leurs prieurs des arts et conseil des anciens
, Chartier, l'Esperance, p. 315.
XVIe s. L'archier crioit?: Monsieur le priour, monsieur l'abbé futur?
, Rabelais, I, 44.
Encyclopédie, 1re édition
PRIEUR, s. m. (Gramm. & Jurispr.) est un ecclésiastique qui est préposé sur un monastere ou bénéfice qui a le titre de prieuré.
L'origine des prieurés est fort ancienne. Depuis que les réguliers eurent été enrichis par les libéralités des fideles, comme outre les biens qu'ils possédoient aux environs de leur monasteres, ils avoient aussi quelquefois des fermes & des métairies considérables qui en étoient fort éloignées, ils envoyerent dans chacun de ces domaines un certain nombre de leurs religieux ou chanoines réguliers, qui régissoient le temporel & célébroient le service divin entr'eux dans une chapelle domestique. On appelloit ces fermes celles ou obédiences.
Celui qui étoit le chef des religieux ou chanoines réguliers d'une obédience, se nommoit prieur ou prevôt ; & la chapelle & maison qu'ils desservoient, fut aussi nommée prieuré ou prevôté.
Le prieur, & ceux qui lui étoient adjoints, étoient obligés de rendre compte de leur régie tous les ans au monastere duquel ils dépendoient ; ils ne pouvoient prendre sur le revenu de la métairie que ce qui étoit nécessaire pour leur entretien.
L'abbé pouvoit, lorsqu'il le jugeoit à-propos, rappeller le prieur ou prevôt & ses religieux dans le monastere.
Le relâchement de la discipline monastique s'étendit bientôt dans ces petits monasteres. Le concile de Latran tenu en 1179, ordonna que les choses seroient remises sur l'ancien pié, mais cela ne fut pas observé.
En effet, dès le commencement du xiij. siecle, il y eut des abbés qui donnerent des ordres à quelques-uns de leurs religieux, pour demeurer pendant leur vie dans une obédience, & pour en gouverner les biens comme fermiers perpétuels.
Cet usage fut d'abord regardé comme un abus. Le pape Innocent III. écrivant en 1213 à un abbé & aux religieux d'un monastere de l'ordre de saint Benoît, leur défendit de donner ces obédiences à vie, & voulut que ceux qui les desservoient fussent révocables à la volonté de l'abbé.
Cependant cette loi ne fut pas exécutée ; les prieurs au contraire voyant que les abbés & autres officiers des monasteres s'étoient attribué chacun une partie des revenus de l'abbaye, s'approprierent aussi les revenus dont ils n'étoient originairement que fermiers.
Ce changement s'affermit si bien, que sur la fin du xiij. siecle les prieurés qu'on nommoit cependant encore obédiences & administrations, étoient reglés comme de vrais bénéfices.
Plusieurs titulaires de ces prieurés en expulserent les religieux qui y vivoient avec eux, & y demeurerent seuls : de-là vient la distinction des prieurés conventuels, & des prieurés simples.
Le concile de Vienne, auquel présidoit Clément V. défendit à tous religieux qui avoient inspection sur les monasteres ou prieurés, d'aliéner ou affermer les droits ou revenus à vie, & même de les accorder à tems pour de l'argent, à-moins que la nécessité ou l'utilité du monastere ne le demandât, ou du-moins sans le consentement de l'évêque du lieu, quand le prieuré étoit indépendant.
Il défendit aussi de conférer les prieurés, quoiqu'ils ne soient pas conventuels, à d'autres clercs qu'à des religieux profès âgés de 20 ans, & enjoignit à tous prieurs de se faire ordonner prêtres, sous peine de privation du bénéfice, dès qu'ils auroient atteint l'âge prescrit par les canons pour le sacerdoce, & leur ordonna de résider dans leurs prieurés, dont ils ne pourroient s'absenter que pour un tems en faveur des études, ou pour quelqu'autre cause approuvée par les canons. Enfin, ce concile déclare que si les abbés ne conferent pas les prieurés, administrations ; & autres bénéfices réguliers dans le tems prescrit aux collateurs par le concile de Latran, l'évêque du lieu où le prieuré est situé pourra en disposer.
Les prieurés-cures, qui se trouvent en grand nombre dans l'ordre de saint Augustin, & dans celui de saint Benoît, sont aussi devenus des bénéfices, au lieu de simples administrations qu'ils étoient d'abord. Ceux-ci ne sont pas tous formés de la même maniere.
Les uns étoient déja des paroisses avant qu'ils tombassent entre les mains des religieux ; d'autres ne le sont devenus que depuis que les monasteres en ont été les maîtres.
L'établissement des prieurés-cures de la premiere classe, vient de ce que les évêques donnerent aux abbayes, tant de moines que de chanoines réguliers, les dixmes & autres revenus d'un grand nombre de paroisses, ce qu'il appelloient altaria. L'abbé qui percevoit les revenus de la cure, étoit obligé de la faire desservir par un de ses religieux, quand la communauté étoit composée de chanoines réguliers, & par un prêtre séculier, quand la communauté suivoit la regle de S. Benoît.
A l'égard des prieurés-cures fondés par les monasteres, ce n'étoient d'abord que des chapelles domestiques d'une ferme, qu'on nommoit grange dans l'ordre des Prémontrés. Les religieux y célébroient le service divin, auquel leurs domestiques assistoient les fêtes & dimanches. On permit ensuite au prieur d'administrer les sacremens à ceux qui demeureroient dans la ferme, & insensiblement cela fut étendu à tous ceux qui demeuroient aux environs, sous prétexte que c'étoient aussi des gens qui servoient le prieuré ; & par ce moyen ces chapelles devinrent des paroisses, & ensuite des titres perpétuels de bénéfices, dans la plûpart desquels les prieurs-curés sont demeurés seuls, de même que dans les prieurés simples, les religieux qui y demeuroient auparavant avec eux ayant été rappellés dans les monasteres dont ils dépendoient.
Il y a néanmoins des monasteres dont les prieurés qui en dépendent sont toujours demeurés sur le pié de simples administrations, dont les pourvus sont obligés de rendre compte à leur supérieur, lequel peut les révoquer quand il lui plaît.
Pour posséder un prieuré simple, c'est-à-dire qui n'est ni claustral ni conventuel, ni à charge d'ames, il faut, suivant la jurisprudence du parlement, avoir quatorze ans, mais suivant la jurisprudence du grand-conseil, il suffit d'avoir sept ans. Voyez le P. Thomassin, d'Héricourt, Fuet, les mémoires du clergé, & les articles Abbaye, Bénéfice, Commende, Couvent, Cure, Monastere, Religieux. (A)
Prieur chef d'ordre, voyez Prieuré chef d'ordre.
Prieur claustral, voyez Prieuré claustral.
Prieur commendataire, voyez Prieuré en commende.
Prieur conventuel, voyez Prieuré conventuel.
Prieur curé, voyez Prieuré cure.
Grand-prieur, voyez Grand prieuré.
Prieur titulaire, voyez Prieuré en titre.
Prieur, (Jurisdiction consulaire.) on donne ce nom en quelques villes de France, comme à Rouen, à Toulouse, à Montpellier, &c. à celui qui préside au consulat des marchands, & qui y tient la place que le grand-juge tient à la jurisdiction consulaire de Paris.
Prieur de Sorbonne, (Hist. mod.) c'est un bachelier en licence que la maison & société de Sorbonne choisit tous les ans parmi ceux de son corps pour y présider pendant ce tems. Tous les soirs on lui porte les clés de la maison ; il préside aux assemblées tant des bacheliers que des docteurs qui y font leurs résidences. Il ouvre le cours des thèses appellées sorboniques, par un discours latin qu'il prononce dans la grande salle de Sorbonne en présence d'une assemblée, où les prélats qui se trouvent alors à Paris assistent. Il ouvre aussi chaque sorbonique par un petit discours & quelques vers à la louange du bachelier qui répond ; & dans les repas particuliers de la maison de Sorbonne donnés par ceux qui soutiennent des thèses ou qui prenent le bonnet, il doit aussi présenter des vers. Le prieur de Sorbonne pretend le pas dans les assemblées, processions, &c. sur toute la licence ; mais le plus ancien, ou le doyen des bacheliers le lui dispute. Cette contestation qui a produit de tems en tems divers mémoires, & qui a été portée au parlement, n'est pas encore décidée. La place de prieur de Sorbonne est honorable, dispendieuse, & demande des talens dans ceux qui la remplissent.
Prieur, grand, (Hist. mod.) chevalier de Malte, distingué par une dignité de l'ordre qu'on nomme grand-prieuré. Dans chaque langue il y a plusieurs grands-prieurs ; par exemple, dans celle de France on en compte trois ; savoir, le grand-prieur de France, celui d'Aquitaine & celui de Champagne. Dans la langue de Provence on compte ceux de S. Gilles & de Toulouse, & dans celle d'Auvergne le grand prieuré d'Auvergne. Il y a également plusieurs grands-prieurs dans les langues d'Italie, & d'Espagne & d'Allemagne, &c. Les grands-prieurs, en vertu d'un droit attaché à leur dignité, conferent tous les cinq ans une commanderie qu'on appelle commanderie de grace, il n'importe si elle est du nombre de celles qui sont affectées aux chevaliers, ou de celles qui appartiennent aux servans d'armes, il peut en gratifier qui il lui plaît. Il préside aussi aux assemblées provinciales de son grand-prieuré. La premiere origine de ces grands prieurs paroît être la même que celle des prieurs chez les moines. Les chevaliers de S. Jean de Jérusalem étoient religieux, menoient la vie commune comme ils la menent encore à Malte ; ceux qui étoient ainsi réunis en certain nombre avoient un chef qu'on a nommé grand-prieur, du latin prior, le premier, parce qu'en effet il est le premier de ces sortes de divisions, quoiqu'il ne soit pas le chef de toute la langue ; on nomme celui-ci pilier. Voyez Pilier.
Étymologie de « prieur »
- (Nom 1) (XIIe siècle) Du latin prior (« le tout premier »). Ce mot a été choisi de préférence au mot abbé, qui était traditionnellement utilisé pour ce type de fonctions dans les monastères jusqu'alors, au vu du fait que le mot abbé signifie « père » et que Jésus recommande de ne pas prendre le titre de « père » (Mt 23:8-12).
- (Nom 2) (Siècle à préciser) Composé de prier et -eur.
Lat. priorem, qui précède, qui est plus en avant, comparatif dont primus est le superlatif.
prieur au Scrabble
Le mot prieur vaut 8 points au Scrabble.
Informations sur le mot prieur - 6 lettres, 3 voyelles, 3 consonnes, 5 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot prieur au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
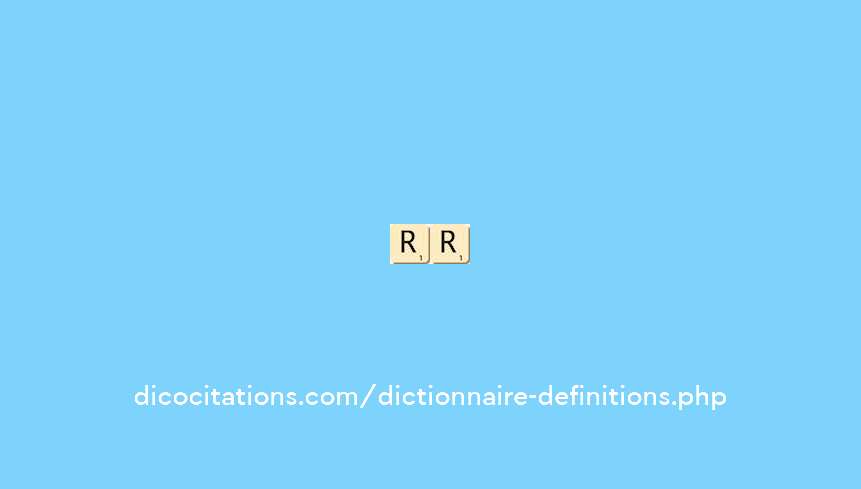
Les rimes de « prieur »
On recherche une rime en 9R .
Les rimes de prieur peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en 9R
Rimes de munster Rimes de déblayeur Rimes de aviateur Rimes de sertisseur Rimes de empoisonneur Rimes de entôleur Rimes de distillateurs Rimes de cofondateurs Rimes de masticateurs Rimes de songeurs Rimes de démonstrateur Rimes de bretteurs Rimes de stoppeur Rimes de frayeur Rimes de strip-teaseurs Rimes de tapageurs Rimes de postérieures Rimes de commis-voyageurs Rimes de harceleur Rimes de conducteurs Rimes de blondeurs Rimes de mi-pêcheurs Rimes de friseur Rimes de majeures Rimes de campeur Rimes de bouffeur Rimes de contemplateur Rimes de éplucheur Rimes de rôdeur Rimes de étameurs Rimes de splendeur Rimes de changeur Rimes de tiédeur Rimes de sous-directeurs Rimes de résonateur Rimes de casseur Rimes de téléspectateurs Rimes de rémouleurs Rimes de diffuseurs Rimes de fossoyeurs Rimes de contradicteur Rimes de percolateur Rimes de aviateurs Rimes de Poulseur Rimes de humeurs Rimes de majeur Rimes de radioamateur Rimes de fusils-mitrailleurs Rimes de aboyeur Rimes de épaisseurMots du jour
munster déblayeur aviateur sertisseur empoisonneur entôleur distillateurs cofondateurs masticateurs songeurs démonstrateur bretteurs stoppeur frayeur strip-teaseurs tapageurs postérieures commis-voyageurs harceleur conducteurs blondeurs mi-pêcheurs friseur majeures campeur bouffeur contemplateur éplucheur rôdeur étameurs splendeur changeur tiédeur sous-directeurs résonateur casseur téléspectateurs rémouleurs diffuseurs fossoyeurs contradicteur percolateur aviateurs Poulseur humeurs majeur radioamateur fusils-mitrailleurs aboyeur épaisseur
Les citations sur « prieur »
- Vous vous souvenez peut-être de cette parole de la prieure Blanche de la Force dans les Dialogues des carmélites de Bernanos : « Cette simplicité de l'âme, nous consacrons notre vie à l'acquérir, ou à la retrouver si nous l'avons connue, car c'est un don de l'enfance qui le plus souvent ne survit pas à l'enfance… Il faut très longtemps souffrir pour y rentrer, comme tout au bout de la nuit on retrouve une autre aurore… » Ai-je suffisamment souffert au cours de ma longue vie ? Il ne m'appartient pas de le dire, mais il est vrai qu'il m'arrive parfois de retrouver ce sentiment cosmique de mon enfance. Auteur : François Cheng - Source : De l'âme (2016)
- Dans ce tintouin de paroles, ce fracas d'armes, et parfois ce bon bruit d'écus, ce qu'on entend encore le moins, ce sont les cris de ceux qu'on rompt ou qu'on tenaille. Tel est le monde, monsieur le prieur.
Auteur : Marguerite Yourcenar - Source : Alexis ou le Traité du vain combat (1929)
- A-t-elle jamais tenté de s'enfuir du prieuré ? - Elle se sent observée nuit et jour avec vigilance; une tentative d'évasion l'exposerait à une réclusion plus sévère.Auteur : Auguste, comte de Villiers de l'Isle-Adam - Source : Axël (1890)
- Il n'avait point pour principe, disait-il, ni de laisser aller le monde comme il veut, ni de dire toujours du bien de M. le prieur, ni de faire son devoir tellement quellement.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Eloges, abbé de Saint-Pierre
- La sagesse du moine de Rabelais est la vraie sagesse, pour son repos et pour celui des autres: faire son devoir tellement quellement; toujours dire du bien de Monsieur le Prieur, et laisser aller le monde à sa fantaisie.Auteur : Denis Diderot - Source : Le Neveu de Rameau (1762)
- Vous les voyez, Monsieur ? Tous les onze, de gauche à droite : Billaud, Carnot, Prieur, Prieur, Couthon, Robespierre, Collot, Barère, Lindet, Saint-Just, Saint-André. Invariables et droits. Les commissaires. Le grand comité de la grande Terreur. Quatre mètres virgule trente sur trois, un peu moins de trois. Le tableau de ventôse. Le tableau si improbable, qui avait tout pour ne pas être, qui aurait si bien pu, dû ne pas être, que planté devant on se prend à frémir qu'il n'eût pas été, on mesure la chance extraordinaire de l'Histoire et celle de Corentin. On frémit comme si on était soi-même dans la poche de la chance. Le tableau – peint de la main de la Providence, ainsi qu'on aurait dit cent ans plus tôt, ainsi que Robespierre le disait encore chez la mère Duplay comme s'il eût été dans Port-Royal.Auteur : Pierre Michon - Source : Les Onze (2009)
Les mots proches de « prieur »
Priant, ante Priape Prié, ée Prie-dieu Prier Prier-dieu Prière Prieur Prieural, ale Prieure Prieuré Primaire Primat Primatial, ale Primatie Primauté Prime Prime Prime Prime Prime Primé, ée Primefeuille Primefleur Primer Primerole Primerose Prime-sautier, ière Primeur Primevère Primitif, ive Primitivement Primogéniture Primordial, ale Prince Princerie Princesse Principal, ale Principal Principalement Principalité Principat Principauté Principe Principion Princiser Printanier, ière Printemps Priori (à) PriorissaleLes mots débutant par pri Les mots débutant par pr
pria priai priaient Priaires priais priait priâmes priant priant priant priapique priapiques priapisme priasse priât Priay prie prié prie-dieu priée priées prient prier priera prierai prieraient prierais prierait prieras prière prièrent prières prierez prierons prieront pries priés prieur prieur prieure prieuré prieurés prieurs priez Priez Prignac Prignac-en-Médoc Prignac-et-Marcamps Prigonrieux priions
Les synonymes de « prieur»
Les synonymes de prieur :- 1. supérieur
2. abbé
3. doyen
4. religieux
5. croyant
6. dévot
7. mystique
8. pratiquant
9. sprituel
10. père
11. frère
12. prêtre
13. moine
synonymes de prieur
Fréquence et usage du mot prieur dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « prieur » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot prieur dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Prieur ?
Citations prieur Citation sur prieur Poèmes prieur Proverbes prieur Rime avec prieur Définition de prieur
Définition de prieur présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot prieur sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot prieur notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 6 lettres.
