Définition de « principe »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot principe de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur principe pour aider à enrichir la compréhension du mot Principe et répondre à la question quelle est la définition de principe ?
Une définition simple : (fr-rég|p???.sip) principe (m)
Expression : Principes immédiats (chim) Se dit de certains corps retirés de substances végétales ou animales complexes, sans que leur constitution soit altérée.
Définitions de « principe »
Trésor de la Langue Française informatisé
PRINCIPE, subst. masc.
Wiktionnaire
Nom commun - français
principe \p???.sip\ masculin
-
Commencement ; origine ; source : cause première.
- La Foi qui sert de fondement à toutes les Religions n'est qu'un principe d'erreurs, d'illusions et d'impostures. ? (Jean Meslier, Le Testament, chap. X, édition de Rudolf Charles, 1864, tome 1, page 66)
- Et elle accomplissait cet ouvrage en invoquant Jésus-Christ, principe et fin de toutes les entreprises des justes. ? (Anatole France, L'Étui de nacre, 1892, réédition Calmann-Lévy, 1923, page 55)
- Des philosophes ont fait de l'intérêt personnel le principe de toutes nos actions.
-
(Art) Premiers préceptes ; premières règles d'un art.
- Il veut parler d'un art dont il n'a même pas les premiers principes.
-
(Philosophie) Première et plus évidente des vérités qui peut être connue par la raison.
- Ce principe de la philosophie cartésienne, « je pense, donc je suis », est ce que les adversaires du cartésianisme ont attaqué avec le plus de persévérance; et cela se conçoit, car ce principe admis, l'autorité de la conscience et de la raison s'ensuit nécessairement. ? (Jules Simon, Introduction de: « ?uvres de Descartes », édition Charpentier à Paris, 1845)
- Il ne disait pas encore , comme Franklin, que « le temps, c'est de l'argent », mais ce principe s'appliquait déjà en un sens spirituel : le temps est infiniment précieux parce que toute heure de travail perdue était une heure de moins au service de la gloire de Dieu. ? (Max Weber, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, chap.II (Éthique du métier), § 2, traduction Flammarion, 2000)
- Ainsi, Constantin V, successeur de Léon III, en partant des mêmes principes christologiques que les iconophiles, arrive à des conclusions opposées aux leurs. ? (Carole Talon-Hugon, Une histoire personnelle et philosophique des arts : Moyen Âge et Renaissance, Presses Universitaires de France, 2014)
-
(Sciences & techniques) Notion fondamentale qui est à la base d'une science ou d'une technique.
- Ray, Montius, Scheuchzer, Micheli se sont les premiers occupés de l'Agrostographie. Tous ont à peu près suivi le même plan, et travaillé d'après les mêmes principes et sur les mêmes bases. ? (Ambrose-Marie-François-Joseph Palisot de Beauvois, Essai d'une nouvelle agrostographie ou Nouveaux genres des graminées;, page LI, 1812)
- La lisseuse est à tubes sécheurs ou à tambours sécheurs, mais le principe reste toujours le même. ? (D. de Prat, Nouveau manuel complet de filature; 1re partie: Fibres animales & minérales, Encyclopédie Roret, 1914)
- Leur activité se donnait surtout libre cours dans la location des bicyclettes. C'était là un singulier commerce que ne régissait aucun principe commercial ou économique connu, que ne régissait, à vrai dire, aucun principe. ? (H. G. Wells, La Guerre dans les airs, 1908, traduction d'Henry-D. Davray et B. Kozakiewicz, Mercure de France, Paris, 1910, page 44 de l'édition de 1921)
-
(Sciences) Loi que certaines observations ont d'abord rendue vraisemblable et à laquelle on a donné ensuite la plus grande généralité.
- Ne regardons donc plus comme des principes absolus des faits n'ayant jamais existé que dans l'imagination de ceux qui les ont conçus ; [?]. ? (Jean Déhès, Essai sur l'amélioration des races chevalines de la France, École impériale vétérinaire de Toulouse, Thèse de médecine vétérinaire, 1868)
- L'opinion de Pavlov sur le rôle décisif du milieu ambiant [?], se trouve ainsi en concordance parfaite avec les thèses théoriques de Mitchourine, avec les principes du darwinisme soviétique créateur développé actuellement par T. Lyssenko. ? (E. Asratian, I. Pavlov : sa vie et son ?uvre, Éditions en langues étrangères, Moscou, 1953, page 100)
-
(Chimie) Élément constitutif des corps.
- Si l'on admet que, pour végéter, la plante doive retirer du sol les principes minéraux qui lui sont nécessaires, il n'y a plus d'espèces préférantes ni indifférentes, mais uniquement des espèces propres à tel ou tel sol. ? (Bulletin de la Société Botanique de France, 1858, vol.5, page 73)
- Le jus contient, en outre du principe sucré, une foule de matières étrangères dont quelques-unes sont susceptibles de fermenter et d'altérer le sucre. ? (Edmond Nivoit, Notions élémentaires sur l'industrie dans le département des Ardennes, E. Jolly, Charleville, 1869, page 125)
-
(Courant) Maxime ; motif ; règle de conduite.
- Et il faut que notre expérience s'incline devant les idées préconçues et les principes d'un tas de crétins, envoyés à la Chambre parce qu'ils ont bien déliré pendant les trois semaines d'une période électorale dans les arrière-salles de café. ? (André Cayatte & ?Philippe Lamour, Un monstre, Nouvelles Éditions Latines, 1934, page 175)
- La doctrine mercantiliste, sur les relations entre économie et politique des nations, a pour point de départ, pour principe la formule célèbre : « L'argent est le nerf de la guerre. » ? (Raymond Aron, Paix et Guerre entre les nations, Calman-Lévy, 1962, p.249)
-
(Absolument) Base de la morale, de la religion.
- La lutte des intérêts matériels et des principes moraux, de l'utilité et du devoir, du matérialisme et du spiritualisme, se représente ici avec une nouvelle force, et sous un point de vue encore plus important. ? (Pellegrino Rossi, Traité de droit pénal, 1829, page 180)
- Là dessus, ses principes étaient d'autant plus fixes qu'ils étaient plus récents. ? (Pierre Louÿs, Les aventures du roi Pausole, 1901)
- LA FARLETTE.? Il y a ceux qui sont à cheval sur les principes, et ceux qui s'assoient dessus. Pour moi, je les monte en amazone. ? (Marcel Jouhandeau, Chaminadour, Gallimard, 1941 et 1953, collection Le Livre de Poche, page 380)
- Admettre cette préséance, c'est léser l'esprit républicain, porter atteinte aux principes de 89, faire fi des sacrifices consentis par les révolutionnaires de 1830 à 1871 ! ? (Jean Rogissart, Passantes d'Octobre, Librairie Arthème Fayard, Paris, 1958)
Littré
-
1Origine, cause première.
J'ai tâché de trouver en général les principes ou premières causes de tout ce qui est ou qui peut être dans le monde, sans rien considérer pour cet effet que Dieu seul qui l'a créé, ni les tirer d'ailleurs que de certaines semences de vérités qui sont naturellement en nos âmes
, Descartes, Méth. VI, 3.Ces titres si ordinaires?: des Principes des choses, des Principes de la philosophie, et titres semblables aussi fastueux en effet, quoique non en apparence, que cet autre qui crève les yeux?: De omnire scibili
, Pascal, Pens. I, 1, édit. HAVET.Tant que nous regarderons l'homme par les yeux du corps, sans y démêler par l'intelligence ce secret principe de toutes nos actions qui, étant capable de s'unir à Dieu, doit nécessairement y retourner
, Bossuet, Duchesse d'Orléans.Comme il est nécessaire que chaque chose soit réunie à son principe
, Bossuet, ib.Non-seulement le principe de ma pensée m'est inconnu, mais le principe de mes mouvements m'est également caché
, Voltaire, Hist. d'un bon bramin.Je dirai que nos sens sont le principe de nos connaissances, parce que c'est aux sens qu'elles commencent, et je dirai une chose qui s'entend
, Condillac, Log. II, 6.Dès le principe, dès le commencement.
Dans le principe, dans le commencement.
-
2En un sens plus restreint, ce qui produit, opère comme un principe.
Nous avons un autre principe d'erreur, les maladies?; elles nous gâtent le jugement et le sens
, Pascal, Pens. III, 3, édit. HAVET.Examinons donc, je vous prie, de quel principe part ce mouvement [une certaine déclaration des jésuites]
, Pascal, Prov. XII.Il jetait dans les esprits le principe de cette licence
, Bossuet, Hist. III, 7.Comme la matière que je traite me fournit un exemple manifeste et unique dans tous les siècles de ces extrémités furieuses [les révolutions], il est de la nécessité de mon sujet de remonter jusqu'au principe
, Bossuet, Reine d'Anglet.Je vois de tes froideurs le principe odieux
, Racine, Phèdre, IV, 2.Vous êtes, madame, le premier principe de tant de faveurs
, Voltaire, Lett. Mme de Choiseul, 26 mars 1770. -
3Les deux principes, les deux causes suprêmes du bien et du mal, suivant la religion des Perses et suivant les manichéens.
La secte impie des marcionites et des manichéens qui enseignaient deux principes, et attribuaient au mauvais la création de l'univers
, Bossuet, Var. XI, 201.Les mages admettaient deux principes?: l'un du bien et de la lumière, Oromaze?; l'autre du mal et des ténèbres, Arimane
, Condillac, Hist. anc. III, 6. -
4 Terme de physique. Ce qui constitue, compose les choses matérielles.
Selon quelques philosophes, les atomes sont les principes de tous les corps
, Dict. de l'Acad.Terme de chimie. Synonyme d'élément.
Principes actifs, certains corps qui agissent sur les autres, et principes passifs, corps qui sont le sujet de cette action (cette locution ne se dit plus guère).
En chimie organique, principes immédiats, ceux qui sont tout formés dans les êtres vivants, et qu'on en sépare au moyen des réactifs ou des dissolvants.
Principes nutritifs, ou, absolument, principes, ce qui, dans les substances alimentaires, sert à la nutrition.
Ce lait [de la jument], quoique moins séreux que celui d'ânesse, n'est cependant pas aussi riche en principes, que celui des ruminants
, Genlis, Maison rust. t. II, p. 39, dans POUGENS. -
5Il se dit de toutes les causes naturelles, de toutes celles par lesquelles les corps se meuvent, agissent, vivent. Le principe de la chaleur.
Il ne s'agit pas de savoir ce que c'est que la gravitation?; je crois qu'il est impossible de connaître jamais aucun premier principe
, Voltaire, Mél. litt. Au père Tournemine.Cette gaieté annonce en elle [Votre Majesté] un principe de vie encore très animé
, D'Alembert, Lett. au roi de Prusse, 26 oct. 1781.Le principe de la vie est précisément le principe de la mort?; et ce qui nous fait vivre est réellement ce qui nous fait mourir
, Bonnet, Paling. XXII, 6.Allant demander au soleil quelques principes de vie pour lutter contre mes maux
, Staël, Corinne, I, 2.Le livre des Principes de Newton, ouvrage contenant la théorie du système du monde.
Principe vital, la cause, quelle qu'elle soit, des phénomènes que manifestent les êtres organisés.
Principe se dit aussi de ce qui fait la vie d'un État.
Le gouvernement est frappé dans son principe
, Montesquieu, Esp. XIII, 20.Lorsque les principes du gouvernement sont une fois corrompus, les meilleures lois deviennent mauvaises, et se tournent contre l'État?; lorsque les principes en sont sains, les mauvaises ont l'effet des bonnes?; la force du principe entraîne tout
, Montesquieu, ib. VIII, 11. -
6Les premiers préceptes d'un art, d'une science. Les principes de la géométrie, de la physique, de la chimie.
Benedetto Lutti donna les premiers principes de l'art à Jean et Charles Vanloo
, Diderot, Salon de 1765, ?uvres, t. XIII, p. 39, dans POUGENS.S'emploie, au pluriel, dans le titre de plusieurs ouvrages didactiques élémentaires?: Principes de calcul, de chimie, etc.
Principes de dessin, principes d'architecture, recueils d'exemples à l'usage de l'enseignement primaire. On dit semblablement?: Principes d'écriture, de musique, etc.
-
7 Terme de philosophie. Opinion, proposition que l'esprit admet comme point de départ.
Elles [les sciences] sont infinies dans la multitude et la délicatesse de leurs principes?; car qui ne voit que ceux qu'on propose pour les derniers ne se soutiennent pas d'eux-mêmes et qu'ils sont appuyés sur d'autres qui, en ayant d'autres pour appui, ne souffrent jamais de dernier??
Pascal, Pens. I, 1, édit. HAVET.L'omission d'un principe mène à l'erreur
, Pascal, ib. VII, 2 bis.Ceux qui sont accoutumés à raisonner par principes ne comprennent rien aux choses de sentiment, y cherchant des principes, et ne pouvant voir d'une vue
, Pascal, ib. VII, 33.Un principe jeté dans un bon esprit produit
, Pascal, ib. XXV, 65.Les principes généraux sont bientôt saisis, quand ils peuvent l'être
, Fontenelle, Lahire.Plus on diminue le nombre des principes d'une science, plus on leur donne d'étendue, puisque, l'objet d'une science étant nécessairement déterminé, les principes appliqués à cet objet seront d'autant plus féconds qu'ils seront en plus petit nombre
, D'Alembert, Disc. Encycl ?uv. t. I, p. 202, dans POUGENS.Les vérités que, dans chaque science, on appelle principes et qu'on regarde comme la base des vérités de détail, ne sont peut-être elles-mêmes que des conséquences fort éloignées d'autres principes plus généraux que leur sublimité dérobe à nos regards
, D'Alembert, Mélanges, etc. t. V, § III.Cette maxime singulière, qu'il ne faut pas mettre les principes en question, maxime d'un abus d'autant plus grand qu'il n'y a point d'erreur où elle ne puisse entraîner
, Condillac, Traité des syst. ch. 3.Principe et maxime sont deux mots synonymes?: ils signifient tous deux une vérité qui est le précis de plusieurs autres?; mais celui-là s'applique plus particulièrement aux connaissances théoriques, et celui-ci aux connaissances pratiques
, Condillac, Art d'écr. II, 9.Principe d'Archimède, principe d'hydrostatique d'après lequel tout corps plongé dans un liquide perd de son poids une partie égale au poids du volume de liquide qu'il déplace.
Premiers principes, vérités ou propositions primitives.
-
8Maxime, règle de conduite, précepte de morale. De bons, de mauvais principes. Un faux principe d'honneur.
Qu'est-ce que nos principes naturels, sinon nos principes accoutumés??
Pascal, Pens. III, 13, édit. HAVET.Je ne suis ni à Dieu ni au diable? on n'est point au diable, parce qu'on craint Dieu et qu'au fond on a un principe de religion?; on n'est point à Dieu?
, Sévigné, 10 juin 1671.Elle [la mère de Montausier] employa ses premiers soins à lui apprendre les principes d'une fausse religion [le protestantisme]
, Fléchier, Duc de Mont.Ceux qui ont des principes pour le gouvernement
, Fénelon, Tél. XXII.Il faut avoir des principes certains de justice
, Fénelon, ib. XXIV.Vous n'avez que des vertus naturelles?; elle a des principes solides et invariables
, Genlis, Veill. du chât t. I, p. 288, dans POUGENS.Se dit, dans la logique de Kant, d'un jugement à priori immédiatement certain.
-
9 Absolument, au pluriel, il se dit de bons principes de morale, de religion.
La plupart des femmes n'ont guère de principes?; elles se conduisent par le c?ur, et dépendent, pour leurs m?urs, de ceux qu'elles aiment
, La Bruyère, III.J'entends par des principes des idées justes sur ce qui est mal
, Genlis, Ad. et Théod. t. I, p. 214, dans POUGENS.C'est un homme sans principes, et on m'en a conté des traits abominables
, Genlis, Mères riv. t. I, p. 31, dans POUGENS.
HISTORIQUE
XIVe s. De chascun des premiers principes, puisqu'il est le premier et commencement, il ne fault plus en oultre enquerir
, Oresme, Éth. XI, 17. Il convient que les premisses de aucun sillogisme soient principes, et que elles ne soient pas monstrées ou prouvées par autre sillogisme
, Oresme, ib. 173. Comment oses-tu m'oultrageant, Sans congnoistre mon vif argent, Qu'est mon principe vivifique, Tenter l'euvre philosophique??
Nat. à l'alch. 103.
XVIe s. Les principes de geometrie
, Montaigne, I, 180. Les principes d'Aristote ne luy soient principes, non plus que ceulx des stoiciens ou epicuriens
, Montaigne, I, 162. Or estant M. de Chastillon colonnel, pour son principe [son début] il fut devant Boulogne
, Brantôme, Cap. franç. t. IV, p. 223, dans LACURNE.
Encyclopédie, 1re édition
Principe, s. m. (Phys.) on appelle principe d'un corps naturel, ce qui contribue à l'essence d'un corps, ou ce qui le constitue primitivement. Voyez Corps.
Pour avoir une idée d'un principe naturel, il faut considérer un corps dans ses différens états ; un charbon, par exemple, étoit une petite piece de bois ; par conséquent le morceau de bois contient le principe du charbon, &c. Chambers.
Principes, (Chimie.) la maniere dont les Chimistes conçoivent & considerent la composition des sujets chimiques, est exposée dans plusieurs articles de ce Dictionnaire, & principalement dans l'article Chimie, & dans l'article Mixtion. Les divers matériaux dont ces corps sont composés, sont leurs principes chimiques : c'est ainsi que le savon étant formé par l'union chimique de l'huile & de l'alkali fixe, l'huile & l'alkali fixe sont les principes du savon.
Mais comme l'huile & l'alkali fixe sont eux-mêmes des corps composés ; que l'huile grasse employée à la préparation du savon vulgaire, par exemple, est formée par l'union de l'huile primitive, (voyez Huile.) & d'une substance mucilagineuse ; que chacune de ces nouvelles substances est composée encore ; l'huile primitive, par exemple, d'acide, de phlogistique, & d'eau, & que cet acide l'est à son tour de terre & d'eau : on peut absolument diviser sous cet aspect les principes des mixtes en principes immédiats ou prochains, & en principes éloignés. Cette maniere d'envisager cet objet n'est pourtant point exacte : car les principes dont les matériaux immédiats d'un certain corps sont formés, n'appartiennent pas proprement à ce corps ; les matériaux de ce corps, soit après, soit avant leur séparation, sont des substances distinctes, dont la connoissance ultérieure peut bien importer à la connoissance très-intime du premier corps, mais n'entre point dans l'idée de sa composition. Au reste, si cette observation est utile pour fixer la meilleure maniere de concevoir la composition des corps chimiques ; elle est bien plus essentielle encore lorsqu'on l'applique à la pratique, qu'on l'emploie à éclairer la marche réguliere de l'analyse : car une analyse ne peut être exacte qu'autant qu'elle attaque successivement les divers ordres de composition, qu'elle sépare le savon premierement en huile, & en alkali fixe ; qu'elle prend ensuite l'huile d'un côté, & l'alkali de l'autre ; qu'elle procede sur chacun de ces principes séparément, jusqu'à ce qu'elle soit parvenue à des corps inaltérables, ou qui sont suffisamment connus : car une analyse est complette dès qu'on est parvenu aux principes suffisamment connus, soit absolument, soit relativement au dessein actuel de l'analyste. Ainsi l'analyse du savon seroit achevée dès qu'il seroit résout en huile & en alkali fixe, pour quiconque connoîtroit d'ailleurs l'huile & l'alkali fixe ; on n'auroit pas besoin, relativement à sa recherche présente, d'en déterminer la nature chimique, la composition intérieure. Au contraire, le vice capital de l'analyse chimique, c'est de procéder tumultueusement, d'attaquer pêle-mêle, & tout-d'un-coup, les ordres de principes les plus éloignés ; de décomposer en même tems, dans l'exemple proposé, & l'acide de l'huile, & les principes du même ordre de l'alkali fixe, &c. Cette doctrine est exposée à propos de l'analyse des végétaux à l'article Végétal, (Chimie.) Voyez cet article.
Lorsqu'on a admis une fois cette meilleure maniere d'envisager les composés chimiques, & de procéder à leur décomposition, toutes les discussions qui ont divisé les Chimistes sur la doctrine des principes, & dans lesquelles les Physiciens ont aussi balbutié ; toutes ces discussions, dis-je, tombent d'elles-mêmes ; car elles sont toutes nées de la maniere vicieuse de concevoir & d'opérer, qui lui est opposée.
Premierement, c'est parce que la distillation analytique qu'on employa seule pendant long-tems à la décomposition des corps très-composés, savoir les végétaux & les animaux, fournit un petit nombre de principes toujours les mêmes, & dont on ne pouvoit ou ne savoit point reconnoître l'origine, qu'on agita ces problèmes si mal discutés des deux parts ; savoir, si ces produits étoient des principes hypostatiques, ou prééxistans dans le mixte, ou bien des créatures du feu ; savoir, s'ils étoient des principes principians ou principiés, c'est-à-dire des corps simples, les vrais élémens, ou des substances composées ; savoir, s'il y avoit trois principes seulement, ou bien cinq, ou bien un seul, savoir, si tous les mixtes contenoient tous les principes, &c. Encore un coup, toutes ces questions sont oiseuses, dès qu'elles sont fournies par une méthode qu'il faut abandonner. Il faut savoir pourtant sur toute cette fameuse doctrine des trois & des cinq principes, que Paracelse répandit principalement, le dogme, que tous les corps naturels sont formés de trois principes, sel, soufre, & mercure, dogme qu'il avoit pris de Basile Valentin, ou de Hollandus, & qui n'avoit été appliqué d'abord qu'aux substances métalliques ; comme le dogme des trois terres de Becher, qui ne sont proprement que ces trois principes sous d'autres noms (Voyez Terres de Becher.), que Paracelse, & les Paracelsistes varierent, retournerent, forcerent, détournerent singulierement l'application de ces différens noms aux divers produits de l'analyse des végétaux, & des animaux ; qu'enfin, Willis rendit cette doctrine plus simple, plus soutenable, en ajoutant aux trois principes, au ternaire paracelsique, deux nouveaux principes, le phlegme, ou eau, & la terre, qui s'appella quelquefois damnée, ou caput mortuum, (Voyez Caput mortuum) ; que la plus grande puérilité dans laquelle soient tombés les demi-chimistes, ou les physiciens, qui ont combattu cette doctrine véritablement misérable en soi, c'est d'avoir appliqué bonnement ce nom de mercure ou de soufre, au mercure commun, & au soufre commun ; car quoique la substance désignée par ces expressions, & sur-tout par ce mot mercure, (voyez Mercure principe.) soit très-indéfinie chez les Paracelsistes, il est clair au moins qu'il ne s'agit point du mercure commun, & beaucoup moins encore du soufre commun. Il est même très-connu, que le soufre retiré par l'analyse à la violence du feu, des végétaux & des animaux, est de l'huile. Ainsi Boyle auroit dû au-moins produire de l'huile, & non pas du soufre vulgaire, pour objecter légitimement aux Chimistes la producibilité de ce principe chimique. Enfin, il est reconnu généralement aujourd'hui que la plûpart de ces produits de l'analyse à la violence du feu, ne sont pas les principes hypostatiques, ou formellement préexistans des végétaux & des animaux d'où on les retire ; mais que les Chimistes très-versés dans la connoissance des principes réels, & préexistans dans ces corps, que l'analyse menstruelle découvre très-évidemment, & dans celle de l'action réciproque de tous ces principes ; ces Chimistes, dis-je, connoissent très-bien l'origine de tous ces divers produits ; ils savent quels d'entre eux proviennent du premier ordre de composition, où étoient principes véritablement immédiats, hypostatiques, constituans ; quels autres sont des débris de tel ou de tel principe immédiat ; quels autres sont dûs à des combinaisons nouvelles, &c. & que cette théorie très-transcendante, & qui jusqu'à présent n'a pas été publiée, est une de ces subtilités de pure spéculation, & de l'ordre des problèmes très-compliqués sur les objets scientifiques de tous les genres, qui n'ont d'autre mérite que celui de la difficulté vaincue. J'ai cité dans un mémoire sur l'analyse des végétaux, (Mémoires présentés à l'académie royale des Sciences, par divers savans, &c. vol. II.) comme un exemple de ces théories chimiques très-compliquées, celle de la préparation du sublimé corrosif à la maniere d'Hollande, & celle que Mender a donnée de la préparation du régule d'antimoine par les sels. La théorie dont il s'agit ici, est encore d'un ordre bien supérieur. Au reste, j'observerai sur ces trois théories si merveilleuses, qui demandent beaucoup de connoissances & de sagacité, qu'elles ont toutes les trois pour objet des opérations vicieuses, ou du-moins imparfaites & mal entendues ; d'où on est porté à inférer qu'en chimie, vraissemblablement comme par-tout ailleurs, les man?uvres les plus compliquées sont toujours les plus mauvaises, & cela tout aussi-bien quand on entend leur théorie, que quand on ne l'entend pas.
Mais il y a une question plus importante sur les principes chimiques : nous avons dit plus haut que l'analyse ou décomposition des corps parvenoit enfin quelquefois jusqu'à des principes inaltérables, du moins que l'art ne savoit point simplifier ultérieurement, & dont on n'observoit aucune altération dans la nature. Les Chimistes appellent ces corps premiers principes ou élémens : ces élémens de chimistes sont donc des substances indestructibles, incommutables, persistant constamment dans leur essence quelques mixtions qu'elles subissent, & par quelque moyen qu'on les dégage de ces mixtions.
Cette question importante roule sur ces premiers principes, savoir s'il y a plusieurs corps qui soient véritablement & essentiellement élémentaires, ou s'il n'y a qu'une matiere unique ou homogene qui constitue par ses diverses modifications tous les corps, même réputés les plus simples.
L'observation bien résumée, ou le système de tous les faits chimiques démontre qu'une pareille matiere est un pur concept, un être abstrait, que non-seulement on admet gratuitement & inutilement, mais même dont la supposition a jetté dans des erreurs manifestes tous les philosophes qui l'ont défendue, parce qu'ils ont attribué aux corps dépouillés de leurs qualités réelles par cette abstraction, des propriétés qu'ils ne peuvent avoir qu'à raison de ces qualités. C'est de cette source, par exemple, qu'a coulé l'erreur des Physiciens sur les prétendues lois de la cohésion observée entre les différens corps, c'est-à-dire, entre diverses portions de matiere déja spécifiée, les corps ou la matiere, ont-ils dit, sont cohérens en raison de la proximité de leurs parties : mais nul corps de la nature n'est de la matiere proprement dite, & par conséquent nul exercice des lois de la cohésion entre diverses portions de matiere ; les sujets soumis à ces lois sont toujours ou de l'eau ou de l'air, ou un métal, ou de l'huile, &c. Or la façon de l'être qui spécifie chacun de ces corps, diversifiant essentiellement & manifestement leur cohésibilité réciproque, il est clair que la contemplation des lois d'adhésion, qui devroient être absolument uniformes entre les portions d'une matiere homogene, ne peut être qu'abstraite, & que lorsque l'esprit l'applique à des sujets qui existent réellement & hors de lui, prend nécessairement sa chimere pour la réalité. Cette considération est vraiment essentielle & fondamentale dans la doctrine chimique, qui ne connoît d'abstractions que les vérités composées ou générales, & qui dans l'estimation des faits singuliers, n'établit jamais ses dogmes que d'après l'observation.
Les chimistes modernes ont admis assez généralement pour leurs principes premiers & inaltérables, les quatre élémens des Péripatéticiens ; le feu qu'ils appellent phlogistique avec les Stahlliens, l'air, l'eau, & la terre. Mais cette énumération est incomplette & inexacte, en ce qu'il y a plusieurs especes de terre véritablement inaltérables & incommutables, & qui seront par conséquent pour eux autant de premiers principes, tant qu'ils n'auront pas su simplifier ces especes de terre jusqu'au point de parvenir à un principe terreux, unique & commun.
Il est très-vraissemblable pourtant que cette vraie terre primitive réellement simple existe, & que l'une des quatre terres connues, savoir, la vitrifiable, l'argileuse, la calcaire, & la gypseuse ; que l'une de ces quatre terres, dis-je, est la terre primitive, mais sans qu'on sache laquelle, & quoiqu'il puisse bien être aussi que pas une des quatre ne soit simple.
Si les deux métaux parfaits, l'or & l'argent, sont véritablement indestructibles, on n'est en droit de leur refuser la simplicité, que parce qu'il est très probable qu'ils sont formés des mêmes principes que les autres substances métalliques, dont ils ne different que par l'union plus intime de ces principes.
Bien loin que l'esprit se prête difficilement à concevoir plusieurs principes primitifs essentiellement divers & incommutables, ou, ce qui est la même chose, plusieurs matieres primitivement & essentiellement diverses ; il me semble au contraire qu'il s'accommode mieux de cette pluralité de matieres, & que la magnificence de la nature que cette opinion suppose, vaut bien la noble simplicité qui peut faire pencher vers le sentiment opposé. Je trouve même très-probable que les corps composés des autres mondes, & même des autres planetes de celui-ci, aient non-seulement des formes diverses, mais même qu'ils soient composés d'élémens divers ; qu'il n'y ait, par exemple, dans la lune ni terre argilleuse, ni terre vitrifiable, ni peut-être aucune matiere douée des propriétés très-communes de nos terres ; qu'il y ait au lieu de cela un élément qu'on peut appeller si l'on veut, lune, &c. ce n'est que le feu qui me paroît être très-vraissemblablement un élément universel.
Parmi les systèmes philosophiques, tant anciens que modernes, qui ont admis un principe unique & primitif de tous les êtres, le plus ancien & celui qui mérite le plus d'attention, est celui que Thalès a publié ou plûtôt renouvellé, que Vanhelmont a soutenu & prétendu prouver par des expériences, & qui admet l'eau pour ce principe premier & commun. Mais, malgré les expériences postérieures de Boyle & de M. Duhamel, rapportées au commencement de l'article Eau, Chimie, (voyez cet article.) les chimistes modernes ont appris à ne plus conclure de ces expériences, que l'eau se change en terre, en air, & autres principes éloignés des végétaux. (b)
Étymologie de « principe »
Lat. principium, du même radical que princeps (voy. PRINCE).
- (Siècle à préciser) Du latin principium.
principe au Scrabble
Le mot principe vaut 14 points au Scrabble.
Informations sur le mot principe - 8 lettres, 3 voyelles, 5 consonnes, 6 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot principe au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
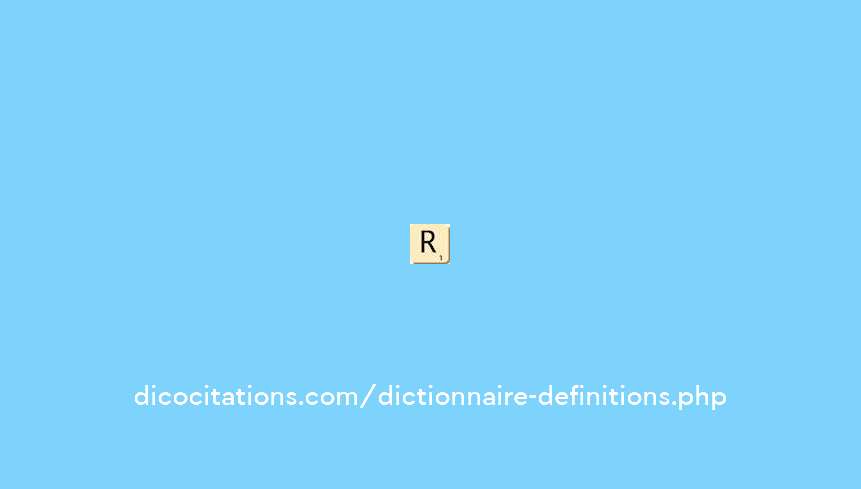
Les rimes de « principe »
On recherche une rime en IP .
Les rimes de principe peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en ip
Rimes de snipe Rimes de constipe Rimes de équipes Rimes de antigrippe Rimes de rééquipent Rimes de manipe Rimes de caryotype Rimes de daguerréotypes Rimes de prénom-type Rimes de archétype Rimes de nippes Rimes de midship Rimes de grippes Rimes de cheap Rimes de oedipe Rimes de nippe Rimes de fripent Rimes de frippe Rimes de kips Rimes de tipe Rimes de trips Rimes de slips Rimes de principes Rimes de linotypes Rimes de linotype Rimes de archétypes Rimes de dissipent Rimes de grippe Rimes de monotype Rimes de vidéoclip Rimes de tulipes Rimes de vidéo-clip Rimes de stéréotypes Rimes de philippe Rimes de kip Rimes de type Rimes de anticipe Rimes de étripent Rimes de flippe Rimes de nippe Rimes de Sao Tomé-et-Principe Rimes de émancipe Rimes de protège-slip Rimes de équipe Rimes de lippes Rimes de flippent Rimes de pipe Rimes de fripe Rimes de agrippes Rimes de flipMots du jour
snipe constipe équipes antigrippe rééquipent manipe caryotype daguerréotypes prénom-type archétype nippes midship grippes cheap oedipe nippe fripent frippe kips tipe trips slips principes linotypes linotype archétypes dissipent grippe monotype vidéoclip tulipes vidéo-clip stéréotypes philippe kip type anticipe étripent flippe nippe Sao Tomé-et-Principe émancipe protège-slip équipe lippes flippent pipe fripe agrippes flip
Les citations sur « principe »
- La miséricorde est un principe général de conduite à l'usage de ceux qui ne veulent pas abdiquer devant la lâcheté, le doute et la bêtise. La miséricorde permet à l'homme flétri de reverdir. Ma miséricorde est un engrais dont je fais grand usage.Auteur : Olivier de Kersauson - Source : Ocean's Songs (2008)
- L'absolu n'a besoin de rien. Ni de dieu, ni d'ange, ni d'homme, ni d'esprit, ni de principe, ni de matière, ni de continuité.Auteur : Antonin Artaud - Source : Héliogabale ou l'Anarchiste couronné
- Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation, qui n’est que la réunion de la femme et de l’homme ; nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. Auteur : Olympe de Gouges - Source : Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791)
- L'étranger n'est pas celui que sépare de nous le hasard d'une rivière ou d'une montagne. Mais celui dont les principes, les voeux et les sentiments sont en guerre avec vos principes, vos voeux et vos sentiments.Auteur : Henri Beyle, dit Stendhal - Source : L'Italie en 1818
- Dieu n'est que l'image de quelque chose, principe, force, idée, esprit, volonté, que nous ne pouvons concevoir ni nommer.Auteur : René Barjavel - Source : La faim du tigre
- Que vaut l'absoluité des principes, si c'est au détriment de la simple humanité, du bon sens, de la douceur, de la compassion?Auteur : André Comte-Sponville - Source : Petit traité des grandes vertus
- Je crois qu'il faut adopter le principe : agis dans ton lieu, pense avec le monde. C'est cela la mondialité. Une politique du monde qui s'oppose aux aspects négatifs de la mondialisation.Auteur : Edouard Glissant - Source : Entretien L'Humanité, 6 Février 2007 réalisé par Rosa Moussaoui et Fernand Nouvet
- Les meilleurs principes se recommandent plus par le succès que par les moyens mis à leur service.Auteur : Marcel Aymé - Source : Vogue la galère (1947), III, 13, le Lieutenant
- Que de vérité et de sagesse dans tout ce que Votre Majesté dit sur cette philosophie des stoïciens, plus grande que nature et si peu propre, avec ses grands mots et ses principes exagérés, à soulager ceux qui souffrent!Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Lettre au roi de Prusse, 9 août 1782
- Je parvins jusqu'à l'âge de quarante ans, flottant entre l'indigence et la fortune, entre la sagesse et l'égarement, plein de vices d'habitude sans aucun mauvais penchant dans le coeur, vivant au hasard sans principes bien décidés par ma raison.Auteur : Jean-Jacques Rousseau - Source : Les Rêveries du promeneur solitaire (1776-1778, édition posthume 1782), III
- La Bible peut être une oeuvre de fiction saisissante et poétique, mais ce n'est pas le genre de livre à donner à ses enfants pour élaborer leurs principes moraux.Auteur : Richard Dawkins - Source : Pour en finir avec Dieu (2008)
- Tous les échecs de la métaphysique viennent de ce que les métaphysiciens ont substitué à l'être, comme premier principe de leur science, l'un des aspects particuliers de l'être étudiés dans les diverses sciences de la nature.Auteur : Etienne Gilson - Source : L'Etre et l'essence (1948)
- Il n’est pas facile de ne plus être président de l’OM. Il est encore moins facile d’en ressentir l’injustice. Ayant exercé ma fonction selon certains principes, j’ai toujours su qu’ils auraient une contrepartie intangible : un jour ou l’autre, ils m’obligeraient à partir. Auteur : Pape Diouf - Source : C'est bien plus qu'un jeu (2013)
- Les Français vaudront tout leur prix, lorsqu'ils substitueront les principes à la turbulence, l'orgueil à la vanité, et surtout l'amour des institutions à l'amour des places.Auteur : Napoléon Bonaparte - Source : Maximes de guerre et pensées, 173
- La notion de chocolat contredit-elle le principe du libre-arbitre?Auteur : Sandra Boynton - Source : Sans référence
- Le pacifiste par principe est un vaincu par nature.Auteur : Bernard Willems-Diriken, dit Romain Guilleaumes - Source : Le Bûcher des Illusions, Impertinences (2004)
- La partie poilue du pinceau (celle qui en principe sert à peindre!) appliquée sur la surface y laisse son empreinte. Et voilà le travail et voilà la peinture.Auteur : Niele Toroni - Source : Sans référence
- L'aristocratisme du désintéressement est sans doute au principe de nombre de condamnations de la société de consommation qui oublient que la condamnation de la consommation est une idée de consommation.Auteur : Pierre Bourdieu - Source : La distinction : critique sociale du jugement (1979)
- Les principes se sentent, les propositions se concluent.Auteur : Blaise Pascal - Source : Pensées (1670), 282
- Le monde n'est par lui-même ni bon ni mauvais. La nature, Dieu, ou quelque principe que ce soit à qui nous attribuons la direction de notre existence, n'apportent ni récompense ni châtiment. A nous de tirer leçon de nos expériences. Il n'est qu'une seule faute : l'ignorance.
Auteur : Anne Rice - Source : Les Chroniques des Vampires (1990)
- C'est au moment où l'on rejette tous les principes qu'il convient de se munir de scrupules.Auteur : Marguerite Yourcenar - Source : Alexis ou le Traité du vain combat (1929)
- Pour les hommes vraiment honnêtes, et qui ont de certains principes, les commandements de Dieu ont été mis en abrégé sur le frontispice de l'abbaye de Thélème: fais ce que tu voudras.Auteur : Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort - Source : Maximes et Pensées, Caractères et Anecdotes (1795)
- La Corée du Nord s'est arc-boutée sur ses principes et n'a pas changé envers ceux qu'elle appelle « les salauds ». Caché derrière ses murailles et sa doctrine, le pays s'est autoverrouillé, assujettissant le peuple à un délire et à un cule de la personnalité exponentiels. Chaque citoyen serait réparti dans l'une des trois classes (les « durs », les « hésitants », les « hostiles ») Auteur : Jean-Luc Coatalem - Source : Nouilles froides à Pyongyang (2013)
- Les grandes récompenses dans une monarchie et dans une république sont un signe de leur décadence, parce qu'elles prouvent que leurs principes sont corrompus.Auteur : Charles de Secondat, baron de Montesquieu - Source : De l'esprit des lois (1748)
- Malheur au roi qui contraint son peuple à discuter les principes de l'autorité et de l'obéissance!Auteur : Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes - Source : Pensées et Maximes
Les mots proches de « principe »
Priant, ante Priape Prié, ée Prie-dieu Prier Prier-dieu Prière Prieur Prieural, ale Prieure Prieuré Primaire Primat Primatial, ale Primatie Primauté Prime Prime Prime Prime Prime Primé, ée Primefeuille Primefleur Primer Primerole Primerose Prime-sautier, ière Primeur Primevère Primitif, ive Primitivement Primogéniture Primordial, ale Prince Princerie Princesse Principal, ale Principal Principalement Principalité Principat Principauté Principe Principion Princiser Printanier, ière Printemps Priori (à) PriorissaleLes mots débutant par pri Les mots débutant par pr
pria priai priaient Priaires priais priait priâmes priant priant priant priapique priapiques priapisme priasse priât Priay prie prié prie-dieu priée priées prient prier priera prierai prieraient prierais prierait prieras prière prièrent prières prierez prierons prieront pries priés prieur prieur prieure prieuré prieurés prieurs priez Priez Prignac Prignac-en-Médoc Prignac-et-Marcamps Prigonrieux priions
Les synonymes de « principe»
Les synonymes de principe :- 1. archétype
2. prototype
3. type
4. essence
5. modèle
6. original
7. étalon
8. exemple
9. parangon
10. axiome
11. postulat
12. prémisse
13. proposition
14. évidence
15. adage
16. aphorisme
17. maxime
18. sentence
19. credo
20. foi
21. loi
22. norme
23. règle
24. élément
25. substance
26. milieu
27. arôme
28. carburant
29. espèce
30. prescription
31. canon
32. ligne
33. philo
synonymes de principe
Fréquence et usage du mot principe dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « principe » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot principe dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Principe ?
Citations principe Citation sur principe Poèmes principe Proverbes principe Rime avec principe Définition de principe
Définition de principe présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot principe sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot principe notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 8 lettres.
