Définition de « violon »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot violon de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur violon pour aider à enrichir la compréhension du mot Violon et répondre à la question quelle est la définition de violon ?
Une définition simple : (fr-rég|vj?.l??) Synonyme : archet, alto, contrebasse
Approchant : violoniste, violoncelle, viole, violon électrique
Définitions de « violon »
Trésor de la Langue Française informatisé
VIOLON, subst. masc.
Wiktionnaire
Nom commun - français
violon \vj?.l??\ masculin
-
(Musique) Luth à manche court dont la touche lisse est dépourvue de frettes, muni de quatre cordes que l'on frotte avec un archet.
- Nous entrons à Mirecourt tout étonné de n'y entendre point crincrinner les violons ; car on ne fait que des violons, à Mirecourt, des violons, encore des violons, [?]. ? (Gustave Fraipont, Les Vosges, 1923)
-
Enfin, elle articula timidement, d'une voix aiguë et mal assurée comme un violon qui crincrine :
? Vous n'auriez pas une goutte de lait ? ? (Jacques Yonnet, Enchantements sur Paris?, 1966, page 77) - Le fracas de l'orchestre leur arrivait, assourdissant. Par instants, les violons dominaient le vacarme qu'ils semblaient apaiser, caresser, contenir, mais le saxo, le piston, la clarinette et surtout la trompette [?] se mettaient ensemble à mugir et à pétarader de telle sorte que personne ne parlait plus. ? (Francis Carco, L'Homme de minuit, Éditions Albin Michel, Paris, 1938)
- Nous vîmes apparaître [?] deux ou trois camarades de l'autre batterie ; l'un portait un violon emprunté au 18e d'artillerie et dont la chanterelle était remplacée par un fil d'acier. ? (Alain, Souvenirs de guerre, page 196, Hartmann, 1937)
- Quand le chef monta sur l'estrade, le pianiste leva les yeux et lui sourit. Puis il hocha la tête, et l'on entendit le frémissement des violons, la pulsion d'un pouls profond qui annonçait l'entrée du piano. ? (Michel Benoît, Le Secret du treizième apôtre, Éditions Albin Michel, 2006, chap. 68)
- Celui, celle qui joue du violon.
- Une troupe de violons.
- Les violons de l'opéra.
- Il y a tant de violons dans cet orchestre.
- Premier, second violon.
-
(Argot) (Prison) Sorte de prison contiguë à un corps de garde ; dépôt pour les gardes à vue.
- [?] ; mais le dépôt étant considéré comme une sorte de violon central, destiné, comme les autres violons, aux arrestations provisoires qui doivent être prochainement régularisées, les détenus s'y trouvent, au point de vue légal, dans une condition particulière et en quelque sorte anormale. ? (Paul-Gabriel d'Haussonville, L'Enfance à Paris, 1879, Calmann-Lévy, p.195)
- Paul traversa la ville. Les deux gendarmes le tenaient chacun par un bras pour mieux montrer à tout le monde qu'ils l'emmenaient avec eux. On le mit au violon. ? (Charles-Louis Philippe, Dans la petite ville, 1910, réédition Plein Chant, page 158)
- Sarah-Rivka au violon ! Elle y passera la nuit, en compagnie de prostituées et de pochardes. ? (Gabriel Roth, Le Rire de Job, page 115, L'Harmattan, 2005)
-
(Art) Sorte de touret à main que l'on fait mouvoir à l'aide d'un archet.
- Un violon de serrurier.
-
(Marine) Cordelettes et planchettes que l'on dispose par mauvais temps le long des tables des navires pour retenir les assiettes, les verres, etc.
- La table modifie sa pente à chaque instant. Une bouteille d'eau minérale est calée dans le violon antiroulis par un gros livre broché. ? (Pierre Schoendoerffer, Le Crabe-tambour, 1976, p. 53)
- La mer était grosse, on a été obligés de mettre les violons.
- (Acadie) (Botanique) Nom vernaculaire de Larix laricina, le mélèze laricin.
-
(Héraldique) Meuble représentant l'instrument de musique du même nom dans les armoiries. Il est généralement représenté en pal, manche vers le chef. À rapprocher de claricorde, guitare, harpe, luth, lyre et vièle.
 Armoiries avec un violon (sens héraldique)
Armoiries avec un violon (sens héraldique)- D'argent à un violon au naturel et une masse de sable passés en sautoir, qui est de la commune de Zwota en Allemagne ? voir illustration « armoiries avec un violon »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Instrument de musique formé d'une caisse en bois munie de quatre cordes et dont on joue avec un archet. Jouer du violon. Joueur de violon. Danser au violon, au son du violon. Un bon violon. L'âme d'un violon. Sonate pour piano et violon. Un concerto de violon, Un concerto où le violon fait la principale partie. Un solo, un accompagnement de violon, Un solo, un accompagnement exécuté au violon.
VIOLON désigne aussi Celui, celle qui joue du violon. Une troupe de violons. Les violons de l'opéra. Il y a tant de violons dans cet orchestre. Premier, second violon. Fig. et fam., Il a payé les violons, Il a payé les frais d'une chose dont les autres ont eu le profit ou le plaisir.
VIOLON se dit encore d'une Sorte de prison contiguë à un corps de garde. Il faisait du tapage dans la rue, on l'a arrêté et mis au violon. En termes d'Arts, il se dit d'une Sorte de touret à main que l'on fait mouvoir à l'aide d'un archet. Un violon de serrurier. En termes de Marine, il se dit de Cordelettes et de planchettes que l'on dispose par mauvais temps le long des tables des navires pour retenir les assiettes, les verres, etc. La mer était grosse, on lui obligé de mettre les violons.
Littré
-
1Instrument de musique à quatre cordes accordées de quinte en quinte (sol, ré, la, mi), et dont on joue avec un archet.
Les acteurs laissant le masque antique, Le violon tint lieu de ch?ur et de musique
, Boileau, Art p. III.Un violon faux qui jure sous l'archet
, Boileau, Sat. III.Lulli, qui n'avait point encore le privilége de l'opéra, fit la musique du ballet de Pourceaugnac?; il y dansa, il y chanta, il y joua du violon
, Voltaire, Vie de Molière.Un grand chanteur est un être essentiellement nerveux?; c'est le tempérament contraire qu'il faut pour bien jouer du violon
, Stendhal, Vie de Rossini, p. 266, éd. Michel Lévy.Vers le XVe siècle, il paraît qu'on réduisit en France la viole à de plus petites proportions, pour en former le violon tel qu'on le connaît aujourd'hui, et pour borner cet instrument à quatre cordes?; ce qui peut faire croire que cette réforme se fit en France, c'est que le violon est indiqué dans les partitions italiennes de la fin du XVIe siècle sous le nom de petit violon à la française
, Fétis, la Musique, II, 16.Le violon, destiné à l'exécution des parties aiguës les plus importantes de l'instrumentation
, Fétis, Manuel du compos. II, 1.Violons d'auteur, violons des plus habiles facteurs, et qui se sont améliorés en vieillissant.
Symphonie de violon, concerto de violon, symphonie, concerto où le violon exécute la partie principale.
Un solo, un accompagnement de violon, un solo, un accompagnement exécuté par le violon.
Donner les violons, donner une sérénade, payer les violons d'un bal.
Le G*** [gouverneur] me donna les violons, que je trouvai très bons
, Sévigné, 157.C'est moi qui donne les violons dans ce canton des Champs Élysées
, Dancourt, Fête du Cours, sc. 16.Fig. Se donner les violons, être content de soi, s'applaudir, se vanter.
Fig. Se donner les violons, avoir les violons de quelque chose, en tirer vanité.
Il est cruel pour nous d'être en but à la maudite intrigue de gens qui, peut-être sans faire des choses merveilleuses, veulent avoir les violons de tout
, Corresp. de Klinglin, t. II, p. 298.Fig. Payer les violons, faire les frais d'une chose dont les autres ont tout le profit, tout le plaisir.
Je ne suis point d'humeur à payer les violons pour faire danser les autres
, Molière, Comtesse, 21.Nous verrons s'il me faut, avec ces scélérats, Payer les violons quand je ne danse pas
, Poisson, Les fous divert. dans LEROUX, Dict. com.On ne danse guère que dans la paix?; il est vrai que vous avez fait payer les violons à quelques puissances voisines?; mais c'est pour le bien commun et pour le vôtre
, Voltaire, Lett. au roi de Pr. 15 mai 1742.Fig. Il paye les violons et les autres dansent, ou les autres ont dansé et il a payé les violons, se dit quand quelqu'un fait les frais d'un divertissement où il a le moins de part.
On dit simplement aussi?: Il a payé les violons.
Couteau manche violon, couteau dont le manche est en forme de manche de violon.
-
2Famille du violon?; ce sont les violons, les altos, les violoncelles et les contre-basses, dont la forme est exactement semblable sous des dimensions très différentes. La forme un peu bombée des deux tables, l'âme qui communique les vibrations de l'une à l'autre, la pression du chevalet, tout concourt à donner à ces instruments une sonorité, une puissance que n'ont pas les autres instruments à cordes.
Les violons, violes et basses (comprenant les violoncelles et contre-basses) sont restés et resteront toujours le fondement des orchestres
, Fétis, la Musiq. XVIII. -
3Violon d'amour, violon ordinaire auquel on ajoute quatre cordes de laiton.
Violon harmonique, instrument d'invention récente.
-
4Celui qui fait profession de jouer du violon.
Ferme, ô violons de village?!
Molière, Précieus. 13.Qu'on fasse venir les violons du village, et que la journée finisse par des danses
, Marivaux, l'Épreuve, sc. 21.On fit entrer les violons, et l'on dansa
, Diderot, Lett. à Mlle Voland, 15 sept. 1760.Ce violon fameux que nous devons entendre
, Boissy, Deh. tromp. III, 5.Paganini, le premier violon d'Italie et peut-être du monde
, Stendhal, Vie de Rossini, p. 266.Il ne faut pas entendre Paganini lorsqu'il cherche à lutter avec des violons du Nord dans de grands concertos
, ID. ib. p. 267.Fig.
Toutes nos langues modernes sont sèches, pauvres et sans harmonie, en comparaison de celles qu'ont parlées nos premiers maîtres, les Grecs et les Romains?; nous ne sommes que des violons de village
, Voltaire, Lett. Mme du Deffant, 19 mai 1754.Fig. Premier violon, deuxième violon, violons jouant la première, la deuxième partie.
Les vingt-quatre violons du roi, la grande bande de violons, sous Louis XIV et Louis XV.
Quand le cardinal Mazarin fit venir chez nous l'opéra, nous n'avions que vingt-quatre violons discordants qui jouaient des sarabandes espagnoles
, Voltaire, Lett. Mme du Deffant, 12 août 1774.Anciennement, le roi de tous les violons, maîtres à danser et joueurs d'instruments, celui qui était à la tête de la communauté et qui la gouvernait avec les maîtres de la confrérie. Les aspirants devaient faire expérience devant le roi des violons.
- 5Jeu d'orgues de tuyaux à bouche, ouvert de deux pieds, qui sert d'unisson au principal.
- 6Prison contiguë à un corps de garde dans laquelle on dépose provisoirement des gens arrêtés le soir pour qu'ils y passent la nuit, en attendant que la justice prononce le lendemain matin si leur emprisonnement doit être ou non maintenu. Il fut mis au violon.
-
7Anciennement, homme de rien, mauvais sujet.
Godeau?: Colletet, je vous trouve un gentil violon. - Colletet?: Nous sommes tous égaux, étant fils d'Apollon
, Saint-Évremond, les Académiciens, I, 2.? Cet homme-là [le grand Corneille], malgré son Apollon, Fut naguère cité devant cette police Ainsi qu'un petit violon
, Gazette rimée de Robinet, citée par M. ÉD. FOURNIER, dans son Paris démoli, 2e éd. 1855, p. 185.On roua avant-hier un violon, qui avait commencé la danse et la pillerie du papier timbré
, Sévigné, 229.Dans les nouveaux dialogues on lui donne un caractère aussi bas qu'au plus misérable violon qui ait jamais été
, Fontenelle, Jugem. de Pluton.Il est comme les violons qui n'ont point de pire maison que la leur, se dit de celui qui n'est guère à sa maison.
Sentir le violon, être sur le point de devenir misérable
, Oudin, Curios. franç. -
8 Terme de marine. Poulie à violon, poulie dont la caisse a quelque chose de la forme d'un violon.
Se dit de bordages épais, placés de chaque côté du beaupré pour le maintenir et découpés en forme de violon.
Violons, nom donné, sur les paquebots, aux cordes disposées parallèlement d'une extrémité de la table à l'autre, pour permettre aux assiettes, aux verres, aux bouteilles, etc. de se tenir sans trébucher malgré les mouvements du navire.
-
9Outil du treillageur, espèce de touret.
Ustensile de chapelier.
Terme de typographie. Longue galée sans coulisses pour mettre en pages.
-
10Nom que les habitants de la Guyane ont quelquefois donné aux tatous.
PROVERBE
Du proverbe?: sec comme rebec, nous avons fait?: sec comme un violon,
Castil-Blaze, Molière musicien, t. I, p. 9.
HISTORIQUE
XVIe s. Au son de la bourse, commencerent tous les chats fourrés jouer des gryphes, comme si fussent violons desmanchés
, Rabelais, V, 13. Riz [Rizzio], chantre, joueur de lut et fils d'un violon de Thurin
, D'Aubigné, Hist. I, 256.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
VIOLON. Ajoutez?:Planche carrée qui est garnie de fils de fer parallèlement placés, comme le sont les cordes de l'instrument de musique dont elle a pris le titre?; chacun de ces fils correspond à une des boîtes de couleur?; on se sert du violon dans l'impression des tissus, Magasin pittoresque, 1858, p. 175.
Encyclopédie, 1re édition
VIOLON, s. m. (Luth.) instrument de musique à cordes & à archet, représenté figure 7. Planche de Lutherie. Cet instrument, comme tous les autres de son espece, est composé de deux tables contournées, comme on voit dans la figure. Celle de dessous est ordinairement e hêtre, & est de deux pieces collées, suivant la largeur. Celle de dessus, sur laquelle porte le chevalet qui soutient les cordes, est de sapin ou de cedre, comme les tables des clavecins ; les deux tables sont jointes ensemble par les bandes de bois ab, bcd, def, qu'on appelle éclisses, & dont la largeur détermine l'épaisseur du corps de l'instrument. Ces éclisses sont de bois de hêtre. On ménage en taillant la table de dessus, une épaisseur A fig. à la partie intérieure & supérieure de cette table : cette épaisseur est quelquefois un morceau de bois collé & chevillé en cet endroit ; cette épaisseur sert d'épaulement & de point d'appui au talon a du manche aA, qui est composé de trois parties ; du manche proprement dit, qui est depuis a jusqu'en L, du sommier LA, qui est de la même piece, lequel est évuidé pour faire place aux cordes qui vont s'envelopper au-tour des chevilles 1, 2, 3, 4. Ce sommier dans lequel les chevilles tiennent à frottement, est armé à sa partie supérieure A d'un rouleau de sculpture, ou quelquefois d'une tête d'homme ou d'animal à la volonté du facteur ; car ces sortes de choses ne font rien à la bonté de l'instrument. La troisieme partie du manche est la touche Bk, qui est collée sur le manche, laquelle est ordinairement d'ébene ou de bois noirci ; c'est sur cette touche que celui qui joue de cet instrument appuie les cordes pour déterminer leur longueur, qui se prend depuis le chevalet D jusqu'au filet d'ivoire B, lorsqu'on les touche à vuide, & seulement depuis le même chevalet jusqu'à l'endroit de la touche où elles sont tenues appliquées par le doigt lorsqu'on ne les touche pas à vuide. Ces instrumens sont en outre percés de deux ouvertures ii, dont on voit le modele dans la figure, Pl. de Lutherie. Ces ouvertures que l'on fait pour donner passage aux sons qui se forment non-seulement par les vibrations des cordes, mais aussi par celles de la table supérieure, s'appellent les ouies, lesquelles ont la forme d'une S ; au-lieu que celles des violes & contre-basses, &c. ont la forme d'un C.
Pour faire un violon, après avoir collé les deux pieces qui doivent former la table de dessus, & les avoir chantournées, suivant l'un ou l'autre des patrons AB, fig. Pl. de Luth. on applique cette table sur la machine représentée, fig. appellée creusoir, sur laquelle on l'affermit au moyen des deux vis & de leurs écrous am. Après que la table est ainsi affermie, & que le creusoir est arrêté sur l'établi, on creuse la table autant qu'il convient, en épargnant la partie qui doit servir d'appui au talon du manche ; on fait ensuite l'autre côté de table, qu'on applique pour cet effet sur la planche représentée, fig. On fait la même chose à la planche de sapin qui doit servir de table à l'instrument, observant de la creuser davantage sur le milieu, & de la réduire à environ de ligne d'épaisseur, plus ou moins, selon la taille de l'instrument & la qualité du bois, car il s'en trouve qui sont plus ou moins sonores les uns que les autres.
Pour creuser les tables, on se sert de rabots de fer ou de cuivre ABC, représentés, Pl. fig. dont quelques-uns, comme B, ont le fer denté. Ces rabots, dont on se sert pour creuser des surfaces courbes, ont la semelle convexe, le fer est arrêté par un coin D, qui passe entre lui & une cheville : on se sert en premier lieu du rabot dont le fer est denté ; en second lieu de ceux dont le fer est tranchant, & on acheve avec des ratissoirs d'acier, qui sont des morceaux de ce métal aiguisés en biseau sur une pierre à l'huile. Pour juger de l'épaisseur de la table, on se sert du compas à mesurer les épaisseurs, représenté, fig. qui est tellement construit que lorsque les deux pointes d embrassent l'épaisseur de la table, les deux autres pointes e laissent entr'elles un vuide égal à l'épaisseur que le compas embrasse par les autres pointes.
Après que les tables sont achevées, on prend le moule d'une grandeur convenable. Le moule est une piece de bois chantournée de même que l'instrument, ou une carcasse, comme celle de la fig. On allege le moule lorsqu'il est fait d'une seule piece de bois par de grandes mortaises, ce qui ôte un poids superflu ; ce qu'on n'est pas oblige de faire lorsque le moule est de pieces d'assemblage, soit que l'on se serve de l'un ou de l'autre des deux moules représentés, Pl. fig. Ils doivent être tellement construits qu'il y ait six entailles aa, bb, cd, dans la circonférence du moule. Ces entailles servent à placer des tasseaux sur lesquels on colle les éclisses ; les quatre entailles aabb servent à placer les tasseaux des coins des éclisses, & l'entaille c, celui du bouton auquel le tirant est attaché : l'entaille d sert à placer le tasseau qui soutient le talon du manche. Après que les tasseaux sont placés, on colle dessus les éclisses qui doivent prendre la forme du moule, & avoir la même largeur. Les éclisses des violons sont de quatre pieces ; savoir deux pour les parties concaves xx, qui servent de voie à l'archet ; une autre piece xdx, qui fait le tour du haut du corps, & enfin la piece xcb, qui fait le tour par en-bas du même corps. On lie les éclisses sur le moule, après les avoir ployées à coups de batte pour leur faire prendre pli. Après que les éclisses sont collées & séchées sur les tasseaux, on retire le moule, & on colle les éclisses toutes assemblées sur la table de dessous, sur laquelle on les tient appliquées par le moyen des presses ou happes, représentées, fig. dont on serre les vis ou les écrous. Après que l'ouvrage est placé entre les branches des happes, si on se sert des presses, représentées, fig. Pl. de Luth. on applique l'épaulement A de la vis sous la table inférieure, & le bord de l'écrou B sur le champ des éclisses que l'on comprime par ce moyen sur la table, & qu'on laisse en cet état jusqu'à ce que la colle soit séchée. On prépare ensuite la table supérieure, dont les ouies doivent être percées avant de la coller. Pour percer les ouies, on se sert des emporte-pieces Aa ; l'emporte piece est un fer à découper, lequel est rond, en sorte que son empreinte est en cercle ; on le présente sur la table par le trou rond 1 2, qui est à l'extrémité des S ou des C des patrons des violons ou des violes, voyez les figures, que l'on place sur la table de l'instrument, en sorte que l'ouverture du patron réponde vis-à-vis le lieu où doivent être les ouies ; on appuie l'emporte-piece sur la table par cette ouverture, & on tourne cet outil que l'on tient par la poignée CD, jusqu'à ce que l'on ait percé le trou & emporté la piece. Après que les ronds sont percés, & que l'S ou le C est tracé sur la table, on prend une petite scie ou équoine, avec laquelle on fait une fente qui communique depuis l'un des trous jusqu'à l'autre en suivant le contour de l'S ou du C : on élargit ensuite cette fente avec de petits couteaux F, jusqu'à ce qu'on ait atteint le trait qui termine le contour de l'S.
Lorsque les ouies sont percées & reparées, on trace tout-au-tour à quelques instrumens un double filet, qui sont deux traits éloignés l'un de l'autre d'environ demi-ligne, lesquels bordent ces ouvertures. L'outil avec lequel on trace ces filets, que l'on remplit ensuite de noir, & qu'on appelle tire-filet, est représenté dans les Planches.
Figure a est le fer qui a deux pointes pour tracer les deux traits. b est le guide qui suit le contour intérieur des S, pendant que les deux pointes tracent les filets. CD sont deux vis, dont la premiere c retient le guide b & la seconde D le burin à deux pointes a dans la boîte E. Cette boîte est emmanchée au moyen de la frette G au manche F, par lequel on tient cet instrument.
Les facteurs se servent aussi d'un autre tire-filet, représenté, fig. Pl. pour tracer les filets qui entourent tout l'instrument, & qui suivent la même direction que les éclisses. A & B est la tige de cet outil qui est de fer ; la tige est percée d'un trou quarré par lequel passe le burin DE, qui a une ou plusieurs pointes, selon le nombre de filets dont on veut entourer l'instrument. Le burin est arrêté dans son trou par les vis C. La piece en équerre gFG sert de guide, & dont on fixe la branche G à telle distance que l'on veut de la pointe E du burin, au moyen des vis gF. On se sert de cet outil comme du trusquin, dont il est une espece. Après que la table est préparée, comme il a été dit ci-devant, & avant de tracer tout au tour les filets, on la colle sur les éclisses vis-à-vis de la fausse table, avec laquelle au moyen de la colle elle ne doit plus faire qu'un même corps ; c'est pourquoi les éclisses doivent s'appliquer exactement sur le côté intérieur de cette table, qui doit être aussi collée sur les tasseaux. On tient cette table sur les éclisses par le moyen des happes & des presses, comme on a fait la premiere, jusqu'à ce que la colle soit séchée ; on polit ensuite le corps de l'instrument, tant sur les tables que sur les éclisses, avec les ratissoirs ou grattoirs dont on a parlé ci-devant, & avec de la peau de chien de mer. Quand tout le corps est ainsi achevé, on colle le manche par son talon sur le tasseau d d'en-haut, sur lequel il doit être fermement attaché. Sur le tasseau inférieur c on colle un bouton d'ivoire ou d'ébene, après y avoir percé un trou pour faire entrer la queue de ce bouton, fig. qui sert d'attache au tiran h auquel les cordes sont attachées. Par-dessus le manche on colle la touche Bk, qui est d'ébene ou de quelqu'autre bois dur noirci, laquelle doit être un peu plus longue que la moitié de l'intervalle BD, compris entre le sillet B & le chevalet D. Cette touche ne doit point toucher sur le corps de l'instrument dans la partie ak, mais elle doit en être éloignée d'environ un tiers de pouce, & être un peu convexe par-dessus, & un peu concave par dessous seulement dans la partie qui répond vis-à-vis du corps & plate par-dessous dans la partie aB où elle est appliquée & collée sur le manche. La partie AB du manche qui s'incline un peu en arriere, & qu'on appelle le sommier, est traversée de quatre chevilles 1 2 3 4 ; ces chevilles ont un trou dans la partie qui traverse le sommier ; on fait passer la corde dans ce trou pour qu'elle puisse tenir en s'enveloppant au-tour de la cheville, lorsqu'on la tourne pour tendre la corde qui est attachée par l'autre extrémité au tiran h par le moyen d'un anneau ou anse qui passe par un des trous de cette piece, laquelle on tend sur le chevalet D & le fillet B : ces deux pieces ont de petites entailles pour loger les cordes qui, sans cette précaution ne pourroient pas rester dessus. Le chevalet est un morceau de bois plat qui a deux piés, lesquels portent sur la table, & dont l'autre côté est une portion de cercle : le milieu est découpé à jour selon le dessein qu'il plaît à ceux qui les font. Le violon est monté de quatre cordes de boyau, dont la plus menue, qui est tendue par la cheville 1, s'appelle chanterelle ou e si mi ; la seconde tendue, la cheville 2, s'appelle a mi la, & la troisieme s'appelle d la ré, & la quatrieme qui est la plus grosse de toutes, g ré sol, ou la basse, à cause de la gravité de ses tons. Ces deux dernieres cordes, qui sont tendues par les chevilles 3 4, sont filées d'argent ou de cuivre. Ce qu'on appelle des cordes filées ; ce sont des cordes de boyau qui sont entourées dans toute leur longueur d'un fil d'argent ou de cuivre argenté fort menu, qui va en tournant tout du long, en sorte que la corde en est toute couverte. Pour revêtir ainsi les cordes d'un fil d'argent ou de cuivre, les facteurs se servent d'un rouet LK, par le moyen duquel ils font tourner sur elle-même la corde AB, attachée d'un bout à l'émerillon C, voy. Emerillon, lequel est lui-même attaché à un bout de ficelle qui passe par-dessus la poulie B, attachée à la muraille, & au bout duquel est attaché le poids D ; l'autre extrémité de corde prend dans un crochet A, dont la tige traverse une poulie sur laquelle passe la corde sans fin APLQ, laquelle passe aussi sur la roue PLK, que l'on tourne avec la manivelle L, par le moyen de laquelle on fait tourner la poulie A, qui transmet son mouvement à la corde AC ; présentement si on attache un fil d'argent avec la corde à l'émerillon C, il s'enveloppera autour de cette corde à mesure qu'elle tournera sur elle-même, comme on conçoit qu'il s'envelopperoit au-tour d'un cylindre. On conduit le fil tout du long de la corde avec une éponge humide que l'on tient de la main gauche E, afin qu'il ne redouble pas plusieurs fois sur lui-même. La main droite F sert à conduire le fil qu'on fait passer dans l'anneau que l'on forme avec le doigt index & le pouce. G est la bobine au-tour de laquelle le fil d'argent est enveloppé ; elle peut tomner librement au-tour de la cheville fixée dans le montant A du rouet, dont elle est traversée. H est une boëte dans laquelle sont les différens assortimens de fil d'argent, de cuivre ou de cordes de boyau sur lesquelles il faut opérer. Le reste de la machine est facile à entendre ; c'est un banc bordé de regles de bois pour retenir ce que l'on met dessus, dans lequel sont plantées les jumelles N qui tiennent la roue du rouet en état, & le montant A qui porte la poulie, à la tige de laquelle la corde est attachée. Ces trois pieces, les deux jumelles N & le montant A sont arrêtés par-dessous l'établi par le moyen de trois clés qui les traversent.
L'archet avec lequel on fait parler les cordes de cet instrument, est composé d'une baguette AC, fig. 8. Pl. II. courbée un peu en A, pour éloigner les crins de la baguette, qui est de quelque bois dur, ordinairement du bois de la Chine, quoique tout autre qui a la force nécessaire soit également propre à cet usage, d'un faisceau de crins AB, composé de 80 ou 100 crins de cheval, tous également tendus & attachés dans la mortaise du bec A, par le moyen d'un petit coin, qui ne laisse point sortir l'extrémité des crins qui sont liés ensemble avec de la soie : ces crins sont attachés dans une semblable mortaise, qui est au bas c de la baguette de l'archet. La piece de bois B, qu'on appelle la hausse, parce qu'elle tient les crins éloignés de la baguette ou fust de l'archet, communique par le moyen d'un tenon taraudé, qui passe par une mortaise à la vis dont la piece d'ivoire D est la tête, laquelle entre 4 ou 5 pouces dans la tige de l'archet ; on se sert de cette vis pour faire avancer la hausse B vers A ou vers D, pour détendre ou pour tendre les crins de l'archet.
Pour jouer du violon, que l'on tient de la main gauche, l'archet de la droite ; on le prend par le manche aL, ensorte que le revers du manche soit tourné du côté du creux de la main, le pouce de la main gauche du côté de B, & les quatre autres doigts de la même main du côté de L ; l'index doit être près du fillet, & les autres doigts près les uns des autres, prêts à toucher la chanterelle, on porte ensuite en tournant le poignet la partie inférieure du corps de l'instrument sous le menton, ensorte que le tasseau où le bouton f est attaché, réponde sur la clavicule gauche, vers laquelle on tourne & on incline un peu la tête pour appuyer avec le menton sur l'endroit où
est la lettre E, & ainsi affermir l'instrument. Voyez la figure.
On prend ensuite l'archet avec la main droite à environ deux pouces de distance de la hausse B, & on le tient avec les quatre premiers doigts ; ensorte que le pouce & les deux premiers doigts portent sur le fust de l'archet, & le quatrieme ou annulaire sur le crin que l'on doit faire passer sur les cordes, à environ deux pouces de distance du chevalet, comme si on vouloit les scier en cet endroit ; on frotte le crin de l'archet sur un morceau de colophane, sorte de résine, pour le rendre plus rude, on passe le crin de l'archet sur la colophane, comme si on vouloit le scier en deux : quelques-uns la mettent en poudre, & passent le coin de l'archet dans le papier où est cette poudre ; ces deux manieres reviennent à-peu-près au même.
Il faut ensuite connoître le manche, que l'on supposera divisé en touches, pour la facilité de l'explication, & que d'ailleurs les traits marqueront les endroits où il faudra poser les doigts.
Il faut savoir en premier lieu, que les cordes du violon, & de tous les instrumens qui en dépendent, sont accordées de quinte en quinte ; que la seconde corde marquée 2, sonne l'a mi la, & qu'on la sonne à vuide, pour donner le ton dans les concerts. Cette corde la sonne l'unisson du la, qui suit immédiatement la clé de g ré sol des clavecins. La chanterelle sonne la quinte mi au-dessus, & la troisieme la quinte ré au-dessous ; la quatrieme sonne la quinte au-dessous de cette troisieme corde ou l'unisson du sol à l'octave au-dessous de celui de la clé de G re sol, au sol qui suit immédiatement la clé d'F ut fa des clavecins, auquel tous les autres instrumens rapportent leur étendue. Voyez la table du rapport de l'étendue de tous les instrumens, & la tablature qui suit, ou les notes de musique, font voir l'étendue de cet instrument, & les quatre lignes qui sont dessous représentent les cordes numérotées comme ci-devant 1 2 3 4, à commencer par la chanterelle : les chiffres qui sont sur les lignes font connoître de quel doigt il faut toucher la corde, & la lettre de la tablature qui est au-dessous, faite à l'instar de celle de la viole, quoiqu'elle ne soit pas en usage pour le violon, montrera l'endroit de la touche où il faut poser le doigt, comme si elle étoit divisée ainsi que celle de la viole. Voyez Viole, où on trouvera des régles pour gouverner l'archet, observant de lire dans ces régles pousser au lieu de tirer, & tirer au-lieu de pousser, pour les raisons déduites au même article.

Le violon ou proprement la viole d'amour. Cet instrument est plus grand que les grands dessus de viole, il est de la même forme, monté de même à six cordes ; outre ces six cordes il en a six autres de laiton, qui passant en-dedans la touche soutenue par le milieu du chevalet, sont attachées au-dessous de la queue par autant de crochets. Son accord & sa tablature sont différente, des autres instrumens à son accord ; car il s'accorde selon le ton ou mode des pieces que l'on veut jouer. Par exemple, si la piece est en d la ré, son accord sera ré, la, ré, fa, la, ré, ou ré, fa, la, ré, fa ; ce qui veut dire que sa maniere de l'accorder est prise des notes de l'accord parfait de la tonique de l'air qu'on veut jouer. Si quelquefois il y a une corde accordée dans un autre mode ; de la maniere dont la musique est copiée, à l'exécution cela revient au même : car telle ou telle note devient différente à l'exécution qu'elle ne paroît, puisque souvent il y a à la clé des dièzes & des bémols en même tems sur le papier. Nous avons quelques sonates de violon & de violoncelle dans ce genre. Cette sorte de tablature est faite ainsi tant pour l'accord que pour la maniere de copier la musique, afin de conserver la méchanique des doigts pour la position.
A l'égard des cordes de laiton qui sont en-dessous, elles sont accordées à l'octave ou à l'unisson des autres cordes.
De-sorte que cet accord à la tierce, quarte, quinte, & ces doubles cordes sont comme une espece d'écho, qui rendent cet instrument fort mélodieux, très-propres sur-tout pour les airs tendres & affectueux.
Violons, roides, (Musique.) c'est à Paris le chef perpétuel de la communauté des maîtres à danser & joueurs d'instrumens. Il est pourvu par lettres de provision de sa majesté, & est un des officiers de sa maison. (D. J.)
Étymologie de « violon »
Dérivé de viole?; provenç. violon?; catal. violi?; espagn. violon?; ital. violino. Quant à violon, prison, Génin, Récréat. t. I, p. 226, dit que, dans le XIVe siècle, psaltérion, sorte d'instrument de musique, avait pris le sens de prison, parce que mettre au psaltérion, c'était mettre en pénitence pour chanter les psaumes avec le psaltérion, et que, le psaltérion ayant passé de mode, on y avait substitué le violon. D'autres ont dit que le violon était un local de la Conciergerie où l'on enfermait les perturbateurs pendant les audiences, en leur laissant la liberté de jouer du violon. M. Kastner, dans sa Parémiologie, remarque que le psaltérion était un cep en bois où l'on passait les pieds des gens que l'on condamnait à cette punition?: Robert le fournier, pour le soupçon d'avoir robé Colin le varlet, rompu sa huche, et y prins onze solz tournois, fut mis ou cep dit salterion desdites prisons, Lett. de rémiss. 1377. Il remarque en outre qu'en allemand Fiedel ou Geige, qui signifie violon, a aussi le sens du cep des anciennes prisons. Il en conclut que violon a été dit, à l'imitation des Allemands, pour cep, qu'il a remplacé le psaltérion, et que du sens de cep le violon a passé au sens du lieu où était le cep. C'est de ce sens de cep que violon a pris celui de mauvais sujet.
- De viole avec le suffixe diminutif -on.
violon au Scrabble
Le mot violon vaut 9 points au Scrabble.
Informations sur le mot violon - 6 lettres, 3 voyelles, 3 consonnes, 5 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot violon au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
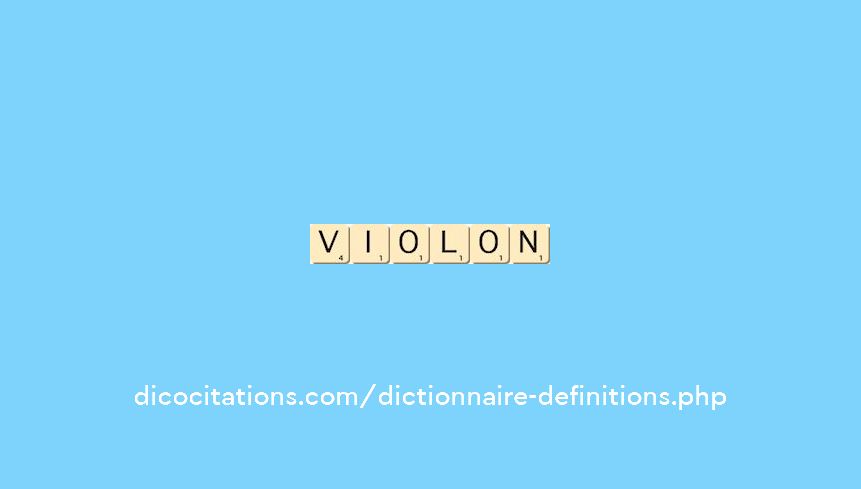
Les rimes de « violon »
On recherche une rime en L§ .
Les rimes de violon peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en l§
Rimes de chalon Rimes de long Rimes de décathlons Rimes de emballons Rimes de foulon Rimes de fignolons Rimes de coulons Rimes de circulons Rimes de mouflon Rimes de félons Rimes de galons Rimes de salons Rimes de talons Rimes de violons Rimes de caquelon Rimes de Borlon Rimes de pentathlon Rimes de chambre-salon Rimes de melon Rimes de tallons Rimes de récapitulons Rimes de dépucelons Rimes de talon Rimes de ballons Rimes de jalon Rimes de vallon Rimes de surplombs Rimes de cinglons Rimes de onglon Rimes de révélons Rimes de muselons Rimes de félon Rimes de aiglon Rimes de melons Rimes de blond Rimes de orlon Rimes de mouflons Rimes de tromblons Rimes de sablons Rimes de surplomb Rimes de engueulons Rimes de ondulons Rimes de gonfalon Rimes de roulons Rimes de survolons Rimes de contemplons Rimes de colons Rimes de triathlon Rimes de vallons Rimes de empilonsMots du jour
chalon long décathlons emballons foulon fignolons coulons circulons mouflon félons galons salons talons violons caquelon Borlon pentathlon chambre-salon melon tallons récapitulons dépucelons talon ballons jalon vallon surplombs cinglons onglon révélons muselons félon aiglon melons blond orlon mouflons tromblons sablons surplomb engueulons ondulons gonfalon roulons survolons contemplons colons triathlon vallons empilons
Les citations sur « violon »
- En toute chose il faut écrire à temps le mot finis, il faut se contenir, quand cela devient urgent, tirer le verrou sur son appétit, mettre au violon sa fantaisie et se mener soi-même au poste.Auteur : Victor Hugo - Source : Les Misérables (1862), Première partie, III, 7, Sagesse de Tholomyès
- Je me demande pourquoi nous prenons à nos femmes / Pourquoi nous violons nos femmes, nous haïssons nos femmes / Je crois qu'il est temps de tuer pour nos femmes / Temps de guérir nos femmes, d'être vrai envers nos femmes / Et si nous ne le faisons pas, nous aurons une race de bébés / Qui haïra les dames, qui font les bébés / Et à moins qu'un homme ne puisse en faire un / Il n'a aucun droit de dire à une femme quand et où en faire un / Alors, les vrais hommes vont-ils se lever ? / Je sais que vous en avez assez, mesdames, mais gardez la tête haute.Auteur : Tupac Shakur - Source : Keep Ya Head Up
- Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir;
Le violon frémit comme un coeur qu'on afflige;
Valse mélancolique et langoureux vertige !
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir.Auteur : Charles Baudelaire - Source : Les Fleurs du Mal (1857), XLVII - Harmonie du soir - Le violoniste fait chanter son instrument, le violoneux le fait danser... Auteur : Louise Penny - Source : Le beau mystère (2012)
- De violon, l'homme en vieillissant devient violoncelle, puis contrebasse: un corps épais, une voix grave et pas grand-chose à dire.Auteur : Gilbert Cesbron - Source : Sans référence
- La peinture est le métier le plus long et le plus difficile. Il lui faut l'érudition comme au compositeur, mais il lui faut aussi l'exécution comme au violon.Auteur : Eugène Delacroix - Source : Sans référence
- Très tôt, j'ai sauté dans le vide. Très vite, j'ai su que désobéir, c'était chercher. A ma façon, j'ai caressé le monde ! J'ai ri. J'ai bu. J'ai joué du violon. J'ai connu des passions funestes. Mais pas que ça. Il faut que ça se sache... J'ai souvent pris la mauvaise porte. J'ai vécu l'instant délicieux du danger, la cruauté du désir, la jalousie, la vengeance et l'envie de devenir un salaud absolu. Inutile, n'est-ce pas, d'ajouter le remords au regret. Là-dessus, pour le moment, je me tais. Auteur : Jean Vautrin - Source : Gipsy Blues (2014)
- La valse triste, le troisième violon qui joue faux, le maître d'hôtel qui a un oeil sur la steppe et l'autre sur l'addition. Avoue que rien n'est changé.Auteur : Michel Audiard - Source : Le Gentleman d'Epsom (1962) de Gilles Grangier
- Dans le silence qui suivit l'explosion, les plaintes flottèrent comme les notes de violoncelle bon marché qui émanent des cages à bestiaux dans lesquelles les bovins flairent leur avenir baigné de sang.Auteur : Toni Morrison - Source : Home (2012)
- Habitude: Est une seconde nature. Les habitudes de collège sont de mauvaises habitudes. Avec de l'habitude on peut jouer du violon comme Paganini.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Dictionnaire des idées reçues (1913)
- Je ne retrouve rien de mon violon, ni de son âme de bois, ni de son corps pas si verni que ça.Auteur : Jean Emmanuel Conil, dit Alain Page - Source : L'Ecume des nuits (2009)
- Toutes les belles choses sont difficiles, comme dit le proverbe ; et celui-là ne saura jamais le violon, qui n'a su que s'y amuser.Auteur : Emile-Auguste Chartier, dit Alain - Source : Propos
- Qui paie les violons ne danse pas toujours.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe
- Sans transition, les deux violons s'étaient lancés dans une tonitruante Gaillarde à vous fouetter les sangs.Auteur : Herbert Le Porrier - Source : Le Luthier de Crémone (1977)
- Les violons: l'âme des pieds.Auteur : sieur de Somaize, Antoine Baudeau - Source : Grand Dictionnaire des Précieuses ou la Clef de la langue des ruelles (1660)
- A cette époque, mon père tenait table ouverte. On ballait pendant trois jours: les maîtres, dans la grand-salle, au raclement d'un violon; les vassaux, dans la Cour Verte, au nasillement d'une musette.Auteur : François-René de Chateaubriand - Source : Mémoires d'outre-tombe (1848), Partie 1, Livre 2, Chapitre 2
- Jouer du violon le mardi.Auteur : Paul Éluard - Source : 152 Proverbes mis au goût du jour (1925), 100
- Un prodige, c'est un gamin qui joue du violon alors qu'il devrait être au lit depuis longtemps!Auteur : Michel Galabru - Source : Pensées, répliques et anecdotes (2006)
- L'attrait qu'exerce le virtuose sur le public paraît assez semblable à celui qui attire les foule vers les jeux du cirque. On espère toujours qu'il va se passer quelque chose de dangereux : M. Ysaye va jouer du violon en prenant M. Colonne sur ses épaules, ou bien M. Pugno terminera son morceau en saisissant le piano entre ses dents...Auteur : Claude Debussy - Source : Monsieur Croche, et autres écrits (1987)
- Les mille clairons du désir, les mille tam-tams du sang résonnèrent dans mes veines, et les mille violons du plaisir attaquèrent leur valse pour nous.Auteur : Françoise Sagan - Source : Un profil perdu (1974)
- Le violon seul chante sa pastorale mystique, reprise par les clarinettes et les bassons, en cantabile enamouré.Auteur : Romain Rolland - Source : Le Chant de la Résurrection (1937)
- Elle pensait que chaque être et chaque action étaient une note de violon dans la grande symphonie de l'existence.Auteur : Alice Zeniter - Source : Sombre Dimanche (2013)
- Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon coeur d'une langueur monotone.Auteur : Paul Verlaine - Source : Poèmes saturniens, Chanson d'automne
- J’ai compris pourquoi nous faisons pleurer les violons. Nous sommes un peuple du soleil et si nous sommes venus jusque dans les brumes, c’est seulement pour chercher refuge et nourriture. Auteur : Jean Vautrin - Source : Gipsy Blues (2014)
- Le génie est moins rare aujourd'hui qu'au temps de M. Ingres. Il y a mille peintres, et plus, qui jouent du violon.Auteur : Paul-Jean Toulet - Source : Les Trois Impostures (1922), 259
Les mots proches de « violon »
Vioche Viol Violabilité Violable Violacer Violat Violateur, trice Violation Violâtre Viole Violé, ée Violement Violemment Violence Violent, ente Violenté, ée Violenter Violer Violet, ette Violeter Violette Violeur Violier Violon Violonar Violoncelle Violoncelliste Violoniste ViorneLes mots débutant par vio Les mots débutant par vi
vioc viocard Viocourt viocque viocs Viodos-Abense-de-Bas viol viola violaçait violacé violacé violacée violacée violacées violacées violacer violacés violacés violaient Violaines violais violait violant violation violations violâtre violâtres Violay viole viole violé violée violées violemment violence violences violent violent violent violentaient violentait violente violente violenté violentée violenter violentes violents violents violer
Les synonymes de « violon»
Les synonymes de violon :- 1. viole
2. outrage
3. alto
4. Stradivarius
5. Amati
synonymes de violon
Fréquence et usage du mot violon dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « violon » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot violon dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Violon ?
Citations violon Citation sur violon Poèmes violon Proverbes violon Rime avec violon Définition de violon
Définition de violon présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot violon sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot violon notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 6 lettres.


