La définition de I du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
I
Nature : s. m.
Prononciation : i
Etymologie : I latin, qui est l'iota grec, lequel provient de l'i, des alphabets semitiques, de iod, la main.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de i de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec i pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de I ?
La définition de I
La neuvième lettre de l'alphabet et la troisième des voyelles. Un i. Deux i. La lettre i. Un ï tréma. Un î circonflexe. La voyelle i. Un i long. Un i bref.
Toutes les définitions de « i »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
La neuvième lettre de l'alphabet. Elle représente une des voyelles. La lettre I. Faire un i, un petit i, un grand I. Deux i. On met un point au-dessus de l'i, excepté quand il est majuscule : Isaac, Italie. On met un tréma sur l'i pour indiquer que, dans a prononciation, il doit se séparer de la voyelle qui précède ou qui suit : Achaïe, faïence, Moïse, ambiguïté, ïambe. Un ï tréma. Un î circonflexe. La voyelle I. Un i long. Un i bref. Fig., Mettre les points sur les i. Préciser, entrer dans le détail, déterminer les points essentiels dans une contestation. Fig. et fam., Il faut avec cet homme mettre les points sur les i, il faut être avec lui d'une exactitude scrupuleuse; et, dans un autre sens, il faut prendre avec lui les plus grandes précautions. Fam., Droit comme un I, Très droit. Malgré son grand âge, cet homme est encore droit comme un I.
Littré
-
1La neuvième lettre de l'alphabet et la troisième des voyelles. Un i. Deux i. La lettre i. Un ï tréma. Un î circonflexe. La voyelle i. Un i long. Un i bref.
C'était, dans la nuit brune, Sur le clocher jauni, La lune, Comme un point sur un i
, Musset, Ball. à la lune.Droit comme un i, très droit. Malgré son grand âge, cet homme est encore droit comme un i.
Fig. Il n'est bon qu'à mettre les points sur les i, c'est un homme qui ne s'attache qu'aux minuties dans les ?uvres d'esprit, et aussi qui n'a qu'une exactitude minutieuse et inutile.
Fig. Il faut avec cet homme mettre les points sur les i, c'est-à-dire il exige une exactitude scrupuleuse, et aussi il importe de prendre avec lui des précautions minutieuses.
Le régent était importuné des entraves continuelles que le duc de Noailles mettait aux opérations de Law, et des points sur les i qu'y mettait son ami le chancelier
, Saint-Simon, 479, 191.Mettre les points sur les i, expliquer les choses dans les détails les plus minutieux. On dit d'une façon analogue?: Mettre les points sur les i, s'expliquer de façon qu'il n'y ait pas d'erreur possible.
- 2Dans la logique scolastique, l'i était le signe des propositions particulières et affirmatives entrant dans les syllogismes.
- 3I, dans les chiffres romains, signifie un et s'additionne avec les lettres numérales à la suite desquelles on l'écrit?; mais, placé devant un nombre plus grand, il marque un à retrancher?: IV vaut quatre?; IX vaut neuf.
- 4Sur les anciennes monnaies de France, I indique qu'elles ont été frappées à Limoges.
REMARQUE
1. On met un point au-dessus de l'i, excepté quand il est majuscule?: Isaac, Italie.
2. On met un tréma sur l'ï, pour indiquer que, dans la prononciation, il doit se séparer de la voyelle qui précède?: Achaïe, faïence, Moïse, ambiguïté.
3. Lorsque, dans une syllabe, l'i se joint à la consonne qui le suit, sans être précédé d'une autre voyelle, il conserve sa prononciation naturelle, à moins que la consonne avec laquelle il se trouve joint ne soit une m ou une n illustre, irrégulier, issue. Mais dans impression, imprudent, impassible, printemps, brin, fin, lin, et autres semblables, le son de l'i se perd et il se forme une voyelle nasale dont le son ne peut être figuré et doit être perçu directement par l'oreille. Cependant, si l'm auquel i est joint se trouve redoublée, cette voyelle reprend sa prononciation naturelle, comme dans immédiat, immersion, immense, etc. Il en est de même lorsque l'n qui se trouve après l'i est suivie d'une voyelle ou d'une h non aspirée, comme dans inaction, inattendu, inexorable, inouï, inusité, inhabile, etc.
4. I s'unit avec a, e, u et ou pour former des diphtongues, comme dans?: mail. bataille, pied, premier, nuit, buis, oui, etc.
5. Il se joint souvent aux voyelles a, e et o pour représenter des sons très différents du son qui lui est propre. Ainsi dans?: faire, peine, ai et ei se prononcent ê, è.
6. I au milieu d'un mot est remplacé par y?: 1° dans les mots où il se dédouble, comme dans payer, où l'on entend pè-ier?; 2° dans les mots dérivés du grec, où il exprime l'upsilon de cette langue, comme dans hymen, martyr.
7. La lettre i s'élide dans la conjonction si avant le pronom masculin il, ils, tant au singulier qu'au pluriel?: Il viendra s'il veut?; ils auront tort s'ils se fâchent.
8. Autrefois on admettait deux i, l'i voyelle qui est notre i, et l'i consonne qui est notre j. C'est avec toute raison qu'on a fait cesser cette confusion.
HISTORIQUE
XIIIe s. Après vous conterai de l'i?; N'i a meillor lettre de li?; Plus est au mont [monde] li delis cors [le plaisir court], Que de l'i n'est petis li cors, Senefiance de l'ABC
, Jubinal, t. II, p. 278.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
I. - REM. Ajoutez?:
9. Dans immanquable et quelques autres, les deux m ne se dédoublent pas et l'on prononce in-manquable, et non i-mmanquable, comme on prononce i-mmense.
Encyclopédie, 1re édition
, s. m. c'est la neuvieme lettre de l'alphabet latin. Ce caractere avoit chez les Romains deux valeurs différentes ; il étoit quelquefois voyelle, & d'autres fois consonne.
I. Entre les voyelles, c'étoit la seule sur laquelle on ne mettoit point de ligne horisontale pour la marquer longue, comme le témoigne Scaurus. On allongeoit le corps de la lettre, qui par-là devenoit majuscule, au milieu même ou à la fin des mots pIso, vIvus, ædIlis, &c. C'est à cette pratique que, dans l'Aululaire de Plaute, Staphyle fait allusion, lorsque voulant se pendre, il dit : ex me unam faciam litteram longam.
L'usage ordinaire, pour indiquer la longueur d'une voyelle, étoit, dans les commencemens, de la répéter deux fois, & quelquefois même d'insérer h entre les deux voyelles pour en rendre la prononciation plus forte ; de-là ahala ou aala, pour ala, & dans les anciens mehecum pour mecum ; peut-être même que mihi n'est que l'orthographe prosodique ancienne de mi que tout le monde connoit, vehemens de vemens, prehendo de prendo. Nos peres avoient adopté cette pratique, & ils écrivoient aage pour age, roole pour rôle, separeement pour séparément, &c.
Un I long, par sa seule longueur, valoit donc deux ii en quantité ; & c'est pour cela que souvent on l'a employé pour deux ii réels, manubIs pour manubiis, dIs pour diis. De-là l'origine de plusieurs contractions dans la prononciation, qui n'avoient été d'abord que des abréviations dans l'écriture.
Par rapport à la voyelle I, les Latins en marquoient encore la longueur par la diphthongue oculaire ei, dans laquelle il y a grande apparence que l'e étoit absolument muet. Voyez sur cette matiere le traité des lettres de la Méth. lat. de P. R.
II. La lettre I étoit aussi consonne chez les Latins ; & en voici trois preuves, dont la réunion combinée avec les témoignages des Grammairiens anciens, de Quintilien, de Charisius, de Diomede, de Térencien, de Priscien, & autres, doit dissiper tous les doutes, & ruiner entierement les objections des modernes.
1°. Les syllabes terminées par une consonne, qui étoient brèves devant les autres voyelles, sont longues devant les i que l'on regarde comme consonnes, comme on le voit dans ?dj?vat, ?b J?ve, &c. Scioppius répond à ceci, que ad & ab ne sont longs que par position, à cause de la diphthongue iu ou io, qui étant forte à prononcer, soutient la premiere syllabe. Mais cette difficulté de prononcer ces prétendues diphthongues, est une imagination sans fondement, & démentie par leur propre briéveté. Cette brièveté même des premieres syllabes de j?vat & de J?ve prouve que ce ne sont point des diphthongues, puisque les diphthongnes sont & doivent être longues de leur nature, comme je l'ai prouvé à l'article Hiatus. D'ailleurs si la longueur d'une syllabe pouvoit venir de la plénitude & de la force de la suivante, pourquoi la premiere syllabe ne seroit-elle pas longue dans ?da?ctus, dont la seconde est une diphtongue longue par nature, & par sa position devant deux consonnes ? Dans l'exacte vérité, le principe de Scioppius doit produire un effet tout contraire, s'il influe en quelque chose sur la prononciation de la syllabe précédente ; les efforts de l'organe pour la production de la syllabe pleine & forte, doivent tourner au détriment de celles qui lui sont contiguës soit avant soit après.
2°. Si les i, que l'on regarde comme consonnes, étoient voyelles ; lorsqu'ils sont au commencement du mot, ils causeroient l'élision de la voyelle ou de l'm finale du mot précédent, & cela n'arrive point : Audaces fortuna juvat ; interpres divûm Jove missus ab ipso.
3°. Nous apprenons de Probe & de Térencien, que l'i voyelle se changeoit souvent en consonne ; & c'est par-là qu'ils déterminent la mesure de ces vers : Arietat in portas, parietibusque premunt arctis, où il faut prononcer arjetat & parjetibus. Ce qui est beaucoup plus recevable que l'opinion de Macrobe, selon lequel ces vers commenceroient par un pié de quatre brèves : il faudroit que ce sentiment fût appuyé sur d'autres exemples, où l'on ne pût ramener la loi générale, ni par la contraction, ni par la syncrèse, ni par la transformation d'un i ou d'un u en consonne.
Mais quelle étoit la prononciation latine de l'i consonne ? Si les Romains avoient prononcé, comme nous, par l'articulation je, ou par une autre quelconque bien différente du son i ; n'en doutons pas, ils en seroient venus, ou ils auroient cherché à en venir à l'institution d'un caractere propre. L'empereur Claude voulut introduire le digamma F ou F à la place de l'u consonne, parce que cet u avoit sensiblement une autre valeur dans uinum, par exemple, que dans unum : & la forme même du digamma indique assez clairement que l'articulation designée par l'u consonne, approchoit beaucoup de celle que représente la consonne F, & qu'apparemment les Latins prononçoient vinum, comme nous le prononçons nous mêmes, qui ne sentons entre les articulations f & v d'autre différence que celle qu'il y a du fort au foible. Si le digamma de Claude ne fit point fortune, c'est que cet empereur n'avoit pas en main un moyen de communication aussi prompt, aussi sûr, & aussi efficace que notre impression : c'est par-là que nous avons connu dans les derniers tems, & que nous avons en quelque maniere été contraints d'adopter les caracteres distincts que les Imprimeurs ont affectés aux voyelles i & u, & aux consonnes j & v.
Il semble donc nécessaire de conclure de tout ceci, que les Romains prononçoient toûjours i de la même maniere, aux différences prosodiques près. Mais si cela étoit, comment ont-ils cru & dit eux-mêmes qu'ils avoient un i consonne ? c'est qu'ils avoient sur cela les mêmes principes, ou, pour mieux dire, les mêmes préjugés que M. Boindin, que les auteurs du dictionnaire de Trévoux, que M. du Marsais lui-même, qui prétendent discerner un i consonne, différent de notre j, par exemple, dans les mots aïeux, foyer, moyen, payeur, voyelle, que nous prononçons a teux, fo-ïer, moi-ïen, pai-ïeur, voi-ïelle : MM. Boindin & du Marsais appellent cette prétendue consonne un mouillé foible. Voyez Consonne. Les Italiens & les Allemands n'appellent-ils pas consonne un i réel qu'ils prononcent rapidement devant une autre voyelle, & ceux-ci n'ont-ils pas adopté à peu-près notre i pour le représenter ?
Pour moi, je l'avoue, je n'ai pas l'oreille assez délicate pour appercevoir, dans tous les exemples que l'on en cite, autre chose que le son foible & rapide d'un i ; je ne me doute pas même de la moindre preuve qu'on pourroit me donner qu'il y ait autre chose, & je n'en ai encore trouvé que des assertions sans preuve. Ce seroit un argument bien foible que de prétendre que cet i, par exemple dans payé, est consonne, parce que le son ne peut en être continué par une cadence musicale, comme celui de toute autre voyelle. Ce qui empêche cet i d'être cadencé, c'est qu'il est la voyelle prépositive d'une diphthongue ; qu'il dépend par conséquent d'une situation momentanée des organes, subitement remplacée par une autre situation qui produit la voyelle postpositive ; & que ces situations doivent en effet se succéder rapidement, parce qu'elles ne doivent produire qu'un son, quoique composé. Dans lui, dira-t-on que u soit une consonne, parce qu'on est forcé de passer rapidement sur la prononciation de cet u pour prononcer i dans le même instant ? Non ; ui dans lui est une diphtongue composée des deux voyelles u & i ; ié dans pai-ïé en est une autre, composée de i & de é.
Je reviens aux Latins : un préjugé pareil suffisoit pour décider chez eux toutes les difficultés de prosodie qui naîtroient d'une assertion contraire ; & les preuves que j'ai données plus haut de l'existence d'un i consonne parmi eux, démontrent plûtôt la réalité de leur opinion que celle de la chose : mais il me suffit ici d'avoir établi ce qu'ils ont crû.
Quoi qu'il en soit, nos peres, en adoptant l'alphabet latin, n'y trouverent point de caractere pour notre articulation je : les Latins leur annonçoient un i consonne, & ils ne pouvoient le prononcer que par je : ils en conclurent la nécessité d'employer l'i latin, & pour le son i & pour l'articulation je. Ils eurent donc raison de distinguer l'i voyelle de l'i consonne. Mais comment gardons-nous encore le même langage ? Notre orthographe a changé ; le Bureau typographique nous indique les vrais noms de nos lettres, & nous n'avons pas le courage d'être conséquens & de les adopter.
L'Encyclopédie étoit assûrément l'ouvrage le plus propre à introduire avec succès un changement si raisonnable : mais on a craint de tomber dans une affectation apparente, si l'on alloit si directement contre un usage universel. Qu'il me soit permis du moins de distinguer ici ces deux lettres, & de les cotter comme elles doivent l'être, & comme elles le sont en effet dans notre alphabet. Peut-être le public en sera-t-il plus disposé à voir l'exécution entiere de ce système alphabétique, ou dans une seconde édition de cet ouvrage, ou dans quelque autre dictionnaire qui pourroit l'adopter.
I, c'est la neuvieme lettre & la troisieme voyelle de l'alphabet françois. La valeur primitive & propre de ce caractere est de représenter le son foible, délié, & peu propre au port de voix que presque tous les peuples de l'Europe font entendre dans les syllabes du mot latin inimici. Nous représentons ce son par un simple trait perpendiculaire, & dans l'écriture courante nous mettons un point au-dessus, afin d'empêcher qu'on ne le prenne pour le jambage de quelque lettre voisine. Au reste, il est si aisé d'omettre ce point, que l'attention à le mettre est regardée comme le symbole d'une exactitude vetilleuse : c'est pour cela qu'en parlant d'un homme exact dans les plus petites choses, on dit qu'il met les points sur les i.
Les Imprimeurs appellent ï trema, celui sur lequel on met deux points disposés horisontalement : quelques Grammairiens donnent à ces deux points le nom de diérèse ; & j'approuverois assez cette dénomination, qui serviroit à bien caractériser un signe orthographique, lequel suppose effectivement une séparation, une division entre deux voyelles ; ?????????, divisio, de ???????, divido. Il y a deux cas où il faut mettre la diérèse sur une voyelle. Le premier est, quand il faut la détacher d'une voyelle précédente, avec laquelle elle feroit une diphtongue sans cette marque de séparation : ainsi il faut écrire Laïs, Moïse, avec la diérèse, afin que l'on ne prononce pas comme dans les mots laid, moine.
Le second cas est, quand on veut indiquer que la voyelle précédente n'est point muette comme elle a coûtume de l'être en pareille position, & qu'elle doit se faire entendre avant celle où l'on met les deux points : ainsi il faut écrire aiguille, contiguïté, Guïse (ville) avec diérèse, afin qu'on les prononce autrement que les mots anguille, guidé, guise, fantaisie.
Il y a quelques auteurs qui se servent de l'ï tréma dans les mots où l'usage le plus universel a destiné l'y à tenir la place de deux ii : c'est un abus qui peut occasionner une mauvaise prononciation ; car si au lieu d'écrire payer, envoyer, moyen, on écrit païer, envoïer, moïen, un lecteur conséquent peut prononcer pa-ïer, envo-ïer, mo-ïen, de même que l'on prononce pa-ïen, a-ïeux.
C'est encore un abus de la diérèse que de la mettre sur un i à la suite d'un e accentué, parce que l'accent suffit alors pour faire détacher les deux voyelles ; ainsi il faut écrire, athéisme, réintégration, déifié, & non pas athéisme, réïntégration, déïfié.
Notre orthographe assujettit encore la lettre i à bien d'autres usages, que la raison même veut que l'on suive, quoiqu'elle les desapprouve comme inconséquens.
1°. Dans la diphtongue oculaire AI, on n'entend le son d'aucune des deux voyelles que l'on y voit.
Quelquefois ai se prononce de même que l'e muet ; comme dans faisant, nous faisons, que l'on prononce fesant, nous fesons : il y a même quelques auteurs qui écrivent ces mots avec l'e muet, de même que je ferai, nous ferions. S'ils s'écartent en cela de l'étymologie latine facere, & de l'analogie des tems qui conservent ai, comme faire, fait, vous faites, &c. ils se rapprochent de l'analogie de ceux où l'on a adopté universellement l'e muet, & de la vraie prononciation.
D'autres fois ai se prononce de même que l'e fermé ; comme dans j'adorai, je commençai, j'adorerai, je commencerai, & les autres tems semblables de nos verbes en er.
Dans d'autres mots, ai tient la place d'un è peu ouvert ; comme dans les mots plaire, faire, affaire, contraire, vainement, & en général par-tout où la voyelle de la syllabe suivante est un e muet.
Ailleurs ai représente un ê fort ouvert ; comme dans les mots dais, faix, mais, paix, palais, portraits, souhaits. Au reste, il est très-difficile, pour ne pas dire impossible, d'établir des régles générales de prononciation, parce que la même diphthongue, dans des cas tout-à-fait semblables, se prononce diversement : on prononce je sais, comme je sés ; & je fais, comme je fés.
Dans le mot douairière, on prononce ai comme a, douarière.
C'est encore à-peu-près le son de l'e plus ou moins ouvert, que représente la diphthongue oculaire ai, lorsque suivie d'une m ou d'une n, elle doit devenir nasale ; comme dans faim, pain, ainsi, maintenant, &c.
2°. La diphthongue oculaire EI est à-peu-près assujettie aux mêmes usages que AI, si ce n'est qu'elle ne représente jamais l'e muet. Mais elle se prononce quelquefois de même que l'é fermé ; comme dans veiné, peiner, seigneur, & tout autre mot où la syllabe qui suit ei n'a pas pour voyelle un e muet. D'autres fois ei se rend par un è peu ouvert, comme dans veine, peine, enseigne, & tout autre mot où la voyelle de la syllabe suivante est un e muet : il en faut seulement excepter reine, reitre & seize, où ei vaut un ê fort ouvert. Enfin, l'ei nasal se prononce comme ai en pareil cas : plein, sein, éteint, &c.
3°. La voyelle i perd encore sa valeur naturelle dans la diphtongue oi, qui est quelquefois impropre & oculaire, & quelquefois propre & auriculaire.
Si la diphtongue oi n'est qu'oculaire, elle représente quelquefois l'è moins ouvert, comme dans foible, il avoit ; & quelquefois l'ê fort ouvert, comme dans Anglois, j'avois, ils avoient.
Si la diphtongue oi est auriculaire, c'est-à-dire, qu'elle indique deux sons effectifs que l'oreille peut discerner ; ce n'est aucun des deux qui sont représentés naturellement par les deux voyelles o & i : au lieu de o, qu'on y prenne bien garde, on prononce toujours ou ; & au lieu de i, on prononce un e ouvert qui me semble approcher souvent de l'a ; devoir, sournois, lois, moine, poil, poivre, &c.
Enfin, si la diphtongue auriculaire oi, au moyen d'une n, doit devenir nasale, l'i y désigne encore un è ouvert ; loin, foin, témoin, jointure, &c.
C'est donc également un usage contraire à la destination primitive des lettres, & à l'analogie de l'orthographe avec la prononciation, que de représenter le son de l'e ouvert par ai, par ei & par oi ; & les Ecrivains modernes qui ont substitué ai à oi partout où cette diphtongue oculaire représente l'e ouvert, comme dans anglais, français, je lisais, il pourrait, connaître, au lieu d'écrire anglois, françois, je lisois, il pourroit, connoître ; ces écrivains, dis-je, ont remplacé un inconvénient par un autre aussi réel. J'avoue que l'on évite par-là l'équivoque de l'oi purement oculaire & de l'oi auriculaire : mais on se charge du risque de choquer les yeux de toute la nation, que l'habitude a assez prémunie contre les embarras de cette équivoque ; & l'on s'expose à une juste censure, en prenant en quelque sorte le ton législatif, dans une matiere où aucun particulier ne peut jamais être législateur, parce que l'autorité souveraine de l'usage est incommunicable.
Non seulement la lettre i est souvent employée à signifier autre chose que le son qu'elle doit primitivement représenter : il arrive encore qu'on joint cette lettre à quelqu'autre pour exprimer simplement ce son primitif. Ainsi les lettres ui ne représentent que le son simple de l'i dans les mots vuide, vuider, & autres dérivés, que l'on prononce vide, vider, &c. & dans les mots guide, guider, &c. quitte, quitter, acquitter, &c. & par-tout où l'une des deux articulations gue ou que précede le son i. De même les lettre ie représentent simplement le son i dans maniement, je prierois, nous remercierons, il liera, qui viennent de manier, prier, remercier, lier, & dans tous les mots pareillement dérivés des verbes en ier. L'u qui précéde l'i dans le premier cas, & l'e qui le suit dans le second, sont des lettres absolument muettes.
La lettre J, chez quelques auteurs, étoit un signe numéral, & signifioit cent, suivant ce vers,
J, C compar erit, & centum significabit.
Dans la numération ordinaire des Romains, & dans celle de nos finances, i signifie un ; & l'on peut en mettre jusqu'à quatre de suite pour exprimer jusqu'à quatre unités. Si la lettre numérale i est placée avant v qui vaut cinq, ou avant x qui vaut dix, cette position indique qu'il faut retrancher un de cinq ou de dix ; ainsi iv signifie cinq moins un ou quatre, ix signifie dix moins un ou neuf : on ne place jamais i avant une lettre de plus grande valeur, comme l cinquante, c cent, d cinq cens, m mille ; ainsi on n'écrit point il pour quarante-neuf, mais x lix.
La lettre i est celle qui caractérise la monnoie de Limoges.
Wiktionnaire
Pronom personnel - ancien français
i \i\
-
Y.
- Il n'i a si hardi qui ost lance lever. ? (La Chanson des quatre fils Aymon, c.a. XIIe siècle, transcription de Ferdinand Castet)
Pronom personnel - français
i \i\
-
(Populaire) Il.
- Tiens : eurgarde : j' t'ai tout marqué sur un papier, tu n'auras qu'à le li donner, i s'arrangera ben avec ! ? (Gérard Nédellec, Anjou, les histoires extraordinaires de mon grand-père, 2013)
-
Ils.
- I disent au poste qu'i va faire beau demain.
-
(Vendée) Je.
- En Vendée, i signifie « je » et o signifie « il ».
Trésor de la Langue Française informatisé
I, i, subst. masc.
La neuvième lettre de l'alphabet. Un exemplaire de cette lettre. Le mot lisibilité compte 4 i; l'i grec, syntagme désignant le graphème y, dont la valeur phonique en français est ordinairement [i].I, i, subst. masc.
La neuvième lettre de l'alphabet. Un exemplaire de cette lettre. Le mot lisibilité compte 4 i; l'i grec, syntagme désignant le graphème y, dont la valeur phonique en français est ordinairement [i].I au Scrabble
Le mot i vaut 1 points au Scrabble.
Informations sur le mot i - 1 lettres, 1 voyelles, 0 consonnes, 1 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot i au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
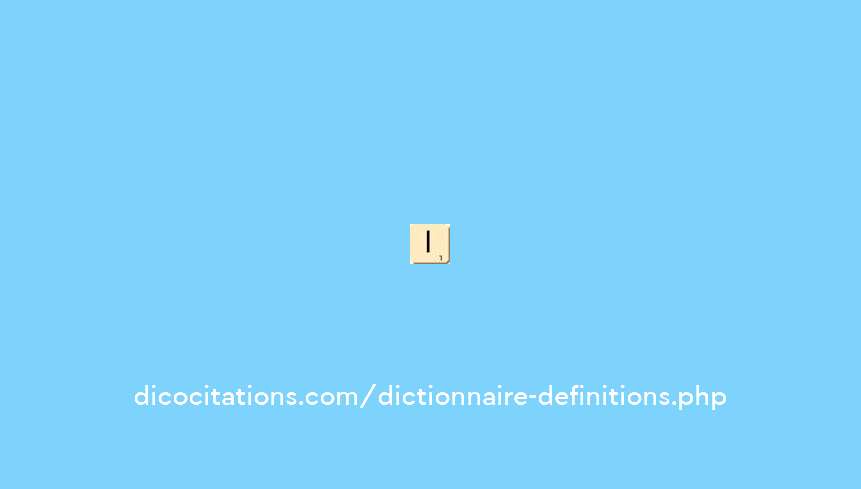
Les mots proches de I
I Iahve ou iahvé Ïambe Ibis Iceberg Icelui Ichneumon Ichor Ichoreux, euse Ichthyologie Ici Icoglan Iconarithme Icône Iconoclaste Iconoclastie Ictéricie Ictérique Idéal, ale Idéalement Idéalisme Idéaliste Idéation Idée Identification Identifier Identité Idéographiquement Idéographisme Idéologie Idéologiste Idéologue Ides Idiome Idiot, ote Idiotisme Idiotisme Idoine Idolâtre Idolâtré, ée Idolâtrement Idolâtrer Idolâtrie Idolâtrique Idole Idonéité Idoscopique Idylle If Ignacien i i i i.e. iambe iambique iambiques Ibarrolle ibère ibère ibères ibérique ibériques ibex Ibigny ibis ibm ibo iboga Ibos icarienne ice cream ice-cream ice-creams iceberg icebergs icelle icelles icelui Ichtegem Ichtratzheim ichtyologie ichtyologiste Ichy ici ici ici-bas icoglan icoglans icône icônes iconoclaste iconoclaste iconoclastes iconoclastes iconographe iconographie iconographies iconographique iconostaseMots du jour
-
capitules souper sécherait multipliée intentionnées colonisées bourrant anti-évasion lotionnés pauvrement
Les citations avec le mot I
- Il fallut faire vite, et donc assumer tout ce qu'emporte de risques, d'imprudences et d'impuretés, la précipitation dans le travail.Auteur : Paul Valéry - Source : Tel Quel (1941), L'Idée fixe
- Le métier des lettres est tout de même le seul où l'on puisse sans ridicule ne pas gagner d'argent.Auteur : Jules Renard - Source : Journal
- Une vieille femme, ça ne peut pas être très bien - et une vieille dame, c'est si joli!Auteur : Sacha Guitry - Source : Théâtre, je t'adore
- Les chevaux s'en coururent à bride abbatue avec leur charriot devers la ville de Rome.Auteur : Jacques Amyot - Source : Publicola, 26
- Ce qu'expriment la plupart des phénomènes physiques, c'est simplement la tendance naturelle des populations de molécules à passer de l'ordre au chaos.Auteur : François Jacob - Source : La Logique du vivant (1976)
- Le gin a une âcreté qui aura toujours le goût de Londres, peu importe où vous en buvez de par le mondeAuteur : Joseph O'Connor - Source : Muse (2011)
- J'éprouve une passion irrésistible pour les livres et un besoin constant de cultiver mon esprit, d'étudier, qui m'est aussi vital que le pain.Auteur : Vincent Van Gogh - Source : Lettres de Vincent à son frère Théo (1872-1890)
- Il s'agissait seulement de donner pendant quelque temps les preuves de sa compétence dans les questions délicates que posait l'administration de notre cité.Auteur : Albert Camus - Source : La Peste (1947)
- Il m'est plus aisé d'apprendre à vingt personnes ce qu'il est bon de faire, que d'être l'une des vingt à suivre mes propres leçons.Auteur : William Shakespeare - Source : Le Marchand de Venise
- Chacun expie son premier instant.Auteur : Emil Cioran - Source : De l'inconvénient d'être né (1973)
- Présentateur de nombreuses émissions populaires, Guy Lux aura marqué de son empreinte le petit écran.Auteur : Jacques Chirac - Source : Réactions à la mort de Guy Lux, le 13 juin 2003.
- Je suis profondément convaincu, que la vérité de Dieu n'est pas plus mystérieuse que la vérité scientifique. - Mais nous sommes intoxiqués par les fumées d'encens dressées comme un rideau stratégique entre Dieu et les hommes.Auteur : René Barjavel - Source : La faim du tigre
- Ne vous imaginez jamais ne pas être autrement que ce qu'il pourrait apparaître aux autres que ce que vous fûtes ou auriez pu être, ne serait pas autrement que ce que vous aviez été et leur serait apparu comme étant autrement.Auteur : Charles Lutwidge Dodgson, dit Lewis Carroll - Source : Alice au Pays des Merveilles (1865)
- Lord X sera chez lui tel jour de telle heure à telle heure. - G.-B. Shaw aussi.Auteur : George Bernard Shaw - Source : Sans référence
- Soudain, il comprit que la joie et la peine sortent du même creuset. Le courage et la peur aussi ne sont qu'une même chose.Auteur : John Steinbeck - Source : A l'est d'Eden (1952)
- L'étendue de l'amour des femmes n'est pas connue, même de ceux qui sont les objets de leur affection, à cause de sa subtilité, et aussi de l'avarice et de la finesse naturelle du sexe féminin.Auteur : Vâtsyayâna - Source : Kama Sutra
- L'acquisition des qualités morales requiert une disposition particulière de l'âme et ne dépend pas seulement de l'éducation.Auteur : Ostad Elahi - Source : 100 Maximes de Guidance
- On rencontre de par le monde d'austères moralistes toujours à cheval sur le devoir. Mais ils ont un manège en ville.Auteur : Paul Masson - Source : Les Pensées d'un Yoghi (1896)
- Quand on obtient d'une chose ce qu'on en attendait, on n'en demande pas plus.Auteur : Winston Churchill - Source : Sans référence
- Je suis un tantinet hypocondriaque alors je consulte régulièrement mon médecin légiste à titre préventif.Auteur : Philippe Geluck - Source : Le chat a encore frappé (2005)
- Est-ce la liberté qui change la saveur de la vie ?Auteur : Catherine Cusset - Source : Un brillant avenir (2008)
- La passion de l'étude, ainsi que toutes les autres, a ses instants d'humeur et de dégoût comme ses moments de plaisir et d'enivrement.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Apologie de l'étude
- Je n'aime pas les femmes qui couchent le premier soir. Je déteste ça, il faut attendre tout l'après-midi.Auteur : Patrick Timsit - Source : Fallait pas l'ouvrir
- La jalousie se nourrit dans les doutes, et elle devient fureur, ou elle finit, sitôt qu'on passe du doute à la certitude.Auteur : François de La Rochefoucauld - Source : Réflexions ou Sentences et Maximes morales (1664), 32
- On ne demande aux naïfs que d'être honnêtes, moyennant quoi ils peuvent prétendre à être les bases des monarchies.Auteur : Victor Hugo - Source : L'Homme qui rit (1869)
Les citations du Littré sur I
- Mais dans une profane et riante peinture De n'oser de la Fable employer la figure, C'est d'un scrupule vain s'alarmer sottementAuteur : BOILEAU - Source : ib.
- Et [les seigneurs] mirent plusieurs devises et preschemens avant, desquelles nulles ne vinrent à l'effetAuteur : Jean Froissard - Source : I, I, 319
- Si j'ai dit que je voulais corriger ma conduite et me jeter dans un train de vie exemplaireAuteur : Molière - Source : Festin, V, 2
- Si l'aguignant, elle me contre-oeilladeAuteur : JACQUES TAHUREAU - Source : Poésies, p. 301, dans LACURNE
- Là jura et fiança le dit comte madame Isabelle....Auteur : Jean Froissard - Source : I, I, 311
- Quand ces nouvelles lui vinrent en la main [au comte de Valois], lui convint porter ; car autre chose n'en put avoirAuteur : Jean Froissard - Source : II, II, 233
- Façon d'être ou d'agir dans le commerce de la vie, dans le monde Suréna, mes pareils n'aiment point ces manièresAuteur : Corneille - Source : Suréna, IV, 4
- Qu'est devenu ce front poly, Ces cheveulx blonds, sourcilz voultyz ?Auteur : VILLON - Source : Belle heaulmière.
- Les rois aux chiens flatteurs donnent le premier lieu, Et de cette canaille endormis au milieu....Auteur : D'AUB. - Source : Tragiques, II, p. 57
- L'on y construisit une citadelle, pour garantir la stabilité de la conquêteAuteur : RAYNAL - Source : Hist. phil. I, 16
- Ah ! si d'un autre amour le penchant invincible Dès lors à mes bontés vous rendait insensibleAuteur : Jean Racine - Source : Mithr. IV, 4
- Il [M. le duc] me dit qu'avec un établissement son frère reviendrait ; hé bien, repris-je, voilà donc l'enclouureAuteur : SAINT-SIMON - Source : 508, 222
- Quand je me vis donnée au public et répandue dans les provinces [il s'agit du portrait satirique de Mme de Sévigné par Bussy], je vous avoue que je fus au désespoirAuteur : Madame de Sévigné - Source : à Bussy, 28 août 1668
- La mort de Tycho mit Kepler en possession de la collection précieuse de ses observations ; et il en fit l'emploi le plus utile, en fondant sur elles trois des plus importantes découvertes que l'on ait faites dans la philosophie naturelleAuteur : LA PLACE - Source : Exp V, 4
- Il a apporté une modération à cette permission généraleAuteur : Blaise Pascal - Source : Prov. IX.
- Car tousjours un plaisir est meslé de douleurAuteur : RONS. - Source : 793
- Le plomb entraîne le cuivre dans sa vitrification, et il rejette le fer sur les bords de la coupelle ; c'est par cette propriété particulière qu'il purge l'or et l'argent de toute matière métallique étrangèreAuteur : BUFF. - Source : Min. t. V, p. 269
- Un écrit scandaleux sous votre nom se donneAuteur : BOILEAU - Source : Ép. VI
- De même que la foi vivifie les oeuvres, on peut dire que les oeuvres vivifient la foiAuteur : BOURD. - Source : ib. p. 178
- Ah ! que les hommes s'entendent mal en gloire !Auteur : FÉN. - Source : Tél. XXII
- Les curieux se jettent au plus frequent lieu du port où abondent les naviresAuteur : AMYOT - Source : De la curiosité, 13
- On sait bien que Célie A causé des désirs à Léandre et LélieAuteur : Molière - Source : l'Étourdi, V, 3
- Tant que le jugement peut vaciller et que la volonté est muable, la réflexion leur est nécessaireAuteur : BOSSUET - Source : États d'orais. v, 5
- Si les convint couper plançons de bois à leurs espées et leurs badelaires pour leurs chevaux lierAuteur : Jean Froissard - Source : I, I, 38
- Nos deux furies entendirent plus d'à demi ces parolesAuteur : Jean de La Fontaine - Source : Psyché, I, p. 76
Les mots débutant par I Les mots débutant par I
Une suggestion ou précision pour la définition de I ? -
Mise à jour le lundi 26 janvier 2026 à 03h12

- Idee - Idée - Identite - Idiot - Idiotie - Ignorance - Illusion - Image - Imaginaire - Imagination - Imbecile - Imitation - Impatience - Impossible - Impot - Impression - Improvisation - Inattendu - Indelicatesse - Independance - Indifference - Indigestion - Individu - Infini - Ingrat - Ingratitude - Injure - Injustice - Innocence - Inoubliable - Inquietude - Insomnie - Inspiration - Instant - Instinct - Insulte - Intellectuel - Intelligence - Interet - Intérêt - International - Internet - Interprete - Interrogation - Introspection - Intuition - Inutilite - Invitations - Invite - Ironie - Irresolution - Irriter - Islam - Ivresse
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur i
Poèmes i
Proverbes i
La définition du mot I est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot I sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification I présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
