La définition de Bord du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Bord
Nature : s. m.
Prononciation : bor ; le d ne se lie pas : un bord escar
Etymologie : Espagn. et ital. bordo ; de l'anc. haut allem. bort, bord d'un vaisseau. Il y a aussi dans le celtique : gaél. bord, planche ; cornw. bord ; kymri, burdd, table ; et dans le germanique : anc. scand. bord ; anc. haut allem. bort, table, planche. Le bord est donc proprement une planche ; et l'étymologie permet de saisir l'enchaînement des significations. La première est celle de bord d'un vaisseau, c'est-à-dire ouvrage fait en planches ; puis, par métonymie, ce qui borde, ce qui renferme, ce qui limite, ce qui est à l'extrémité.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de bord de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec bord pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Bord ?
La définition de Bord
Terme de marine. Côté d'un vaisseau. Le bord du vaisseau fut enfoncé par une lame furieuse.
Toutes les définitions de « bord »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
L'extrémité d'une surface ou Ce qui la termine, la ligne qui forme le contour d'une chose. Le bord d'une robe, d'un manteau. Le bord d'un verre. S'asseoir sur le bord d'un chemin. Le bord, les bords d'un précipice. Avoir un mot sur le bord des lèvres, Être ou se croire tout près de se souvenir d'un mot, d'un nom qu'on a oublié et qu'on cherche à se rappeler. Avoir un aveu, un secret sur le bord des lèvres, Éprouver une grande envie de faire un aveu, de révéler un secret. Fig., Être au bord du précipice, être sur le bord du précipice, Être près de tomber dans un malheur, dans quelque grand danger; être sur le point de se perdre, d'être ruiné. On dit en des sens analogues Conduire, pousser quelqu'un au bord du précipice; l'arrêter au bord du précipice. Un rouge bord, Un verre de vin rempli jusqu'au bord. Il se dit aussi de Tout ce qui s'étend vers les extrémités de certaines choses. Le bord, les bords d'un plat, Tout ce qui est depuis la partie concave d'un plat jusqu'à l'extrémité. Les bords d'un chapeau, Tout ce qui excède par en bas la forme d'un chapeau. Chapeau à grands bords, à petits bords, à bords relevés. Il se dit particulièrement du Terrain, du sol qui est le long de la mer, d'un fleuve, autour d'un lac, etc. Se promener sur le bord, sur les bords de la mer. Le bord de l'eau. Le bord, les bords d'une rivière, d'un lac, d'un étang. Cette plante ne croît que sur les bords de la mer. Les bords du Rhin sont fort pittoresques. Cette rivière coule à pleins bords. Poétiquement, Les sombres bords, Les bords du Cocyte, l'enfer païen. Venir, arriver à bord, Atteindre le rivage, arriver au bord de l'eau, au bord de la mer. Il se dit d'un bateau ou d'un navire. Il ne put atteindre le bord et se noya, Il ne put atteindre le rivage et se noya. Elliptiq., À bord, à bord. Cri de gens qui sont sur un navire pour avertir qu'ils veulent aller à terre, ou de gens qui sont sur le rivage pour demander à s'embarquer. Au pluriel, il se dit poétiquement des Régions, des contrées environnées d'eau. Les bords africains. Les bords indiens. Vivre sur les bords étrangers. Il a quitté ces bords. Il s'est éloigné de nos bords. Il se dit aussi d'une Espèce de ruban ou galon, d'une bande d'étoffe dont on borde certaines parties de l'habillement. Mettre un bord à un chapeau, à une jupe.
BORD, en termes de Marine, désigne le Côté d'un bâtiment, d'un vaisseau. De quel bord vient le vent. S'appuyer sur le bord d'un navire. Sauter par-dessus le bord. Le bord d'un bateau. Ces deux bâtiments sont bord à bord, Côté à côté. Faire feu des deux bords en même temps. Voyez BÂBORD et TRIBORD. Virer de bord, Changer de route, en mettant au vent un côté du bâtiment pour l'autre. Figurément et familièrement, Changer la direction de sa conduite, s'attacher à un autre parti. Cet homme est inconstant, il a viré de bord en mainte occasion. Courir bord sur bord, Louvoyer à petites bordées, tantôt à droite, tantôt à gauche, pour se maintenir à la même place, ou pour ne changer de place que le moins possible. Rouler bord sur bord, Éprouver un roulis violent et continu. Être bord à quai, se dit quand l'un des côtés du bâtiment touche à un quai. Vaisseau de haut bord se disait autrefois de Tout bâtiment qui naviguait au long cours, par opposition à Vaisseau de bas bord, qui se disait de Tout petit bâtiment plat. Vaisseau de haut bord ne se dit plus aujourd'hui que des Bâtiments de guerre à plusieurs ponts. Il se dit aussi du Navire, du bâtiment même. Le capitaine nous régala sur son bord. Il a tant de matelots, de soldats, de passagers à son bord. Prendre quelqu'un à bord, sur son bord. Monter à bord. Coucher à bord. Aller à bord. Envoyer à bord. Il était à bord de l'amiral. Être consigné à bord. Descendre, sortir du bord. Quitter le bord. Fig., Être du bord de quelqu'un, Être de son parti, de son avis, de son opinion. Il se dit quelquefois pour Bordée. Courir des bords. Louvoyer à petits bords. Courir un bord à terre, un bord au large. Le bon bord, Celle des deux bordées qui rapproche du but; et Le mauvais bord, Celle qui en éloigne.
Littré
-
1 Terme de marine. Côté d'un vaisseau. Le bord du vaisseau fut enfoncé par une lame furieuse.
Le bord du vent, le bord qui est du côté d'où le vent souffle, par opposition au bord sous le vent, qui est l'autre bord.
Rouler bord sur bord, éprouver un roulis continu.
Virer de bord, changer de route?; et au figuré, changer de conduite.
Vaisseau de haut bord, autrefois, tout bâtiment qui naviguait au long cours, par opposition aux petits bâtiments plats qu'on désignait sous le nom de vaisseaux de bas bord?; aujourd'hui vaisseau de guerre à plusieurs ponts.
Bord à bord, locution adverbiale qui s'emploie pour exprimer la proximité de deux bâtiments. Les deux vaisseaux étant bord à bord.
Par extension. La rivière est bord à bord du quai, elle est si haute que le bord de la rivière se confond avec le bord du quai, elle affleure le quai.
-
2Bordée. Le navire courait des bords. Courir bord sur bord, louvoyer à petites bordées, de manière à ne guère changer de place.
Le bon bord, la bordée qui rapproche du but?; le mauvais bord, celle qui en éloigne?; et au figuré, courir le bon bord, se livrer à la piraterie?; et, par extension, faire des siennes.
La connétable Colonne ne contraignit pas ses m?urs à Rome, ni de courir le bon bord, du vivant et surtout depuis la mort de son mari
, Saint-Simon, 149, 182.Fig. et dans le langage familier, être du bord de quelqu'un, être de son avis, de son parti.
Il verra M. de Seignelay dans son bord
, Sévigné, 569. Nous disons maintenant, non pas dans son bord, mais de son bord.Il est seul de son bord, il est seul de son avis.
-
3Le vaisseau même. Étant passé de son bord sur celui de l'amiral. Aller ou monter à bord. Aussitôt tous les équipages furent à bord. Mettre à bord.
Achillas à son bord [au bord du vaisseau de Pompée] joint son esquif funeste
, Corneille, M. de Pomp. II, 2.Vingt corsaires pourtant montèrent sur son bord
, La Fontaine, Fianc.Le capitaine me prit à son bord avec mon domestique
, Chateaubriand, Itin. 6.À bord?! commandement de revenir au vaisseau.
- 4Extrémité d'une surface quelconque, par comparaison avec le bord d'un vaisseau. Les bords d'un bouclier. Les bords d'un chapeau. Frotter d'un topique les bords d'une plaie.
-
5Rivage de la mer. Il s'avança jusqu'au bord de la mer. Suivre le bord de la mer. Venir ou arriver à bord.
L'honneur est comme une île escarpée et sans bords
, Boileau, Sat. X.N'est-ce pas nous rendre au naufrage Après nous avoir mis à bord??
Malherbe, III, 1.Un nautonier s'offre à le mettre à bord, Mais ce pilote est l'ami du naufrage
, Millevoye, l'Amour naut.Par extension, en langage poétique, région, pays. Se fixer sur les bords ausoniens.
Je demande Thésée aux peuples de ces bords?
, Racine, Phèd. I, 1.Achille était absent, et son père Pélée L'avait, tu t'en souviens, rappelé de ces bords
, Racine, Iphig. I, 1.Vous mourûtes aux bords où vous fûtes laissée
, Racine, Phèd. I, 3.Les sombres bords, la demeure des morts.
On ne voit point deux fois le rivage des morts, Seigneur?; puisque Thésée a vu les sombres bords, En vain vous espérez qu'un Dieu vous le renvoie
, Racine, Phèd. II, 5.Fig.
Moi qui? Pensais toujours du bord contempler les orages
, Racine, Phèdr. II, 2.Alors sa charité rompit les bords
, Fléchier, Aig.Faut-il sans boire abandonner ce bord [la vie]?? Priez pour moi, je suis mort, je suis mort
, Béranger, Mort vivant. -
6Le rivage d'un fleuve, d'une rivière, d'un lac, d'un torrent. Sur le bord d'un fleuve, d'un ruisseau. Les bords du Rhône, de l'Eurotas. En suivant les bords du lac de Genève. Couler à pleins bords.
Tel en un secret vallon, Sur le bord d'une onde pure, Croît à l'abri de l'aquilon Un jeune lis, l'amour de la nature
, Racine, Ath. II, 9.En même temps que l'eau [d'un fleuve] les a rongés [ses bords], elle a élargi son lit, c'est-à-dire qu'elle a perdu de sa hauteur et de sa force?; ce qui étant arrivé à un certain point, il se fait encore un équilibre entre la force de l'eau et la résistance des bords, et les bords sont établis
, Fontenelle, Guglielmini.Mon lac est le premier?; c'est sur ses bords heureux Qu'habite des humains la déesse éternelle, L'âme des grands travaux, l'objet des nobles v?ux, Que tout mortel embrasse ou désire ou rappelle, La liberté?
, Voltaire, Épît. 76. -
7Ce qui borde un puits, une fontaine, un fossé. Le bord d'un puits. Narcisse couché sur le bord de la fontaine.
Fig. Vieillard qui est sur le bord du tombeau, sur le bord de sa fosse. Il arrête un ami sur le bord de l'abîme. Être au bord du précipice.
Cette bouteille donna la mort au pape, et mit son fils au bord du tombeau
, Voltaire, M?urs, 111.Vois-je l'État penchant au bord du précipice??
Racine, Bérén. IV, 4.Je leur semai de fleurs le bord des précipices
, Racine, Athal. III, 3.Les dieux nous ont conduits jusqu'au bord de l'abîme
, Fénelon, Tél. VII.Quand nous sommes aux bords d'une pleine victoire?
, Corneille, Sertor. II, 2.Il n'était pas sur les bords du sommeil que?
, La Fontaine, Rem. - 8Limite d'un chemin. Maison de campagne qui est au bord de la route.
-
9Orifice d'un vase. Remplir un verre jusqu'aux bords.
De peur que je n'en gronde, Verse au moins jusqu'au bord
, Béranger, Inf. de Lis.C'est l'orgie opulente enviée au dehors, Contente, épanouie, Qui rit, et qui chancelle, et qui boit à pleins bords, De flambeaux éblouie
, Hugo, Crépusc. 33.Familièrement. Un rouge bord, un verre plein de vin jusqu'au bord. Boire des rouges bords. Boire à rouge bord.
Un laquais effronté m'apporte un rouge bord D'un auvernat fumeux qui, mêlé de lignage, Se vendait chez Crenet pour vin de l'Ermitage
, Boileau, Sat. III. -
10Bout en parlant des lèvres. Mouiller le bord de ses lèvres.
Avoir un mot sur le bord des lèvres, être sur le point de se le rappeler et de le prononcer. Avoir un aveu sur le bord des lèvres, être tout disposé à le faire.
Fig. Avoir l'âme sur le bord des lèvres, être près de mourir.
Tour des yeux. Il a le bord des yeux rouge et malade.
Bordure d'un vêtement. Tunique ayant un bord de pourpre. Heureux ceux qui purent seulement toucher le bord de ses vêtements.
Ruban, galon, qui sert à border. Un mètre de bord.
Endroit où la cloche a le plus d'épaisseur.
Bord de front, tresses qui se placent sur le bord d'une perruque.
SYNONYME
BORD, CÔTE, RIVE, RIVAGE. En général la bande de terre qui limite et contient une eau. Bord est le terme le plus général?; toute eau a des bords?; au lieu que la côte ne se dit que de la mer et s'élève au-dessus des flots qu'elle domine. Bord exprimant ce qui borde, ce qui contient, et côte ce qui domine et est élevé, rive et rivage expriment ce qui n'a ni l'une ni l'autre de ces conditions, et ne sont considérés que comme la langue de terre adjacente à un cours d'eau. La mer, les fleuves, les grandes rivières, qui ont seuls des rivages, ont des rives comme les ruisseaux.
HISTORIQUE
XIIIe s. À tant se sont empaint en mer, En retraiant pour avoir bort?; Toutes les nès issent du port
, Fl. et Bl. 1380.
XIVe s. Sa nef? Tu en cele emprise douteuse Bort à bort contre l'orgueilleuse, Qui si fut très durement grande
, Branche des royaux lignages, t. II, p. 375. À Huguelin de Champdivers, enlumineur de livres, pour sa paine et sallaire d'avoir enluminé par les bors et relié une grant heures pour monseigneur le duc de Thourraine
, De Laborde, Émaux, p. 169. Mais au bort du fossé vint li ducs chiere lie, Et voit les assaillants faisant gran envaïe
, Guesclin. 19997.
XVe s. Ne jouez plus de vostre sort, Car trop le passez oultre bort
, Orléans, Bal. 91.
XVIe s. Aratus non pour cela ne voulut oncques y mener ses citoyens [au camp ennemi], ains les arresta sur le bord d'une grande baricave qu'il y avoit entre deux, et les engarda de passer oultre
, Amyot, Aratus, 45.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
BORD. - REM. On le trouve au sens d'espèce de diamant. C'est une fausse orthographe pour bort (voy. ce mot au Supplément).
HISTORIQUE
XIIe s. L'escu qui plus est blans que neis [neige] o une boucle de fin or Orlé de pierres tuit li bor
, Benoit de Sainte-Maure, Roman de Troie, V. 23378.
XIIIe s. Ajoutez?: Charles s'en va, le cuer ot moult irié, Et outre bort [de l'autre côté du gué], de duel mesaisié?: Las, que diront, fait-il, François prisié??
Adenes LI Rois, les Enfances Ogiers, V. 3005. (c'est la reproduction de ces vers?: Moult dolans s'est enz ou gué embatus?; Outre l'emporte li bons destriers crenus, V. 2972?; ce qui prouve que outre bort signifie bien à l'autre bord). Cette remarque est nécessaire, parce que bord au sens de rive est très rare?; cet exemple d'Adenes est le seul que nous connaissions.
Encyclopédie, 1re édition
BORD, s. m. (Gramm.) se dit communément des parties les plus éloignées du milieu d'une étendue limitée. Cette définition est presque générale ; & c'est en ce sens qu'on dit le bord d'un pré, d'une table, d'un lit, d'une riviere, &c.
Bord, on entend ordinairement par le mot bord, le vaisseau même. On dit retourner à bord, sortir du bord, pour dire retourner au vaisseau, sortir du vaisseau ; venir à bord, c'est se rendre au vaisseau.
Renverser, tourner, changer le bord ; c'est revirer, & porter le cap sur un autre air de vent.
Rendre le bord, c'est-à-dire, venir mouiller, ou donner fond dans quelque rade ou quelque port.
Bord sur bord, courir bord sur bord ; c'est louvoyer, & gouverner tantôt à stribord, tantôt à basbord : lorsque le vent est contraire, & qu'il ne permet pas de porter à route, on chicane le vent, & on court sur plusieurs routes, pour approcher du lieu où l'on veut aller, ou pour ne s'abbatre pas, & ne s'éloigner que le moins qu'on peut.
Faire un bord, faire une bordée ; c'est faire une route, soit à basbord, soit à stribord.
Courir même bord que l'ennemi ; tenir même bord, c'est virer à stribord & à basbord, selon que l'ennemi y a viré, & porter sur le même rumb.
Mettre à l'autre bord ; virer, changer de bord.
Tenir bord sur bord, c'est-à-dire, courir d'un côté ou d'un autre au plus près de vent, soit pour attendre un vaisseau qui est de l'arriere, soit pour s'entretenir dans un parage. (Z) De bord à bord ; cette expression veut dire autant sur un côté du vaisseau que sur l'autre, & signifie encore de part & d'autre, de la droite route ; ce qui désigne la même chose. Lorsque l'on dit, par exemple, que l'on peut naviger ou faire des bordées sur onze points de compas de bord à bord, cela signifie qu'on peut se servir des onze airs de vent qui sont à stribord, ou à l'un des côtés du vent de la route ; & encore des onze autres airs de vent qui sont à basbord, ou à l'autre côté du même vent de la route. Comme si le lieu de la route est à l'ouest, le vent d'est sera le vent de la droite route : mais l'on peut se servir de vingt-deux rumbs de vents différens pour porter à l'ouest, ou s'en approcher ; savoir des onze airs de vent qui sont depuis l'est jusqu'au sud-ouest, quart de sud, & des onze autres airs de vent qui sont depuis l'est jusqu'au nord-ouest. Ainsi c'est naviger & gouverner sur onze airs de vent de bord à bord.
Bord à bord, deux vaisseaux qui sont bord à bord ; c'est-à dire, qu'ils sont prêts l'un de l'autre de l'avant en arriere.
Un bord qui allonge, c'est-à-dire, que la bordée que l'on court sert à la route, quoique le vent soit contraire.
Bon bord, faire un bon bord ; c'est-à-dire, que l'on a gagné ou avancé à sa route, étant au plus près du vent.
Bord à terre, bord au large ; on employe ce terme, lorsqu'on parle d'un vaisseau qui court à la mer, & qui recourt à terre, ou de la mer à terre, & de la terre à la mer.
Passe du monde sur bord ; c'est un commandement qui se fait à l'équipage, pour faire passer des matelots des deux côtés de l'échelle, pour recevoir ceux qui veulent entrer ou sortir du vaisseau. Ce commandement ne se fait que pour les officiers, & pour ceux à qui on veut rendre des honneurs.
Bas bord, haut bord ; on dit un vaisseau de haut bord, on dit aussi un vaisseau de bas bord. Voyez Navire & Vaisseau.
Bord de la mer, c'est le rivage ou les premieres terres qui bordent la mer.
Bord, Bordage ; ce sont les planches qu'on emploie à border un vaisseau.
Franc bord, ce sont les bordages qui couvrent les membres du vaisseau. Ce mot se prend aussi en particulier pour le bordage, depuis le bas des fleuves jusqu'au haut du vaisseau. (Z)
Bord de bassin, en Architecture, c'est la tablette ou le profil de pierre ou de marbre, ou le cordon de gason ou de rocaille, qui pose sur le petit mur, ou circulaire, ou quarré, ou à pans d'un bassin d'eau. (P)
Bords dentelés, (Rubannerie-Tissuterie.) est la même chose que dent de rat. Voyez Dent de rat.
Bord, Ruban, ou Galon, qu'on met aux extrémités des chapeaux, des juppes, & sur les coutures des habits, &c. On fabrique des bords de différente largeur, & de toute sorte de matiere, comme or, argent, soie, fil, &c.
On fait à Amiens quantité de bords de laine ; on en compte de trois sortes : l'un qu'on appelle petite bordure, dont la chaîne doit être composée de vingt-sept fils, & la piece doit contenir vingt-quatre aunes : l'autre dont la chaîne est de trente-trois fils, & la piece de vingt-quatre aunes, se nomme bord & demi ; & le troisieme qui doit avoir trente-six fils à la chaîne, & trente-six aunes à la piece, est appellé bord à dentelle. Voyez Rouleau de laine.
Bord, en terme de Vannier, c'est un cordon d'osier, plus ou moins gros selon la piece qu'il termine par en-haut, & qu'il rend plus solide.
Bord, en terme de Fondeur de cloche, est la plus grande épaisseur qu'elle ait, sur laquelle frappe le battant. Voyez l'article Fonte des cloches, & la fig. 1. Plan. de la fonderie des cloches. La troisieme partie du bord s'appelle corps. Voyez Corps.
Bord de manchon, en Pelleterie ; c'est une fourrure que l'on fait avec la peau d'un animal, aux deux bouts des manchons. Voyez Manchon.
Bord de front, terme de Perruquier ; c'est le nom que ces ouvriers donnent aux tresses qui se placent sur le bord de la perruque qui touche au front, & regnent depuis une des tempes jusqu'à l'autre.
Wiktionnaire
Nom commun - français
bord \b??\ masculin
-
Extrémité d'une surface ou ce qui la termine, la ligne qui forme le contour d'une chose.
- Un morceau de savon traînait sur le bord de la baignoire en bois. ? (Jean-Baptiste Charcot, Dans la mer du Groenland, 1928)
- (Figuré) A cette nouvelle, il tomba sans connaissance ; sa douleur le mit au bord du tombeau ; il fut longtemps malade. ? (Voltaire, Zadig ou la Destinée, I. Le borgne, 1748)
- Le bord d'une robe, d'un manteau, d'un verre. ? Le bord, les bords d'un précipice.
-
? Cette petite demoiselle va se réchauffer avec un doigt de vin chaud !
Un doigt ? Le verre tendu, si le cafetier relevait trop tôt le pichet à bec, je savais commander : « Bord à bord ! » ? (Colette, La maison de Claudine, Hachette, 1922, coll. Livre de Poche, 1960, page 40.)
-
(Figuré) Limite.
- Pour la énième fois, je me fis la réflexion que, depuis un certain temps, je brûlais la chandelle par les deux bouts. En fait, j'étais au bord du surmenage professionnel. ? (James Patterson, Une ombre sur la ville, traduit de l'américain par Philippe Hupp, éditions L'Archipel, 2010, chap. 12)
- Tout ce qui s'étend vers les extrémités de certaines choses.
- (En particulier) Tout ce qui est depuis la partie concave d'un plat, d'une assiette, jusqu'à l'extrémité.
-
(En particulier) Tout ce qui excède par en bas la forme d'un chapeau.
- Sous son chapeau, à bords retroussés, apparaissaient, riches et crépus, des cheveux plutôt roux que blonds [?] ? (Alexandre Dumas, La Reine Margot, 1845, volume I, chapitre IV)
-
(En particulier) Terrain, sol qui est le long de la mer, d'un fleuve, autour d'un lac, etc.
- Cette plante ne croît qu'au bord de la mer.
- Les bords du Rhin sont fort pittoresques.
- Sorte de ruban ou galon, bande d'étoffe dont on borde certaines parties de l'habillement.
- Mettre un bord à un chapeau, à une jupe.
-
(Marine) Côté d'un bateau.
- De quel bord vient le vent ?
- Sauter par-dessus bord.
-
(Par métonymie) Le navire lui-même.
- Le capitaine nous régala sur son bord.
-
(Quelquefois) Bordée.
- Courir des bords.
- Louvoyer à petits bords.
- Courir un bord à terre, un bord au large.
- (Topologie) Pour une partie A d'un espace topologique, son adhérence privée de son intérieur. Un point x de X appartient au bord de A ssi tout voisinage de x rencontre à la fois A et son complémentaire.
-
(Au pluriel) (Poétique) Régions, des contrées environnées d'eau.
- Les bords africains, indiens.
- Vivre sur les bords étrangers.
- (Jeux) Au cinq-cents, le valet d'atout et le valet de l'autre sorte de même couleur ; ce sont les cartes les plus fortes, exception faite des jokers.
-
(Figuré) Opinion.
- Et vous, les mamans, les femmes de Ménilmontant, qui m'accostez dans la rue, qui me traitez en camarade, j'aurai eu beau faire : je ne suis pas de votre bord, je ne suis qu'une déguisée ! ? (Léon Frapié, La maternelle, Librairie Universelle, 1908)
- Vous devez être, ironisais-je, un de ces anciens rebelles vendéens, un de ces nostalgiques royalistes. Je ne suis pas de ce bord-là. J'ai toujours été républicain. ? (A. M. Ivankov-Diaz, Moi, Jean Thomas Collot, fils de gueux, L'encre et le grattoir, 2017, ISBN 978-2-9562146-0-1)
-
(Par métonymie) (Par euphémisme) Orientation sexuelle ; en particulier, homosexualité.
- Il y a un type qui n'arrête pas de mater dans ma direction. Il sort sur son balcon, les yeux rivés sur moi ; il rentre et, derrière la vitre, reste un long moment tourné complètement face à moi. Il commence à me courir à la fin ! Je lui ai fait signe du revers de la main d'arrêter son cirque et de me lâcher en lui faisant comprendre que je ne suis pas de ce bord-là. ? (Hoda Barakat traduit par Philippe Vigreux, Courrier de nuit, Actes Sud, 2018, ISBN 978-2330113711)
Trésor de la Langue Française informatisé
BORD, subst. masc.
Bord au Scrabble
Le mot bord vaut 7 points au Scrabble.
Informations sur le mot bord - 4 lettres, 1 voyelles, 3 consonnes, 4 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot bord au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
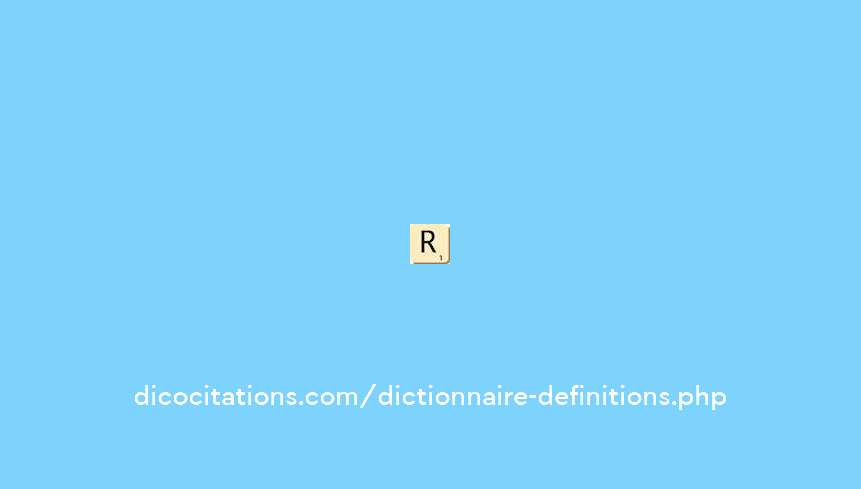
Les mots proches de Bord
Borax Borborygme Bord Bordage Borde Bordé, ée Bordeau Bordeaux (vin de) ou vulgairem Bordée Bordel Bordelier Bordement Border Bordereau Borderie Bordeyer Bordier Bordure Boréal, ale Borée Borer Borgne Bornage Bornal Borne Borné, ée Borner Bornoyer Bort Bor-et-Bar bora Boran-sur-Oise borax borborygme borborygmes Borce borchtch Borchtlombeek Borcq-sur-Airvault bord Bord-Saint-Georges borda bordage bordages bordai bordaient bordait bordant borde bordé bordé bordé bordeau bordeaux bordeaux Bordeaux Bordeaux Bordeaux Bordeaux Bordeaux Bordeaux Bordeaux Bordeaux Bordeaux Bordeaux-en-Gâtinais Bordeaux-Saint-Clair bordée bordée bordée bordées bordées bordées bordées bordel bordelais bordelais bordelaise bordelaise bordelaisesMots du jour
-
entrecoupais poireauté cachotterie cédule barbelé sexagénaire perturba prévalent tourbillonnait curviligne
Les citations avec le mot Bord
- Est-ce qu'elle vient de sortir d'un oeuf ? Est-ce que cette fille se mange ? Est-ce qu'elle est en chocolat ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?Auteur : Mathias Malzieu - Source : La Mécanique du coeur (2007)
- Ce sont ordinairement les meilleures choses que ravissent d'abord les mains avides de la mort.Auteur : Ovide - Source : Les Amours, II, 6, 39
- Montrer les limites de l'interprétation psychanalytique et de l'explication marxiste et que seule la liberté peut rendre compte d'une personne dans sa totalité, faire voir cette liberté aux prises avec le destin, d'abord écrasée par ses fatalités puis se retournant sur elles pour les digérer peu à peu, prouver que le génie n'est pas un don mais l'issue qu'on invente dans les cas désespérés, retrouver le choix qu'un écrivain fait de lui-même, de sa vie et du sens de l'univers jusque dans les caractères formels de son style et de sa composition, jusque dans la structure de ses images, et dans la particularité de ses goûts, retracer en détail l'histoire d'une libération : voilà ce que j'ai voulu.Auteur : Jean-Paul Sartre - Source : Saint Genet, comédien et martyr (1952)
- Le plaisir physique, étant dans la nature. est connu de tout le monde, mais n'a qu'un rang subordonné aux yeux des âmes tendres et passionnées.Auteur : Henri Beyle, dit Stendhal - Source : De l'amour (1822)
- Les vrais problèmes sont d'abord amers à goûter; le plaisir viendra à ceux qui auront vaincu l'amertume.Auteur : Emile-Auguste Chartier, dit Alain - Source : Propos sur l'éducation (1932)
- On nous fait coucher ce soir à bord pour démarrer demain au lever du soleil.Auteur : Voltaire - Source : Amabed
- Un banc à l'arrière, un second banc au milieu, pour maintenir l'écartement, un troisième banc à l'avant, un plat-bord pour soutenir les tolets de deux avirons, une godille pour gouverner, complétaient cette embarcation.Auteur : Jules Verne - Source : L'Ile mystérieuse (1873-1875)
- Il accrocha la serviette au séchoir, posa le tapis de bain sur le bord de la baignoire et le saupoudra de gros sel afin qu'il dégorgeât toute l'eau contenue. Le tapis se mit à baver en faisant des grappes de petites bulles savonneuses.Auteur : Boris Vian - Source : L' Ecume des jours (1947)
- On se surprend à marcher sur le bord du trottoir comme on faisait enfant, comme si c'était la marge qui comptait, le bord des choses.Auteur : Philippe Delerm - Source : La première gorgée de bière
- Ses compagnons s'employèrent à l'abattage et au charroi des arbres qui devaient fournir les courbes, la membrure et le bordé.Auteur : Jules Verne - Source : L'Ile mystérieuse (1873-1875)
- Je passai la tête d'abord, j'avais les mains à plat sur le sol de la cour que mes hanches se tortillaient encore, prises entre les dormants.Auteur : Samuel Beckett - Source : Nouvelles et textes pour rien (1955)
- Il estoit homme désordonné, dissolu et desbordé en despense et abysmé de dettes.Auteur : Jacques Amyot - Source : Galba, 26
- Ils parlèrent de Paris, des environs, des bords de la Seine, des villes d'eaux, des plaisirs de l'été, de toutes les choses courantes sur lesquelles on peut discourir indéfiniment sans se fatiguer l'esprit.Auteur : Guy de Maupassant - Source : Bel-Ami (1885)
- On aime d'abord la nature. Ce n'est bien plus tard qu'on arrive à l'homme.Auteur : Jules Renard - Source : Journal
- Inhospitalier de nature, le Français soigne d'une manière défensive ses abords immédiats, s'entoure d'églantier, d'épine noire et de genévrier; il barbèle au besoin son jardin, et sa première débauche d'imagination est pour la clôture.Auteur : Sidonie Gabrielle Colette - Source : Flore et Pomone
- On est touriste, en amour, on cherche l'autre et l'ailleurs, et on les trouve d'abord dans la langue. Auteur : Camille Laurens - Source : Celle que vous croyez (2016)
- Je regrette pas d'avoir fait la guerre: d'abord parce que j'suis pas mort, et puis parce que j'ai été décoré; évidemment parce que j'suis pas mort. A la guerre, on décore ceux qui reviennent; ceux qui sont courageux, c'est ceux qui sont morts.Auteur : Coluche - Source : L'Ancien combattant
- Ils envoient leur conscience au bordel et tiennent leur contenance en règle.Auteur : Michel de Montaigne - Source : Essais, IV, 5
- Quelque lié qu'il soit à la civilisation où il naît, l'art la déborde souvent - la transcende peut-être... - comme s'il faisait appel à des pouvoirs qu'elle ignore, à une inaccessible totalité de l'homme.Auteur : André Malraux - Source : Les Voix du silence (1951)
- Quels vents impétueux, ô puissante Sagesse,
De l'île du Bonheur me repoussent sans cesse!
Que d'écueils menaçants en défendent les bords!Auteur : Claude Adrien Helvétius - Source : Le Bonheur (1773), Chant I - Couchés au bord de l'entonnoir, quelques soldats guettaient, l'oeil au ras de l'herbe; les autres discutaient entassés dans le trou.Auteur : Roland Dorgelès - Source : Les Croix de bois (1919)
- Pourquoi l'amour ne serait-il pas d'abord ce qui fait plaisir au coeur? On a bien le temps de souffrir par la suite.Auteur : Jean Anouilh - Source : La répétition
- Pour vaincre, il faut tout d'abord regarder tout ennemi bien en face.Auteur : Daniel Desbiens - Source : Maximes d'Aujourd'hui
- Nous étions au bord d'un gouffre, nous avons fait un grand pas en avant...Auteur : Félix Houphouët-Boigny - Source : Sans référence
- Ne tiens pas tête à la colère d'un roi ni au débordement d'un fleuve.Auteur : Proverbes arabes - Source : Proverbe
Les citations du Littré sur Bord
- Je cherchai dans le voisinage un abri.... le seul qui pût me convenir était un petit rebord de deux pieds de largeur au plus, saillant au-dessus du précipiceAuteur : SAUSSURE - Source : Voy. Alpes, t. V, p. 131, dans POUGENS
- Approcherent la dite galere des François et tant qu'ils aborderent et commencerent à eulx gripper aux cordes et monter pour cuider entrer dedansAuteur : JEAN D'AUTON - Source : Annales de Louis XII, mss. f° 27, dans LACURNE
- Elle [une fleur] est nuancée, bordée, huilée, à pièces emportées [à découpures]Auteur : LA BRUY. - Source : XIII
- Le chancelier me parla d'abord avec une entière ouverture, mais une imposition étroite du secretAuteur : SAINT-SIMON - Source : 297, 66
- L'un avalait d'abord trois ou quatre lampéesAuteur : HAUTEROCHE - Source : Nobles de province, I, 9
- Les murtes, la lavande, la rosmarine, la trufemande et le bouïs sont les plus propres plantes pour borduresAuteur : O. DE SERRES - Source : 580
- Ce peuple [de Bordeaux] qui employa touts les plus extremes moyens qu'il eust en ses mains à me gratifier.... et feit bien plus pour moi en me redonnant ma charge, qu'en me la donnant premierementAuteur : MONT. - Source : IV, 171
- Au bord de la partie éclairée du disque lunaire, les montagnes se présentent sous la forme d'une dentelure qui s'étend au delà de la ligne de lumièreAuteur : LAPLACE - Source : Exp. I, 4
- L'ode avec plus d'éclat et non moins d'énergie, Élevant jusqu'au ciel son vol ambitieux, Entretient dans ses vers commerce avec les dieux ; Aux athlètes dans Pise elle ouvre la barrière, Chante un vainqueur poudreux au bout de la carrière, Mène Achille sanglant au bord du Simoïs, Ou fait fléchir l'Escaut sous le joug de LouisAuteur : BOILEAU - Source : Art p. II
- Je ne remplirai point sa mangeoire [d'un serin] par dessus les bords, pour l'exposer à crever de gogailleAuteur : BERQUIN - Source : Ami des enfants, Favori.
- La différente découpure de leurs bords qui s'ajustent ensemble, qui s'engrènent mutuellementAuteur : MAIRAN - Source : Éloges, Hunauld.
- D'abord superbe et triomphante, Elle vint en grand apparat, Traînant avec des airs d'infante Un flot de velours nacaratAuteur : TH. GAUTIER - Source : Émaux et camées, le Poëme de la femme
- Et déjà sur les bords de la cuve fumante S'élève en bouillonnant la vendange écumanteAuteur : DELILLE - Source : Géorg. II
- On le déclara vice-amiral [le czar Pierre], en considération de ses services ; cérémonie bizarre, mais utile dans un pays où la subordination militaire était une des nouveautés que le czar avait introduitesAuteur : ID. - Source : Charles XII, 7
- Ce qui augmenta le péril, c'est qu'on prit d'abord ces clameurs pour des acclamations, et ces hourras pour des cris de vive l'empereur ; c'était Platof et six mille cosaques...Auteur : SÉGUR - Source : Hist. de Nap. IX, 3
- Pour entrer d'abord dans mon sujet, je présuppose ici.... ce que la foi nous enseigneAuteur : BOURDAL. - Source : Carême, III, Résurr. de J. C. 309
- Non que pour cela j'osasse entreprendre d'abord d'examiner toutes celles difficultés] qui se présenteraientAuteur : DESC. - Source : Méth II, 13
- Les sables qui sont mobiles dans le moment où les flots les amoncellent sur les bords, mais qui, par le moyen du suc calcaire que la mer y infiltre, se durcissent graduellement au point de servir à des pierres meulièresAuteur : SAUSSURE - Source : Voy. Alpes, t. I, p 363, dans POUGENS
- La botanique veut que l'on coure les montagnes et les forêts, que l'on gravisse contre des rochers escarpés, que l'on s'expose aux bords des précipicesAuteur : FONTEN. - Source : Tournefort.
- Sur ces deux ailes, gens d'armes les [les Flamands] commencerent à pousser de leurs roides lances à longs fers et durs de Bordeaux.... dont ceux qui en estoient atteints se restreignirent pour eschever les horionsAuteur : Jean Froissard - Source : II, II, 197
- Le contour de la supérieure [mandibule] est bordé près de la tête et comme ourlé d'un rebord de substance membraneuse ou calleuse, criblée de petits trousAuteur : BUFF. - Source : Ois. t. XVIII, p. 31
- Après deux petits stellionats faits au sieur Jean-François de la Borde, son bienfaiteurAuteur : Voltaire - Source : Pol. et lég. procès de Claustre.
- Le soleil en naissant la regarde d'abord, Et le mont la défend des outrages du nordAuteur : BOILEAU - Source : Épît. VI
- D'abord une source de feux, Comme un fleuve éternel répandue en tous lieux, De sa flamme invisible échauffant la matière, Jadis versa la vie à la nature entièreAuteur : DELILLE - Source : Én. VI
- Le faire [du tableau] est rapide, la pâte un peu grasse et lisse, de premier jet, sans reliefs inutiles, coulante, abondante, plutôt écrasée et légèrement blaireautée par les bordsAuteur : FROMENTIN - Source : les Maîtres d'autrefois, p. 370
Les mots débutant par Bor Les mots débutant par Bo
Une suggestion ou précision pour la définition de Bord ? -
Mise à jour le mardi 10 février 2026 à 13h30
Dictionnaire des citations en B +
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur bord
Poèmes bord
Proverbes bord
La définition du mot Bord est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Bord sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Bord présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
