Définition de « plastique »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot plastique de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur plastique pour aider à enrichir la compréhension du mot Plastique et répondre à la question quelle est la définition de plastique ?
Une définition simple : (fr-rég|plas.tik) plastique (mf)
Définitions de « plastique »
Trésor de la Langue Française informatisé
PLASTIQUE, adj. et subst.
Wiktionnaire
Nom commun 2 - français
plastique \plas.tik\ masculin
-
Matériau organique de synthèse fondé sur l'emploi des macromolécules (polymères).
- Pas un bruit, sauf la pièce qui tombe dans le distributeur, le bruit du moteur, le café qui coule dans le godet en plastique. Personne ne parle. ? (Catherine Guibourg, Le oui européen et le non français, La Compagnie Littéraire, 2006, page 107)
- Alors, c'était du neuf, à part un lot d'outils de jardin et quelques meubles en plastique que j'avais récupérés dans une vente de garage. ? (Luc Baranger & André Marois, « Servez-vous, c'est gratis », dans Tab'arnaques : nouvelles, Québec Amérique, 2011)
- L'homme fait preuve en général d'une grande désinvolture par rapport aux déchets en plastique, mais sur les Midway Islands, les conséquences de la culture des déchets en plastique jetés n'importe où sont de plus en plus claires. ? (Arnaud Lefebvre, « Îles Midway : comment un endroit paradisiaque est devenu un enfer de plastique », L'Express Business, 14 juin 2018)
Nom commun 1 - français
plastique \plas.tik\ féminin
-
(Art) Art d'exprimer la forme.
- Pour Orson Welles, l'image n'est jamais première, la plastique est détestable si elle est une fin en soi.
-
Silhouette, forme gracieuse d'une personne.
- Cette femme a une très belle plastique.
Adjectif - français
plastique \plas.tik\ masculin et féminin identiques
-
(Art) Relatif au modelage.
- Art plastique, Art de modeler toutes sortes de figures et d'ornements en plâtre, en terre, en stuc, etc.
-
(Par extension) Tous les arts du dessin.
- Exemple d'utilisation manquant. (Ajouter)
-
(Médecine) Qui cherche à remodeler les formes du corps.
- La chirurgie plastique.
- Souple, malléable.
- Tout en invectivant, il arpentait l'écurie au regard étonné des vaches qui tordaient leurs cols plastiques pour suivre ses allées et venues. ? (Marcel Aymé, La jument verte, Gallimard, 1933, collection Le Livre de Poche, page 115.)
-
(Philosophie) Scolastique, ce qui a la puissance de former.
- La vertu plastique des animaux, des végétaux.
- Pouvoir, force plastique.
- Qui est propre à recevoir une forme.
- L'argile est plastique.
- Pâte plastique.
-
(Physique) Qualifie une déformation qui persiste lorsque sa cause a disparu.
- Exemple d'utilisation manquant. (Ajouter)
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
. Il se dit, en termes de Philosophie scolastique, de Ce qui a la puissance de former. La vertu plastique des animaux, des végétaux. Pouvoir, force plastique. Art plastique, Art de modeler toutes sortes de figures et d'ornements en plâtre, en terre, en stuc, etc. On dit substantivement, dans le même sens, La plastique. Arts plastiques se dit, par extension, de Tous les arts du dessin.
PLASTIQUE signifie aussi Qui est propre à recevoir une forme. L'argile est plastique. Pâte plastique.
Littré
-
1 Terme de philosophie scolastique. Qui a la puissance de former.
Il imagina qu'il y avait dans les écrevisses une âme plastique ou formatrice qui savait leur refaire de nouvelles jambes
, Fontenelle, Hartsoeker.Ce seraient là les natures plastiques de M. Cudworth, qui ont eu de célèbres partisans, si ce n'était que celles-ci agissent sans connaissance, et que celles de M. Hartsoeker sont intelligentes
, Fontenelle, ib.Premièrement il y a la nature en général?; ensuite il y a des natures plastiques qui forment tous les animaux et toutes les plantes?; vous entendez bien?? - Pas un mot, monsieur. - Continuons donc
, Voltaire, Philos. Ignor. 28. -
2 Terme de physiologie. Qui forme, qui sert à former.
Liquide plastique ou blastème, liquide qui, sorti des capillaires, sert à la génération ou à la nutrition des éléments anatomiques.
Force plastique, activité plastique, la force qui est supposée présider aux phénomènes de nutrition et de reproduction ou de réparation des tissus dans les corps organisés.
Aliments plastiques, d'après Dumas et Liebig, substances qui renferment de l'azote (gluten, albumine, caséine, fibrine, etc.), et sont regardées comme spécialement destinées à être assimilées.
Vie plastique, la nutrition et les fonctions qui concourent à son accomplissement dans tous les tissus?: digestion, urination, respiration et circulation.
-
3Se dit de toute substance propre à la fabrication des poteries. L'argile pure est plastique.
Art plastique, art de modeler les figures en plâtre, etc.
Au plur. Les arts plastiques, se dit de tous les arts du dessin.
Fig. Il se dit de la poésie, quand elle s'efforce, par le vers, de peindre et de sculpter.
-
4 S. f. La plastique, nom donné, chez les Grecs, à toutes les branches de la sculpture et même à toute imitation du corps humain en y comprenant la graphique.
Après eux parurent Dédale et Théodore qui étaient de Milet, auteurs de la statuaire et de la plastique
, Barthélemy, Anach. ch. 37, note 25.
Encyclopédie, 1re édition
PLASTIQUE, (Métaphysique.) nature plastique, principe que quelques philosophes prétendent servir à former les corps organisés, & qui est différent de la vie des animaux. On attribue cette opinion à Aristote, Platon, Empédocle, Héraclite, Hippocrate & aux Stoïciens, auxquels on joint les nouveaux Platoniciens, les Péripatéticiens modernes, & même les Paracelsistes qui ont donné dans le corps des animaux le nom d'archée à ce principe. Mais cette hypothese a été sur-tout ramenée & étayée de toutes les preuves dont elle est susceptible, par M. Cudvorth dans son système intellectuel.
Tous ces Philosophes disent que sans ces natures, il faudroit supposer l'une de ces deux choses, ou que dans la formation des corps organisés chaque chose se fait fortuitement sans la direction d'aucune intelligence, ou que Dieu fait lui-même, & pour ainsi dire, de ses propres mains les moindres animaux & leurs petites parties. Or, selon eux, ces deux suppositions sont insoutenables ; car 1°. assurer que tous les effets de la nature se font par une nécessité méchanique, ou par le mouvement fortuit de la matiere, sans aucune direction d'un autre être, c'est assurer une chose également déraisonnable & impie. Non-seulement on ne sauroit concevoir que l'infinie régularité qui est dans tout l'univers résulte constamment du simple mouvement de la matiere, mais il y a encore plusieurs phénomenes particuliers qui passent le pouvoir du mouvement méchanique, comme la respiration des animaux, & il y en a même qui sont contraires à ces lois, comme la distance du pole de l'équateur à celui de l'écliptique. Henri Morus a donné divers exemples de ces deux cas dans son Enchiridion metaphysicum, imprimé à Londres en 1699 avec le reste de ses ?uvres en trois vol. in-fol. Outre cela, ceux qui veulent que tout se fasse par les lois de la méchanique, font de Dieu un spectateur oisif de ce qui résultera des mouvemens fortuits ou nécessaires de la matiere. puisqu'il n'agit en aucune maniere au dehors. Ils rendent la même raison des effets de la nature, qu'un sculpteur, par exemple, rendroit de la maniere dont il auroit fait une statue, s'il disoit que son ciseau étant tombé sur tel ou tel endroit, il l'a creusé, que les autres sont demeurés relevés, & qu'ainsi toute la statue s'est trouvée faite, sans qu'il eût dessein de la faire. C'est tomber dans la même absurdité que de dire, pour rendre raison de la formation des corps des animaux, que les parties de la matiere dont ils sont formés, se sont mues, en sorte qu'elles ont fait, par exemple, le cerveau en tel endroit de telle maniere, le c?ur là & de cette figure, & ainsi du reste des organes, sans que le dessein de ce mouvement fut de former un homme, tout cela étant seulement le résultat immédiat du mouvement. Dire d'un autre côté, que Dieu est l'auteur immédiat de tout, c'est faire la Providence embarrassée, pleine de soins & de distractions, & par conséquent en rendre la créance plus difficile qu'elle n'est, & donner de l'avantage aux Athées. C'est le jugement de l'auteur du livre de mundo, qui croit qu'il est indigne de Dieu de faire tout lui-même jusqu'aux moindres choses : « puisqu'il seroit, dit-il, au-dessous de la grandeur de Xerxès de faire tout lui-même, d'exécuter ce qu'il souhaite, & d'administrer tout immédiatement, combien plus seroit-ce une chose peu séante pour la divinité ? Il est bien plus conforme à sa grandeur, & plus décent, qu'une vertu qui soit répandue par tout le monde remue le soleil & la lune ». D'ailleurs, disent nos Philosophes, il ne paroît pas conforme à la raison, que la nature considérée comme quelque chose de distinct de la divinité, ne fasse rien du tout, Dieu faisant toutes choses immédiatement & miraculeusement. Enfin la lenteur avec laquelle tout est produit, paroîtroit une vaine pompe ou une formalité inutile, si l'agent étoit tout puissant. On ne comprendroit pas non plus comment il y auroit des désordres dans l'univers, où quantité de productions réussissent mal, parce que la matiere ne se trouve pas bien disposée, ce qui marque que l'agent n'a pas une puissance à laquelle rien ne peut résister, & que la nature aussi-bien que l'art est une chose qui peut quelquefois manquer, & être frustrée dans ces desseins, à cause de la mauvaise disposition de la matiere, comme un agent tout puissant peut faire ce qu'il se propose en un moment, il arrive toujours infailliblement à ses fins sans que rien l'en puisse empêcher.
Ce sont-là les raisons qui font conclure les philosophes que nous avons nommés, qu'il y a sous la divinité des natures plastiques, qui comme autant d'instrumens, exécutent les ordres de sa providence, en ce qui regarde les mouvemens réguliers de la matiere. Ces natures, à ce qu'ils prétendent, ne doivent point être confondues avec les qualités occultes des Péripatéticiens. Ceux qui attribuent un phénomene à quelque qualité occulte, n'en marquent aucune cause, ils témoignent seulement qu'elle leur est cachée ; mais ceux qui disent que l'ordre qu'on voit dans le monde vient d'une nature plastique, en marquent une cause distincte & intelligible ; car ce ne peut être qu'une intelligence qui soit la cause de cette régularité, & c'est ce qu'assurent ceux qui établissent une semblable nature ; au lieu que ceux qui établissent un méchanisme fortuit, pour parler ainsi, & qui ne reconnoissant aucune cause finale, ne veulent pas qu'une intelligence ait part à la formation des choses ; ces gens-là ne rendent aucune raison de l'ordre de l'univers, à moins qu'on ne dise que la confusion est cause de l'ordre, & le hasard de la régularité. Il y a donc une grande différence entre les qualités occultes & les natures plastiques. Mais les défenseurs de ces natures conviennent en même tems qu'il est très-difficile de s'en faire l'idée, & qu'on ne peut les connoître que par une espece de description. Aristote apprend, Physiq. liv. XVI. ch. viij. comment on peut concevoir la nature plastique en général, en disant que si l'art de bâtir des vaisseaux étoit dans le bois, cet art agiroit comme la nature, c'est-à-dire qu'il croîtroit des vaisseaux tout faits, comme il croît des fruits & d'autres choses semblables. Il en est de même de tous les autres arts. Si l'art de bâtir qui est dans l'esprit des architectes, étoit dans les pierres, dans le mortier & dans les autres matériaux, ils se rangeroient par le moyen de ce principe intérieur dans le même ordre auquel nous le mettons, comme les Poëtes ont dit qu'Amphion en jouant de la lyre, attiroit les pierres, en sorte qu'elles formoient d'elles-mêmes les murailles de Thèbes. La nature plastique est donc une espece d'artisan, mais elle a plusieurs avantages sur l'art humain. Au lieu que celui-ci n'agit qu'en dehors & de loin, sans pénétrer la matiere, qu'il se sert de beaucoup d'instrumens, & qu'il travaille à grand bruit pour imprimer avec peine dans la matiere la forme que l'artisan a dans l'esprit, la nature dont on parle, agit intérieurement & immédiatement sans instrument & sans aucun fracas, d'une maniere cachée, & avec beaucoup de facilité. M. Cudvorth dit que cet art est comme incorporé dans la matiere, & nomme sa maniere d'agir vitale, & même magique, pour l'opposer à la méchanique dont les hommes se servent. 2°. Au lieu que nos artisans sont souvent obligés de chercher comment ils feront pour venir à bout de leurs desseins, qu'ils consultent, qu'ils déliberent, & qu'ils corrigent souvent les fautes qu'ils avoient faites, la nature plastique au contraire ne s'arrête jamais, & n'est point en peine de ce qu'elle doit faire ; elle agit toujours sans jamais changer ou corriger ce qu'elle a fait ; elle est une empreinte de la toute puissance divine qui est la loi & la regle de tout ce qu'il y a de meilleur dans chaque chose.
Néanmoins il faut bien se garder de confondre la nature plastique avec la divinité même. C'est quelque chose de tout différent & qui est fort au-dessous. L'art de la divinité, à proprement parler, n'est que la lumiere, l'intelligence & la sagesse qui est en Dieu lui-même, & qui est d'une nature si éloignée de celle des corps, qu'elle ne peut être mêlée dans la nature corporelle. La nature n'est pas cet art archetipe ou original qui est en Dieu, elle n'est qu'une copie, qui quoique vivante & semblable à divers égards à son original, conformément auquel elle agit, n'entend pas néanmoins la raison pour laquelle elle agit. On peut exprimer leur différence par la comparaison de la raison intérieure, ou du discours intérieur, & de la raison proférée, ou discours extérieur, le second quoique image du premier, n'étant qu'un son articulé, destitué de tout sentiment & de toute intelligence.
L'activité vitale des natures plastiques n'est accompagnée d'aucun sentiment clair & exprès. Ce sont des êtres qui ne s'apperçoivent de rien, & qui ne jouissent pas de ce qu'ils possedent. On allegue diverses raisons pour justifier cette partie de l'hypothèse, qui est une des plus difficiles à digérer.
1°. Les Philosophes mêmes qui veulent que l'essence de l'ame consiste dans la pensée, & que la pensée soit toujours accompagnée d'un sentiment intérieur, ne sauroient prouver avec quelque vraissemblance que l'ame de l'homme dans le plus profond sommeil, dans les léthargies, dans les apoplexies, & que les ames même des enfans dans le sein de leurs meres pensent, & sentent ce qu'elles pensent ; & néanmoins si elles ne pensent pas, il faut que, selon eux, elles ne soient pas. Si donc les ames des hommes sont pendant quelque tems sans ce sentiment intérieur, il faut que l'on accorde que ce sentiment-là du moins clair & exprès n'est pas nécessaire à un être vivant.
2°. Il y a une certaine apparence de vie dans les plantes que l'on nomme sensitives, auxquelles néanmoins on ne sauroit attribuer imagination ni sentiment.
3°. Il est certain que l'ame humaine ne sent pas toujours ce qu'elle renferme. Un géometre endormi a en quelque sorte tous ses théoremes & toutes ses connoissances en lui-même : il en est de même d'un musicien accablé d'un profond sommeil, & qui sait alors la musique & quantité d'airs sans le sentir. L'ame ne pourroit-elle donc pas avoir en elle-même quelque activité qu'elle ne sût pas ?
4°. Nous savons par l'expérience que nous faisons quantité d'actions animales sans y faire aucune attention, & que nous exécutons une longue suite de mouvemens corporels, seulement parce nous avons eu intention de les faire sans y penser davantage.
5°. Ce rapport vital par lequel notre ame est liée si étroitement à notre corps, est une chose dont nous n'avons aucun sentiment direct, & que nous ne connoissons que par les effets. Nous ne pouvons pas dire non plus de quelle maniere les différens mouvemens de notre corps produisent divers sentimens dans notre ame, ou comment nos ames agissent sur les esprits animaux dans notre cerveau, pour y produire les changemens dont l'imagination a besoin.
6°. Il y a une sorte de pouvoir plastique dans l'ame, s'il est permis de parler ainsi, par lequel elle forme ses propres pensées, & dont souvent elle n'a point de sentiment ; comme lorsqu'en songeant nous formons des entretiens entre nous & d'autres personnes, assez longs & assez suivis, & dans lesquels nous sommes surpris des réponses que ces autres personnes semblent nous faire, quoique nos ames forment elles-mêmes cette espece de comédie.
7°. Enfin non-seulement les mouvemens de nos paupieres & de nos yeux se font en veillant sans que nous les appercevions, mais nous faisons encore divers mouvemens en dormant sans les sentir. La respiration & tous les mouvemens qui l'accompagnent, dont on ne peut pas rendre des raisons méchaniques qui satisfassent, peuvent passer quelquefois plutôt pour des actions vitales, que pour des actions animales, puisque personne ne peut dire qu'il sent en lui-même cette activité de son ame qui produit ces mouvemens quand il veille, & encore moins quand il dort. De même les efforts que Descartes a faits pour expliquer les mouvemens du c?ur, se trouvent refutés par l'expérience, qui decouvre que la systole est une contraction musculaire causée par un principe vital. Comme notre volonté n'a aucun pouvoir sur la systole & la dyastole du c?ur, nous ne sentons aussi en nous-mêmes aucune action du nôtre qui les produise ; & nous en concluons qu'il y a une activité vitale qui est sans imagination & sans sentiment intérieur.
Il y a une nature plastique commune à tout l'univers. Il y a des natures particulieres qui sont dans les ames des animaux, & il n'est pas impossible qu'il n'y en ait encore d'autres dans des parties considérables du monde, & que toutes ne dépendent d'une ame universelle, d'une parfaite intelligence qui préside sur le tout. Telle est l'hypothèse des natures plastiques, contre laquelle on a formé diverses objections. Voici les principales.
1°. On lui reproche de n'être autre chose que la doctrine des formes substantielles ramenée sous une autre face. C'est M. Bayle qui forme cette accusation, dans sa continuation des pensées diverses, ch. xxj. On lui a opposé les réponses suivantes. 1°. Les défenseurs des natures plastiques suivent la philosophie corpusculaire ; ils disent que la matiere de tous les corps est une substance étendue, divisible, solide, capable de figure & de mouvement. 2°. Ils n'attribuent aucune autre forme à chaque corps considéré simplement comme tel, qu'une forme accidentelle qui consiste dans la grosseur, la figure, la situation ; & ils tâchent de rendre raison par-là des qualités des corps. 3°. Cette doctrine est très-éloignée de celle des Péripatéticiens, qui établissent je ne sais quelle matiere premiere, destituée de toutes sortes de qualités, & à laquelle une forme substantielle qui lui est unie, donne certaines propriétés. Cette forme est, selon leur définition, une substance simple & incomplette, qui en actuant la matiere (qui n'est autrement qu'une puissance) compose avec elle l'essence d'une substance complette. Une pierre, par exemple, est composée d'une matiere qui n'a point de propriété, mais qui devient pierre étant jointe à une forme substantielle. La nature plastique n'est pas une faculté du corps qui y existe comme dans son sujet, ainsi que la forme substantielle est appartenante à la matiere qui la renferme dans son idée. C'est une substance immatérielle qui est entierement distincte. Elle n'est pas non plus unie avec le corps pour faire un tout avec lui. Elle n'est pas engendrée & ne périt pas avec le corps, comme les formes substantielles.
2°. On prétend qu'elle favorise l'athéïsme. C'est encore M. Bayle qui objecte que la supposition des natures plastiques, que l'on dit agir en ordre sans en avoir d'idée, donne lieu aux Athées de retorquer contre nous l'argument par lequel nous prouvons qu'il y a un Dieu qui a créé le monde en faisant remarquer l'ordre qui y regne. « Cette objection, dit-il, hist. des Sav. Décembre, 1704, n°. 40. est fondée sur ce que quand même par un dato non concesso on accorderoit que la nature, quoique destituée de connoissance & de plusieurs autres perfections, existeroit d'elle-même, on ne laisseroit pas de pouvoir nier qu'elle fût capable de pouvoir organiser les animaux, vû que c'est un ouvrage dont la cause doit avoir beaucoup d'esprit ». On répond qu'à la vérité nul être n'a pu concevoir le dessein de former les animaux tels qu'ils sont, sans avoir beaucoup de lumieres ; mais la cause suprème & souverainement sage, après avoir conçu ce dessein, a pu produire des causes inférieures qui exécutent son projet sans en savoir les raisons ni les fins, & sans avoir d'idée de ce qu'on appelle ordre, qui est une disposition de parties rangées ensemble d'une maniere propre à parvenir à un certain but. Pourquoi Dieu ne pourroit-il pas faire un être immatériel dont il borne la connoissance & le pouvoir d'agir selon son plaisir ? Il est nécessaire que l'inventeur d'une machine ait beaucoup d'esprit, mais il n'est pas nécessaire que ceux à qui il la fait faire en sachent le dessein & les raisons. Il suffit qu'ils exécutent ses ordres suivant l'étendue de leurs facultés. La preuve que l'on donne de l'existence de Dieu par l'ordre que l'on voit dans la nature, n'est pas appuyée sur cette supposition, que tout ce qui contribue à cet ordre le comprend, mais seulement sur ce que cela ne s'est pu faire sans qu'au moins la cause suprème en ait eu une idée, & l'on démontre par-là son existence. Rien, dit-on, ne peut agir en ordre sans en avoir l'idée, ou sans avoir reçu cette faculté d'un être qui a cette idée. Or, si les Athées accordent cela, il faudra nécessairement qu'ils reconnoissent un Dieu, & ils ne pourront point retorquer l'argument. Les défenseurs des natures plastiques y donneroient lieu s'ils disoient que Dieu ne s'est point formé d'idée de l'univers avant qu'il fût fait, mais qu'une certaine nature l'a produit sans savoir ce qu'elle faisoit. L'ordre du monde, qui seroit alors un effet du hasard, ne prouveroit point dans cette hypothèse qu'il y a un Dieu ; mais il n'en est pas de même lorsqu'on suppose que Dieu, après avoir conçu l'ordre du monde, a produit des êtres immortels pour l'exécuter sous sa direction.
3°. On regarde enfin comme absurde la supposition de ces natures formatrices, qui ne savent ce qu'elles font, & qui font néanmoins les organes des plantes & des animaux. Cette troisieme difficulté se réduit à cette proposition : « S'il peut y avoir une nature immatérielle & agissante par elle-même, qui forme en petit par la faculté qu'elle en a reçue de Dieu, des machines telles que sont les corps des plantes & des animaux, sans néanmoins en avoir d'idées ». Les Plasticiens disent qu'oui, en supposant toujours que celui qui a fait cette nature, a en lui-même des idées très-distinctes de ce qu'elle fait. « Mais, continue l'antagoniste, cette nature est donc un pur instrument passif entre les mains de Dieu, ce qui revient à la même chose que de faire Dieu auteur de tout ». On répond que non, parce que suivant l'hypothese, c'est une nature agissante par elle-même. Ici se présente l'exemple des bêtes, que les hommes emploient pour faire diverses choses qu'elles ne savent pas qu'elles font, comme des instrumens actifs pour exécuter des choses que les hommes ne pourroient pas faire immédiatement, ou par leurs propres forces. Car tout ce que font les hommes dans ces occasions, c'est d'appliquer les bêtes d'une certaine maniere à la matiere par des cordes, ou autrement, en sorte qu'elles agissent nécessairement d'une certaine façon, & de les obliger de marcher en les piquant ou en les frappant. Ce n'est pourtant pas que M. Cudvorth ait prétendu que les natures formatrices soient tout-à-fait semblables à l'ame des bêtes, puisqu'il ôte tout sentiment à ces natures, au-lieu que les bêtes sentent. On ne se sert donc de cet exemple que pour faire voir qu'il y a des instrumens actifs, & qui agissent en ordre sans en avoir d'idée, lorsqu'ils sont appliqués aux choses sur lesquelles ils agissent par une intelligence qui sent quel est cet ordre. Il se peut faire, dit-on, que Dieu ait créé, outre les intelligences qui sont au-dessus de la nature humaine, outre les ames des hommes qui sentent & qui raisonnent, outre les ames des bêtes qui sentent, & qui font peut-être quelques raisonnemens grossiers, il se peut que Dieu ait créé des natures immatérielles qui ne sentent ni ne raisonnent ; mais qui ont la force d'agir en un certain ordre, non comme une matiere qui n'agit qu'autant qu'elle est poussée, mais par une activité intérieure, quoique nécessaire : il n'y a rien-là de contradictoire, ni d'absurde. On ajoute que cette nature aveugle peut être bornée, en sorte qu'elle agit toujours d'une certaine façon sans pouvoir s'en éloigner.
M. Bayle demandoit à ce sujet, si Dieu pourroit faire une nature aveugle qui écrivît tout un poëme sans le savoir ; & il prétendoit que la machine du corps d'un animal est encore plus difficile à faire sans intelligence. On répondoit, 1°. Que si l'on avoit vu comment les principes des animaux se forment, on pourroit dire si cette formation est plus difficile que la composition d'un poëme, ou que l'action de l'écrire sans le savoir ; mais que comme on ne l'a point vu, personne n'en sait rien. 2°. Que Dieu peut tout ce qui n'est pas contradictoire, & qu'il pourroit faire une nature qui agiroit sur de la matiere dans un certain ordre nécessaire que Dieu auroit conçu, sans que cette nature sût ce qu'elle feroit, en autant de manieres, & pendant autant de tems que Dieu le voudroit : cette nature donc ne pourroit pas écrire d'elle-même un poëme dont elle n'auroit aucune idée, sans que Dieu en eût réglé les actions d'une certaine maniere, dont elle ne sût s'écarter ; mais elle le pourroit dans cette supposition. Dieu ne seroit pas pour cela l'auteur immédiat de chacune de ses actions, parce qu'elle agiroit d'elle-même ; ainsi Dieu a fait nos ames en sorte qu'elles souhaitant nécessairement d'être heureuses, sans qu'elles puissent s'en empêcher, mais ce n'est pas Dieu qui produit chaque souhait en nous.
Ces raisons n'empêchent pas cependant que la supposition de ces natures formatrices ne soit sort inutile. C'est une vraie multiplication d'êtres faite sans nécessité. Les réponses précédentes peuvent peut-être mettre cette opinion à l'abri du reproche d'absurdité & de contradiction, mais je ne crois pas qu'on puisse y faire sentir de grandes utilités. Je sais bien qu'on a voulu s'en servir pour expliquer le premier principe de la fécondité des plantes & des animaux, & pour rendre raison de leur multiplication prodigieuse. Ce sont, dit-on, les natures plastiques qui travaillent immédiatement & sans cesse les semences des plantes & des animaux, à mesure que la propagation se fait. Comme elles travaillent sans savoir le succès de leur travail, elles font infiniment plus d'embryons qu'il n'en faut pour la propagation des especes, & il s'en perd sans comparaison plus qu'il n'y en a qui réussissent. Il semble que si ces ouvrages sortoient immédiatement de la main de Dieu qui sait ce qui doit arriver, le nombre en seroit plus réglé & la conservation plus constante ; mais il me semble d'un autre côté que l'on met Dieu encore plus en dépense, si je puis m'exprimer ainsi, dans la création de ce nombre infini de natures ouvrieres, que dans la perte d'une partie des semences dont on vient de parler. Quoi qu'il en soit, ceux qui voudront achever d'approfondir cette matiere, peuvent recourir au Systeme intellectuel de M. Cudvorth, & à la Bibliotheque choisie de M. le Clerc, tome II. art. 2. tome V. art. 4. tome VI. art. 7. tome VII. art. 7. & tome X. article dernier.
Plastique, Plastice, (Sculpture.) art plastique, c'est une partie de la Sculpture qui consiste à modeler toutes sortes de figures en plâtre, en terre, en stuc, &c. Les artistes qui s'exercent à ces sortes d'ouvrages s'appellent en latin plastes. La Plastique differe de la Sculpture, en ce que dans la premiere les figures se font en ajoutant de la matiere, au lieu que dans l'autre on les fait pour ainsi du bloc en ôtant ce qui est superflu.
Étymologie de « plastique »
?????????, de ????????, former.
- (XVIIIe siècle) Du latin plasticus, issu du grec ancien ?????????, plastikos (« relatif au modelage »), dérivé du verbe ????????, plássein (« mouler, former ») dont dérive aussi plasma.
- (Nom 2) (Par ellipse) (XXe siècle) De matière plastique.
plastique au Scrabble
Le mot plastique vaut 18 points au Scrabble.
Informations sur le mot plastique - 9 lettres, 4 voyelles, 5 consonnes, 9 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot plastique au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
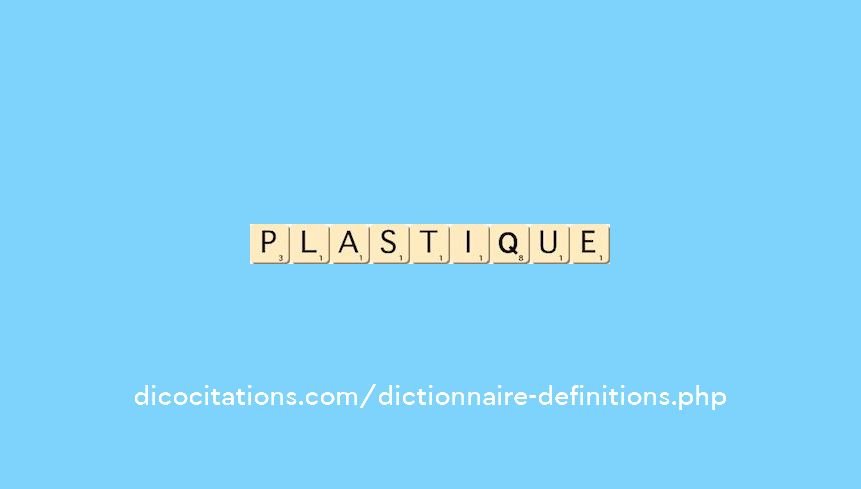
Les rimes de « plastique »
On recherche une rime en IK .
Les rimes de plastique peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en ik
Rimes de suppliques Rimes de arithmétique Rimes de éthiques Rimes de plastiques Rimes de euphonique Rimes de topographiques Rimes de diarrhéique Rimes de algébriques Rimes de post-romantique Rimes de islamiques Rimes de cyclonique Rimes de eugénique Rimes de agronomique Rimes de apodictique Rimes de ethnologiques Rimes de benthique Rimes de encéphaliques Rimes de hypothétiques Rimes de catholique Rimes de métaphoriques Rimes de runiques Rimes de acnéiques Rimes de sclérotique Rimes de autistique Rimes de démocratiques Rimes de psychiques Rimes de logistique Rimes de anti-démocratiques Rimes de hygrométrique Rimes de élastiques Rimes de salvifique Rimes de mnémonique Rimes de sémiotique Rimes de moustiques Rimes de analgésiques Rimes de lyriques Rimes de astic Rimes de beatniks Rimes de mimique Rimes de métabolique Rimes de utopiques Rimes de hypnotique Rimes de informatiques Rimes de antirabique Rimes de radiophonique Rimes de franco-britanniques Rimes de narcotiques Rimes de prismatique Rimes de néo-gothique Rimes de neuroniqueMots du jour
suppliques arithmétique éthiques plastiques euphonique topographiques diarrhéique algébriques post-romantique islamiques cyclonique eugénique agronomique apodictique ethnologiques benthique encéphaliques hypothétiques catholique métaphoriques runiques acnéiques sclérotique autistique démocratiques psychiques logistique anti-démocratiques hygrométrique élastiques salvifique mnémonique sémiotique moustiques analgésiques lyriques astic beatniks mimique métabolique utopiques hypnotique informatiques antirabique radiophonique franco-britanniques narcotiques prismatique néo-gothique neuronique
Les citations sur « plastique »
- L'évocation de la pensée par la ligne, l'arabesque et les moyens plastiques.Auteur : Gustave Moreau - Source : Sans référence
- On avait le temps de désirer les choses, la trousse en plastique, les chaussures à semelles de crêpe, la montre en or. Leur possession ne décevait pas.Auteur : Annie Ernaux - Source : Les Années (2008)
- Je déteste les fleurs artificielles. Une rose en plastique ou en synthétique, c'est comme une lampe de chevet qui voudrait imiter le soleil. Auteur : Valérie Perrin - Source : Changer l'eau des fleurs (2019)
- Les actrices se croient généralement obligées, dès qu'elles jouent des personnages antiques ou mythologiques, de prendre des poses plastiques, hiératiques, de psalmodier comme des prêtresses. Elles veulent jouer aux vases grecs, et font les cruches.Auteur : Paul Léautaud - Source : Correspondance
- Pour moi, on peut parler de chef-d'oeuvre quand j'éprouve la sensation puissante et claire d'avoir vécu ou pensé ce que l'oeuvre je suis en train de lire, regarder ou écouter, exprime, qu'elle dit exactement la même chose que moi, mais au moyen d'une phrase meilleure, d'une composition plastique ou musicale plus belle que je n'aurais pu l'imaginer. Il m'arrive d'éprouver de manière fugace un sentiment de beauté et de bonheur. Si cela m'arrive en lisant un livre, c'est pour moi de la grande littérature, si cela se produit au cinéma, c'est pour moi du grand cinéma. Auteur : Krzysztof Kieslowski - Source : Le cinéma et moi (2006)
- L'oeuvre plastique, pour répondre à la nécessité de révision absolue des valeurs réelles sur laquelle aujourd'hui tous les esprits s'accordent, se réfèrera donc à un modèle purement intérieur ou ne sera pas.Auteur : André Breton - Source : Le Surréalisme et la Peinture (1928)
- La pulsion qui pousse quelqu’un à ornementer son visage et tout ce qui peut s'atteindre est le tout premier commencement des arts plastiques. C'est le balbutiement de la peinture.Auteur : Adolf Loos - Source : Ornement et Crime (1908)
- La partie physique de l'opération n'a pas de secret pour nous. Quand un chirurgien sculpte un beau visage, il utilise une sorte de plastique intelligent spécial pour remodeler les os. Pour qu'un jeune Pretty devienne grand ou ancien, il suffit d'ajouter un catalyseur chimique à ce plastique et il redevient mou comme de l'argile. Auteur : Scott Westerfeld - Source : Uglies (2005)
- On la tolère encore un peu, la forêt, pour la hacher en pâte à papier ou la laminer en simili-massif. Le jour où la civilisation n'aura plus besoin de papier ni de maquiller le plastique en faux bois, adieu le dernier arbre!Auteur : François Cavanna - Source : La belle fille sur le tas d'ordures (1991)
- La foi, l'amour et l'espérance sentirent dans un moment de calme et de mutuelle sympathie un instinct plastique qui les porta à créer une charmante statue, une Pandore dans un sens plus élevé : la patience.Auteur : Johann Wolfgang Goethe - Source : Maximes et réflexions (1833)
- De même, l'enfant est un ange; l'adulte le diabolise. Supprimez les tanks en plastique et les panoplies de parachutiste, le monde futur sera gentil comme une poupée.Auteur : Louis Pauwels - Source : La liberté guide mes pas: chroniques, 1981-1983 (1984)
- Mais qu'est-ce que c'est encore, M. Le Curé ? Déjà qu'on dit plus la messe en latin, c'est pas que vous allez mettre du plastique sur les murs, non ?Auteur : Pierre Christin - Source : Légendes d'aujourd'hui, Le Vaisseau de pierre (1976)
- Mais ces mots aussi sont une valise, une boîte noire, ils sont faits de plastique, compacts et verrouillés. La vérité est à l'intérieur, hors de portée. Mes souvenirs, eux, sont un château de sable assailli par les vagues d'un océan froid dont la surface change de couleur avec la lumière et les saisons.Auteur : Monica Sabolo - Source : La Vie clandestine (2022)
- C'est bien. J'ai votre confiance. Ça m'aide. Vous êtes des amis en plastique et des collègues en carton, je saurais même pas dans quelle poubelle vous recycler. Auteur : Olivier Norek - Source : Surtensions (2016)
- Combien reste impénétrable dans chaque destinée le noyau véritable de l'être, la cellule plastique d'où jaillit toute croissance!Auteur : Stefan Zweig - Source : La Confusion des sentiments (1927)
- Carte de crédit: Chacun des petits rectangles de plastique, dont l'ensemble constitue un jeu de société de consommation, aussi appelé jeu de cash-cash.Auteur : Albert Brie - Source : Le mot du silencieux, Dictionnaire du marginal
- Pour toutes les idées claires, il existe une pensée plastique qui les traduit.Auteur : Pierre Puvis de Chavannes - Source : Sans référence
- Parmi les différentes expressions de l'art plastique, l'eau-forte est celle qui se rapproche le plus de l'expression littéraire et qui est la mieux faite pour trahir l'homme spontané.Auteur : Charles Baudelaire - Source : Curiosités esthétiques (1868)
- Le coeur de Simon migre maintenant, il est en fuite sur les orbes, sur les rails, sur les routes, déplacé dans ce caisson dont la paroi plastique, légèrement grumeleuse, brille dans les faisceaux de lumière électrique, convoyé avec une attention inouïe, comme on convoyait autrefois les coeurs des princes, comme on convoyait leurs entrailles et leur squelette, la dépouille divisée pour être répartie, inhumée en basilique, en cathédrale, en abbaye, afin de garantir un droit à son lignage, des prières à son salut, un avenir à sa mémoire –on percevait le bruit des sabots depuis le creux des chemins, sur la terre battue des villages et le pavé des cités, leur frappe lente et souveraine, puis on distinguait les flammes des torches (…) mais l'obscurité ne permettait jamais de voir cet homme, ni le reliquaire posé sur un coussin de taffetas noir, et encore moins le coeur à l'intérieur, le membrum principalissimum, le roi du corps, puisque placé au centre de la poitrine comme le souverain en son royaume, comme le soleil dans le cosmos, ce coeur niché dans une gaze brochée d'or, ce coeur que l'on pleurait.Auteur : Maylis de Kerangal - Source : Réparer les vivants (2013)
- L'importance d'un artiste se mesure à la quantité de nouveaux signes qu'il aura introduits dans le langage plastique.Auteur : Louis Aragon - Source : Sans référence
- Dans les arts plastiques, c'est le sujet qui se charge de proposer; ce qui dispose, en fin de compte, c'est le tempérament de l'artiste.Auteur : Aldous Huxley - Source : Les portes de la perception (1954)
- Regarder, c'est être peintre. Souffrir, c'est être poète. De l'union de la plastique et de l'âme on peut faire naître le plus bel art vivant intégral: le théâtre.Auteur : Henry Bataille - Source : Sans référence
- Il y avait un bouton de sonnette avec un nom écrit au-dessous, sous un couvercle de matière plastique encrassé. J'ai lu le nom.Auteur : J. M. G. Le Clézio - Source : La Ronde et autres faits divers (1982)
- La pulsion qui pousse quelqu'un à ornementer son visage et tout ce qui peut s'atteindre est le tout premier commencement des arts plastiques. C'est le balbutiement de la peinture. Tout art est érotique.Auteur : Adolf Loos - Source : Ornement et Crime (1908)
- Chercher l'erreur: brancardier aux bras de fer, cardiologue aux nerfs d'acier, infirmière au coeur d'or, chirurgien plastique.Auteur : Patrick Sébastien - Source : Carnet de notes (2001)
Les mots proches de « plastique »
Placable Placage Placard Placarder Placardeur Place Placé, ée Placement Placenta Placer Placet Placet Placide Placidement Placidité Placoïdien, ienne Plafond Plafonnant, ante Plafonnement Plage Plagiaire Plagiat Plagié, ée Plagiocéphalie Plaid Plaid Plaidailler Plaider Plaiderie Plaideur, euse Plaidoirie Plaidoyable Plaidoyer Plaie Plaignant, ante Plain, aine Plain-chant Plaindre Plaine Plaint, ainte Plainte Plaintif, ive Plaintivement Plaire Plaisamment Plaisance Plaisant, ante Plaisanter Plaisanterie PlaisirLes mots débutant par pla Les mots débutant par pl
Pla Plabennec plaça placage placages plaçai plaçaient plaçais plaçait plaçant placard placardait placarde placardé placardée placardées placarder placardes placardés placardier placards plaçât place place placé placé Placé placebo placebos placée placée placées placées placement placements placent placenta placentaire placentas placer placer placera placerai placeraient placerais placerait placeras placèrent placerez placerons
Les synonymes de « plastique»
Les synonymes de plastique :- 1. flexible
2. souple
3. élastique
4. pliant
5. pliable
6. mou
7. malléable
8. docile
9. obéissant
10. ductile
11. morphologie
12. anatomie
13. corps
14. forme
15. sculpture
16. modèle
17. dynamite
18. sculptural
19. architectural
synonymes de plastique
Fréquence et usage du mot plastique dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « plastique » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot plastique dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Plastique ?
Citations plastique Citation sur plastique Poèmes plastique Proverbes plastique Rime avec plastique Définition de plastique
Définition de plastique présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot plastique sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot plastique notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 9 lettres.
