Définition de « prison »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot prison de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur prison pour aider à enrichir la compréhension du mot Prison et répondre à la question quelle est la définition de prison ?
Une définition simple :
Approchant : emprisonner, emprisonnement, prisonnier
Définitions de « prison »
Trésor de la Langue Française informatisé
PRISON, subst. fém.
Wiktionnaire
Nom commun 2 - ancien français
prison \Prononciation ?\ masculin
-
Prisonnier.
-
Li reis demande ses prisons
[...]
Davant sei les fait amener ? (Le Roman de Thèbes, édition de Constans, page 168, tome I) - Trente prisons ont envoié Pepin ? (Garin le Loherain, édition de P. Paris, page 277)
-
Li reis demande ses prisons
Nom commun 1 - ancien français
prison \Prononciation ?\ féminin
- Prison.
Nom commun - français
prison \p?i.z??\ féminin
-
Endroit clos où sont enfermés les personnes condamnées à une peine de privation de liberté ou les prévenus en attente de jugement.
- Une insulte faite au baylon (syndic) est punie d'une amende de dix écus, et même de la prison, à la diligence du viguier ; le délinquant ne sortait de prison que sur l'intervention du syndic. ? (Archives israélites de France?, T. 4, 1843, page 685)
- Nos terroristes du quinzième et du seizième siècle ont été des moines. Les prisons monastiques furent toujours les plus cruelles. ? (Jules Michelet, Du prêtre, de la femme, de la famille, 3e éd., Hachette & Paulin, 1845, Préface de la 3e édition, page XVII)
- Tout s'est modernisé, et il y a de tout, sauf des gendarmes et des prisons, car le crime est encore inconnu. ? (Jean-Baptiste Charcot, Dans la mer du Groenland, 1928)
- La plupart de ces messieurs que tu vois là, autour de nous, s'enorgueillissent de casiers judiciaires confortables? Ils sortent de prison ou vont y entrer. Ce sont les risques du métier, Mais le métier a du bon. ? (Victor Méric, Les Compagnons de l'Escopette, Éditions de l'Épi, Paris, 1930, pages 19-20)
- Il entre en prison pour vol de voiture et en sort pour bonne conduite. ? (Michel Beaudry, Le vélo tricolore, Le Journal de Montréal, 29 mai 2021)
-
(Par extension) Peine afflictive subie dans un tel lieu ; emprisonnement.
- Ces gens-là savent bien qu'ils sont exposés à des dommages-intérêts et même à la prison ; mais que leur importe ? ils ont changé d'habit, donné un faux nom et une fausse adresse et par-dessus tout ils sont insolvables. ? (Gabriel Maury, Des ruses employées dans le commerce des solipèdes, Jules Pailhès, 1877)
- Un travail conduit démocratiquement serait réglementé par des arrêtés, surveillé par une police et soumis à la sanction de tribunaux distribuant des amendes ou de la prison. ? (Georges Sorel, Réflexions sur la violence, Chap.VII, La morale des producteurs, 1908, page 347)
- Un jour, il « chroniqua » si fort que le Parquet lui réclama des comptes. Traduit en justice pour avoir injurié les « armées de terre et de mer » et prêché la guerre civile, il s'en tira avec deux mois de prison et quelques francs d'amende. ? (Victor Méric, Les Compagnons de l'Escopette, Éditions de l'Épi, Paris, 1930, pages 28-29)
-
(Figuré) Ce qui tient enfermé quelqu'un ou quelque chose.
- La chrysalide est sortie de sa prison pour se transformer en papillon.
-
(Figuré) (Par hyperbole) Lieu sombre et triste.
- Cette maison est une prison.
Littré
-
1Logis où l'on enferme ceux qu'on veut détenir.
Quel charme, quel désordre, ou quelle raillerie Des prisons de Lyon fait votre hôtellerie??
Corneille, Suite du Ment. I, 1.Vos pères [jésuites] le firent mettre en prison [un domestique]
, Pascal, Prov. VI.[Elle] Hante les hôpitaux, visite les prisons
, Boileau, Sat. X.J'ai vu ce matin M. de Meaux, bien convaincu qu'il faut laisser Mme Guyon en prison
, Maintenon, Lett. au card. de Noailles, 21 mai 1701.Il vous tiendrait en prison
, Fénelon, Tél. III.Lorsque les vents, méditant le ravage, Pour forcer leur prison réunissent leur rage
, Racine L. dans GIRAULT-DUVIVIER.D'une prison sur moi les murs pèsent en vain?; J'ai les ailes de l'espérance
, Chénier, Jeune captive.Hélas?! dans la prison, triste s?ur de la tombe, Ta main vient soutenir le malheur qui succombe
, Delille, Pit. II.?Convient-il qu'au fond d'une prison Je contemple le deuil de ma propre maison??
P. Lebrun, Marie St. II, 4.Fig.
Ma cour fut ta prison, mes faveurs tes liens
, Corneille, Cinna, v, 1.Et ne savez-vous pas que de cette maison Pour Camille et pour moi l'on fait une prison??
Corneille, Hor. III, 2.Fig. Cette maison est une vraie prison, elle est sombre et triste.
Aimable, gracieux comme une porte de prison, se dit de quelqu'un dur et brutal.
Fig. La prison de Saint-Crépin, soulier étroit qui blesse le pied (saint Crépin est le patron des cordonniers).
-
2Emprisonnement. Il a été condamné à deux ans de prison.
De là vient [du besoin de distraction] que la prison est un supplice si horrible
, Pascal, Pens. IV, 2, éd. HAVET.Il disait, en parlant de cette prison malheureuse, qu'il y était entré le plus innocent de tous les hommes, et qu'il en était sorti le plus coupable
, Bossuet, Louis de Bourbon.La prison, sans aucun commerce avec les hommes, est un supplice inventé par les tyrans
, Voltaire, M?urs, 146. -
3Captivité.
Ce fut dans ce voyage et durant sa prison Qu'il étreignit le n?ud de cette trahison
, Mairet, Soliman, II, 7.Contraint de racheter sa liberté après une longue prison, durant les guerres d'Allemagne
, Fléchier, Duc de Mont. -
4 Fig. Ce qui renferme, enclôt.
Vastes cieux, prisons éclatantes, Qui renfermez les airs, et la terre et les eaux
, Corneille, Trad du ps. 148.Dans sa verte prison la figue recueillie
, Chénedollé, dans GIRAULTDUVIVIER.Par quel rapide essor la sublime pensée Des prisons du cerveau tout à coup élancée, Suit-elle dans leurs cours ces vastes tourbillons??
Lebrun, dans GIRAULT-DUVIVIER.Et toi, lampe nocturne, ?ô toi qui jusqu'au jour De ta prison de verre éclairais nos tendresses
, Chénier, Élégies, 37.Viens donc, viens détacher mes chaînes corporelles, Viens, ouvre ma prison, viens, prête-moi tes ailes
, Lamartine, Médit. V.Borne, limite.
Maudit soit le premier dont la verve insensée Dans les bornes d'un vers renferma sa pensée, Et, donnant à ses mots une étroite prison, Voulut avec la rime enchaîner la raison?!
Boileau, Sat. II.Celui qui, franchissant l'étroite prison de l'intérêt personnel et des petites passions terrestres
, Rousseau, 2e dial. -
5Dans le langage de la galanterie, service amoureux auprès d'une dame.
Je voulus être sien?; j'entrai dans sa prison, Et de tout mon pouvoir essayai de lui plaire, Tant que ma servitude espéra du salaire
, Malherbe, VI, 32.Ils ne savent jamais que se charger de chaînes, Que bénir leur martyre, adorer leur prison
, Boileau, Art p. II. - 6 Terme d'alchimie. Prison des sages, fourneau philosophique.
PROVERBES
Le corps est la prison de l'âme.
Il n'y a point de belle prison ni de laides amours.
HISTORIQUE
XIe s. E Bramidone qu'il mene en sa prisun
, Ch. de Rol. CCLXIX.
XIIe s. Debonaire prison Avez doné [à] mon fin cuer qui vous prie
, Couci, II. Et jà de sa prison [de ma dame] [je] Ne quier issir, se mors ou amés non
, ib. IX. Al jugement en vunt la maisnie Nerun, Lur pere esperital jugent comme bricun, Que li reis le presist e mesist en prisun
, Th. le mart. 44.
XIIIe s. En tele maniere que dedens les quinze jors il paiast ou il revenist en le [la] prison, sor paine de prison brisie
, Beaumanoir, XXX, 26.
XVe s. Et enconvenança [promit] sur sa loyauté de venir dedans trois jours tenir prison à Valenciennes
, Froissart, I, I, 110. Si fut enclos de ses ennemis par trop demeurer derriere, et fiança prison, et aussi deux escuyers
, Froissart, I, I, 139. Si fut messire Jehan Bucq mis en prison courtoise à Londres?; il pouvoit aller et venir parmy la ville?; mais dès souleil couchant il convenoit qu'il fust à l'hostel
, Froissart, liv. III, p. 167, dans LACURNE.
XVIe s. Caesar, ayant une fois esté surpris par les coursaires en Asie, et estant par eulx detenu prisonnier, s'escria tout hault?: quel plaisir tu auras, Crassus, quand tu entendras ma prison?!
Amyot, Crassus, 12. Et se l'appelleur donne bons pleges, qui le prennent en garde et le rendent au jour qui est assigné, ou mort ou vif, il leur pourra bien estre baillié à garder?; et ce appelle l'en vive prison au duc de Normendie
, Du Cange, prisonia.
Encyclopédie, 1re édition
PRISON, (Hist. mod.) on appelle ainsi le lieu destiné à enfermer les coupables, ou prévenus de quelque crime.
Ces lieux ont probablement toujours été en usage depuis l'origine des villes, pour maintenir le ben ordre, & renfermer ceux qui l'avoient troublé. On n'en trouve point de traces dans l'Ecriture avant l'endroit de la Genèse où il est dit que Joseph fut mis en prison, quoiqu'innocent du crime dont l'avoit accusé la femme de Putiphar. Mais il en est fréquemment parlé dans les autres livres de la Bible, & dans, les écrits des Grecs & des Romains. Il paroît par les uns & les autres que les prisons étoient composées de pieces ou d'appartemens plus ou moins affreux, les prisonniers n'étant quelquefois gardés que dans un simple vestibule, où ils avoient la liberté de voir leurs parens, leurs amis, comme il paroît par l'histoire de Socrate. Quelquefois, & selon la qualité des crimes, ils étoient renfermés dans des souterrains obscurs, & dans des basses fosses, humides & infectes, témoin celle où l'on fit descendre Jugurtha, au rapport de Sallaste. La plupart des exécutions se faisoient dans la prison, sur-tout pour ceux qui étoient condamnés à être étranglés, ou à boire la ciguë.
Eutrope attribue l'établissement des prisons à Rome, à Tarquin le superbe ; tous les auteurs le rapportent à Ancus Martius, & disent que Tullus y ajouta un cachot qu'on appella long-tems Tullianum. Au reste Juvenal témoigne qu'il n'y eut sous les rois & les tribuns, qu'une prison à Rome. Sous Tibere on en construisit une nouvelle, qu'on nomma la prison de Mamertin. Les Actes des apôtres, ceux des martyrs, & toute l'histoire ecclésiastique des premiers siecles, font foi qu'il n'y avoit presque point de ville dans l'Empire qui n'eût dans son enceinte une prison ; & les Jurisconsultes en parlent souvent dans leurs interprétations des lois. On croit pourtant que par mala mansio, qui se trouve dans Ulpien, on ne doit pas entendre la prison, mais la préparation à la question, ou quelqu'autre supplice de ce genre, usité pour tirer des accusés l'aveu de leur crime, ou de leurs complices.
Les lieux connus sous le nom de lautumiæ, & de lapidicinæ, que quelques-uns ont pris pour les mines auxquelles on condamnoit certains criminels, n'étoient rien moins que des mines, mais de véritables prisons, ou souterrains creusés dans le roc, ou de vastes carrieres dont on bouchoit exactement toutes les issues. On met pourtant cette différence entre ces deux especes de prisons, que ceux qui étoient renfermés dans les premieres n'étoient point attachés, & pouvoient y aller & venir ; au lieu que dans les autres on étoit enchaîné & chargé de fers.
On trouve dans les lois romaines différens officiers commis soit à la garde, soit à l'inspection des prisons & des prisonniers. Ceux qu'on appelloit commentarii avoient soin de tenir registre des dépenses faites pour la prison dont on leur commettoit le soin ; de l'âge, du nombre de leurs prisonniers, de la qualité du crime dont ils étoient accusés, du rang qu'ils tenoient dans la prison. Il y avoit des prisons qu'on appelloit libres, parce que les prisonniers n'étoient point enfermés, mais seulement commis à la garde d'un magistrat, d'un sénateur, &c. ou arrêtés dans une maison particuliere, ou laissés à leur propre garde dans leur maison, avec défense d'en sortir. Quoique par les lois de Trajan & des Antonins les prisons domestiques, ou ce que nous appellons chartres privées, fussent défendues, il étoit cependant permis en certains cas, à un pere de tenir en prison chez lui un fils incorrigible, à un mari d'infliger la même peine à sa femme, à plus forte raison un maître avoit-il ce droit sur ses esclaves : le lieu où l'on mettoit ceux-ci s'appelloit ergastulum.
L'usage d'emprisonner les ecclésiastiques coupables, est beaucoup plus récent que tout ce qu'on vient de dire ; & quand on a commencé à exercer contre eux cette sevérité, ç'a moins été pour les punir, que pour leur donner des moyens de faire pénitence. On appelloit les lieux où on les renfermoit à cette intention, decanica, qu'on a mal-à-propos confondu avec diaconum. Voyez Diaconie. Ils sont aussi de beaucoup antérieurs au tems du pape Eugene II. auquel le jurisconsulte Duaren en attribue l'invention. Long-tems avant ce pontife on usoit de rigueur contre ceux du clergé qui avoient violé les canons dans des points essentiels ; mais après tout, cette rigueur étoit tempérée de charité ; ce n'étoit ni la mort, ni le sang du coupable qu'on exigeoit, mais sa conversion & son retour à la vertu.
C'est ce qui fait que dans l'antiquité on a blâmé les prisons des monasteres, parce qu'il arrivoit qu'on y portoit souvent les châtimens au-delà des justes bornes d'une sévérité prudente. La regle de S. Benoit ne parle point de prison ; elle excommunie seulement les religieux incorrigibles ou scandaleux, c'est-à-dire qu'elle veut qu'ils demeurent séparés du reste de la communauté ; mais non pas si absolument privés de tout commerce, que les plus anciens & les plus sages ne doivent les visiter pour les exhorter à rentrer dans leur devoir, & enfin que s'il n'y a point d'espérance d'amendement, on les chasse hors du monastere. Mais on ne garda pas par-tout cette modération ; des abbés non contens de renfermer leurs religieux dans d'affreuses prisons, les faisoient mutiler, ou leur faisoient crever les yeux. Charlemagne par ses capitulaires, & le concile de Francfort en 785, condamnerent ces excès par rapport à l'abbave de Fuldes. C'est ce qui fit qu'en 817, tous les abbés de l'ordre, assemblés à Aix-la-Chapelle, statuerent que dorenavant dans chaque monastere, il y auroit un logis séparé pour les coupables, consistant en une chambre à feu, & une antichambre pour le travail ; ce qui prouve que c'étoit moins une prison qu'une retraite. Le concile de Verneuil en 844, ordonna la prison pour les moines incorrigibles & fugitifs. On imagina une espece de prison affreuse, où l'on ne voyoit point le jour ; & comme ceux qu'on y renfermoit devoient ordinairement y finir leur vie, on l'appella pour ce sujet, vade in pace. Pierre le vénérable, dit que Matthieu, prieur de S. Martin des Champs à Paris, fit construire un souterrain en forme de sépulcre, où il renferma de la sorte un religieux incorrigible : son exemple trouva des imitateurs. Ceux qu'on mettoit dans ces sortes de prisons y étoient au pain & à l'eau, privés de tout commerce avec leurs confreres, & de toute consolation humaine ; en sorte qu'ils mouroient presque tous dans la rage & le désespoir. Le roi Jean à qui on en porta des plaintes, ordonna que les supérieurs visiteroient ces prisonniers deux fois par mois, & donneroient outre cela permission à deux religieux, à leur choix, de les aller voir, & fit expédier à cet effet des lettres patentes, dont il commit l'exécution au sénéchal de Toulouse, & aux autres sénéchaux de Languedoc où il étoit alors. Les Mineurs & les Freres Prêcheurs murmurerent, reclamerent l'autorité du pape ; mais le roi ne leur ayant laissé que l'alternative d'obéir ou de sortir du royaume, ils affecterent le parti de la soumission. Ce qui n'empêche pas que dans certains ordres il n'y ait toujours eu des prisons monastiques très-rigoureuses, qui ont conservé le nom de vade in pace.
Comme les évêques ont une jurisdiction contentieuse, & une cour de justice qu'on nomme officialité, ils ont aussi des prisons de l'officalité pour renfermer les ecclésiastiques coupables, ou prévenus de crimes. Parmi les prisons séculieres on peut en distinguer de plusieurs sortes. Celles qui sont destinées à renfermer les gens arrêtés pour dettes, comme le Fort-l'Evêque à Paris ; celles où l'on tient les malfaiteurs atteints de crimes de vol & d'assassinat, telles que la Conciergerie, la Tournelle, le grand & le petit Châtelet à Paris, Newgate à Londres, &c. les prisons d'état, comme la Bastille, Vincennes, Pierre Encise, le château des sept Tours à Constantinople, la Tour de Londres ; les prisons perpétuelles, comme les îles de sainte Marguerite ; & enfin les maisons de force, comme Bicêtre, Charenton, S. Lazare : ces dernieres ont pour chefs des directeurs ou supérieurs. Les prisons pour criminels d'état ont des gouverneurs, & les premieres ont des concierges ou geoliers, aussi les appelle-t-on dans plusieurs endroits, la Geole & la Conciergerie. Dans presque toutes les prisons il y a une espece de cour ou esplanade, qu'on nomme préau ou préhaut, dans laquelle on laisse les prisonniers prendre l'air sous la conduite de leurs geoliers, guichetiers & autres gardes. Tiré du supplém. de Moreri, tom. II. avec quelques additions.
Prison, (Jurisprud.) on peut être emprisonné pour dette en vertu d'un jugement portant contrainte par corps, ou bien en vertu d'un decret de prise de corps pour crime, ou bien en vertu d'un ordre du roi pour quelque raison d'état.
On peut aussi être retenu en prison après un jugement interlocutoire pendant le délai qui est ordonné pour informer plus amplement, ou même après un jugement définitif par forme de peine ; mais quand un criminel est condamné à une prison perpétuelle, cette peine ne s'exécute pas dans les prisons ordinaires, on transfere le criminel dans quelque maison de force où il est également tenu prisonnier.
La prison même pour crime n'ôte pas les droits de cité, ainsi un prisonnier peut faire tous actes entrevifs & à cause de mort ; on observe seulement que le prisonnier soit entre les deux guichets lorsqu'il passe l'acte, pour dire qu'il a été fait avec liberté.
Mais celui qui est prisonnier pour crime, dont il peut résulter des réparations civiles & la peine de confiscation, ne peut faire aucune disposition en fraude des droits qui sont acquis sur ses biens.
Quand l'accusé est condamné par le juge séculier à une prison perpétuelle, il perd la liberté & les droits de cité, & conséquemment il est réputé mort civilement ; mais si la condamnation à une prison perpétuelle est émanée du juge d'église, elle n'emporte pas mort civile.
Il y a trois sortes de prisons ; savoir, les prisons royales, celles des seigneurs, & les prisons des officialités.
Il est défendu à toutes personnes de tenir quelqu'un en chartre privée, & aux seigneurs justiciers, d'avoir des prisons dans leurs châteaux, & cela pour empêcher l'abus qu'ils en pourroient faire.
L'ordonnance d'Orléans leur enjoint d'avoir des prisons sûres & qui ne soient pas plus basses que le rez-de-chaussée, ils doivent aussi entretenir un geolier qui y réside ; & si faute de ce, les prisonniers s'échappent, ils en sont responsables, tant au civil, qu'au criminel.
On voit par les anciennes ordonnances, que les habitans de certains pays avoient autrefois des privileges pour n'être pas emprisonnés ; par exemple, on ne pouvoit pas arrêter prisonniers les habitans de Nevers, s'ils avoient dans la ville ou dans le territoire des biens suffisans pour payer ce à quoi ils pouvoient être condamnés ; & au cas qu'ils n'en eussent pas, en donnant des ôtages ; ils pouvoient cependant être constitués prisonniers dans le cas de vol, de rapt, & d'homicide, lorsqu'ils étoient pris sur le fait, ou qu'il se présentoit quelqu'un qui s'engageoit à prouver qu'ils avoient commis ces crimes.
On ne pouvoit pas non plus mettre en prison un habitant de la ville de Saint-Géniez, en Languedoc, pour des délits légers, s'il donnoit caution de payer ce à quoi il seroit condamné.
De même à Villefranche en Périgord, on ne pouvoit pas arrêter un habitant, ni saisir ses biens, s'il donnoit caution de se présenter en justice, à moins qu'il n'eût fait un meurtre ou une plaie mortelle, ou commis d'autres crimes, emportant confiscation de corps & de biens.
Les habitans de Boiscommun & ceux de Chagny, jouissoient du même privilege.
Les Castillans commerçant dans le royaume, ne pouvoient être mis en prison avant d'avoir été menés devant le juge ordinaire.
Celui qui n'avoit pas le moyen de payer une amende étoit condamné à une prison équipollente à cette amende.
Les prisonniers du châtelet de Paris devoient avoir une certaine quantité de pain, de vin & de viande le jour de la fête de la confrairie des drapiers de Paris, & les gentilshommes devoient avoir le double.
Les orfevres de Paris donnoient aussi à dîner le jour de Pâque aux prisonniers qui vouloient l'accepter.
Une partie des marchandises de rôtisserie qui étoient confisquées, étoit donnée aux pauvres prisonniers du châtelet.
Les privileges accordés par le roi Jean, à la ville d'Aigues-Mortes en 1350, portent que les femmes prisonnieres seront séparées des hommes, & qu'elles seront gardées par des femmes sûres.
Le surplus de ce qui concerne les prisons & les prisonniers, se trouve expliqué aux mots Contrainte par corps, Dette & Élargissement, {Emprisonnement. Voyez aussi le tit. 13. de l'ordonnance de 1670. Bornier, ibid. & la déclaration du 6 Janvier 1680. (A)
Prison des vents, (Architect.) ou pour le dire plus noblement, palais d'Eole ; c'est un lieu souterrein, comme une carriere, où les vents frais étant conservés, se communiquent par des conduites ou voûtes souterreines, appellées en italien ventidotti, dans les salles pour les rendre fraîches pendant l'été. Voyez l'Architecture de Palladio, l. I. c. 27. (D. J.)
Étymologie de « prison »
- (Date à préciser) Du moyen français prison[1], de l'ancien français prisun ou prison[1], eux-même du latin prehensio[1]. Le sens (3) « ce qui entrave » est attesté vers (1380) dans des textes de Corneille[1].
Wallon, prihon?; prov. preisô?; espagn. prision?; ital. prigione?; du lat. prehensionem, prise, de prehendere (voy. PRENDRE). À côté de prison, féminin, il y avait aussi prison, masculin, signifiant prisonnier.
prison au Scrabble
Le mot prison vaut 8 points au Scrabble.
Informations sur le mot prison - 6 lettres, 2 voyelles, 4 consonnes, 6 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot prison au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
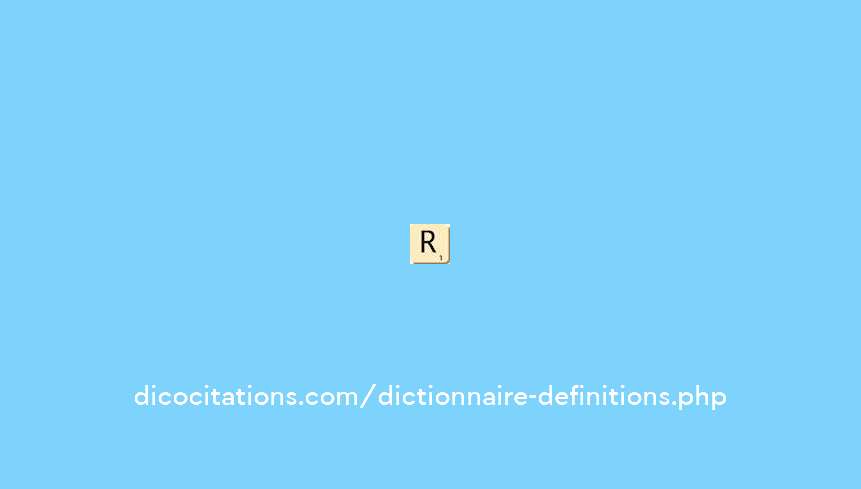
Les rimes de « prison »
On recherche une rime en Z§ .
Les rimes de prison peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en z§
Rimes de fenaison Rimes de antipoisons Rimes de puisons Rimes de raisons Rimes de osons Rimes de badigeon Rimes de salaison Rimes de convergeons Rimes de flottaison Rimes de venaisons Rimes de jugeons Rimes de pigeons Rimes de téléchargeons Rimes de feuillaison Rimes de causons Rimes de saccageons Rimes de blouson Rimes de rédigeons Rimes de diffusons Rimes de livraisons Rimes de prisons Rimes de badigeons Rimes de insurgeons Rimes de pigeons Rimes de détruisons Rimes de interdisons Rimes de zonzon Rimes de infligeons Rimes de esturgeon Rimes de échangeons Rimes de tison Rimes de hébergeons Rimes de mobilisons Rimes de frison Rimes de arrière-saison Rimes de oison Rimes de reposons Rimes de réduisons Rimes de combinaison Rimes de bourgeon Rimes de divergeons Rimes de démangeaison Rimes de capitalisons Rimes de flottaisons Rimes de bougeons Rimes de défloraison Rimes de immergeons Rimes de garnisons Rimes de livraison Rimes de interrogeonsMots du jour
fenaison antipoisons puisons raisons osons badigeon salaison convergeons flottaison venaisons jugeons pigeons téléchargeons feuillaison causons saccageons blouson rédigeons diffusons livraisons prisons badigeons insurgeons pigeons détruisons interdisons zonzon infligeons esturgeon échangeons tison hébergeons mobilisons frison arrière-saison oison reposons réduisons combinaison bourgeon divergeons démangeaison capitalisons flottaisons bougeons défloraison immergeons garnisons livraison interrogeons
Les citations sur « prison »
- Nelson Mandela a été un symbole très important. Je suis de cette génération qui a grandi sans savoir à quoi il ressemblait. En 1986, j'avais écrit pour Mandela une chanson, « Asimbonanga », qui signifie en zoulou « nous ne l'avons pas vu ». A l'époque, nous savions qu'il était emprisonné sur Robben Island, mais comme nous n'étions pas autorisés à avoir un portrait de lui, c'était pour nous un symbole sans visage, une étoile qui brillait dans notre ciel.Auteur : Johnny Clegg - Source : Interview de Johnny Clegg au « Nouvel Observateur », avril 2013.
- Mme Guigou annonce qu'elle va fermer certaines prisons! C'est vrai qu'il vaut mieux les fermer, parce que si on les laisse ouvertes, ça ne sert pas à grand-chose...Auteur : Laurent Ruquier - Source : Vu à la radio (2001)
- Quelle sorcière qu'une jolie femme! Le vrai nom de l'amour, c'est captivité. On est fait prisonnier par l'âme d'une femme. Par sa chair aussi. Quelquefois plus encore par la chair que par l'âme. L'âme est l'amante; la chair est la maîtresse.Auteur : Victor Hugo - Source : L'Homme qui rit (1869)
- Mal de Saint-Médard: emprisonnement.Auteur : Saints et Maladies - Source : Sans référence
- Je pressentais, je devinais une partie de cette réalité : la prison n’est pas faite pour protéger la société de certains individus en les privant de liberté, elle est faite pour les détruire, les anéantir, les supprimer, avec le consentement, plus ou moins avoué, d’une très grande majorité de la population. Dans la peine qui m’a été infligée, c’était bien ma mort politique, médiatique et sociale qui était recherchée. Eh bien, c’est perdu ! Tant pis. Je vis. Auteur : Bernard Tapie - Source : Librement (1998)
- Les livres sont la plus forte contradiction des barreaux. Ils ouvrent le plafond de la cellule du prisonnier allongé sur son lit.Auteur : Erri De Luca - Source : Les poissons ne ferment pas les yeux (2013)
- En prison, la naïveté n'a pas droit de cité.Auteur : Victor Del Arbol - Source : La Maison des chagrins (2013)
- Le pire des malheurs en prison, c'est de ne pouvoir fermer sa porte.Auteur : Henri Beyle, dit Stendhal - Source : Le Rouge et le Noir (1830)
- La maison familiale est une prison pour les jeunes filles et une maison de correction pour les femmes.Auteur : George Bernard Shaw - Source : Sans référence
- Mon corps est prisonnier mais mon esprit est libre.Auteur : Catel Muller, dite Catel - Source : Olympe de Gouges (2012)
- Méchant ! s'exclama La Force en s'adressant au prisonnier. Tu croyais bien avoir tué le roi, mais il n'est pas mort ! - Si fait, répondit l'autre, il l'est, et s'il ne l'était pas, je le tuerais encore.Auteur : Jean-Christian Petitfils - Source : L'assassinat d'Henri IV. Mystères d'un crime (2009)
- C'est une Anglaise dont le mari, estampeur de premier ordre, s'est fait pincer l'an dernier pour une escroquerie colossale et a été mis en prison pour plusieurs années.Auteur : Georges Darien - Source : Le Voleur (1897)
- L'homme le plus inquiet d'une prison est le directeur.Auteur : George Bernard Shaw - Source : Bréviaire du révolutionnaire (1929)
- La prison n'est pas fondée sur un système d'entraide ou de solidarité. C'est un monde où les intérêts personnels cohabitent, sans se mêler. A l'occasion, ils peuvent s'accorder sur un objectif commun, mais la règle est de ne jamais sortir de son propre cercle d'existence. Une logique de rats, où l'intelligence ne s'applique qu'à sa survie immédiateAuteur : Jean-Christophe Grangé - Source : La Ligne noire
- Si un prisonnier veut libérer ses compagnons d'infortune, il faut d'abord qu'il brise ses propres chaînes.Auteur : Jean-François Ricard, dit Jean-François Revel - Source : Le Moine et le Philosophe (1997)
- La prison est l’école de la délinquance, du crime et de la récidive. Pour celui qui est allé en prison, l’emploi, le logement, la formation, deviennent interdits. La prison ne prépare aucune réinsertion, elle veille méticuleusement à l’interdire. Il n’y a pas de système répressif collectif parfait, mais je sais qu’on a choisi le plus mauvais, que la prison ne répond à aucun de ses objectifs affichés, et que, dans sa pratique quotidienne, elle est une véritable honte pour le pays des droits de l’homme. Auteur : Bernard Tapie - Source : Librement (1998)
- Le dolorisme a beau se délecter dans les tortures, il reste dérisoirement prisonnier de l'hédonisme.Auteur : Vladimir Jankélévitch - Source : L'Austérité et la Vie morale (1956)
- Sous un gouvernement qui emprisonne injustement, la place de l'homme juste est aussi en prison.Auteur : Henry David Thoreau - Source : La Désobéissance civile (1862)
- Ouvrir une école c'est fermer une prison.Auteur : Félix Guillaume Marie Bogaerts - Source : Pensées et Maximes
- Dans une société juste, les prisons n'existeraient plus. C'est un suicide pour la société que de créer des monstres pour ensuite les relâcher dans le monde. Auteur : George Jackson - Source : Les Frères de Soledad
- Nous prisons mieux et plus l'oeuf qu'on nous refuse que le boeuf qu'on nous donne.Auteur : Jean Antoine Petit, dit John Petit-Senn - Source : Bluettes et boutades (1846)
- La liberté se lève à sept heures dans toutes les prisons de France.Auteur : Michel Audiard - Source : Mélodie en Sous-Sol (1963) d'Henri Verneuil
- Nommez une prison immense à insécurité maximum... la Terre.Auteur : Félix Leclerc - Source : Sans référence
- Quelques jours avant, il avait capturé, à l'aide de trappes, un couple de buffles sauvages, qu'il retenait prisonniers avec de fortes lianes enroulées autour de leurs cornes et fixées à un tronc d'arbre.Auteur : Raymond Roussel - Source : Impressions d'Afrique (1910)
- Les porcs ont le droit d'être des porcs. Une société qui met ces créatures en prison aux seuls motifs qu'ils ont des goûts propres à leur espèce n'est pas une société libre et juste.Auteur : Marcela Iacub - Source : Belle et Bête (2013)
Les mots proches de « prison »
Priant, ante Priape Prié, ée Prie-dieu Prier Prier-dieu Prière Prieur Prieural, ale Prieure Prieuré Primaire Primat Primatial, ale Primatie Primauté Prime Prime Prime Prime Prime Primé, ée Primefeuille Primefleur Primer Primerole Primerose Prime-sautier, ière Primeur Primevère Primitif, ive Primitivement Primogéniture Primordial, ale Prince Princerie Princesse Principal, ale Principal Principalement Principalité Principat Principauté Principe Principion Princiser Printanier, ière Printemps Priori (à) PriorissaleLes mots débutant par pri Les mots débutant par pr
pria priai priaient Priaires priais priait priâmes priant priant priant priapique priapiques priapisme priasse priât Priay prie prié prie-dieu priée priées prient prier priera prierai prieraient prierais prierait prieras prière prièrent prières prierez prierons prieront pries priés prieur prieur prieure prieuré prieurés prieurs priez Priez Prignac Prignac-en-Médoc Prignac-et-Marcamps Prigonrieux priions
Les synonymes de « prison»
Les synonymes de prison :- 1. ergastule
2. cachot
3. caveau
4. geôle
5. pénitencier
6. bagne
7. chiourme
8. détention
9. cellule
10. forteresse
11. centrale
synonymes de prison
Fréquence et usage du mot prison dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « prison » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot prison dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Prison ?
Citations prison Citation sur prison Poèmes prison Proverbes prison Rime avec prison Définition de prison
Définition de prison présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot prison sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot prison notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 6 lettres.
