Définition de « canard »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot canard de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur canard pour aider à enrichir la compréhension du mot Canard et répondre à la question quelle est la définition de canard ?
Une définition simple : (fr-rég|ka.na?)
Définitions de « canard »
Trésor de la Langue Française informatisé
CANARD, subst. masc. et adj.
Wiktionnaire
Nom commun - français
canard \ka.na?\ masculin (pour une femelle, on dit : cane)
-
Oiseau aquatique palmipède dont la chair est très recherchée, qu'il vive à l'état sauvage ou à l'état domestique.
-
Es tu venu pour cy faire voler
Sacre, faucon, ou éprevier en l'air?
Pour joindre & prendre héron, canard, ou pie?
Plutôt prendrais a ton nez la roupie. ? (L'épistre de M. Malingre envoyée à Clément Marot, en laquelle est demandée la cause de son département de France, avec la responce dudit Marot..., Harlem, Paris, 1546) - [?], après une autre étape de quatre heures, atteignons Souk El-Arbâ (le marché du mercredi), dans un cirque rocheux où les pluies ont formé de nombreux étangs regorgeant d'oiseaux aquatiques : canards, poules d'eau, bécassines, hérons, etc. ? (FrédéricWeisgerber, Trois mois de campagne au Maroc : étude géographique de la région parcourue, Paris : Ernest Leroux, 1904, page 152)
- Le canard de Rouen est des plus recommandables par sa taille, sa rusticité, sa précocité et son aptitude à l'engraissement. ? (L'Élevage des Canards, dans Almanach de l'Agriculteur français - 1932, éditions La Terre nationale, page 106)
- Je songe à la définition de Victor Hugo : « Le canard est un cochon à plumes. » Il ne savait pas si bien dire. Car leurs ébats sexuels ont de quoi faire rougir le témoin le moins porté sur la pudibonderie. Rien n'égale leur priapisme. ? (Michel Tournier, Journal extime, 2002, Gallimard, collection Folio, page 53)
-
Es tu venu pour cy faire voler
-
Nouvelle fausse, bobard.
- Ce serait être incomplet que de ne pas faire observer ici que Gaspard Hauser n'a jamais existé, pas plus que Clara Wendel et le brigand Schubry. Paris, la France et l'Europe ont cru à ces canards. Napoléon a pensionné un homme qui, pendant cinq ans, a publié dans le Moniteur de faux bulletins de la guerre des Affgans contre les Anglais. ? (Honoré de Balzac, « Monographie de la Presse parisienne », dans La grande ville nouveau tableau de Paris comique, critique et philosophique, Paris : chez Maresq, 1844, page 146)
- Les quatre vers ci-dessus paraîtraient en effet justifier assez bien cette remarque. Canard, dans le sens de mensonge, serait-il donc une importation champenoise ? Ce qui m'empêche de le croire, c'est que, bien avant Boursault, deux auteurs qui n'étaient pas Champenois, François d'Amboise, dans ses Néapolitaines (1584), et Adrien de Montluc, dans sa comédie des Proverbes (1616), employaient déjà l'expression de bailler un canard à moitié, donneur de canard à moitié, pour tromper, trompeur. J'avoue que ce demi-canard me paraît encore moins clair que le canard tout entier. Car les raisons ne manquent pas tout à fait pour expliquer que canard ait pris l'acception de mensonge. ? (O. D., « Canard », dans L'Intermédiaire des chercheurs et curieux, n° 131, du 25 juin 1870, page 358)
- Dans mes deux discours, je glisse ce canard : l'empereur Dioclétien avait conçu pour son esclave Sébastien une amitié passionnée, et il aurait voulu lui faire jouer le rôle qui avait été celui d'Antinoüs auprès de son prédécesseur Hadrien. Il connaissait leur aventure par les mémoires de la confidente d'Hadrien, Margarita Yourcenaria, qui était son livre de chevet. À Paris quelques sourires accueillent mon histoire. À Francfort personne ne bronche. ? (Michel Tournier, Journal extime, 2002, Gallimard, collection Folio, page 50)
-
(Familier) Journal d'actualité de peu de valeur.
- ? Tâche à présent, si qu'tu écris des articles sur ici, d'pas oublier d'marquer dans ton canard qu'un bal au jour d'aujourd'hui n'est plus miteux comme autrefois. ? (Francis Carco, Images cachées, Éditions Albin Michel, Paris, 1928)
- La Victoire affirmée, Fagerolle [?] pensait pouvoir, sans effort, réoccuper son rang. Il dégota, péniblement, une place de sous-reporter, dans un canard impécunieux du matin. ? (Victor Méric, Les Compagnons de l'Escopette, Éditions de l'Épi, Paris, 1930)
-
(Argot) Homme mené à la baguette qui cède à tous les caprices d'une femme et qui fuit toute confrontation.
- Ce mec est une vraie serpillière, j'ai rarement rencontré un canard pareil ! En tout cas, on sait qui porte le caleçon au sein du couple ; c'est elle évidemment.
-
(Argot) (Par extension) Homme sortant le grand jeu, offrant énormément de choses gracieusement dans l'espoir d'entamer une relation avec une femme.
- L'un des avantages d'une meuf en boîte c'est qu'elle a juste à se trouver un canard en manque et lui vendre du rêve pour avoir les consos gratuites.
- Sébastien, il faut l'avoir à l'?il, car il s'empresse à faire le canard pour n'importe quels beaux yeux.
-
Morceau de sucre que l'on trempe dans un liquide, en particulier dans du café ou une eau-de-vie, avant de le manger.
- [?], il n'en va pas de même avec l'alcool. Il arrive même que la première rencontre se situe dès 4 ou 5 ans sous forme d'un « canard » (sucre trempé dans un alcool fort), du cidre, une gorgée de champagne lors d'un mariage, etc. ? (O. Phan, « Les alcoolisations aiguës à l'adolescence : le phénomène du binge drinking », chapitre 8 de Alcool et troubles mentaux: De la compréhension à la prise en charge du trouble diagnostic, coordonné par Amine Benyamina, Michel Reynaud & Henri-Jean Aubin, éditions Elsevier-Masson, 2013, page 75)
-
(Familier) (Musique) Fausse-note aiguë produite par un instrument à vent, le plus souvent à anche. (Voir aussi couac).
- Personne n'a entendu le canard du hautboïste car au même moment, un spectateur éternuait.
-
(Industrie minière) Conduit d'aérage des galeries de mines.
- Pour l'aérage, l'air arrive dans un royon ou compartiment en briques situé dans le bouveau du Nord, monte dans le touret par les canards, puis de là redescend par le compartiment des hourds dans le bouveau du Nord , et enfin remonte au jour par le puits n° 7 muni d'un foyer d'appel. ? (Henri Glépin, Note sur le creusement sous stot des puits de mines, Revue Universelle des Mines, de la Métallurgie, des Travaux Publics, des Sciences et des Arts appliqués à l'industrie, Pais & Liège, 1872, volume 31, page 9)
- Verre ergonomique permettant de boire sans en renverser.
-
(Héraldique) Meuble représentant l'animal du même nom dans les armoiries. Il est normalement représenté de profil mais souvent, il est présenté volant. À rapprocher de cane, canette, cygne, jars et oie.
 Armoiries avec 3 canards (sens héraldique)
Armoiries avec 3 canards (sens héraldique)- D'azur à la fasce ondée d'argent soutenue d'un canard d'or, au chef du même chargé de deux canards affrontés de sinople, qui est de Sost des Hautes-Pyrénées ? voir illustration « armoiries avec 3 canards »
-
(Sports de glisse) Plongeon en canard.
- Exemple d'utilisation manquant. (Ajouter)
-
(Québec) Bouilloire.
- Exemple d'utilisation manquant. (Ajouter)
-
(Belgique) Petit bisou sur les lèvres.
- Exemple d'utilisation manquant. (Ajouter)
Adjectif 2 - français
canard \ka.na?\ masculin
- Chiens canards : Chiens de chasse qui ont le poil long, épais et frisé et qui sont dressés à aller chercher dans l'eau les canards qu'on a tirés. ? voir barbet
- Bois canards : Bois qui, étant jetés à bois perdu dans un canal, dans une rivière, vont au fond de l'eau ou s'arrêtent sur les bords.
- Bâtiment canard : (Marine) Navire plongeant par l'avant et qui en tanguant reçoit des lames sur son avant.
Adjectif 1 - français
canard \ka.na?\ invariable
- D'une couleur bleu moyen soutenu et teinté de vert. #048B9A
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Oiseau aquatique palmipède dont la chair est très recherchée, qu'il vive à l'état sauvage ou à l'état domestique. Canard de rivière. Canard domestique. Canard sauvage. Chasser aux canards. Tirer aux canards. Canard rôti. Canard en salmis, aux navets, aux olives, etc. Fam., Mouillé comme un canard, Très mouillé. La pluie nous surprit en chemin et nous arrivâmes mouillés comme des canards. Plonger comme un canard, Plonger habilement; et fig., S'esquiver, se soustraire à un danger. Il se dit, par extension, d'un Morceau de sucre trempé dans du café ou de la liqueur. Donner un canard à un enfant. Fig. et fam., Un canard, Une nouvelle fausse lancée dans la presse pour tromper le public. Il désigne aussi un Journal éphémère et sans valeur. Adjectivement, Chiens canards, Chiens de chasse qui ont le poil long, épais et frisé et qui sont dressés à aller chercher dans l'eau les canards qu'on a tirés. Voyez BARBET. En termes de Marchand de bois, Bois canards, Ceux qui, étant jetés à bois perdu dans un canal, dans une rivière, vont au fond de l'eau ou s'arrêtent sur les bords. En termes de Marine, Bâtiment canard, Bâtiment plongeant par l'avant et qui en tanguant reçoit des lames sur son avant.
Littré
-
1Oiseau palmipède, lamellirostre, vivant à l'état sauvage et domestique, recherché pour sa chair.
Canard musqué, oiseau d'Amérique, nommé à tort canard de Barbarie.
Familièrement. Mouillé, trempé comme un canard, très mouillé.
Il vint ici mouillé comme un canard
, Sévigné, 163.Plonger comme un canard, très bien plonger?; et figurément, s'esquiver, se soustraire à un danger.
Familièrement. C'est un canard privé, c'est-à-dire c'est un homme qui joue le rôle du canard privé, qui par son cri attire dans le piège les canards sauvages.
-
2 Populairement, conte absurde et par lequel on veut se moquer de la crédulité des auditeurs. Cette nouvelle n'était qu'un canard.
Je suis fâché de ne vous avoir pas traité comme mon enfant?; vous le méritiez mieux que ce donneur de canard à moitié qui nous promettait tant de châteaux en Espagne
, la Comédie des proverbes, III, 7.Vous serez mis en cage?; vous êtes un bailleur de canards
, Recueil des plus excellents ballets, p. 19, 1612. -
3Petit imprimé contenant le récit d'un événement du jour et dont on crie la vente à Paris.
Se dit ironiquement de faits, de nouvelles, de bruits plus ou moins suspects qui se mettent dans les journaux. Cette nouvelle n'est qu'un canard. Quel canard?!
- 4Note fausse tirée d'un instrument à anche à sons éclatants. Cette clarinette fait des canards.
- 5Petit morceau de sucre trempé dans de l'eau-de-vie ou dans le café (comme le canard dans l'eau).
- 6Sorte d'artifice lancé dans l'eau.
- 7Espèce de filet soutenu par des roseaux.
- 8 S. m. plur. Conduits d'air dans des galeries souterraines de mines.
-
9 Adj. Chiens canards, chiens à poil épais et frisé qu'on dresse à aller chercher dans l'eau les canards atteints par le chasseur?; et, substantivement, un canard.
Bois canards, morceaux de bois flotté qui vont à fond ou s'arrêtent sur les bords.
Terme de marine. Bâtiment canard, barque canarde, etc. qui tangue beaucoup et embarque de l'eau par l'avant.
HISTORIQUE
XVIe s. Et en sort une troisiesme et bastarde race, quand le canard d'Inde et la cane commune s'accouplent ensemble
, De Serres, 346. La charge d'un canard est de huit ou dix canes
, De Serres, 377. Vendre ou donner un canard à moitié, mentir, en donner à garder, en faire accroire
, Cotgrave ? Il baissait la teste comme un canard [il était honteux]
, Nuits de Straparole, t. I, p. 92, dans LACURNE.
Encyclopédie, 1re édition
CANARD, s. m. anas, (Hist. nat. Zoolog.) oiseau aquatique, dont la femelle porte le nom de cane. Les canards & autres oiseaux de riviere sont pesans, & semblent se mouvoir difficilement ; c'est pourquoi ils font du bruit avec leurs ailes en volant. Il y a des canards sauvages qui sont aussi gros & plus que les canards domestiques, & qui leur ressemblent à tous égards ; d'autres qui sont plus petits : ainsi il y en a de deux sortes. On doit les distinguer en grands & en petits, & non pas en sauvages & en domestiques, puisque ceux-ci sont venus des ?ufs de canards sauvages. Les couleurs de ceux-ci sont constantes : mais celles des autres varient ; ils sont quelquefois mi-partis de blanc ou entierement blancs. Cependant il s'en trouve qui ont les mêmes couleurs que les sauvages. Belon, Hist. de la nat. des oiseaux.
Il y a quantité d'especes de canards : il suffira de rapporter ici les principales, je veux dire celles qui ont été nommées en François.
Canard à bec crochu, anas rostro adunco : le mâle pese deux livres deux onces ; il a depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue environ deux piés de longueur : l'envergure est de trente-deux pouces ; le bec est long de deux pouces & demi ; il est un peu courbé, & d'un verd pâle ; la pointe qui est à l'extrémité est de couleur noire. Le plumage de la tête & du dessous du cou est d'un verd sombre, & il y a deux raies formées par de petits points ou taches blanches ; l'une des raies passe au-dessus du bec, presque sur l'?il, & s'étend jusqu'au derriere de la tête, & l'autre va depuis le bec jusqu'au-dessous de l'?il, qui est entouré d'un cercle de plumes de la même couleur : le plumage du menton est aussi bigarré de la même maniere ; celui de la gorge, de la poitrine & du ventre, est blanc, & cette couleur est mêlangée de quelques petites taches transversales d'un brun rougeâtre ; les plumes du dos de même que celles de la naissance des ailes & des flancs, sont de cette même couleur, & bordées & bigarrées par-tout de blanc. Les grandes plumes des ailes sont au nombre de vingt-quatre, les six premieres sont toutes blanches, & les autres sont d'un brun rougeâtre ; les petites plumes du premier rang sont bleues, à l'exception des pointes qui sont blanches ; les plumes du second rang sont brunes, & leur pointe est blanche : la queue est composée de vingt plumes noires, leurs pointes sont blanches ; les quatre du milieu sont recourbées par en haut en forme de cercle vers le dos : les jambes & les pattes sont de couleur orangée. La femelle de cet oiseau ressemble beaucoup à celle du canard ordinaire, à l'exception du bec qui est crochu ; elles pondent plus qu'aucunes autres de ce genre. Derham, Hist. nat. des oiseaux. Voyez Oiseau.
Canard à crête noire, anas fuligula prima Gesn. il pese deux livres ; sa longueur depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue est de quinze à seize pouces ; & l'envergure est de deux piés & trois ou quatre pouces : le bec a depuis la pointe jusqu'aux coins de la bouche, environ deux pouces de longueur ; il est large, d'un bleu pâle par-tout, excepté à la pointe qui est noire : les narines sont grandes, & environnées par un espace dégarni de plumes : l'iris des yeux est jaune, ou de couleur d'or : les oreilles sont petites ; la tête, sur-tout le sommet, est d'un pourpre noirâtre, ou plutôt d'une couleur mêlangée de noir & de pourpre ; c'est pourquoi on appelle cet oiseau à Venise, & dans d'autres endroits d'Italie, capo-negro. Il a une crête qui pend derriere la tête, de la longueur d'un pouce & demi : la couleur du cou, des épaules, du dos, enfin toute la partie supérieure de l'oiseau est d'un brun foncé, presque noir. Les ailes sont courtes, & toutes les petites plumes sont noires ; les quatre premieres grandes plumes sont de la même couleur que le corps ; les six qui suivent deviennent successivement blanches par degrés ; les dix suivantes sont blanches comme neige, à l'exception de leurs pointes qui sont noires ; les six dernieres sont entierement noires : la queue est très-courte, & composée de quatorze plumes noires ; le dessous du cou & le devant de la poitrine sont noirs, & le reste de la poitrine est blanc ; le ventre est de la même couleur jusqu'à l'anus, où elle est plus obscure, & au-delà elle est noirâtre : les plumes des côtés, que recouvrent les ailes lorsqu'elles sont pliées, celles qui couvrent les cuisses, & les petites plumes du dessous de l'aile, sont blanches ; les jambes sont courtes, & placées en arriere ; les pattes sont d'une couleur livide, ou de bleu obscur ; les doigts sont longs, & la membrane qui les joint est noire. Le corps de cet oiseau est court, épais, large, & un peu applati. On n'a trouvé que des cailloux & de l'algue dans l'estomac de cet oiseau. Willughby, Ornith. Derham, Hist. nat. des oiseaux. Voyez Oiseau.
Canard à tête élevée, anas arrecta ; le bec de cet oiseau est verd, & mêlé d'une couleur brune ; l'iris des yeux est blanc ; le sommet de la tête est noir ; il y a une bande blanche qui commence sous la base du bec, & qui entoure le sommet de la tête au-dessous du noir ; le reste de la tête est d'une couleur obscure, mêlée de verd & de rouge ; ce qui la fait paroître très-belle, selon les différens reflets de lumiere : le cou est bigarré de plumes noires & blanches ; celles de la poitrine & du ventre sont de cette derniere couleur ; les côtés du ventre sous les ailes & les cuisses, sont d'une couleur obscure tirant sur le noir ; les grandes plumes des ailes sont brunes, & leurs bords extérieurs sont blancs ; le dos est d'une couleur sombre, mêlée de verd & de rouge ; les jambes & les piés sont d'un jaune obscur. Cet oiseau se tient droit en marchant ; c'est pour cette raison qu'on l'appelle le canard droit ou à tête élevée. Derham, Hist. nat. des oiseaux. Voyez Oiseau.
Canard de Barbarie : cet oiseau paroit avoir eu plusieurs dénominations ; car on croit qu'il a été désigné par les noms suivans, anas Moschata, anas Cairina, anas Libyca, anas Indica ; toutes les descriptions que l'on en a faites sous ces différens noms, s'accordent pour la grandeur, pour la voix rauque & entrecoupée comme par des sifflemens, pour les tubérosités dégarnies de plumes entre les narines & autour des yeux, & pour la grandeur du mâle, qui surpasse celle de la femelle. Les couleurs du plumage varient comme dans tous les oiseaux domestiques. J'ai vû un mâle de trois ans qui pesoit quatre livres treize onces ; il avoit deux piés deux pouces & demi de longueur, depuis la pointe du bec jusqu'au bout des pattes, & deux piés & demi jusqu'au bout de la queue ; la partie supérieure du bec a deux pouces cinq lignes de longueur, depuis l'ouverture de la bouche jusqu'à l'extrémité de cette partie supérieure, qui est terminée par une sorte d'ongle large & plat, noir & crochu, assez ressemblant à un ongle humain ; les bords de cet ongle sont blanchâtres ; il y a un pareil ongle à l'extrémité de la partie inférieure du bec ; la supérieure a onze lignes de largeur, & deux pouces huit lignes de longueur jusqu'aux premieres plumes de la tête ; elle est en forme de gouttiere renversée ; les narines sont à égale distance de la pointe du bec & du milieu des yeux : le bec est élevé, & tuberculeux derriere les narines ; mais cette partie est recouverte par une membrane marbrée de noir & de rouge, qui environne la base du bec entier, qui s'étend jusqu'aux yeux, & qui les entoure ; cette membrane recouvre des tubercules osseux plus ou moins gros, qui sont placés autour des yeux, & qui ont une couleur blanche roussâtre ; le bec est marbré de rouge, de couleur de chair & de noir ; les dents sont en forme de scie, comme dans les canards ordinaires ; la langue est aussi pareille ; la tête, & le dessus du cou sur la moitié de sa longueur, sont panachés de noir & de blanc ; tout le reste du dessus du cou, le dos entier, le croupion, & la queue, sont d'une couleur obscure & changeante, mêlée d'or, de pourpre, de bleu & de verd ; les six premieres grandes plumes des ailes sont blanches ; les dix-sept suivantes sont de la même couleur que les longues plumes de l'épaule & de la queue ; la partie moyenne de ces dix-sept grandes plumes de l'aile est panachée de noir & de blanc, principalement sur les barbes intérieures ; car les barbes extérieures des dernieres de ces dix-sept grandes plumes, sont de même couleur que l'extrémité, & les trois ou quatre dernieres grandes plumes sont entierement de la même couleur que la pointe des autres ; toutes les plumes qui recouvrent les grandes sont blanches, à l'exception des six ou sept premieres, qui sont en grande partie de la couleur changeante qui est sur la plûpart des grandes plumes : tout le dessous de l'aile est blanc, à l'exception des endroits des plumes qui sont de couleur changeante à l'extérieur ; l'intérieur en est brun ; la gorge est tachetée de blanc, de brun, & de noir ; le cou & la poitrine sont blancs, avec des taches irrégulieres sur le jabot, qui sont formées par plusieurs plumes brunes mêlées parmi les blanches ; le ventre & les cuisses sont bruns ; les côtés & le dessous de la queue sont aussi d'une couleur brune, mais elle est un peu mêlée de couleur changeante ; les pattes sont brunes ; la membrane qui réunit les doigts est aussi brune, & marquetée de blanc sale ; le dessous du pié & les ongles sont d'un blanc sale tacheté de noir. Ces oiseaux sont privés, & se multiplient comme les canards communs. Voyez Oiseau.
Canard de Madagascar, anas Madagascariensis, est un peu plus grand que le canard privé ; le bec est d'un brun jaunâtre, & l'iris des yeux est d'un beau rouge ; le cou & la tête sont d'un verd sombre, & le dos est d'un pourpre foncé mêlangé de bleu, à l'exception des bords des plumes qui sont rouges ; la poitrine est d'un brun sombre, excepté les bords extérieurs des plumes qui sont rouges ; le bas du ventre est brun ; les plumes des épaules sont d'une couleur sombre mêlée de bleu, de même que le premier rang des petites plumes des ailes ; les grandes ont les bords rouges ; le second rang des petites plumes est verd ; les jambes & les piés sont de couleur orangée. Cet oiseau est très-beau ; il vient originairement de Madagascar. Derham, Hist. nat. des oiseaux. Voyez Oiseau.
Canard d'été, anas cristatus elegans ; cet oiseau a une double hupe qui pend en arriere, & un fort beau plumage ; il a été décrit par Catesby, Hist. de la Caroline, vol. I. page 97. il se trouve en Virginie & en Caroline : il fait son nid dans les trous que les piverts font sur les grands arbres qui croissent dans l'eau, & principalement sur les cyprès. Tant que les petits sont encore trop jeunes pour voler, les vieux canards les portent sur leur dos jusque dans l'eau ; & lorsqu'il y a quelque chose à craindre pour eux, ils s'attachent par le bec au dos & à la queue du gros oiseau, qui s'envole avec sa famille. Hist. nat. de divers ois. par Edwards, art. xcjx. Voyez Oiseau.
Canard domestique, anas domestica vulgaris ; il est plus petit que l'oie, & presque de la grosseur d'une poule, mais moins élevé ; le dos & le bec sont larges ; les jambes courtes, grosses, & dirigées en arriere, ce qui lui donne de la facilité pour nager, & de la difficulté pour marcher ; aussi marche-t-il lentement & avec peine. Les couleurs varient à l'infini dans ces canards, de même que dans les poules, & dans tous les autres oiseaux domestiques. Le mâle differe de la femelle, en ce qu'il a sur le croupion des plumes qui s'élevent & se recourbent en avant. La femelle fait d'une seule ponte douze ou quatorze ?ufs, & quelquefois plus ; ils ressemblent à ceux des poules, & sont de couleur blanchâtre teinte de verd ou de bleu ; le jaune en est gros, & d'un jaune rougeâtre. Willughby, Ornith. Voyez Oiseau.
Canard sauvage, ou cane au collier blanc, cane de mer ; boschas major, anas torquata minor, Ald. il pese trente-six à quarante onces ; il a environ un pié neuf pouces de longueur, depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue ; l'envergure a près de deux piés neuf pouces ; le bec est d'un verd jaunâtre ; il a deux pouces & demi de longueur depuis les coins de la bouche jusqu'à son extrémité, & près d'un pouce de largeur ; il n'est pas trop applati ; il y a à l'extrémité de la piece supérieure du bec une appendice ou un ongle rond, comme dans la plûpart des oiseaux de ce genre ; les paupieres inférieures sont blanchâtres ; les pattes sont de couleur de safran ; les ongles sont bruns ; celui du doigt de derriere est presque blanc ; celui du doigt intérieur est le plus petit de tous ceux de devant : la membrane qui joint les doigts ensemble est d'une couleur plus sale ; les cuisses sont couvertes de plumes jusqu'au genou : le mâle a la tête & le dessus du cou d'un beau verd, au bas duquel il y a un collier blanc bien entier en-devant, mais qui ne l'est pas par derriere ; la gorge est de couleur de châtaigne, depuis le collier jusqu'à la poitrine, qui est mêlée de blanc & de cendré, de même que le ventre, & parsemée d'un nombre infini de points bruns ; les plumes de dessous la queue sont noires ; la face supérieure du cou est parsemée de taches rousses, mélée de cendré ; la partie du dos entre les deux ailes est rousse ; le dessous de l'oiseau est noirâtre ; le croupion est d'une couleur plus foncée, & mêlée d'un pourpre luisant ; les côtés sous les ailes, & les plus longues plumes qui vont jusque sur les cuisses, sont marquées de lignes transversales d'un très-beau brun, avec du blanc mêlé de bleu ; les petites plumes des ailes sont roussâtres ; les longues plumes qui sortent des épaules sont de couleur d'argent, & élégamment panachées de petites lignes transversales brunes. Il y a vingt-quatre grandes plumes à chaque aile ; les dix premieres sont brunes ; les dix suivantes ont la pointe blanchâtre, & les barbes extérieures d'un beau pourpre bleuâtre ; entre le bleu & le blanc il y a de petites bandes noires ; la vingt-unieme plume a la pointe blanche, & le bord extérieur de couleur de pourpre obscur ; la vingt-deuxieme a un peu de couleur d'argent dans son milieu ; la vingt-troisieme est entierement blanche, à l'exception des bords qui sont noirâtres ; la vingt-quatrieme est blanche aussi en entier, excepté le bord extérieur qui est noirâtre : les petites plumes sont de la même couleur que les grandes ; cependant celles qui recouvrent les pourprées ont la pointe noire, & ensuite une large ligne ou tache blanche ; la queue est composée de vingt plumes, dont l'extrémité est pointue ; les quatre du milieu sont contournées en cercle, & ont une belle couleur luisante mêlée de pourpre & de noir ; les huit suivantes de chaque côté sont blanchâtres ; les plumes du dessous de l'aile & de la fausse aile sont blanches.
Ces oiseaux vont par troupes pendant l'hyver ; au printems le mâle suit la femelle ; ils marchent par paires, & ils font leur nid le plus souvent près de l'eau, dans les joncs & les bruyeres, & rarement sur les arbres. La femelle fait d'une seule ponte douze ou quatorze ?ufs, & plus, & elle les couve : elle n'a pas la tête verte, ni de collier sur le cou ; sa tête & son cou ont du blanc, du brun, & du roux noirâtre ; le milieu des plumes du dos est d'un brun presque noir, & les bords font d'un blanc roussâtre. Villughby, Ornith. Voyez Oiseau. (I)
Le canard sauvage passe pour meilleur que le domestique, étant nourri à l'air libre, & d'alimens qu'il va chercher lui-même, & plus exercé que l'autre ; ce qui contribue à atténuer & à chasser au-dehors les humeurs grossieres qu'il pourroit contenir, & enfin à exalter de plus en plus les principes de ses liqueurs ; ainsi il abonde davantage en sel volatil : cette chair est cependant de difficile digestion.
Le foie du canard sauvage passe pour propre à arrêter le flux hépatique.
La graisse du canard est adoucissante, résolutive, & émolliente. (N)
Canard de pré de France, voy. Cane petiere.
Canard de Moscovie, voyez Canard de Barbarie.
Canard d'Inde, voyez Canard de Barbarie.
Dans les lieux de grand passage on fait au milieu des prairies & des roseaux, loin de tous arbres & haies, des canardieres ou grandes marres, où l'on met quelques canards privés qui appellent les passans, & un homme caché dans une hute les tire au fusil. On les prend aussi aux piéges, soit collets ou autres : l'heure la plus favorable pour les tirer est de grand matin, à mesure qu'ils partent. On les prend encore avec des nappes ou à l'appât, ou bien au trictrac avec des panneaux, & à la glu le long des marres d'eau où ils se reposent.
Pour le vol du canard il faut se servir des autours qui font leur coup à la toise, c'est-à-dire tout d'une haleine, d'un seul trait d'aile, & sont toûjours plus vîtes à partir du poing que les autres. Quand on est arrivé sur le lieu, & qu'on a observé où sont les canards, on prend les devants le long du fossé avec l'autour sur le poing ; on le présente vis-à-vis les canards, qui prennent l'épouvante & se levent : mais l'autour part aussi-tôt du poing, vole à eux, & en empiete toûjours quelqu'un.
Dans la saison où les canards sauvages font leurs canetons, on suit les bords des étangs & des rivieres avec un filet attaché à la queue d'une barque ; on bat tous les endroits couverts & marécageux, les canetons effrayés sortent & se jettent dans les filets ; on les prend, on leur brûle les bouts des ailes, & on les mêle avec les canetons domestiques.
Canards, ou bois perdus ; voyez Bois.
Étymologie de « canard »
Voy. CANE. Bourguig. cainar?; bas-lat. canardus, sorte de navire. Un canard, pour une billevesée, vient de l'ancienne locution?: vendre un canard à moitié?; locution dans laquelle on a supprimé à moitié. Il est clair que vendre un canard à moitié, ce n'est pas le vendre du tout?; de là le sens de attraper, moquer.
- (Date à préciser) Probablement du même radical que l'ancien français caner « caqueter », avec le suffixe -art que l'on retrouve dans malard, la plus ancienne désignation du canard mâle[1].
canard au Scrabble
Le mot canard vaut 9 points au Scrabble.
Informations sur le mot canard - 6 lettres, 2 voyelles, 4 consonnes, 5 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot canard au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
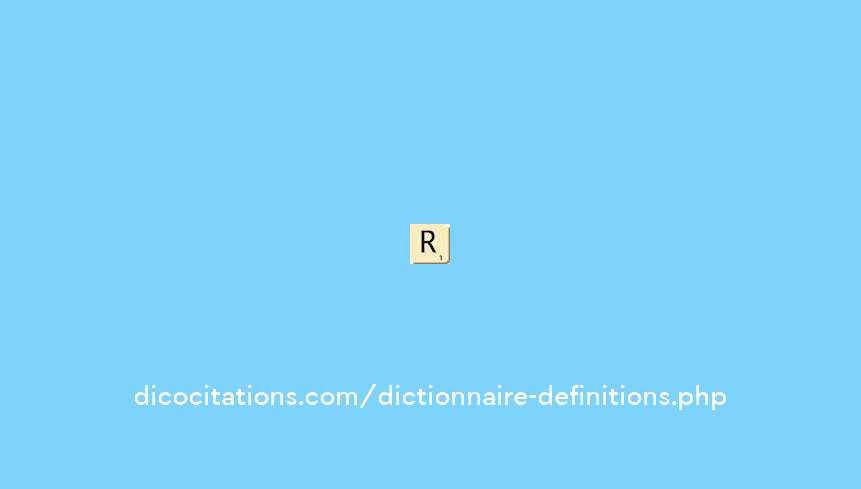
Les rimes de « canard »
On recherche une rime en AR .
Les rimes de canard peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en aR
Rimes de plongeoir Rimes de tubards Rimes de ambulatoire Rimes de traînard Rimes de roublard Rimes de crevards Rimes de drossart Rimes de écritoire Rimes de embauchoir Rimes de amarres Rimes de dilatoire Rimes de Hamoir Rimes de Maransart Rimes de loirs Rimes de perchoir Rimes de richard Rimes de tailloirs Rimes de bolivar Rimes de cuissard Rimes de suçoirs Rimes de eurodollar Rimes de fanfare Rimes de rondouillard Rimes de anti-chars Rimes de czar Rimes de bouilloires Rimes de présentoir Rimes de dare-dare Rimes de politicards Rimes de ares Rimes de boulevard Rimes de mi-pleurnichard Rimes de miroir Rimes de dreyfusard Rimes de peignoirs Rimes de falloir Rimes de Qatar Rimes de dévidoirs Rimes de laboratoires Rimes de Haute-Loire Rimes de Zaffelare Rimes de montagnards Rimes de surard Rimes de rigolard Rimes de vicelards Rimes de binoclard Rimes de provisoire Rimes de désespoirs Rimes de cagoulard Rimes de plongeoirsMots du jour
plongeoir tubards ambulatoire traînard roublard crevards drossart écritoire embauchoir amarres dilatoire Hamoir Maransart loirs perchoir richard tailloirs bolivar cuissard suçoirs eurodollar fanfare rondouillard anti-chars czar bouilloires présentoir dare-dare politicards ares boulevard mi-pleurnichard miroir dreyfusard peignoirs falloir Qatar dévidoirs laboratoires Haute-Loire Zaffelare montagnards surard rigolard vicelards binoclard provisoire désespoirs cagoulard plongeoirs
Les citations sur « canard »
- Je pense que vouloir rencontrer un écrivain parce qu'on aime son livre, c'est comme vouloir rencontrer un canard parce qu'on aime le foie gras. Auteur : Guillaume Musso - Source : La vie secrète des écrivains (2019)
- Lorsque les canards et les oies crient et plongent dans l'eau, c'est signe de pluie.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe
- Y'a pas à dire, dans la vie, y faut toujours se fier aux apparences: quand un homme a un bec de canard, des ailes de canard et des pattes de canard, c'est un canard. Et c'qui est valable pour les canards l'est aussi pour les p'tits merdeux.Auteur : Michel Audiard - Source : Les Vieux de la vieille (1960) de Gilles Grangier
- Comme Margaret Atwood, je pense que vouloir rencontrer un écrivain parce qu'on aime son livre, c'est comme vouloir rencontrer un canard parce qu'on aime le foie gras. Auteur : Guillaume Musso - Source : La vie secrète des écrivains (2019)
- La matière première du romancier ne colle pas aux molaires. Elle flotte autour de lui. Ce sont des larmes, ce sont des lignes. Celles, presque invisibles, d'un canard de province. Celles, trop imposantes, des colonnes nationales.Auteur : Arthur Dreyfus - Source : Belle famille (2012)
- Anjou, feu, feu de cheminée, nez de canard, canard à mare, j'en ai marre, marabout, boue des tranchées dont il s'extirpait, tête baissée tanguant d'une épaule à l'autre, pour aller plus loin vers les reflets du soir, il en avait marre.Auteur : Jean-Baptiste Rossi, dit Sébastien Japrisot - Source : Un long dimanche de fiançailles (1991)
- Mon père était fou amoureux de mon frère. Il était son prince, et moi le vilain petit canard. Il y avait une disparité absolue dans la façon dont il nous traitait. Auteur : Lambert Wilson - Source : Interview Psychologies, par Anne Laure Gannac - le 18 Avril 2011
- S'il pleut à la Saint-Médard, - C'est du beau temps pour les canards.Auteur : Dictons - Source : Dicton
- L'eau sur le canard marque mieux que la souillure sur la femme.Auteur : Jean Giraudoux - Source : La guerre de Troie n'aura pas lieu (1935), II, 12, Ulysse
- Non, ce n'était pas le radeau
De la Méduse, ce bateau,
Qu'on se le dis' au fond des ports,
Dis' au fond des ports,
Il naviguait en pèr' peinard
Sur la grand-mare des canards,
Et s'app'lait les Copains d'abord
Les Copains d'abord.Auteur : Georges Brassens - Source : Les Copains d'abord (1964) - Au brochage il y avait Jeanne... une forte fille roulée au moule... les parechocs... les hanches! Future mamelue aucun doute... sans les restrictions elle aurait peut-être déjà un cul à couver quatorze canards!Auteur : Alphonse Boudard - Source : Les combattants du petit bonheur (1977)
- La durée des villages est dans l'ordre profond, et leur eau à canards veille.Auteur : Jean Follain - Source : Usage du temps
- Vous ne pouvez être spirituel que lorsque ceux qui vous entourent le sont aussi. Le coq a beau chanter aux canards, ils ne l'entendent pas.Auteur : Carmen Sylva - Source : Les Pensées d'une reine (1882)
- L'amour d'une maman, c'est la conviction que ses poussins sont des cygnes; ce qui est la meilleure façon de donner du moral à des enfants qui sont convaincus d'être de vilains petits canards.Auteur : Pam Brown - Source : Maman ou mère
- En dehors de ces articles, on imprime, chaque jour, dans une foule de petits canards, des notes plus ou moins venimeuses, plus ou moins menaçantes.Auteur : Georges Duhamel - Source : Chronique des Pasquier (1933-1945)
- Onze canards en formation font le V de la victoire contre la pesanteur.Auteur : Sylvain Tesson - Source : Aphorismes sous la lune et autres pensées sauvages (2008)
- Octobre: Mois de mai des canards.Auteur : Albert Brie - Source : Le mot du silencieux, Dictionnaire du marginal
- Ils confondent avec les constellations de l'abîme les étoiles que font dans la vase molle du bourbier les pattes des canards.Auteur : Victor Hugo - Source : Les Misérables (1862)
- On pourrait à la rigueur accepter de vivre en ville, si l'on n'y devenait pas tellement ennuyeux à force d'y habiter. Même les canards de l'étang, qui voient tout leur tomber cuit dans le bec, perdent leur éclat et leur caractère.Auteur : Bergsveinn Birgisson - Source : La lettre à Helga (2013)
- S'intéresser à la vie de l'écrivain parce qu'on aime son livre, c'est comme s'intéresser à la vie du canard parce qu'on aime le foie grasAuteur : Margaret Atwood - Source : USA Today – 6 février 2008
- Sophie était naïve. Ni la sauge ni les oignons n'éveillèrent ses soupçons. Et elle alla cueillir dans le jardin de la ferme toutes les herbes que son hôte lui avait demandées et dont on se sert généralement pour rôtir les canards.Auteur : Beatrix Potter - Source : Le Conte de Sophie Canétang (1908)
- J'ai échappé de peu à un accident de voiture. A un carrefour, j'ai vu passer un canard à l'orange mais ai réussi à l'éviter.Auteur : Marc Escayrol - Source : Mots et Grumots (2003)
- Le faucon pèlerin fond sur le canard colvert.
Le sifflement du vol en piqué, dû à la rapidité de la chute, sidère la proie.Auteur : Pascal Quignard - Source : La Haine de la musique (1996) - Et puis toutes les dictatures se ressemblent, jusqu'à la rancune. Gare aux transfuges ! Leur famille, leurs proches, voire leurs amis, s'ils n'ont pas suivi, en font les frais. Dénoncer le canard boiteux est une sécurité en soi – si vous ne l'avez pas fait, c'est que vous êtes aussi coupable, on vous embarquera. Une manière d'amputer haut et court le membre gangrené. Auteur : Jean-Luc Coatalem - Source : Nouilles froides à Pyongyang (2013)
- Des bateaux j'en ai pris beaucoup,
Mais le seul qui'ait tenu le coup,
Qui n'ai jamais viré de bord,
Mais viré de bord,
Naviguait en père peinard
Sur la grand-mare des canards,
Et s'app'lait les Copains d'abord
Les Copains d'abord.Auteur : Georges Brassens - Source : Les Copains d'abord (1964)
Les mots proches de « canard »
Canac Canaille Canaillocratie Canal Canalet Canalisateur Canapé Canapsa Canard Canarder Canari Canari Canarie Cancan Cancel et, suivant quelques-un Cancellation Canceller Cancer Canche Cancouële Cancre Candace ou candaoce Candélabre Candeur Candi Candidat Candide Candidement Candir (se) Cane Canelo Canepetière Canéphore Caner Caneter Caneton Canette Canette Canette Canette Canevas Canevette Cange Caniculaire Canicule Canif Canillon Canin, ine Canivet CannageLes mots débutant par can Les mots débutant par ca
cana canada Canada canadair canadairs canadian river canadien canadien canadienne canadienne canadiennes canadiennes canadiens canadiens canado canaille canaille canaillement canaillerie canailles canailles canal Canale-di-Verde Canale-di-Verde canalicules canalisa canalisaient canalisait canalisateur canalisation canalisations canalise canalisé canalisée canalisées canalisent canaliser canalisés canalisez canalisons Canals cananéen canapé canapé-lit canapés canapés-lits Canaples Canappeville Canapville Canapville
Les synonymes de « canard»
Les synonymes de canard :- 1. colvert
2. eider
3. morillon
4. morille
5. raisin
synonymes de canard
Fréquence et usage du mot canard dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « canard » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot canard dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Canard ?
Citations canard Citation sur canard Poèmes canard Proverbes canard Rime avec canard Définition de canard
Définition de canard présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot canard sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot canard notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 6 lettres.

