Définition de « castor »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot castor de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur castor pour aider à enrichir la compréhension du mot Castor et répondre à la question quelle est la définition de castor ?
Une définition simple : (fr-rég|kas.t??) Synonyme : bièvre
Définitions de « castor »
Trésor de la Langue Française informatisé
CASTOR, subst. masc.
Wiktionnaire
Nom commun - français
castor \kas.t??\ masculin
-
(Zoologie) Quadrupède mammifère rongeur semi-aquatique à queue plate, qui habite ordinairement dans les lieux aquatiques.
- Les castors se sont réfugiés par petits détachements sur les rives des plus lointaines rivières. ? (Jules Verne, Le Pays des fourrures, J. Hetzel et Cie, Paris, 1873)
- Les castors avaient intercepté non seulement le cours de la rivière, au moyen de leur communauté industrieuse, mais encore tous les ruisseaux qui s'y jettent avaient leur cours arrêté, de manière à transformer le sol environnant en un vaste marais. ? (Gustave Aimard, Les Trappeurs de l'Arkansas, Éditions Amyot, Paris, 1858)
- Le castor fournit un pelage duveteux, très fin avec de longs poils brillants. C'est une matière textile de luxe qui vient de Sibérie ou du centre de l'Amérique. ? (D. de Prat, Nouveau manuel complet de filature; 1re partie: Fibres animales & minérales, Encyclopédie Roret, 1914)
-
(Par métonymie) Sa fourrure.
- Un manteau en castor.
- (Argot des Gadz'Arts) Élève des classes préparatoires au concours des Écoles d'Arts et Métiers.
- Dans le monde du négoce en France, désigne un particulier qui construit son habitation largement seul selon le mode de l'autoconstruction.
- [...] le tout juste marié est accueilli par une haie d'honneur... composée de pelles et de pioches. Les 25 hommes qui les tiennent à l'unisson sont ses futurs voisins. Tous sont des « castors ». ? (Le Parisien, Ces « castors » ont construit leur maison, 14 janvier 2015)
-
(Héraldique) (Rare) Meuble représentant l'animal du même nom dans les armoiries. Il est généralement représenté passant. À rapprocher de bièvre, connil, écureuil, lapin et lièvre.
- De gueules au castor d'argent, accompagné en chef de trois coquilles du même, qui est de Bibiche de Moselle ? voir illustration « armoiries avec un castor »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Quadrupède mammifère de l'ordre des Rongeurs, qui habite ordinairement dans les lieux aquatiques et dont l'espèce unique est commune au nord de l'ancien continent et de l'Amérique. Les castors du Canada font des digues et se construisent des habitations. Les castors d'Europe vivent la plupart dans des terriers. Poil de castor. Peau de castor. Gant de castor.
Littré
-
1Quadrupède mammifère de l'ordre des rongeurs, qui habite dans les lieux aquatiques, au nord de l'ancien et du nouveau continent. Le castor d'Europe se terre. Au Canada les castors construisent des digues et des habitations.
Ils y construisent des travaux Qui des torrents grossis arrêtent le ravage, Et font communiquer l'un et l'autre rivage?; L'édifice résiste et dure en son entier?: Après un lit de bois est un lit de mortier?; Chaque castor agit?; commune en est la tâche?; Le vieux y fait marcher le jeune sans relâche?; Maint maître d'?uvre y court et tient haut le bâton?; La république de Platon Ne serait rien que l'apprentie De cette famille amphibie
, La Fontaine, Fabl. X, 1. -
2Chapeau, drap, ras de castor, chapeau, drap, ras fait de poil de castor.
Chacun ordonna que je prendrais la valeur d'un chapeau de castor sur les deniers de ma recette
, Francion, liv. VI, p. 223.Un castor, un chapeau de poil de castor et, dans le langage familier, un chapeau quelconque, vieux, fripé, même un chapeau de femme.
Demi-castor, chapeau de poil de castor mélangé.
Vous trouverez, dans les ballots de M. l'ambassadeur, un étui où il y a deux chapeaux pour vous, un castor fin et un demi-castor
, Racine, Lettres à son fils, 22.Fig. et familièrement. C'est un demi-castor, c'est un homme suspect.
HISTORIQUE
XVIe s. On mettra en l'oreille huile de castor [castoréum] ou de girofle
, Paré, XV, 26. Prenez demie dragme de castor dissout en vin blanc
, Paré, XVIII, 57.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
1. CASTOR. Ajoutez?:Arbre du castor, le magnolia glauca, de l'Amérique septentrionale, Baillon, Dict. de bot. p. 247.
REMARQUE
1. Castor pour chapeau de castor est dans le Dict. de l'Acad. édit. de 1694, et dans FURETIÈRE, 1690, qui donne aussi demi-castor.
2. M. Eug. Rolland, Faune pop. p. 68, pense que la locution?: c'est un demi-castor, c'est un homme ambigu, suspect, vient de ce que, dans les prescriptions du gras et du maigre, le train de derrière du castor était considéré comme maigre, et le train de devant comme gras.
Encyclopédie, 1re édition
CASTOR, s. m. fiber, (Hist. nat.) animal quadrupede amphibie, qui a au plus trois ou quatre piés de longueur, sur douze ou quinze pouces de largeur au milieu de la poitrine, & qui pese ordinairement depuis quarante à soixante livres. Les animaux de cette espece sont pour l'ordinaire fort noirs : dans le nord le plus reculé de l'Amérique il y en a aussi de blancs. La plupart de ceux de Canada sont bruns : cette couleur s'éclaircit à mesure que les pays sont plus tempérés ; car les castors sont de couleur fauve ; & même ils approchent de la couleur de paille, chez les Illinois & chez les Chaoüanons. Celui dont on a fait la description dans les Mém. de l'Académ. roy. des Scien. tom. III. part. I. avoit été pris en Canada, aux environs de la riviere de Saint-Laurent : sa longueur étoit d'environ trois piés & demi, depuis le bout du museau jusqu'à l'extrémité de la queue ; & sa plus grande longueur de près d'un pié : il pesoit plus de trente livres. Il avoit du poil sur tout le corps, à l'exception de la queue, & ce poil étoit de deux sortes mélées ensemble ; l'une avoit environ un pouce & demi de longueur ; celui-là étoit gros comme des cheveux, fort luisant, de couleur brune, tirant un peu sur le minime ; il donne la principale couleur au castor ; sa substance étoit ferme, & si solide, qu'on n'y appercevoit aucune cavité avec le microscope : cependant M. Sarrasin, medecin du Roi en Canada, dit qu'on y remarque dans le milieu une ligne qui est beaucoup moins opaque que les côtés, & qui fait conjecturer que le poil est creux. Mém. de l'Ac. des Scienc. ann. 1704. L'autre sorte de poil n'avoit qu'environ un pouce de longueur ; il étoit beaucoup plus abondant que le premier ; il paroissoit aussi plus délié, & si doux, qu'il ressembloit à de la soie ; c'est un duvet très-fin & très-serré, qui garantit le castor du froid, & qui sert à faire des chapeaux & des étoffes : il ne reste que ce duvet dans les peaux qui ont servi de vêtemens & de couvertures de lits aux sauvages : il est le plus recherché, parce qu'étant engraissé par la matiere de la transpiration, il se foule beaucoup mieux. Le duvet du castor est garanti de la boue par le poil le plus long, lorsque l'animal est en vie & qu'il travaille.
Il y avoit cinq pouces & demi depuis le bout du museau jusqu'au derriere de la tête, & cinq pouces de largeur à l'endroit des os qui font l'éminence des joues ; de sorte que la tête étoit presque quarrée : les oreilles étoient rondes & fort courtes, revêtues de poil par le dehors, & presque sans poil au-dedans. Les yeux du castor sont fort petits : l'ouverture des paupieres n'a qu'environ quatre lignes ; la cornée est ronde, & l'iris d'un bleu foncé. Les dents incisives, qui sont au nombre de deux en chaque mâchoire, étoient tranchantes dans le castor dont la description a été faite, comme celles des écureuils, des porcs-épics, des rats, &c. celles d'en-bas avoient plus d'un pouce de longueur ; celles d'en-haut n'avoient qu'environ dix lignes ; elles glissoient au-dedans des autres lorsqu'on fermoit la bouche de l'animal ; elles étoient demi-rondes par-devant, & comme taillées en biseau de dedans en-dehors ; en-dedans leur couleur étoit blanche, & en-dehors d'un rouge clair tirant sur le jaune ; les unes & les autres étoient larges d'environ trois lignes au sortir de la mâchoire, & de plus de deux lignes à leur extrémité ; il y avoit seize dents molaires, huit de chaque côté, quatre en haut & quatre en bas ; elles étoient directement opposées les unes aux autres.
Ce castor avoit cinq doigts à chaque pié ; ceux des piés de derriere étoient joints ensemble par des membranes, comme ceux d'une oie ; les piés de devant avoient les doigts séparés, & étoient faits comme la main d'un homme, excepté qu'ils étoient couverts de poil, & que les ongles étoient longs & pointus ; les piés de devant avoient six pouces & demi de longueur depuis le coude jusqu'à l'extrémité du plus grand doigt, & trois pouces depuis le commencement de la main jusqu'à cette extrémité du plus grand doigt ; les piés de derriere avoient six pouces depuis l'extrémité du talon jusqu'au bout du plus long des doigts, qui étoit le second ; les ongles étoient taillés de biais, & creux par-dedans comme des plumes à écrire ; il y avoit à la partie externe de chaque pié de devant & de derriere, un petit os qui faisoit une éminence, & qu'on auroit pû prendre pour un sixieme doigt s'il avoit été séparé du pié.
La queue avoit environ onze pouces de longueur, deux pouces de largeur à la racine, & trois pouces dans le milieu, le bout étoit terminé en ovale, l'épaisseur étoit de près de deux pouces vers la racine, d'un pouce dans le milieu, & de cinq lignes & demie à l'extrémité, ses bords étoient ronds, & beaucoup plus minces que le milieu : elle étoit couverte d'une peau garnie d'écailles jointes ensemble par une pellicule, épaisse comme un parchemin, longue au plus d'une ligne & demie, d'un gris brun un peu ardoisé, & pour la plûpart d'une figure hexagone irréguliere. Il sortoit un, deux, ou trois petits poils d'environ deux lignes de longueur, entre les écailles du dessous de la queue. En corroyant la peau de ce castor, les écailles de la queue tomberent, mais leur figure y demeura empreinte. La chair de la queue étoit assez grasse, & avoit beaucoup de conformité avec celle des gros poissons.
Les parties de la génération du castor ne sont pas apparentes au-dehors lorsqu'il n'y a point d'érection ; on ne voit dans le mâle & dans la femelle qu'une ouverture, qui étoit située, dans le castor dont nous suivons la description, entre la queue & les os pubis. Trois pouces & demi plus bas que ces os, pour reconnoître le sexe, il faut pincer plus que la peau qui est entre l'os pubis & cette ouverture ; on y sent dans le mâle la verge qui est dure, grosse, & longue comme le doigt. L'ouverture avoit une figure ovale, longue d'environ neuf lignes, & large de sept ; elle se dilatoit & se resserroit aisément, non pas par le moyen d'un sphincter, mais simplement comme une fente qui se ferme en s'allongeant. Les gros excrémens, l'urine, & même la verge, passent par cette ouverture ; parce que la verge est renfermée dans un conduit qui est couché sur le rectum, & qui aboutit à l'ouverture commune, de même que le rectum : le vagin y aboutit aussi dans les femelles.
Il y avoit aux parties latérales du dedans de l'extrémité du rectum, deux petites cavités, une de chaque côté ; & on sentoit à-travers la peau du dehors deux éminences, qui sont les poches ou vessies dans lesquelles le castoreum est renfermé. Après avoir écorché l'animal, on découvrit à l'endroit où on avoit remarqué les éminences, quatre grandes poches situées au-dessous des os pubis. Les deux premieres étoient placées au milieu, & plus élevées que les deux autres ; elles avoient toutes deux prises ensemble, la forme que l'on donne à un c?ur. Leur plus grande largeur étoit d'un peu plus de deux pouces ; & la longueur depuis le haut de chacune de ces poches jusqu'à l'ouverture commune & extérieure dans la quelle elles communiquoient, étoit aussi d'environ deux pouces. Il y avoit au-dedans de ces poches une tunique qui paroissoit plus charnue que glanduleuse ; elle étoit rougeâtre, & avoit au-dedans plusieurs replis semblables à ceux de la caillette d'un mouton. Ces replis contenoient une matiere grisâtre de fort mauvaise odeur, qui étoit adhérente : ces mêmes replis s'étendoient dans les deux poches qui avoient communication l'une avec l'autre vers le bas par une ouverture de plus d'un pouce, & qui n'étoient séparées que par le fond. Au bas de ces deux premieres poches, il y en avoit deux autres, l'une à droite & l'autre à gauche. Leur figure ressembloit à celle d'une poire longue & un peu applatie ; leur longueur étoit de deux pouces & demi, & la largeur de dix lignes. Ces deux poches inférieures étoient étroitement jointes avec les supérieures vers l'ouverture commune.
Il y a lieu de croire que la matiere du castoreum passe des premieres poches dans les secondes pour s'y perfectionner : aussi ces secondes poches étoient-elles d'une structure différente de celle des premieres ; elles étoient composées de glandes qui formoient à l'extérieur des éminences rondes, dont les plus grandes n'excédoient pas une lentille de grandeur moyenne. Ayant ouvert l'une de ces secondes poches par le fond, on y trouva une liqueur d'une odeur desagréable, jaune comme du miel, onctueuse comme de la graisse fondue, & combustible comme de la térébenthine : en comprimant la poche il ne se fit aucun reflux de cette liqueur dans les poches supérieures, ni dans l'ouverture commune des excrémens. Après avoir vuidé la liqueur de cette seconde poche, on apperçut dans sa partie inférieure une troisieme poche longue d'environ quatorze lignes, & large de six ; elle étoit tellement attachée à la membrane de la seconde, qu'on ne put pas l'en séparer : elle aboutissoit en pointe à la partie latérale de l'ouverture commune ; mais on ne découvrit aucune issue dans les cavités que l'on avoit observées dans cette ouverture. Il y avoit sur la surface extérieure de ces troisiemes poches, des éminences semblables à celles des secondes poches, & on trouva dans leur cavité un suc plus jaune & plus liquide que dans les autres ; il avoit aussi une autre odeur & une couleur plus pâle ; enfin toutes ces poches sont très-différentes des testicules. Ainsi il est bien prouvé que ce ne sont pas les testicules qui contiennent le castoreum ; & par conséquent on ne sera plus tenté de croire que le castor arrache ses testicules lorsqu'il est poursuivi par des chasseurs, afin de s'en délivrer en leur donnant le castoreum qui fait l'objet de leur poursuite. Cette sable n'a jamais eu aucun fondement, puisque les testicules sont cachés dans les aines, un peu plus haut que les poches du castoreum, aux parties externes & latérales des os pubis.
M. Sarrasin a remarqué trois membranes dans la tissure des premieres bourses du castoreum, qu'il appelle bourses supérieures. La premiere de ces membranes est simple, mais très-ferme. La seconde est plus épaisse, moelleuse, & garnie de vaisseaux. La troisieme est particuliere au castor ; elle est seche comme un vieux parchemin, elle en a l'épaisseur, & se déchire de même. Cette membrane forme des replis dans lesquels la seconde membrane s'insere : ces replis sont en si grand nombre, que la troisieme membrane devient trois fois plus étendue lorsqu'elle est développée : elle est inégale au-dedans, & garnie de petits filets, auxquels il adhere une matiere résineuse qui est le castoreum, & qui s'épaissit peu-à-peu dans les bourses, & y acquiert la consistance d'une résine échauffée entre les doigts. Elle conserve sa mollesse plus d'un mois après avoir été séparée de l'animal ; elle sent mauvais dans ce tems-là, & elle est de couleur grisâtre en-dehors & jaunâtre en dedans ; ensuite elle perd son odeur, se durcit, & devient friable comme les autres résines, & en tout tems elle est combustible. Lorsqu'on a découvert la membrane qui enveloppe les bourses inférieures, on trouve de chaque coté, quelquefois deux, quelquefois trois bourses ensemble. Chacun de ces paquets est long de deux pouces & demi sur environ quatorze ou quinze lignes de diametre ; les bourses sont arrondies par le fond, & diminuent insensiblement de grosseur en approchant de l'ouverture commune, que M. Sarrasin nomme cloaque. La plus grande de ces bourses occupe toute la longueur du paquet, & n'a qu'environ huit ou dix lignes de diametre ; la seconde n'a ordinairement pas la moitié du volume de la premiere ; elle n'est pas toûjours plus grande que la troisieme, qui cependant est le plus souvent la plus petite de toutes. Les bourses, tant supérieures qu'inférieures, n'ont point de communication les unes avec les autres, leurs conduits aboutissent dans le cloaque.
On ne sait pas encore, ajoûte M. Sarrasin, à quoi servent pour le castor les liqueurs contenues dans les bourses. Il n'est pas vrai, selon cet auteur, qu'ils en prennent pour exciter leur appétit lorsqu'il est languissant, ni que les chasseurs l'employent, comme on l'a dit, pour attirer les castors : mais on frotte avec la liqueur huileuse les piéges que l'on dresse aux animaux carnassiers qui font la guerre aux castors, comme les martes, les renards, les ours, & sur-tout les carcajoux, qui brisent souvent pendant l'hyver les loges des castors pour les y surprendre. Voyez Carcajou. Les femmes des sauvages graissent leurs cheveux avec cette même huile, quoiqu'elle ait une mauvaise odeur.
Les castors ne vivent dans les pays froids, & pendant l'hyver, que de bois d'aune & de platane, d'orme, de frêne, & de différentes especes de peuplier. Pendant l'été ils mangent de toutes sortes d'herbes, de fruits, de racines, sur-tout de celles de différentes especes de nymphæa. On ne croit pas qu'ils vivent plus de quinze ou vingt ans.
M. Sarrasin ne s'en est pas tenu à la description du castor ; il a aussi rapporté plusieurs faits qui concernent l'histoire de cet animal.
Les castors choisissent pour établir leur demeure un lieu qui soit abondant en vivres, arrosé par une petite riviere, & propre à faire un réservoir d'eau : ils commencent par construire une sorte de chaussée, assez haute pour retenir l'eau à la hauteur du premier étage des cabanes qu'ils doivent faire. Ces chaussées ont dix ou douze piés d'épaisseur dans les fondemens, & deux piés seulement dans le haut ; elles sont construites avec des morceaux de bois gros comme le bras ou comme la cuisse, & longs de 2, 4, 5 ou 6 piés, que les castors coupent & taillent très-facilement avec leurs dents incisives ; ils les plantent fort avant dans la terre & fort près les uns des autres ; ils entrelacent d'autres bois plus petits & plus souples, & ils remplissent les vuides avec de la terre glaise qu'ils amollissent & qu'ils gachent avec leurs piés, & qu'ils transportent sur leur queue, qui leur sert aussi comme une sorte de truelle pour la mettre en place & pour l'appliquer. Ils élevent la digue à mesure que la riviere grossit, & par ce moyen le transport des matériaux est plus facile ; enfin cet ouvrage est assez solide pour soûtenir les personnes qui montent dessus. Les castors ont grand soin d'entretenir ces chaussées en bon état, & pour cela ils appliquent de la terre glaise dans la moindre ouverture qu'ils y apperçoivent.
Après avoir fait la chaussée, ils fondent leurs cabanes sur le bord de l'eau, sur quelque petite île, ou sur des pilotis ; elles sont rondes ou ovales, & débordent des deux tiers hors de l'eau : les murs sont perpendiculaires, & ont ordinairement deux piés d'épaisseur. La cabane est terminée en maniere de dome au-dehors, & en anse de panier en-dedans : elle est bâtie à plusieurs étages, que les castors habitent successivement à mesure que l'eau s'éleve ou s'abaisse : ils ne manquent pas d'y faire une porte que la glace ne puisse pas boucher ; ils ont aussi une ouverture séparée de leur porte & de l'endroit où ils se baignent ; c'est par cette ouverture qu'ils vont à l'eau rendre leurs excrémens. Quelquefois ils établissent la cabane entiere sur la terre, & creusent autour des fossés de cinq ou six piés de profondeur, qu'ils conduisent jusqu'à l'eau : les matériaux sont les mêmes pour les cabanes que pour les chaussées. Lorsque la construction est faite, ils perfectionnent leur ouvrage en coupant avec leurs dents, qui valent des scies, tous les morceaux de bois qui excedent les murailles, & ils appliquent avec leur queue au-dedans & au-dehors de la cabane une sorte de torchis fait avec de la terre glaise & des herbes seches. Une cabane dans laquelle il y a huit ou dix castors, a huit ou dix piés de largeur hors d'?uvre & dix à douze de longueur, supposé qu'elle soit ovale ; dans ?uvre elle a quatre ou cinq piés de largeur, & cinq ou six piés de longueur. Lorsqu'il y a quinze, vingt, ou même trente castors qui habitent la même cabane, elle est grande à proportion, ou il y en a plusieurs les unes contre les autres. On dit qu'on a trouvé jusqu'à quatre cents castors dans différentes cabanes qui communiquoient les unes avec les autres. Les femelles rentrent dans leurs cabanes pour y faire leurs petits, lorsque les grandes inondations sont passées : mais les mâles ne quittent la campagne qu'au mois de Juin ou de Juillet, lorsque les eaux sont tout-à-fait basses ; alors ils réparent leurs cabanes, ou ils en font de nouvelles ; & ils en changent lorsqu'ils ont consommé les alimens qui étoient à portée, lorsque leur nombre devient trop grand, & lorsqu'ils sont trop inquiétés par les chasseurs.
Il y a des castors qui se logent dans des cavernes pratiquées dans un terrein élevé sur le bord de l'eau : on les nomme castors terriers. Ils commencent leur logement par une ouverture, qui va plus ou moins avant dans l'eau, selon que les glaces sont plus ou moins épaisses, & ils la continuent de cinq ou six piés de longueur, sur une largeur suffisante pour qu'ils puissent passer ; ensuite ils font un réservoir d'eau de trois ou quatre piés en tout sens pour s'y baigner ; ils coupent un autre boyau dans la terre, qui s'éleve par étages, où ils se tiennent à sec successivement lorsque l'eau change de hauteur. Il y a de ces boyaux qui ont plus de mille piés de longueur. Les castors terriers couvrent les endroits où ils couchent, avec de l'herbe, & en hyver ils font des copeaux qui leur servent de matelas.
Tous les ouvrages sont achevés au mois d'Août ou de Septembre, sur-tout dans les pays froids ; alors les castors font des provisions pour l'hyver ; ils coupent du bois par morceaux, dont les uns ont deux ou trois piés de longueur, & d'autres ont jusqu'à huit ou dix piés. Ces morceaux sont traînés par un ou plusieurs castors, selon leur pesanteur : ils rassemblent une certaine quantité de bois qui flotte sur l'eau, & ensuite ils empilent d'autres morceaux sur les premiers, jusqu'à ce qu'il y en ait assez pour suffire aux castors qui vivent ensemble. Par exemple, la provision de huit ou dix, est de vingt-cinq ou trente piés en quarré, sur huit ou dix piés de profondeur. Ces piles sont faites de façon qu'ils peuvent en tirer les morceaux de bois à leur choix, & ils ne mangent que ceux qui trempent dans l'eau.
On fait la chasse des castors depuis le commencement de Novembre jusqu'au mois de Mars & d'Avril, parce que c'est dans ce tems qu'ils sont bien fournis de poil. On les tue à l'affût, on leur tend des piéges, & on les prend à la tranche.
Les piéges sont semblables aux quatre de chiffre avec lesquels on prend des rats. On plante fort avant dans la terre plusieurs piquets de trois ou quatre piés de longueur, entre lesquels il y a une traverse fort pesante, élevée d'environ un pié & demi : on met dessous une branche de peuplier longue de cinq ou six piés, qui conduit à une autre branche fort petite, placée de façon que dès que le castor la coupe, la traverse tombe & le tue. Ces animaux ne manquent pas de donner dans ces piéges, en allant de tems en tems dans les bois chercher de nouvelles nourritures, quoiqu'ils ayent fait leurs provisions, parce qu'ils aiment mieux le bois frais que le bois flotté.
Prendre les castors à la tranche, c'est faire des ouvertures à la glace avec des instrumens tranchans, lorsqu'elle n'a qu'environ un pié d'épaisseur ; ces animaux viennent à ces ouvertures pour respirer, & on les assomme à coups de hache. Il y a des chasseurs qui remplissent ces trous avec la bourre de l'épi de typha, pour n'être pas vûs par les castors, & alors ils les prennent par un pié de derriere. S'il y a quelque ruisseau près des cabanes, on en coupe la glace en travers ; on y tend un filet bien fort, ensuite on détruit la cabane : les castors en sortent, & se réfugient dans le ruisseau où ils rencontrent le filet.
On donne le nom de bievre au castor d'Europe. On en a dissequé un à Metz qui avoit la queue beaucoup plus petite, à proportion, que le castor de Canada, dont on vient de donner la description. Ses piés de devant n'étoient pas faits comme des mains : mais il avoit les doigts joints par des membranes comme la loutre. Cependant Rondelet dit expressément que le bievre a les piés de devant semblables aux piés d'un singe. Mém. de l'Acad. roy. des Sc. tom. III. part. I. & année 1704. Rondelet, Hist. des poissons. Voyez Quadrupede. (I)
Le castor fournit plusieurs remedes à la Medecine ; la peau de cet animal appliquée sur les parties affligées de goutte, les défend contre le froid.
On se sert avec succès de l'axonge du castor pour amollir les duretés ; elle est très-efficace dans les tremblemens & les maladies des nerfs, la paralysie, &c. on en oint les parties affligées.
Le castoreum attenue les humeurs visqueuses, fortifie le cerveau, excite les regles, & pousse par la transpiration ; on l'employe dans l'épilepsie, la paralysie, l'apoplexie, & la surdité.
On brule du castoreum, & on en fait respirer l'odeur fétide aux femmes hystériques dans le tems des accès. La teinture du castoreum se fait comme il suit.
Prenez une demi-once de castoreum & une demi-livre d'esprit-de-vin ; mettez-les en digestion pendant quelques jours ; décantez ensuite la liqueur, & la gardez pour l'usage.
On ajoûte quelquefois le sel de tartre à la dose de deux gros, dans le dessein de diviser le tissu résineux du castoreum ; la dose de cette teinture est depuis six jusqu'à douze gouttes dans les cas où on employe le castoreum en substance. Le castoreum entre dans plusieurs compositions de la Pharmacopée de Paris. (N)
Il se fait un grand commerce de peaux de castor ; les marchands, dit M. Savary, les distinguent en castors neufs, castors secs, & castors gras. Les castors neufs sont les peaux des castors qui ont été tués à la chasse pendant l'hyver & avant la mue. Ce sont les meilleures & les plus propres à faire de belles fourrures.
Les castors secs, qu'on nomme aussi castors maigres, sont les peaux de castors, provenant de la chasse d'été, tems auquel l'animal est en mue, & a perdu une partie de son poil. Les castors secs peuvent aussi être employés en fourrures, quoique bien inférieures aux premieres. Leur plus grand usage est pour les chapeaux.
Les castors gras sont des peaux de castor, que les sauvages ont portées sur leurs corps, & qui sont imbibées de leur sueur : le castor gras vaut mieux que le sec ; on ne s'en sert cependant que pour la fabrique des chapeaux.
Outre les chapeaux & les fourrures auxquels on employe le poil & les peaux de castor, on a tenté d'en faire des draps. Cette entreprise méritoit bien d'être tentée, & avoit pour but de rendre le poil de castor d'une utilité plus étendue ; mais les draps ordinaires sont préférables à ceux de castor. L'expérience a fait voir que les étoffes fabriquées avec le poil de castor, quoique mêlé avec la laine de Segovie, ne gardoient pas bien la teinture, & qu'elles devenoient seches & dures comme du feutre.
Castor signifie aussi un chapeau fait avec du poil de castor seul. Un chapeau demi-castor est celui dans lequel on a mêlé une partie de poil de castor avec une partie d'autre poil. Voyez Chapeau.
Castor, en Astronomie, est le nom de la moitié de la constellation des gemeaux. Voyez Gemeaux.
Castor & Pollux, en Météorologie, est un météore igné, qui paroît quelquefois en mer s'attacher à un des côtés du vaisseau, sous la forme d'une, de deux, ou même de trois ou quatre boules de feu. Lorsqu'on n'en voit qu'une, on l'appelle plus proprement Helene ; & lorsqu'on en voit deux, on les nomme Castor & Pollux. Mussch. Ess. de Phys. Voyez Feu Saint-Elme, & l'article qui suit.
* Castor & Pollux, (Myth.) fils de Jupiter & de Léda ; ils furent élevés à Pallene, où Mercure les porta aussi-tôt qu'îls furent nés. Ils s'illustrerent dans l'expédition de la toison d'or : à leur retour ils nettoyerent l'Archipel des corsaires qui l'infestoient. Ce service, l'apparition de deux feux qui voltigerent autour de leur tête, & le calme qui succéda, les firent placer après leur mort, au nombre des dieux tutélaires des nautoniers. Ces feux continuerent d'être regardés comme des signes de la présence de Castor & Pollux. Si l'on n'en voyoit qu'un, il annonçoit la tempête ; s'il s'en montroit deux, on espéroit le beau tems. Nos Marins sont encore aujourd'hui dans la même opinion ou dans le même préjugé ; & ils appellent feux S. Elme & S. Nicolas, ce que les payens appelloient feux de Castor & Pollux. Les deux freres invités aux noces de leurs parentes Hilaire & Phébé, les enleverent. Ce rapt coûta la vie à Castor, qui périt quelque tems après de la main d'un des époux. Pollux, qui aimoit tendrement son frere, demanda à Jupiter la résurection de Castor, & le partage entr'eux de l'immortalité qu'il devoit à sa naissance. Jupiter l'exauça ; & l'un fut habitant des enfers, pendant que l'autre fut citoyen des cieux. Cette fable est fondée sur ce que l'apothéose de ces héros les a placés dans le signe des Gemeaux, dont l'une des étoiles descend sous l'horison quand l'autre y paroît. Pour célébrer leurs fêtes, les Romains envoyoient tous les ans vers leur temple, un homme couvert d'un bonnet comme le leur, monté sur un cheval, & en conduisant un autre à vuide. La Grece les compta parmi ses grands dieux : ils eurent des autels à Sparte & dans Athenes. Les Romains leur éleverent un temple par lequel on juroit : le serment des hommes étoit ?depol, par le temple de Pollux ; & celui des femmes ?castor, par le temple de Castor. Les deux dieux parurent plusieurs fois au milîeu des combats sur des chevaux blancs. On les représentoit sous la figure de jeunes hommes, avec un bonnet surmonté d'une étoile, à cheval, ou en ayant près d'eux. Ils sont connus dans les Poetes sous le nom de Dioscures, ou fils de Jupiter, & de Tyndarides, parce que leur mere étoit femme de Tyndare roi de Sparte. Ils se distinguerent dans les jeux de la Grece : Castor, par l'art de dompter & de conduire des chevaux, ce qui le fit appeller dompteur de chevaux ; Pollux, par l'art de lutter, ce qui le fit regarder comme le patron des athletes. V. M. l'ab. de Claustre.
Étymologie de « castor »
??????, castor?; du mot hébreu qui signifie musc?; en persan moderne, khaz.
- (XIIe siècle) Du latin castor emprunté au grec ancien ??????, kástôr de même sens ; castor a éliminé bièvre en moyen français.
Mise à jour de la notice étymologique par le programme de recherche TLF-Étym :
Histoire :
A. 1. « genre de mammifère rongeur qui construit des barrages ». Attesté depuis ca 1130 (PhThBestWa, page 42, vers 1135 : Castor de beste est nuns Que nus bievre apeluns [?] Oëz cum castor fine [?] Castor en ceste vie Saint ume signefie [?] E tel signefiance Castor fait senz dutance). Le lexème a longtemps vécu seulement sous la forme d'un xénisme, ainsi encore au début du 13e siècle (BestGervM, page 435, vers 686 = GdfC : Une beste est d'autre nature, Castor la nomme l'escripture, En roman l'apele l'an beivre). Première attestation témoignant de la lexicalisation du terme : 1342 (Mach, D. Lyon H., page 172 : Olifans, liepars et liepardes, Ourses, lins, renars et renardes, Loiemiers, grans alans d'Espaingne, Et pluseurs matins d'Alemagne, Castors, aspis et unicornes). -
A. 3. « mousse, jeune marin ». Attesté depuis 1899 (Esnault, Argot : castor n. m. ? [?] 3° Mousse (mar., 1832) : Hé ! castor ! femme du bord !). -
A. 2. « association d'individus qui construisent leur maison en commun, sans aide rémunérée ». Attesté depuis 1949 [juin] (Le Courrier des usines [publication des Établissements Peugeot], in Goux, Mémoires, page 356 : Avez?vous entendu parler des Sociétés nommées « Castor » ? Ce sont des chefs de famille, réunis en équipe qui construisent eux?mêmes leurs maisons dans leur temps libre, en équipe. Ils ont réussi autrefois vers Lyon, Saint?Etienne, à édifier de nombreuses maisons. Aujourd'hui il y en a des groupes importants qui fonctionnent avec succès à Bordeaux, en Alsace par exemple). -
B. 1. « fourrure de castor ». Attesté depuis 1449 (Chart. J., Chron. Ch. VII V., volume 2, chapitre 209, page 163 : et après venoit le roy [?] ayant en sa teste ung chapel de castor, aultrement de bièvre). -
B. 2. « chapeau d'homme en poil de castor ». Attesté depuis 1632 (Corneille, Galerie, acte I, scène 7, vers 195 : Voyez, je vous ferai meilleur marché qu'un autre, Des gants, des baudriers, des rubans, des castors). -
Origine :
Transfert linguistique : emprunt au latin castor subst. masc. « genre de mammifère rongeur qui construit des barrages » (attesté depuis Cicéron ; emprunté au grec ??????? subst. masc. « id. » ; TLL 3, 542?543 ; Ernout?Meillet4). Cf. Kuhn in FEW 2, 473b?474a, castor ; Allaire, Pelleteries. Cet emprunt a commencé à supplanter bièvre* en moyen français..
Rédaction TLF 1977 : Équipe diachronique du TLF. - Mise à jour 2005 : Jean-Pierre Chambon ; Armelle Evrard. - Relecture mise à jour 2005 : Nadine Steinfeld ; Gilles Roques ; Éva Buchi.
castor au Scrabble
Le mot castor vaut 8 points au Scrabble.
Informations sur le mot castor - 6 lettres, 2 voyelles, 4 consonnes, 6 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot castor au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
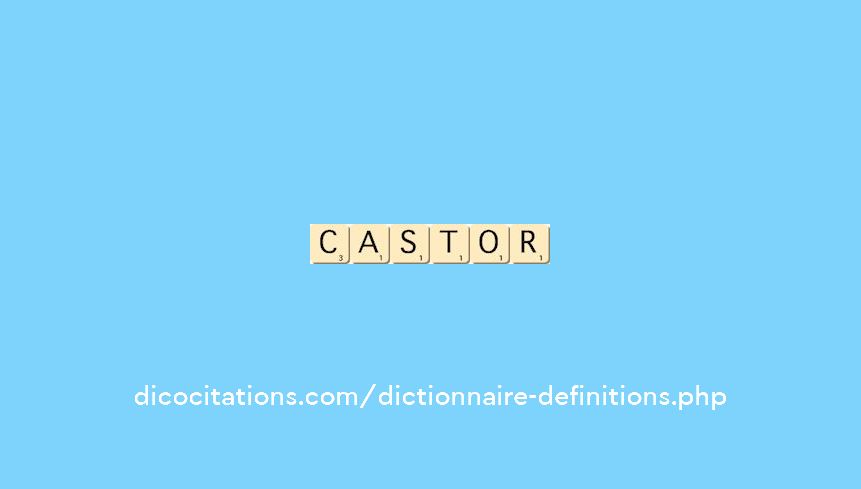
Les rimes de « castor »
On recherche une rime en OR .
Les rimes de castor peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en oR
Rimes de mirliflore Rimes de mort Rimes de technicolor Rimes de maure Rimes de frugivore Rimes de redors Rimes de octuor Rimes de abord Rimes de commémorent Rimes de minotaures Rimes de retors Rimes de sort Rimes de milords Rimes de gore Rimes de Côte-d'Or Rimes de tord Rimes de boutons-d'or Rimes de adores Rimes de explore Rimes de more Rimes de maure Rimes de sort Rimes de stentors Rimes de forts Rimes de report Rimes de théodore Rimes de efforts Rimes de apport Rimes de téléport Rimes de abords Rimes de incorporent Rimes de escalators Rimes de conquistadors Rimes de telesphore Rimes de bords Rimes de sors Rimes de passiflore Rimes de galactophore Rimes de arbores Rimes de victor Rimes de colore Rimes de Milmort Rimes de majore Rimes de corps-mort Rimes de corregidor Rimes de arborent Rimes de bicolores Rimes de claymore Rimes de accore Rimes de infirmière-majorMots du jour
mirliflore mort technicolor maure frugivore redors octuor abord commémorent minotaures retors sort milords gore Côte-d'Or tord boutons-d'or adores explore more maure sort stentors forts report théodore efforts apport téléport abords incorporent escalators conquistadors telesphore bords sors passiflore galactophore arbores victor colore Milmort majore corps-mort corregidor arborent bicolores claymore accore infirmière-major
Les citations sur « castor »
- Les nouvelles générations en concluaient que la duchesse de Guermantes, malgré son nom, devait être quelque demi-castor qui n'avait jamais été tout à fait du gratin.Auteur : Marcel Proust - Source : A la recherche du temps perdu, Le Temps retrouvé (1927)
- C'étaient pas des amis de lux',
Des petits Castor et Pollux,
Des gens de Sodome et Gomorrh',
Sodome et Gomorrh',
C'étaient pas des amis choisis
Par Montaigne et La Boeti',
Sur le ventre ils se tapaient fort,
Les copains d'abord.Auteur : Georges Brassens - Source : Les Copains d'abord (1964) - Graun avait envoyé à Telmann une longue lettre, où il dépeçait les récitatifs de Castor et Pollux. Il en blâmait le manque de naturel, les intonations fausses.Auteur : Romain Rolland - Source : Voyage musical au pays du passé
- Chaque flot du temps superpose son alluvion, chaque race dépose sa couche sur le monument, chaque individu apporte sa pierre. Ainsi font les castors, ainsi font abeilles, ainsi font les hommes. Le grand symbole de l'architecture Babel, est une ruche.Auteur : Victor Hugo - Source : Notre-Dame de Paris (1831)
- Pour sauver un arbre, mangez un castor!Auteur : Henri Prades - Source : Sans référence
- Un belge qui venait d'acheter un castor, l'a installé dans une cage, puis a ensuite appris dans un documentaire télévisé que les castors vivaient dans l'eau. Il a alors essayé en vain de remplir la cage d'eau. Le castor est en état de choc.Auteur : Marc Escayrol - Source : Mots et Grumots (2003)
- Un laborieux castor destructif, voilà ce que l'homme est à mes yeux.Auteur : Jacques Sternberg - Source : Toi ma nuit
- Castoriadis a dit: «L'homme est cet animal fou dont la folie a inventé la raison.»Auteur : Edgar Morin - Source : Amour, poésie, sagesse
- Les castors ne se purgent pas la nuit.Auteur : Paul Éluard - Source : 152 Proverbes mis au goût du jour (1925), 132
- Parfois tout se passe bien, l'arbre se couche sur le sol et les castors commencent à le débiter, comme un bûcheron ferait des billons.Auteur : Roger Frison-Roche - Source : Nahanni (1969)
- Je ferai comme Simonide, qui, n'ayant rien à dire de je ne sais quel athlète, se jeta sur les louanges de Castor et de Pollux.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Lettre au roi de Prusse, 14 mai 1773
- Il passa en l'isle de Samothrace, là où il s'alla rendre en la franchise et sauvegarde du temple de Castor et de Pollux.Auteur : Jacques Amyot - Source : Paul-Aemile, 38
- Souvenez-vous des castors. Vous êtes dispersés sur les bords du fleuve: assemblez-vous, entendez-vous, et vous aurez bientôt opposé une digue inébranlable à ses eaux rapides et profondes.Auteur : Félicité Robert de Lamennais - Source : Le Livre du peuple (1837), XV
- La plupart des espèces d'animaux, comme les abeilles, les araignées, les castors, ont chacun un art particulier, mais unique, et qui n'a point parmi eux de premier inventeur; les hommes ont une infinité d'arts différents.Auteur : Bernard le Bovier de Fontenelle - Source : Eloge de des Billettes
- La femme se procure des fourrures aux dépens de divers animaux. La loutre, par exemple, le castor et le lapin (qui prend des pseudonymes). Mais principalement, l'homme.Auteur : Hervé Lauwick - Source : Les femmes vues de près (1961)
Les mots proches de « castor »
Cas Cas, casse Casanier, ière Casaque Casaquin Cascade Cascatelle Casco Case Casé, ée Casemate Caser Casernier Casette Casier Casin Casino Casoar Casque Casqué, ée Casques Casquet Cassable Cassade Cassant, ante Cassave Casse Casse Casse Casse Cassé, ée Cassement Casse-museau Casser Casserie Casserole Casseron Casse-tête Cassette Casseur, euse Casside Cassine Cassine Cassolette Cassolle Cassonade Cassure Castagnettes Castagneux CastelLes mots débutant par cas Les mots débutant par ca
cas casa casa Casabianca Casabianca casablancaises Casaglione Casaglione casaient casait Casalabriva Casalabriva Casalta Casalta Casamaccioli Casamaccioli casanier casanière casanière casanières casanières casaniers casaniers Casanova Casanova casant casaque casaques casaquin casas casbah cascadaient cascadait cascadant cascadas cascade cascade cascadé cascadent cascader cascadèrent cascades cascades cascadeur cascadeurs cascadeuse cascara Cascastel-des-Corbières cascatelle cascatelles
Les synonymes de « castor»
Aucun synonyme.Fréquence et usage du mot castor dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « castor » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot castor dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Castor ?
Citations castor Citation sur castor Poèmes castor Proverbes castor Rime avec castor Définition de castor
Définition de castor présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot castor sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot castor notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 6 lettres.
