La définition de Cendre du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Cendre
Nature : s. f.
Prononciation : san-dr'
Etymologie : Picard, chaine ; bourguig. çarre ; provenç. cenre, cendre, cene ; catal. cendra ; ital. cenere ; du latin cinerem, le même que le grec.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de cendre de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec cendre pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Cendre ?
La définition de Cendre
Poudre qui reste après la combustion du bois et autres matières. Cendre chaude. Faire cuire sous la cendre, dans les cendres. Lessive de cendres, lessive faite avec des cendres. Mettre en cendre, réduire en cendre, brûler.
Toutes les définitions de « cendre »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Poudre qui reste du bois et des autres matières combustibles après qu'elles ont été brûlées et consumées par le feu. Cendre chaude. Cendre de sarment. Feu couvert de cendre. Faire cuire une galette sous la cendre. Faire cuire des marrons dans les cendres. Réduire en cendres. Ce bel édifice n'est plus aujourd'hui qu'un monceau de cendres. Par exagération, Réduire, mettre en cendres une ville, un pays, Les ravager, y mettre tout à feu et à sang. Tamerlan mit l'Asie en cendres. Fig., C'est un feu caché sous la cendre, se dit d'une Passion qui n'est pas bien éteinte. C'est un feu qui couve sous la cendre, se dit en parlant d'une Personne qui dissimule un désir de vengeance en attendant l'occasion de le satisfaire. Fig., Renaître de ses cendres, se dit des Choses qui prennent une existence nouvelle après avoir été presque entièrement détruites. Cette ville renaît enfin de ses cendres. Au pluriel, il se dit de la Cendre faite de linges qui ont servi à l'autel ou de branches de rameaux bénits et dont le prêtre marque le front des fidèles en forme de croix le premier jour de carême. Recevoir les cendres. Aller prendre les cendres. Le prêtre donne des cendres, les cendres. Le jour des Cendres. Le mercredi des Cendres. Il désigne aussi, poétiquement ou dans le style élevé, les Restes de ceux qui ne sont plus, par allusion à la coutume que les Grecs et les Romains avaient de brûler les morts et d'en recueillir les cendres dans des urnes. La cendre ou les cendres des morts. C'est là que reposent ses cendres chéries. Les cendres de Germanicus furent rapportées en Italie. Le retour des Cendres. Ses cendres furent jetées au vent. Figurément, Honorer les cendres des morts, Honorer leur mémoire. Il ne faut point remuer, il ne faut pas troubler les cendres des morts, Il ne faut point rechercher leurs actions pour les blâmer, pour flétrir inutilement leur mémoire. En termes de Chimie et d'Arts, il se dit en général de Certaines poudres ou résidus qui sont le produit de la combustion ou de quelque autre décomposition analogue. Cendres végétales, cendres animales. Cendres gravelées. Cendres volcaniques. Cendres bleues, Carbonate de cuivre artificiel. Cendre de plomb. Voyez CENDRÉE.
Littré
-
1Poudre qui reste après la combustion du bois et autres matières. Cendre chaude. Faire cuire sous la cendre, dans les cendres. Lessive de cendres, lessive faite avec des cendres. Mettre en cendre, réduire en cendre, brûler.
Leurs trônes mis en cendres
, Corneille, M. de Pomp. I, 1.Brûlez votre recueil et faites-en des cendres
, La Fontaine, On ne s'avise.Cet édifice est réduit en cendres
, Bossuet, Hist. II, 8.Dussé-je après dix ans voir mon palais en cendre?!
Racine, Andr. I, 4.Brûlez le capitole et mettez Rome en cendre
, Racine, Mithr. III, 1.Une ville qui sera mise en cendres comme Troie
, Fénelon, Tél. X.La cendre qui couvre le feu, au propre et au figuré. Le feu couve sous la cendre.
Il ne peut? que se mettre au visage Sur le feu de sa honte une cendre d'ennui
, Malherbe, I, 4.Le feu qui semble éteint souvent dort sous la cendre
, Corneille, Rod. III, 4.Tout cela se préparait et se cuisait sous la cendre, dès le temps que le roi parla à son neveu de ne plus retourner en Espagne
, Saint-Simon, 241, 213.Et tu veux qu'éveillant encore Des feux sous la cendre couverts
, Lamartine, Méd. I, 11. -
2La cendre en tant que signe de deuil, de mortification, au propre et au figuré.
À ces vains ornemens je préfère la cendre
, Racine, Esth. I, 4.Je l'ai trouvé couvert d'une affreuse poussière, Revêtu de lambeaux, tout pâle?; mais son ?il Conservait sous la cendre encor le même orgueil
, Racine, ib. II, 4.Tandis que toute l'Église combat sous la cendre et sous le cilice
, Massillon, Car. Jeûne.Priam, les cheveux souillés de cendres, le visage baigné de pleurs
, Chateaubriand, Génie, II, II, 4.Fig. Faire pénitence avec le sac et la cendre ou dans le sac et la cendre, éprouver une vive affliction de ses péchés, des offenses commises contre Dieu.
Fig.
C'est pourquoi déguisant les bouillons de mon âme, D'un long habit de cendre enveloppant ma flamme, Je cache mon dessein aux plaisirs adonné
, Régnier, Sat. XII.Au plur. Les cendres, cendre des linges de l'autel ou des rameaux bénits dont le prêtre fait une croix au front des fidèles le premier jour de carême. Recevoir, prendre les cendres. Le jour des Cendres, le mercredi des Cendres.
Boniface, donnant les cendres à un archevêque de Gênes, les lui jeta au nez
, Voltaire, M?urs, 65. -
3Reste, débris d'une chose qui a été consumée par le feu ou par ce qui est comparé au feu.
De son vain orgueil les cendres rallumées Poussent déjà dans l'air de nouvelles fumées
, Corneille, M. de Pomp. I, 2.Une autre Rome sort des cendres de la première
, Bossuet, Hist. III, 1.Votre Ilion encor peut sortir de sa cendre
, Racine, Andr. I, 4.Les vices des grands renaissent de leurs cendres
, Massillon, Pet. Car. Vices.L'État renaît pour ainsi dire de sa cendre
, Rousseau, Contr. II, 8. -
4Reste des morts (locution provenant de l'usage des anciens de brûler les cadavres) et, figurément, leur mémoire.
Et qu'ont fait tant d'auteurs pour remuer leur cendre??
Boileau, Sat. IX.Ah?! ranimez les cendres de nos pères
, Massillon, Car. Temples.Gémissez sur les cendres de l'époux qui vous a été enlevé
, Massillon, Or. fun. Villars.On craint que de la s?ur les flammes téméraires Ne raniment un jour la cendre de ses frères
, Racine, Phèd. II, 1.J'ai donné comme toi des larmes à sa cendre
, Voltaire, Alz. I, 4.Que j'unisse ta cendre à celle de ton père
, Chénier, p. 41.Nous respectons les cendres de nos ancêtres, parce qu'une voix nous dit que tout n'est pas éteint en eux
, Chateaubriand, Génie, I, VI, 3.Aime une ombre comme ombre, et de cendres éteintes Éteins le souvenir
, Malherbe, VI, 17.C'est ainsi que la justice divine, justement irritée de notre orgueil, le pousse jusqu'au néant, et que, pour égaler à jamais les conditions, elle ne fait de nous tous qu'une même cendre
, Bossuet, Duch. d'Orl.Ces veuves qui s'ensevelissent, pour ainsi dire, elles-mêmes dans le tombeau de leurs époux, y enterrent tout amour humain avec ces cendres chéries
, Bossuet, Anne de Gonz.Les morts du sein de l'ombre avec terreur s'élancent Pâles, et secouant la cendre des tombeaux
, Gilbert, Jug. dernier.Nous avons cru devoir rendre ce témoignage aux vertus d'un sage dont l'envie n'a point respecté les cendres
, Condorcet, Malouin.Il a dit à la mortelle?: Vite?! éblouis ton amant?; Avant de mourir, sois belle?; Sois un instant étincelle, Puis cendre éternellement
, Hugo, Voix intér. XVII.Il ne faut pas remuer ou troubler les cendres des morts, il ne faut pas dire du mal de ceux qui ne sont plus.
-
5En chimie et dans les arts, certains résidus de la combustion.
Cendre bleue, oxyde de cuivre précipité de la dissolution du sulfate de ce métal par la chaux.
Cendre verte, couleur que les peintres emploient dans les paysages (variété terreuse de carbonate de cuivre).
Cendre gravelée, proprement la cendre des vrilles de la vigne, ou la cendre du sarment?; et par extension et plus particulièrement, le produit de l'incinération du tartre brut ou lie de vin desséchée.
Cendres du Levant, espèce de soude.
- 6Cendre de plomb, le plomb de chasse le plus menu?; on dit plutôt cendrée.
-
7Cendre rouge, variété terreuse de lignite brûlé.
Cendre noire, variété terreuse de lignite à l'état naturel.
PROVERBE
Il faudrait les brûler pour en avoir de la cendre, se dit, pour exprimer la rareté des bons ménages de deux époux excellents l'un pour l'autre.
HISTORIQUE
XIIe s. Je ne pris [prise] pas plein poing de cendre Ta menace ne ton orgueil
, la Charrette, 799. E vestirent eaus [eux] de haires, e mistrent cendres sor lor chef
, Machab. I, 3. D'ire [il] devint vermeilz plus que carbuns sur cendre
, Th. le mart. 44.
XIIIe s. A l'entrée de quaresme, après ce que on prent cendres
, Villehardouin, VI, . Por cel païs qu'il voloit prendre Et les cités livrer à cendre
, Fl. et Bl 63. De toute teinture fors de graine en charrete un denier?; neis [même] se il i a cendre clavelée qui appartient à teinture?
, Liv. des mét. 284. Encor te veuil assez aprendre De mesler tainture avec cendre
, Ren. 12040. Bien le doit-on ardoir en cendre
, ib. 9617.
XVIe s. Abattant boys, bruslant les grosses souches pour la vente des cendres
, Rabelais, Pant. II, 2. Elle se resoult en pouldre comme feroit de la chaux vive ou de la cendre, qui la fouleroit
, Amyot, Sertor. 23. Mieulx vault la cendre divine Que du monde la farine
, Leroux de Lincy, Proverbes, t. I, p. 6. S'il ne s'en trouve après une exacte et diligente recherche, il faudra executer sur toutes sortes de meubles jusques aux cendres du feu, avant qu'en venir aux immeubles
, Nouveau coustumier génér. t. II, p. 1094.
Encyclopédie, 1re édition
CENDRE au sing. ou CENDRES au plur. s. f. (Chimie.) Ce corps terreux, sec, & pulverulent, que tout le monde connoît sous le nom de cendre, est le résidu, ou la partie fixe des matieres détruites par la combustion à l'air libre, ou par l'inflammation. Voyez Calcination.
Les cendres sont donc toûjours des débris d'une substance à la formation de laquelle concouroit le phlogistique, ou le feu, & ordinairement d'un corps organisé, ou de ceux que nous connoissons, dans la doctrine de Stahl, sous le nom de tissu, textum, c'est-à-dire d'un végétal, ou d'un animal. Voyez Tissu.
On a rangé aussi sous le nom générique de cendre, les substances métalliques privées de phlogistique ; c'est ainsi qu'on a dit cendre d'étain, cendre de plomb, &c. & qu'on trouve, sur-tout dans les anciens auteurs, diverses calcinations de substances métalliques désignées par le nom d'incinération ou cinération : mais les chaux métalliques différent assez essentiellement des cendres végétales & animales, pour qu'il soit plus exact de ne pas confondre les unes & les autres sous la même dénomination. Voyez Chaux métallique.
Un végétal ou un animal n'est, pour un Chimiste, qu'une espece d'édifice terreux cimenté par un mastic ou gluten inflammable, & distribué en différentes loges, ou vaisseaux de diverses capacités, qui contiennent des composés de plusieurs especes, tous inflammables ; car nous ne considérons ni dans les végétaux, ni dans les animaux, relativement à leur analyse ou décomposition réelle, nous ne considérons point, dis-je, le véhicule aqueux, qui étend & distribue (dans le vivant) la matiere de la nutrition & des sécretions. Voyez Végétale. (Analyse.)
C'est aux ruines de cet édifice, de la base terreuse, du soûtien (hypostasis) de nos tissus, qu'est dûe la portion la plus considérable de la matiere propre, de la terre de leurs cendres. L'autre portion (infiniment moindre) de cette terre, est fournie par les composés terreux détruits par l'inflammation, & même par quelques mixtes qui n'ont pû échapper à son action. Voyez Végétale. (Analyse.)
Outre la terre dont nous venons de parler, les cendres végétales contiennent presque toutes (on a dit toutes, mais on peut raisonnablement douter que ce produit de l'analyse des végétaux soit absolument général, je dis des végétaux même non épuisés par des extractions) du sel fixe, alkali fixe ou lixiviel, & ordinairement des sels neutres. Le tartre vitriolé & le sel marin sont les seuls que l'on ait observés jusqu'à présent.
Les sels fixes des cendres animales ne sont point encore, malgré l'autorité de plusieurs Chimistes respectables, des êtres dont l'existence soit généralement admise en Chimie. Ces sels, s'ils existoient, seroient sans doute fort analogues à ceux qu'on a tant cherchés dans la chaux ; ou, pour mieux dire, seroient de vrais sels de chaux, sur lesquels il s'en faut bien qu'on ait jusqu'à présent des notions assez claires.
Les cendres, tant les végétales que les animales, contiennent assez généralement du fer. M. Geoffroi a proposé dans les Mém. de l'acad. royale des Sc. en 1705. le problème suivant : trouver des cendres qui ne contiennent aucunes parcelles de fer ; ce n'est que des cendres végétales dont il parle. Ce problème n'a pas encore été résolu, que je sache ; plusieurs Chimistes illustres, entr'autres M. Henckel, & M. Lemery le fils, ont confirmé, au contraire, le sentiment qui en suppose dans tous les végétaux. Le bleu de Prusse, qu'on peut retirer de presque toutes les cendres, que les soudes sur-tout fournissent ordinairement en très grande abondance, est un signe certain de la présence de ce métal, du fer dans les cendres.
La cendre ne differe du charbon que par le phlogistique qui lie les parties de ce dernier, au lieu du gluten dont nous avons parlé plus haut. Voyez Charbon. Les cendres paroissent avoir toûjours passé par l'état de charbon, ensorte que tout composé qui ne donnera que peu ou point de charbon dans les vaisseaux fermés, comme la résine pure, ne donnera que peu ou point de cendres par l'ustion à l'air libre.
La cendre ou la terre qui reste de la destruction des végétaux & des animaux, est une portion peu considérable de leur tout. Cent livres de différens bois neufs, très-secs, brûlés avec le soin nécessaire, pour ne perdre que la terre qui est inévitablement entraînée dans la fumée, n'ont laissé que trois livres dix onces de cendres calcinées, à peu-près un trentieme de leur poids. Ce produit doit varier considérablement selon que le corps qui le fournit est plus ou moins terreux, plus ou moins dense, plus ou moins épuisé de ses sucs, &c. C'est ainsi que les écorces en général, & sur-tout les écorces des vieux troncs, doivent en fournir beaucoup plus qu'une plante aqueuse, ou un fruit pulpeux ; les plantes abondantes en extrait amer, beaucoup plus que les plantes résineuses ; un os beaucoup plus qu'un viscere, &c. Il est telle plante aqueuse dont on peut séparer par la simple dessiccation, jusqu'à de son poids, qui par conséquent dans cet état de secheresse, étant supposée, toutes choses d'ailleurs égales, d'une densité pareille à celle du bois dont nous avons parlé, ne donneroit que le de son poids de cendre. Ceux qui seront curieux de connoître avec détail le rapport du produit dont il s'agit, au corps dont il faisoit partie, peuvent consulter les analyses des premiers Chimistes de l'académie royale des sciences, & celles de la matiere médicale de M. Geoffroy.
La cendre ou la terre végétale & la terre animale conservent chacune inaltérablement un caractere, & comme le sceau de leur regne respectif. La terre végétale, selon l'observation de Becher, porte toûjours dans le verre à la composition duquel on l'employe, une couleur verte, ou tirant foiblement sur le bleu. « Viridis vel subcæruleus, indelebilem sui regni asteriscum servans, nempè vegetabilem viriditatem exprimens ». Et la terre animale une couleur de blanc de lait. C'est à la suite de cette observation que le même Becher forme très-sérieusement ce souhait singulier : « O utinam ita consuetum foret, & amicos haberem qui ultimam istam opellam, siccis, & multis laboribus exhaustis ossibus meis, aliquando præstarent, qui inquam eam in diaphanam illam, nullis sæculis corruptibilem substantiam redigerent, suavissimum sui generis colorem, non quidem vegetabilium virorem, tremuli tamen narcissuli ideam lacteam præsentantem, quod paucis quidem horis fieri posset? Plût à Dieu que ce fût un usage reçû, & que j'eusse des amis qui me rendissent ce dernier devoir, qui, dis-je, convertissent un jour mes os secs, & épuisés par de longs travaux, en cette substance diaphane, que la plus longue suite de siecles ne sauroit altérer, & qui conserve sa couleur générique, non la verdure des végétaux, mais cependant la couleur de lait du tremblant narcisse ; ce qui pourroit être exécuté en peu d'heures, &c. »
M. Pott observe dans sa Lithogeognosie, des différences réelles & caractéristiques dans les terres calcaires & alkalines tirées des trois regnes, & même parmi les différentes terres du même regne, comme entre la craie & la marne, entre l'ivoire, la corne de cerf, les écailles d'huîtres, &c. soit pour le degré de fusibilité, soit pour le plus ou le moins de facilité à être portées à la transparence. Apparemment qu'on trouveroit aussi des différences essentielles entre les cendres lessivées de divers végétaux.
Ces observations prouvent suffisamment que les terres des cendres végétales ou animales, ne sont pas des corps simples, ou qu'on n'est pas encore parvenu à les réduire à la simplicité élémentaire, pas même à la simplicité générique des terres alkalines ou calcaires, dans la classe desquelles on les range ; classe dont, pour le dire en passant, le caractere propre n'existe seul dans aucun sujet connu, ou qui est toûjours modifié dans chacun de ces sujets par des qualités particulieres (qualités qui, dans la doctrine Chimique, sont toûjours des substances ou des êtres physiques (Voyez Chimie) si intimement inhérentes qu'on n'a jamais pû jusqu'à présent simplifier les différentes terres calcaires, au point de les rendre exactement semblables, comme on peut amener à cette ressemblance parfaite les eaux tirées de différentes plantes, ou même celles qu'on tire des différens regnes, les phlogistiques des trois regnes, &c. Voyez Terre.
La fameuse opinion de la résurrection des plantes & des animaux de leurs cendres, qui a tant exercé les savans sur la fin du dernier siecle, & au commencement de celui-ci, ne trouveroit à présent sans doute des partisans que très-difficilement. Voyez Palingenesie.
La terre des cendres entre très-bien en fusion, & se vitrifie avec différens mêlanges, mais sur-tout avec les terres vitrifiables & les alkalis fixes. C'est par cette propriété que les cendres végétales non lessivées, comme les cendres de fougere, les cendres de Moscovie, celles du varec, la soude, &c. sont propres aux travaux de la Verrerie. Voyez Verre.
Les cendres lessivées fournissent aux Chimistes des intermedes & des instrumens, tels que le bain de cendre, & la matiere la plus usitée des coupelles. Voyez Intermede & Coupelle.
Le sel lixiviel ou alkali fixe retiré des cendres des végétaux, est d'un usage très-étendu dans la Chimie physique, & dans différens arts chimiques. Voyez Sel lixiviel.
C'est à ce dernier sel que les cendres doivent leur propriété de blanchir le linge, de dégraisser les étoffes, les laines, &c. Voyez Blanchissage, Sel lixiviel, Menstrue. C'est parce que la plus grande partie, ou au moins la partie la plus saline de la matiere qui fournit ce sel dans l'ustion, a été enlevée par l'eau, au bois flotté, que les cendres de ce bois sont presque inutiles aux blanchisseuses. Voyez Extrait.
Les cendres non lessivées sont employées aussi dans la fabrication du nitre, mais apparemment ne lui fournissent rien le plus souvent, contre l'opinion commune. Voyez Nitre. Cet article est de M. Venel.
* Cendres, (Agriculture.) les cendres sont un fort bon amendement, de quelque matiere & de quelque endroit qu'elles viennent, soit du foyer, soit de lessive, du four à pain, à charbon, à tuile, à chaux, & d'étain ; elles conviennent assez à toutes sortes de terre. On les mêle avec le fumier, pour qu'il s'en perde moins. Quand un champ est maigre, il est assez ordinaire d'y mettre le feu, & de l'engraisser des cendres mêmes des mauvaises herbes qu'il produit, si elles sont abondantes : on le laboure aussi-tôt. On en use de même quand on a des prés stériles & usés ; ou bien on en enleve la surface qu'on transporte par pieces de gasons dans d'autres terres, où on les brûle. Voyez Engrais des terres & Agriculture.
Cendre, pluie de cendres, (Physique.) Dans les Transactions philosophiques il est fait mention d'une ondée ou pluie de cendres dans l'Archipel, qui dura plusieurs heures, & qui s'étendit à plus de cent lieues. Voyez Pluie. Ce phénomene n'a rien de surprenant, puisqu'il est très-possible que lorsqu'il y a quelque part un grand incendie, ou un volcan, le vent pousse les cendres, ou peut-être la poussiere de cet endroit dans un autre, même assez éloigné. (O)
* Cendre de cuivre, (Métallurgie.) c'est une espece de vapeurs de grains menus que le cuivre jette en l'air dans l'opération du rafinage. On peut recevoir cette vapeur en retombant, en passant une pelle de fer, à un pié ou environ au-dessus de la surface du cuivre qui est alors dans un état de fluidité très-subtile. Voyez l'article Cuivre.
Cendres gravelées, (Chimie.) elles se font avec de la lie de vin : voici suivant M. Lemery la façon dont on s'y prend. Les Vinaigriers séparent par expression la partie la plus liquide de la lie de vin, dont ils se servent pour faire le vinaigre ; du marc qui leur reste, ils forment des pains ou gâteaux qu'ils font sécher ; cette lie ainsi séchée se nomme gravelle ou gravelée : ils la brûlent ou calcinent à feu découvert dans des creux qu'ils font en terre, & pour lors on lui donne le nom de cendres gravelées. Pour qu'elles soient bonnes, elles doivent être d'un blanc verdâtre, en morceaux, avoir été nouvellement faites, & être d'un goût fort âcre & fort caustique. L'on s'en sert dans les teintures pour préparer les laines ou les étoffes à recevoir la couleur qu'on veut leur donner. Voyez Teinture. On les employe aussi à cause de leur causticité dans la composition de la pierre à cautere, qui se fait avec une partie de chaux vive, & deux parties de cendres gravelées. Voyez Cautere.
Suivant M. Lemery, la cendre gravelée contient un sel alkali qui ressemble fort au tartre calciné : mais il est chargé de plus de parties terrestres que le tartre, & ne contient point autant de sel volatil que lui ; ce qui ne paroît point s'accorder avec ce que le même auteur dit dans un autre endroit, que le sel qui se tire des cendres gravelées, est beaucoup plus pénétrant que l'autre tartre, & par conséquent plus propre à faire des caustiques.
La plûpart des auteurs s'accordent à dire que les cendres gravelées s'appellent en Latin cineres clavellati ; sur quoi l'on a cru devoir avertir que le célebre Stahl, & généralement tous les Chimistes Allemands, par cineres clavellati, ont voulu désigner la potasse, qui n'est point de la lie de vin brûlée comme les cendres gravelées que l'on vient de décrire dans cet article. Il est vrai que la potasse & la cendre gravelée ont beaucoup de propriétés qui leur sont communes ; l'une & l'autre contiennent du sel alkali, & peuvent s'employer à peu de chose près aux mêmes usages ; mais ces raisons ne paroissent point suffisantes pour autoriser à confondre ces deux substances.
Si l'on a raison de distinguer la cendre gravelée, qui est produite par l'ustion de la lie de vin, d'avec le vrai tartre calciné ; doit-on mettre moins de différence entre cette même lie de vin brûlée, & des cendres d'arbres telle qu'est la potasse ? Voyez Potasse. Le Miscellanea chimica Leydensia appelle cineres clavellati, les cendres de sarmens de vigne brûlés en plein air. Autrefois l'on donnoit aussi ce nom aux cendres de barrils ou tonneaux que l'on brûloit : mais comme il étoit difficile d'en retirer de cette maniere autant que l'on en avoit besoin, on a préféré de se servir de la potasse que l'on pouvoit avoir en plus grande abondance. (?)
Cendre Bleue. Voyez Bleu.
Cendres vertes, (Hist. nat. & Minéralogie.) le nom de cendres a été donné fort improprement à cette substance, qui est une vraie mine de cuivre, d'une consistance terreuse, dont la couleur est d'un verd tantôt clair, tantôt foncé ; on l'appelle en Latin ærugo nativa terreæ. Voyez l'article Verd de montagne. (?)
Cendres de roquette, (Chimie & Art de la Vernerie.) on les nomme aussi poudre de roquette, cendres de Sirie ou du Levant. Neri dit dans son Art de la Verrerie, que la roquette est la cendre d'une plante qui croît abondamment en Egypte & en Syrie, surtout près des bords de la mer. Cette plante n'est autre chose que le kali ; on la coupe vers le milieu de l'été lorsqu'elle est dans sa plus grande force ; on la fait sécher au soleil ; on la met en gerbes que l'on entasse les unes sur les autres, & que l'on brûle ensuite pour en avoir les cendres : ce sont ces cendres que l'on nous envoye du Levant, & surtout de S. Jean d'Acre & de Tripoli ; les Verriers & les Savonniers s'en servent ; elles sont chargées d'un sel très acre & très-fixe que l'on en retire par la méthode ordinaire des lessives & des crystallisations, ou en en faisant évaporer la lessive à siccité. On faisoit autrefois un très-grand cas du sel tire de ces cendres ; soit qu'on lui attribuât plus de force qu'à d'autre, à cause du climat chaud qui le produit, soit que l'éloignement du pays d'où l'on tiroit cette marchandise contribuât à en rehausser le prix : mais Kunckel nous avertit dans ses notes sur l'Art de la Verrerie de Neri, que la soude, la potasse, ou toutes sortes de cendres fournissent un sel aussi bon pour les usages de l'art de la Verrerie, que celui que l'on peut tirer de la roquette, pourvû que ce sel ait été convenablement purifié par de fréquentes solutions, évaporations, & calcinations. (?)
* Cendres, (Hist. anc.) reste des corps morts brûlés, selon l'usage des anciens, Grecs & Romains : on comprend aisément qu'ils pouvoient reconnoître les ossemens ; mais comment séparoient-ils les cendres du corps d'avec celles du bûcher ? Ils avoient, dit le savant pere Montfaucon, plusieurs manieres d'empêcher qu'elles ne se confondissent ; l'une desquelles étoit d'envelopper le cadavre dans la toile d'amiante ou lin incombustible, que les Grecs appellent asbestos. On découvrit à Rome en 1702 dans une vigne, à un mille de la porte majeure, une grande urne de marbre, dans laquelle étoit une toile d'amiante : cette toile avoit neuf palmes romains de longueur, & sept palmes de largeur ; c'est environ cinq piés de large, sur plus de six & demi de long. Elle étoit tissue comme nos toiles ; ses fils étoient gros comme ceux de la toile de chanvre ; elle étoit usée & salle comme une vieille nappe de cuisine ; mais plus douce à manier & plus pliable qu'une étoffe de soie. On trouva dans cette toile des ossemens, avec un crane à demi-brûlé. On avoit mis sans doute dans cette toile le corps du défunt, afin que ses cendres ne s'écartassent point, & ne se mêlassent pas avec celles du bûcher, d'où on les retira pour les transporter dans la grande tombe. On jetta cette toile dans le feu, où elle resta long-tems sans être brûlée ni endommagée. Le pere Montfaucon qui semble promettre plusieurs manieres de séparer les cendres du mort de celles du bûcher, n'indique pourtant que celle-ci. On rapportoit les cendres de ceux qui mouroient au loin, dans leur pays ; & il n'étoit pas rare d'enfermer les cendres de plusieurs personnes dans une même urne. Voyez Bûcher, Funérailles, Urne, Tombeau, &c.
Wiktionnaire
Nom commun - ancien français
cendre \Prononciation ?\ féminin
-
Cendre.
-
Hom n'i trovat ren fors cendre ? (La vie de saint Georges, édition de Matzke, p. 46, fin du XIIe siècle)
- On n'y trouva rien à part de la cendre
-
Hom n'i trovat ren fors cendre ? (La vie de saint Georges, édition de Matzke, p. 46, fin du XIIe siècle)
Nom commun - français
cendre \s??d?\ féminin
-
Résidu pulvérulent de la combustion du bois et d'autres matières organiques.
- L'homme des anciens jours se hâta d'allumer du feu avec des lianes sèches ; il brisa du maïs entre deux pierres, et en ayant fait un gâteau, il le mit cuire sous la cendre. ? (François-René de Chateaubriand, Atala, ou Les Amours de deux sauvages dans le désert)
- Devant la demeure des deux vieilles amies, le vent frais achève de disperser la cendre du foyer éteint, qu'elle emporte en un petit tourbillon bleuâtre. ? (Isabelle Eberhardt, Pleurs d'amandiers, 1903)
- Celui-ci, calme, se leva, chassa d'une chiquenaude une petite parcelle de cendre de cigare tombée sur son pantalon, et prenant son chapeau [?] ? (Octave Mirbeau, Contes cruels : Le Colporteur)
- L'acier peut également être obtenu par déferraillage des cendres d'incinération, mais avec une perte liée à l'oxydation pendant la combustion. La production d'acier à partir de ces ferrailles récupérées nécessite deux fois moins d'énergie que la fabrication à partir de minerai [?] ? (Bruno Peuportier, Éco-conception des bâtiments : bâtir en préservant l'environnement, Presses de l'École des Mines, Paris, 2003, page 33)
-
(Au pluriel) (Religion) Cendre faite de linges qui ont servi à l'autel ou de branches de rameaux bénits et dont le prêtre catholique marque le front des fidèles en forme de croix le premier jour de carême.
- Tout alla bien d'abord, mais lorsque l'heure vint de frotter de cendres le front de ses paroissiens en leur répétant la formule latine consacrée?: Memento quia pulvis es, « Souviens-toi que tu n'es que poussière », il se troussa vivement afin d'atteindre dans sa poche la petite boîte métallique préparée et contenant la poudre grise nécessaire à la cérémonie. ? (Louis Pergaud, Le Sermon difficile, dans Les Rustiques, nouvelles villageoises, 1921)
-
(Soutenu) (Au pluriel) Restes des défunts, par allusion à la coutume que les Grecs et les Romains avaient de brûler les morts et d'en recueillir les cendres dans des urnes.
- Celui qui, se trouvant à la Mecque, irait insulter aux cendres de Mahomet, renverser ses autels, et troubler toute une mosquée, se ferait empaler, à coup sûr, et ne serait peut-être pas canonisé. ? (Denis Diderot, Pensées philosophiques, texte établi par J. Assézat, Garnier, 1875-77)
- Indiens infortunés que j'ai vus errer dans les désert du Nouveau-Monde, avec les cendres de vos aïeux, vous qui m'aviez donné l'hospitalité malgré votre misère, je ne pourrais vous la rendre aujourd'hui, car j'erre, ainsi que vous, à la merci des hommes ; et moins heureux dans mon exil, je n'ai point emporté les os de mes pères. ? (Chateaubriand, Atala, 1801)
- [?] on voulut poursuivre la monarchie jusqu'à sa source, les monarques jusque dans leur tombe, jeter au vent la cendre de soixante rois. ? (Alexandre Dumas, Les Mille et Un Fantômes)
- Le neveu de l'empereur profita de ce qu'on allait rapatrier les cendres de son oncle pour débarquer à Boulogne. ? (Alfred Barbou, Les Trois Républiques françaises, A. Duquesne, 1879)
- Il est affreux et étrange de penser à tous ces hommes, à toutes ces femmes qui n'ont rien à raconter, qui n'envisagent d'autre destin futur que de se dissoudre dans un vague continuum biologique et technique (parce que c'est technique les cendres, même lorsqu'elles ne sont destinées qu'à servir d'engrais, il faut évaluer les taux de potassium et d'azote). ? (Michel Houellebecq, Sérotonine, Flammarion, 2019, page 189.)
- (Au singulier) ? On citait d'elles plusieurs beaux traits dont la cendre de Montyon avait dû tressaillir dans son beau cénotaphe. ? (Auguste de Villiers de L'Isle-Adam, Les Demoiselles de Bienfilâtre, dans les Contes cruels, 1883, éd. J. Corti, 1954, vol. 1, page 5)
-
(Fusion nucléaire) (Au pluriel) Résidu des réactions de fusion.
- Pour la réaction de référence deutérium-tritium, les cendres sont de l'hélium.
-
(Art, Chimie) Poudre ou résidu qui sont le produit de la combustion ou de toute autre décomposition analogue.
- Cendres végétales, animales. Cendres gravelées, volcaniques.
-
(Art) Variété de couleur utilisée en peinture.
- Cendre bleue, cendre verte, cendre d'outremer.
- Qualifie une chose qui possède la couleur ou les caractéristiques physiques de la cendre.
- Cheveux cendre : Cheveux gris-bleu.
-
Accroche-c?ur ?
Aux larmes de cendre,
elle regarda
la rouflaquette de l'écrin,
souvenir
d'une époque crépusculaire,
peu avant le début
?
de sa chimiothérapie.
? (Cornéliu Tocan, Chutes microscopiques. 50 micronouvelles illustrées, Créatique, Québec, 2020, pages 13-14)
Trésor de la Langue Française informatisé
CENDRE, subst. fém.
Cendre au Scrabble
Le mot cendre vaut 9 points au Scrabble.
Informations sur le mot cendre - 6 lettres, 2 voyelles, 4 consonnes, 5 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot cendre au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
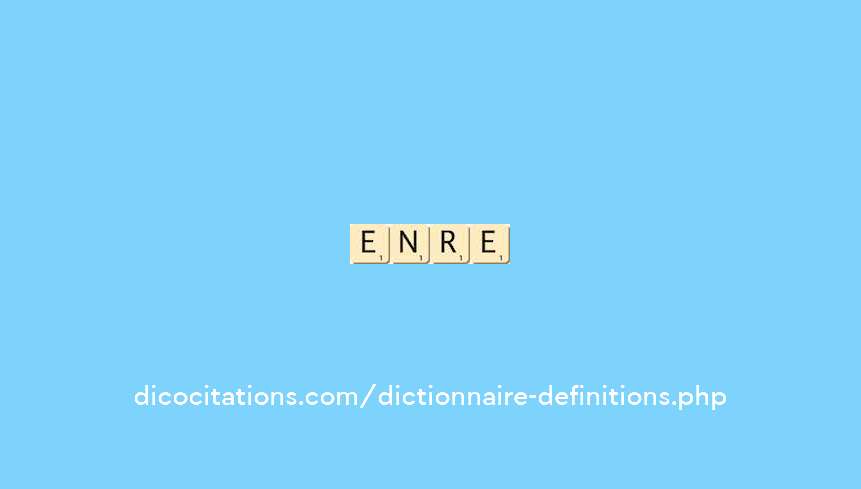
Les mots proches de Cendre
Cénacle Cendal Cendraille Cendre Cendré, ée Cendrée Cendreuse Cendreux, euse Cendrier Cendrure Cène Cenelle Cénobite Cénobitique Cénobitisme Cens Censal Cense Censé, ée Censeur Censier Censive Censorial, ale Censuel, elle Censurable Censure Censurer Cent Centaine Centaure Centaurée Centenaire Centenier Centennal, ale Centième Centinode Centon Centration Centre Centrifuge Centripète Centuple Centuriateur Centurie Centuriés Centurion Cénac Cénac-et-Saint-Julien cénacle cénacles Cenans cendraient cendrait Cendras cendre cendré cendré Cendre Cendrecourt cendrée cendrée cendrée cendrées cendrées cendrées cendres cendrés cendrés cendreuse cendreuses cendreux Cendrey cendrier cendriers Cendrieux cendrillon cendrillons cène Cénevières Cenne-Monestiés cénobite cénobites Cenon Cenon-sur-Vienne cénotaphe cens censé Censeau censée censées censément Censerey censés censeur censeurs censierMots du jour
Rigri Imbiber Inébriatif, ive Végétant, ante Systématisation Mésinterpréter Calfat Follet, ette Contranché, ée Raccroché, ée
Les citations avec le mot Cendre
- Ah ! descendre les cheveux en bas, les membres à l'abandon dans la blancheur du rapide. De quels cordiaux disposez vous ? J'ai besoin d'une troisième main, comme un oiseau, que les autres n'endorment pas.Auteur : André Breton - Source : Les Champs magnétiques (1920)
- Il y a du feu dans l'âtre, mais le vent a embouché la cheminée et il souffle sa musique avec de la fumée, des cendres volantes et en aplatissant la flamme.Auteur : Jean Giono - Source : Regain (1930)
- Comme le feu, la vie débute par la fumée et finit par la cendre.Auteur : Proverbes arabes - Source : Proverbe
- Une sorte de boutade vient de me passer par la tête. Vous m'avez demandé pourquoi j'ai écrit. Après vous avoir parlé de l'intelligence, de la conscience et du subconscient, j'ai presque envie de vous répondre que j'ai peut-être écrit parce que depuis ma tendre enfance je suis somnambule. Enfant, j'avais des barreaux à la fenêtre de ma chambre parce que, certaines nuits, on m'a retrouvé en chemise au coin de la rue. Il m'arrivait de redescendre la nuit pour refaire le devoir que j'avais déjà fait dans la soirée. Je suis toujours somnambule aujourd'hui. Je ne veux pas dormir tout seul. Je ne peux pas dormir sans être gardé. Auteur : Georges Simenon - Source : Conversations avec Simenon de Francis Lacassin (2004)
- C'est tout ce que j'ai à donner, à chercher, à espérer dans la vie; c'est aussi ma destruction, le rien qui m'envahit, la dispersion de ma cendre.Auteur : François Taillandier - Source : Anielka (1999)
- Quoi! Rome et l'Italie en cendre
Me feront honorer Sylla?
J'admirerai dans Alexandre
Ce que j'abhorre en Attila?Auteur : Jean-Baptiste Rousseau - Source : Odes, II, 6, A la Fortune - (A propos d'Edith Cresson) A force de descendre dans les sondages, elle va finir par trouver du pétrole.Auteur : André Santini - Source : Sans référence
- Vous pouvez descendre, dit-il aux Irlandais. Vous êtes en sécurité, en tout cas tant que vous mangez pas la cuisine d'ici. Auteur : Larry McMurtry - Source : Lonesome Dove (1990)
- Il les avoit priés d'empescher que Timoleon ne peust descendre et prendre terre en la Sicile, à fin que, quand ce secours là en seroit exclus, ils peussent à leur aise departir entre eulx toute la Sicile.Auteur : Jacques Amyot - Source : Timoléon, 12
- Tu éprouveras l'amère saveur qu'a le pain d'autrui, et comme il est dur de monter et descendre les escaliers d'autrui.Auteur : Dante - Source : La Divine Comédie, Le Paradis
- On y alimente ses rêveries en entendant le grillon - cette cigale de l'âtre de l'homme, - qui chante dans la cendre chaude, comme la cigale de l'été chante dans les blés brûlés de soleil.Auteur : Jules Amédée Barbey d'Aurevilly - Source : Une vieille maîtresse (1851)
- Un jour on voudrait mourir et le lendemain on réalise qu'il suffisait de descendre quelques marches pour trouver le commutateur et y voir un peu plus clair...Auteur : Anna Gavalda - Source : Ensemble, c'est tout (2004)
- Il est facile de monter sur ses grands chevaux, mais essayez donc d'en descendre gracieusement!Auteur : Franklin Jones - Source : Sans référence
- On se tient mieux sur l'échelle sociale par la crainte d'en descendre que par l'envie d'y monter.Auteur : Jean Antoine Petit, dit John Petit-Senn - Source : Bluettes et boutades (1846)
- A les entendre on dirait que l'objet de notre génération c'est de monter la femme et de descendre l'homme.Auteur : Paul Neuhuys - Source : Le Canari et la Cerise (1921)
- Quand l'homme a passé, les monuments de sa vie sont encore plus vains que ceux de sa mort: son mausolée est au moins utile à ses cendres; mais ses palais gardent-ils quelque chose de ses plaisirs?Auteur : François-René de Chateaubriand - Source : Itinéraire de Paris à Jérusalem
- Loi de Murphy: Tout ce qui monte finit par descendre.Auteur : Bernard Werber - Source : Nous les Dieux (2004)
- Je sais pourquoi là-bas le volcan s'est rouvert... - C'est qu'hier tu l'avais touché d'un pied agile, - Et de cendres soudain l'horizon s'est couvert.Auteur : Gérard de Nerval - Source : Les Chimères, Myrtho
- Voici comment ça s'est passé : j'étais si déprimé que je voulais mourir. je n'arrivais pas à me secouer, à changer. Alors j'ai pensé à me faire descendre par la police, parce que si je m'en chargeais, ce serait un vrai carnage.Auteur : Joyce Carol Oates - Source : Eux (1985)
- Le mal que font les hommes vit après eux : le bien est souvent enseveli avec leurs cendres.Auteur : William Shakespeare - Source : Jules César (1599), III, 3, Antoine
- Suivre la pente de la vertu, c'est monter ; suivre celle du vice, c'est descendre.Auteur : Proverbes chinois - Source : Proverbe
- Descendre par l'étroite, horizontale porte
Où l'on passe étendu, voilé, silencieux ;
Ne plus jamais vous voir, ô Lumière des cieux.
Hélas ! Je n'étais pas faite pour être morte.Auteur : Anna de Noailles - Source : Les Eblouissements (1907), I. Les terres chaudes - C'est à voix basse qu'on enchante - Sous la cendre d'hiver - Ce coeur, pareil au feu couvert - Qui se consume et chante.Auteur : Paul-Jean Toulet - Source : Les Contrerimes (1979)
- A quoi a servi à tant d'hommes qui maintenant sont au tombeau, réduits en cendres, d'avoir eu des inimitiés, des soupçons, des querelles?Auteur : Alphonse Rabbe - Source : Sans référence
- Ce n'était pas sur les Boches qu'il fallait tirer, mais sur les généraux et tous les officiers. Il fallait descendre tous ceux qui seraient assez lâches pour marcher au front.Auteur : Maurice Barrès - Source : Mes Cahiers, XI, 1918
Les citations du Littré sur Cendre
- Comment elle et son mari pouvaient descendre à leurs domestiques sans que ceux-ci fussent tentés de s'égaler à eux à leur tourAuteur : Jean-Jacques Rousseau - Source : Hél. IV, 10
- Quoi ! Rome et l'Italie en cendre Me feront honorer Sylla !Auteur : J. B. ROUSS. - Source : Ode à la Fort.
- Monseigneur descendit, le roi voulut descendre aussi ; monseigneur lui embrassa les genoux ; le roi lui dit : ce n'est pas ainsi que je veux vous embrasser ; et sur cela bras dessus, bras dessous, avec tendresse de part et d'autreAuteur : Madame de Sévigné - Source : 488
- Descendre de tierce, et remonter d'un degréAuteur : GRÉTRY - Source : Méth. pour prél. p. 92, dans POUGENS
- Le feu luy ayant faict fondre la cervelle [à un condamné au bûcher] et descendre par les nazeaux, il l'essuya de ses deux mains liées, et parla encore au peuple aprèsAuteur : D'AUB. - Source : Hist. I, 72
- Les François ayant, n'a pas longtemps, commencé à faire les verres crystallins, ont faict servir le sablon d'Estempes au lieu des cailloux du Tessin, que les ouvriers ont trouvé meilleur que ledict caillou de Pavie ; mais ils n'ont encore sceu inventer chose qui puisse servir au lieu de la susdicte cendre [la soude d'Égypte]Auteur : DE LABORDE - Source : Émaux, p. 539
- L'on voit descendre des montagnes du Nord des rats en multitude innombrable qui, comme un déluge ou plutôt comme un débordement de substance vivante, viennent inonder les plaines....Auteur : BUFF. - Source : ib. t. II, p. 98
- Nous avons cru devoir rendre ce témoignage aux vertus d'un sage dont l'envie n'a point respecté les cendresAuteur : CONDORCET - Source : Malouin.
- Il nous convint descendre en la terre de nos ennemis pour fere feu et cuire viande, pour les enfants repestre et alaitierAuteur : JOINV. - Source : 282
- Mais une terre est détruite, mais le château, les souvenirs, les monuments, l'histoire... les monuments se conservent où les hommes ont péri, à Balbek, à Palmyre et sous la cendre du VésuveAuteur : P. L. COUR. - Source : Lett. V
- A l'entrée de quaresme, après ce que on prent cendresAuteur : VILLEH. - Source : VI,
- Le ventricule qui est laxe et resout, peut descendre jusques dessous le nombrilAuteur : PARÉ - Source : I, 14
- Mais, oh ! que mollement reposera ma cendre....Auteur : A. CHÉN. - Source : Élégies, IX.
- Ah ! ranimez les cendres de nos pèresAuteur : MASS. - Source : Car. Temples.
- Une autre Rome sort des cendres de la premièreAuteur : BOSSUET - Source : Hist. III, 1
- Il faut que je m'acquitte Des funèbres tributs que sa cendre mériteAuteur : Voltaire - Source : Oedipe, V, 2
- Votre Ilion encor peut sortir de sa cendreAuteur : Jean Racine - Source : Andr. I, 4
- Elle aimait trop le bal, c'est ce qui l'a tuée ; Le bal éblouissant, le bal délicieux ! Sa cendre encor frémit doucement remuée, Quand, dans la nuit sereine, une blanche nuée Danse autour du croissant des cieuxAuteur : Victor Hugo - Source : Orient. 33
- S'il faut descendre aux minuties avec une femmeAuteur : BOSSUET - Source : Lett. quiét. 35
- La squille cuite sous la cendreAuteur : PARÉ - Source : XXIII, 23
- Feu bien couvert, comme dit ma bru, Par sa cendre est entretenuAuteur : LEROUX DE LINCY - Source : Prov. t. I, p. 69
- Des cendres de la racine d'asphrodillesAuteur : O. DE SERRES - Source : 971
- Faut-il errer dans les tombeaux d'Athène, Ou réveiller la cendre des Latins ?Auteur : GRESSET - Source : Épître Mus.
- En regardant de loin fumer leurs villes et leurs maisons réduites en cendre, ils pleuraient la mort de leurs proches et la désolation de leur paysAuteur : FLÉCH. - Source : Hist. de Théodose, I, 32
- Elle va descendre à ces sombres lieux, à ces demeures souterraines, pour y dormir dans la poussière avec les grands de la terre, avec ces rois et ces princes anéantis....Auteur : BOSSUET - Source : Duch. d'Ort.
Les mots débutant par Cen Les mots débutant par Ce
Une suggestion ou précision pour la définition de Cendre ? -
Mise à jour le mercredi 11 février 2026 à 03h42
Dictionnaire des citations en C +
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur cendre
Poèmes cendre
Proverbes cendre
La définition du mot Cendre est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Cendre sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Cendre présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.


