La définition de Enfer du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Enfer
Nature : s. m.
Prononciation : an-fèr
Etymologie : Bourg. enfar ; picard, infer ; provenç. infern, yfern, enfern, effern ; catal. infiern ; espagn. infierne ; ital. inferno ; du latin infernus, enfer, proprement lieu bas (voy. ).
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de enfer de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec enfer pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Enfer ?
La définition de Enfer
Terme des anciennes religions polythéistiques. Lieu souterrain qu'habitaient les âmes des morts. Les enfers comprenaient le Tartare pour les méchants, et les Champs-Élysées pour les justes.
Toutes les définitions de « enfer »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Lieu destiné au supplice des damnés. Il est opposé à Ciel et à Paradis. Les tourments de l'enfer. Le feu de l'enfer. La crainte de l'enfer. JÉSUS-CHRIST a promis que les portes de l'enfer (c'est-à-dire les puissances de l'enfer) ne prévaudront point contre son Église. Fig. et fam., C'est un enfer, un véritable enfer, se dit d'un Lieu où l'on souffre, où l'on est au supplice, où l'on est extrêmement gêné, tourmenté, où il y a beaucoup de confusion et de désordre. C'est un enfer pour moi que cette maison. Sauvez-moi de cet enfer. Fig., Porter son enfer avec soi, Porter son supplice avec soi. Les méchants portent leur enfer avec eux. Fig., Avoir l'enfer dans le cœur se dit d'une Personne tourmentée de remords, ou agitée par la haine. Il désigne aussi figurément les Démons, les puissances de l'enfer. L'enfer en gémit. L'enfer se déchaîne contre lui. Fig. et fam., Un feu d'enfer, Un feu très grand, très violent. Il y a toujours un feu d'enfer dans cette verrerie. En termes de Cuisine, Faire griller quelque chose au feu d'enfer, le mettre au feu d'enfer, Le faire griller à un feu de charbons très ardent. Fig. et fam., Jouer un jeu d'enfer, Jouer très gros jeu. Aller un train d'enfer, Aller fort vite. Il se dit figurément d'une Partie réservée d'une bibliothèque où sont conservés les ouvrages dont la communication est jugée dangereuse.
ENFERS se dit au pluriel, dans un sens particulier, du Lieu où étaient les âmes que Notre-Seigneur délivra après sa mort. JÉSUS-CHRIST est descendu aux enfers. La descente de Notre-Seigneur aux enfers.
ENFERS, au pluriel, se prend encore aujourd'hui pour les Lieux souterrains où les païens croyaient que les âmes allaient après la mort. Les Enfers contenaient les Champs-Élysées et le Tartare. Orphée alla chercher Eurydice aux Enfers. Hercule, Énée descendit aux Enfers.
Littré
-
1 Terme des anciennes religions polythéistiques. Lieu souterrain qu'habitaient les âmes des morts. Les enfers comprenaient le Tartare pour les méchants, et les Champs-Élysées pour les justes.
Je saurai le braver jusque dans les enfers
, Corneille, Cinna, II, 2.L'enfer s'émeut au bruit de Neptune en furie?; Pluton sort de son trône, il pâlit, il s'écrie
, Boileau, Longin, sublime, VII.Il précipite dans les enfers une foule de combattants
, Fénelon, Tél. XX.Monstre que dans nos bras les enfers ont jeté
, Racine, Iph. v, 4.Tu peux faire trembler la terre sous tes pas, Des enfers déchaînés allumer la colère
, Rousseau J.-B. Cantate, Circé.Devant le vestibule, aux portes des enfers, Habitent les soucis et les regrets amers, Et des remords rongeurs l'escorte vengeresse?
, Delille, Énéide, VI.Les trois juges des enfers, Minos, Éaque et Rhadamanthe.
Les filles d'enfer, les furies.
Eh bien, filles d'enfer, vos mains sont-elles prêtes?? Pour qui sont ces serpents?
, Racine, Andr. v, 5.En ce sens, enfer se dit le plus souvent au pluriel.
-
2Lieu destiné au supplice des damnés, dans la religion chrétienne?; on dit dans le même sens, au pluriel, les enfers. Le feu de l'enfer.
La bouche de l'enfer est toujours ouverte, et les grands et les petits, les forts et les faibles, les riches et les pauvres y entrent pêle-mêle à tous moments
, Nicole, Ess. mor. 3e traité, ch. 5.L'enfer est le centre des damnés comme les ténèbres sont le centre de ceux qui fuient le jour
, Nicole, ib. 2e traité, ch. 10.Ne trouvant donc point de lieu qui lui soit plus propre et qui lui soit moins pénible que l'enfer, elle [l'âme pécheresse] s'y précipite comme dans son centre et dans le lieu seul qui lui est convenable
, Nicole, ib. 2e traité, ch. 10.Mais il est aux enfers des chaudières bouillantes Où l'on plonge à jamais les femmes mal vivantes
, Molière, Éc. des fem. III, 2.Qui a le plus de sujet de craindre l'enfer, ou celui qui est dans l'ignorance s'il y a un enfer, et dans la certitude de damnation, s'il y en a?; ou celui qui est dans une persuasion certaine qu'il y a un enfer et dans l'espérance d'être sauvé, s'il est??
Pascal, Pensées, part. II, art. 3.[Alexandre] tourmenté par son ambition durant sa vie, et tourmenté maintenant dans les enfers, où il porte la peine éternelle d'avoir voulu se faire adorer comme un dieu soit par orgueil, soit par politique
, Bossuet, la Vallière.Mais lorsqu'en sa malice un pécheur obstiné, Des horreurs de l'enfer vainement étonné
, Boileau, Ép. XI.Je reviendrai bientôt par un heureux baptême T'arracher aux enfers et te rendre à toi-même
, Voltaire, Zaïre, III, 4.L'Enfer, titre d'une des parties de la Divine comédie, poëme de Dante.
Il se dit aussi d'un des enfers ou lieux du supplice décrits dans ce poëme.
On eût dit qu'on entrait dans l'enfer de glace si bien décrit par le Dante
, Staël, Corinne, III, 5. -
3 Fig. Chose excessivement déplaisante, pénible.
Hé?! monsieur, si vous le pouvez, sauvez-vous de cet enfer-là [les procès]
, Molière, Fourb. de Sc. II, 8.Ils lui montrèrent [au duc du Maine] les enfers ouverts sous ses pieds par le mariage de Mlle de Bourbon [avec le duc de Berry]
, Saint-Simon, 267, 101.Au moment où cet enfer [la Bastille] créé par la tyrannie pour le tourment de ses victimes s'est ouvert sous les yeux de la capitale?
, Mirabeau, Collection, t. I, p. 346. -
4 Par extension, les démons, les puissances de l'enfer. C'est l'enfer qui l'a créé. Les enfers ont jeté ce monstre parmi nous.
Mes amis, J'ai soumis L'enfer à ma puissance?; De son obéissance J'ai pour gage certain Un lutin
, Béranger, Colibri. -
5Un enfer, lieu, réunion, vie commune où règnent la discorde, la confusion.
Et j'abhorre des n?uds Qui deviendraient sans doute un enfer pour tous deux
, Molière, D. Garc. I, 1.On a raison d'appeler ces salles [les assemblées de jeu] un enfer
, Mercier, Tableau de Paris, t. II, p. 328 (éd. d'Amst. 1782).Se dit, à Londres, des maisons de jeu et des lieux de débauche.
-
6Désordre, trouble.
Combien n'a-t-on point vu de belles aux doux yeux, avant le mariage anges si gracieux, Tout à coup se changeant en bourgeoises sauvages, Vrais démons, apporter l'enfer dans leurs ménages
, Boileau, Sat. X.Je pense qu'avec eux tout l'enfer est chez moi
, Boileau, ib. VI.Mettre le scandale et l'enfer dans sa maison
, Rousseau, Conf. VI. -
7Violente peine qu'inspire la passion ou le remords. Avoir l'enfer dans le c?ur. Porter son enfer avec soi.
Et si l'enfer est fable au centre de la terre, Il est vrai dans mon sein
, Malherbe, V, 21.Ils commencent leur enfer sur la terre
, Bossuet, Conv. 1.Qu'est-il besoin d'aller chercher l'enfer dans l'autre vie?? il est dès celle-ci dans le c?ur des méchants
, Rousseau, Em. IV.Le supplice d'attendre est l'enfer des amants
, Boissy, Impatient, I, 1.Furie d'enfer, monstre échappé de l'enfer, personne très méchante.
Tison d'enfer, porte d'enfer, c'est-à-dire personne capable d'opérer la perte des âmes.
Votre père Brisacier dit que ceux contre qui il écrit sont des portes d'enfer, des pontifes du diable? s'amuserait-on à prouver qu'on n'est pas porte d'enfer??
Pascal, Prov. X. -
8D'enfer, loc. adject. Excessif. Faire un feu d'enfer. Mener un train d'enfer. Jouer un jeu d'enfer.
M. de Vendôme commença à s'apercevoir que ce feu d'enfer par lequel il avait compté de les écraser [les ennemis] ne leur nuirait guères
, Saint-Simon, 209, 63.On a joué un jeu d'enfer, cinq sous la fiche
, Picard, Petite ville, I, 8.Terme de cuisine. Mettre, faire griller quelque chose au feu d'enfer, le faire griller à un feu de charbon très ardent.
C'est un métier d'enfer, c'est un métier extrêmement fatigant.
- 9 Terme de typographie. Cassetin dans lequel on jette les mauvaises lettres. Vieux. On dit aujourd'hui cassetin du diable.
-
10 Terme d'huilerie. Citerne où se réunissent les eaux qui ont été mêlées avec le marc d'olive.
Les résidus de ces cuviers s'écoulent dans un souterrain qu'on nomme l'enfer? ce qu'on en tire est l'huile d'enfer, qui est la plus basse sorte
, Dict. des arts et mét. Amst. 1767, huilier. - 11Enfer de Boyle, matras de verre à fond plat et à col effilé, dans lequel Boyle et d'autres chauffaient le mercure pendant des mois et des années.
HISTORIQUE
XIe s. L'enchanteür qui ja fut en enfer
, Ch. de Rol. CVI.
XIIe s. L'ame s'en va en enfer osteler
, Ronc. p. 62. Tu ies pieres, e sur ceste piere ferai M'iglise, e ma meisun i edifierai, E les portes d'enfer par li depecerai
, Th. le mart. 79.
XIIIe s. Et li ame de li soit en enfer ravie
, Berte, LXXII. Certes durement me merveil Comment hons, s'il n'iere de fer, Puet vivre un mois en tel enfer
, la Rose, 2606. Sacent donques tuit, que lor ames sunt données as ennemis d'enfer, et lor cors as vers, et lor avoirs à lor parens
, Beaumanoir, LXVIII, 15. Leenz a une grant meson, Qui lors estoit, en la seson, Plaine de fermes et d'enfers [malades]?; Assez estoit griez [fâcheux] cis enfers
, Rutebeuf, II, 181.
XVe s. Dieu la confonde, Et au parfond de la terre la fonde?: Car el porte son enfer en ce monde
, Chartier, le Débat des deux fortunes. L'autre des places estoit Bauverne, où les Anglois avoient compassé une fosse nommée enfer, et là ils jettoient les gens qui ne pouvoient ou vouloient rançonner
, Hist. de Loys III, duc de Bourbon, p. 16, dans LACURNE.
XVIe s. Mais je ne m'en puis descoiffer?; Je pense que c'est un enfer Dont jamais je ne sortiray
, Marot, I, 204. Le lict m'est un enfer, et pense que dedans On ait semé du verre ou des charbons mordants
, Ronsard, 798. ?de l'enfer il ne sort Que l'eternelle soif de l'impossible mort
, D'Aubigné, Trag. liv. VII.
Encyclopédie, 1re édition
ENFER, s. m. (Théologie.) lieu de tourmens où les méchans subiront après cette vie la punition dûe à leurs crimes.
Dans ce sens le mot d'enfer est opposé à celui de ciel ou paradis. Voyez Ciel & Paradis.
Les Payens avoient donné à l'enfer les noms de tartarus ou tartara, hades, infernus, inferna, inferi, orcus, &c.
Les Juifs n'ayant point exactement de nom propre pour exprimer l'enfer dans le sens où nous venons de le définir (car le mot hébreu scheol se prend indifféremment pour le lieu de la sépulture, & pour le lieu de supplice réservé aux réprouvés), ils lui ont donné le nom de Gehenna ou Gehinnon, vallée près de Jérusalem, dans laquelle étoit un tophet ou place où l'on entretenoit un feu perpétuel allumé par le fanatisme pour immoler des enfans à Moloch. De-là vient que dans le nouveau Testament l'enfer est souvent désigné par ces mots Gehenna ignis.
Les principales questions qu'on peut former sur l'enfer se réduisent à ces trois points : son existence, sa localité, & l'éternité des peines qu'y souffrent les réprouvés. Nous allons les examiner séparément.
1°. Si les anciens Hébreux n'ont pas eu de terme propre pour exprimer l'enfer, ils n'en ont pas moins reconnu la réalité. Les auteurs inspirés en ont peint les tourmens avec les couleurs les plus terribles : Moyse, dans le Deutéronome, chap. xxxij. vers. 22. menace les Israëlites infideles, & leur dit au nom du Seigneur : Un feu s'est allumé dans ma fureur, & il brûlera jusqu'au fond de l'enfer ; il dévorera la terre & toutes les plantes, & il brûlera les fondemens des montagnes. Job, chap. xxjv. vers. 19. réunit sur la tête des réprouvés les plus extrèmes douleurs : Que le méchant, dit-il, passe de la froideur de la neige aux plus excessives chaleurs ; que son crime descende jusque dans l'enfer ; & au chap. xxvj. vers. 6. L'enfer est découvert aux yeux de Dieu, & le lieu de la perdition ne peut se cacher à sa lumiere. Enfin, pour ne pas nous jetter dans des citations infinies, Isaïe, chap. lxvj. vers. 24. exprime ainsi les tourmens intérieurs & extérieurs que subiront les réprouvés : Videbunt cadavera virorum qui prevaricati sunt in me, vermis eorum non morietur, & ignis eorum non extinguetur, & erunt usque ad satietatem visionis omni carni ; c'est-à-dire, comme porte l'Hébreu, ils seront un sujet de dégoût à toute chair, tant leurs corps seront horriblement défigurés par les tourmens.
Ces autorités suffisent pour fermer la bouche à ceux qui prétendent que les anciens Hébreux n'ont eu nulle connoissance des châtimens de la vie future, parce que Moyse ne les menace ordinairement que de peines temporelles. Les textes que nous venons de citer énoncent clairement des punitions qui ne doivent s'infliger qu'après la mort. Ce qu'on objecte encore, que les écrivains sacrés ont emprunté ces idées des poëtes grecs, n'a nul fondement : Moyse est de plusieurs siecles antérieur à Homere. Soit que Job ait été contemporain de Moyse, ou que son livre ait été écrit par Salomon, comme le prétendent quelques critiques, il auroit vêcu, vers le tems du siege de Troye, qu'Homere n'a décrit que quatre cents ans après. Isaïe, à la vérité, étoit à-peu-près contemporain d'Hésiode & d'Homere ; mais quelle connoissance a-t-il eu de leurs écrits, dont les derniers sur-tout n'ont été recueillis que par les soins de Pisistrate, c'est-à-dire fort long-tems après la mort du poëte grec, & celle du prophete qu'on suppose avoir été le copiste d'Homere.
Il est vrai que les Esseniens, les Pharisiens, & les autres sectes qui s'éleverent parmi les Juifs depuis le retour de la captivité, & qui depuis les conquêtes d'Alexandre avoient eu commerce avec les Grecs, mêlerent leurs opinions particulieres aux idées simples qu'avoient eu les anciens Hébreux sur les peines de l'enfer. « Les Esseniens, dit Joseph dans son Hist. de la guerre des Juifs, liv. II. chap. xij. tiennent que l'ame est immortelle, & qu'aussi-tôt qu'elle est sortie du corps, elle s'éleve pleine de joie vers le ciel, comme étant dégagée d'une longue servitude & délivrée des liens de la chair. Les ames des justes vont au-delà de l'Océan, dans un lieu de repos & de délices, où elles ne sont troublées par aucune incommodité ni dérangement des saisons. Celles des méchans au contraire sont reléguées dans des lieux exposés à toutes les injures de l'air, où elles souffrent des tourmens éternels. Les Esseniens ont sur ces tourmens à peu-près les mêmes idées que les poëtes nous donnent du Tartare & du royaume de Pluton ». Voyez Esseniens.
Le même auteur, dans ses antiquités judaïques, liv. XVIII. chap. ij. dit « que les Pharisiens croyent aussi les ames immortelles, & qu'après la mort du corps celles des bons joüissent de la félicité, & peuvent aisément retourner dans le monde animer d'autres corps ; mais que celles des méchans sont condamnées à des peines qui ne finiront jamais. » Voyez Pharisiens.
Philon, dans l'opuscule intitulé de congressu quærendæ eruditionis causâ, reconnoît, ainsi que les autres Juifs, des peines pour les méchans & des récompenses pour les justes : mais il est fort éloigné des sentimens des Payens & même des Esseniens au sujet de l'enfer. Tout ce qu'on raconte de Cerbere, des Furies, de Tantale, d'Ixion, &c. tout ce qu'on en lit dans les poëtes, il le traite de fables & de chimeres. Il soûtient que l'enfer n'est autre chose qu'une vie impure & criminelle ; mais cela même est allégorique. Cet auteur ne s'explique pas distinctement sur le lieu où sont punis les méchans, ni sur le genre & la qualité de leur supplice ; il semble même le borner au passage que les ames font d'un corps dans un autre, où elles ont souvent beaucoup de maux à endurer, de privations à souffrir, & de confusion à essuyer : ce qui approche fort de la métempsycose de Pythagore. Voyez Métempsycose.
Les Sadducéens qui nioient l'immortalité de l'ame, ne reconnoissoient par conséquent ni récompenses ni peines pour la vie future. V. Sadducéens.
L'existence de l'enfer & des supplices éternels est attestée presque à chaque page du nouveau Testament. La sentence que Jesus-Christ prononcera contre les reprouvés au Jugement dernier, est concûe en ces termes : Matth. XXV. v. 34. Ite maledicti in ignem æternum qui paratus est diabolo & angelis ejus. Il représente perpétuellement l'enfer comme un lieu ténébreux où regnent la douleur, la tristesse, le dépit, la rage, & comme un séjour d'horreur où tout retentit des grincemens de dents & des cris qu'arrache le desespoir. S. Jean, dans l'Apocalypse, le peint sous l'image d'un étang immense de feu & de soufre, où les méchans seront précipités en corps & en ame, & tourmentés pendant toute l'éternité.
En conséquence, les Théologiens distinguent deux sortes de tourmens dans l'enfer : savoir, la peine du dam, p?na damni seu damnationis ; c'est la perte ou la privation de la vision béatifique de Dieu, vision qui doit faire le bonheur éternel des saints : & la peine du sens, p?na sensûs, c'est à-dire, tout ce qui peut affliger le corps, & sur-tout les douleurs cuisantes & continuelles causées dans toutes ses parties par un feu inextinguible.
Les fausses religions ont aussi leur enfer : celui des Payens, assez connu par les descriptions qu'en ont faites Homere, Ovide & Virgile, est assez capable d'inspirer de l'effroi par les peintures des tourmens qu'ils y font souffrir à Ixion, à Promethée, aux Danaïdes, aux Lapythes, à Phlégias, &c. mais parmi les Payens, soit corruption du c?ur, soit penchant à l'incrédulité, le peuple & les enfans même traitoient toutes ces belles descriptions de contes & de rêveries ; du moins c'est un des vices que Juvenal reproche aux Romains de son siecle.
Esse aliquos manes & subterranea regna,
Et contum, & Stygio ranas in gurgite nigras,
Atque unâ transire vadum tot millia cimbâ,
Nec pueri credunt, nisi qui nondùm ære lavantur.
Sed tu vera puta. Satyr. II.
Voyez Enfer, (Mythologie.)
Les Talmudistes, dont la croyance n'est qu'un amas ridicule de superstitions, distinguent trois ordres de personnes qui paroîtront au jugement dernier. Le premier, des justes ; le second, des méchans ; & le troisieme, de ceux qui sont dans un état mitoyen, c'est-à-dire, qui ne sont ni tout-à-fait justes ni tout-à-fait impies. Les justes seront aussi-tôt destinés à la vie éternelle, & les méchans au malheur de la gêne ou de l'enfer. Les mitoyens, tant Juifs que Gentils, descendront dans l'enfer avec leurs corps, & ils pleureront pendant douze mois, montant & descendant, allant à leurs corps & retournant en enfer. Après ce terme, leurs corps seront consumés & leurs ames brûlées, & le vent les dispersera sous les piés des justes : mais les hérétiques, les athées, les tyrans qui ont desolé la terre, ceux qui engagent les peuples dans le péché, seront punis dans l'enfer pendant les siecles des siecles. Les rabbins ajoûtent que tous les ans au premier jour de Tirsi, qui est le premier jour de l'année judaïque, Dieu fait une espece de révision de ses registres, ou un examen du nombre & de l'état des ames qui sont en enfer. Talmud in Gemar. Tract. Rosch. haschana c. j. fol. 16.
Les Musulmans ont emprunté des Juifs & des Chrétiens, le nom de gehennem ou gehim, pour signifier l'enfer. Gehenem, en arabe, signifie un puits très-profond ; & gehim, un homme laid & difforme ; ben gehennem, un fils de l'enfer, un réprouvé. Ils donnent le nom de thabeck à l'ange qui préside à l'enfer. D'Herbelot, Biblioth. orient. au mot Gehennem.
Selon l'alcoran, au chap. de la priere, les Mahométans reconnoissent sept portes de l'enfer, ou sept degrés de peines ; c'est aussi le sentiment de plusieurs commentateurs de l'alcoran, qui mettent au premier degré de peine, nommé gehennem, les Musulmans qui auront mérité d'y tomber ; le second degré, nommé ladha, est pour les Chrétiens ; le troisieme, appellé hothama, pour les Juifs ; le quatrieme, nommé saïr, est destiné aux Sabiens ; le cinquieme, nommé sacar, est pour les mages ou Guebres, adorateurs du feu ; le sixieme, appellé gehim, pour les Payens & les Idolatres ; le septieme, qui est le plus profond de l'abysme, porte le nom de haoviath ; il est reservé pour les hypocrites qui déguisent leur religion, & qui en cachent dans le c?ur une différente de celle qu'ils professent au-dehors.
D'autres interpretes mahométans expliquent différemment ces sept portes de l'enfer. Quelques-uns croyent qu'elles marquent les sept péchés capitaux. D'autres les prennent des sept principaux membres du corps dont les hommes se servent pour offenser Dieu, & qui sont les principaux instrumens de leurs crimes. C'est en ce sens qu'un poëte Persan a dit : « Vous avez les sept portes d'enfer dans votre corps ; mais l'ame peut faire sept serrures à ces portes : la clef de ces serrures est votre libre arbitre, dont vous pouvez vous servir pour fermer ces portes, si bien qu'elles ne s'ouvrent plus à votre perte ». Outre la peine du feu ou du sens, les Musulmans reconnoissent aussi comme nous celle du dam.
On dit que les Cafres admettent treize enfers, & vingt-sept paradis, où chacun trouve la place qu'il a méritée suivant ses bonnes ou mauvaises actions.
Cette persuasion des peines dans une vie future, universellement répandue dans toutes les religions, même les plus fausses, & chez les peuples les plus barbares, a toûjours été employée par les législateurs comme le frein le plus puissant pour arrêter la licence & le crime, & pour contenir les hommes dans les bornes du devoir.
II. Les auteurs sont extrèmement partagés sur la seconde question : savoir, s'il y a effectivement quelque enfer local, ou quelque place propre & spécifique où les réprouvés souffrent les tourmens du feu. Les prophetes & les autres auteurs sacrés parlent en général de l'enfer comme d'un lieu soûterrain placé sous les eaux & les fondemens des montagnes, au centre de la terre, & ils le désignent par les noms de puits & d'abysme : mais toutes ces expressions ne déterminent pas le lieu fixe de l'enfer. Les écrivains prophanes tant anciens que modernes ont donné carriere à leur imagination sur cet article ; & voici ce que nous en avons recueilli d'après Chambers.
Les Grecs, après Homere, Hésiode, &c. ont conçû l'enfer comme un lieu vaste & obscur sous terre, partagé en diverses régions, l'une affreuse où l'on voyoit des lacs dont l'eau bourbeuse & infecte exhaloit des vapeurs mortelles ; un fleuve de feu, des tours de fer & d'airain, des fournaises ardentes, des monstres & des furies acharnées à tourmenter les scélérats. (Voyez Lucien, de luctu, & Eustathe, sur Homere). l'autre riante, destinée aux sages & aux héros. Voyez Élysée.
Parmi les poëtes latins, quelques-uns ont placé l'enfer dans les régions soûterraines situées directement au-dessous du lac d'Averne, dans la Campagne de Rome, à cause des vapeurs empoisonnées qui s'élevoient de ce lac. Æneide, liv. VI. Voy. Averne.
Calipso dans Homere parlant à Ulysse, met la porte de l'enfer aux extrémités de l'Océan. Xenophon y fait entrer Hercule par la peninsule acherasiade, près d'Héraclée du Pont.
D'autres se sont imaginé que l'enfer étoit sous le Ténare, promontoire de Laconie, parce que c'étoit un lieu obscur & terrible, environné d'épaisses forêts, d'où il étoit plus difficile de sortir que d'un labyrinthe. C'est par-là qu'Ovide fait descendre Orphée aux enfers. D'autres ont crû que la riviere ou le marais du Styx en Arcadie étoit l'entrée des enfers, parce que ses exhalaisons étoient mortelles. Voyez Ténare & Styx.
Mais toutes ces opinions ne doivent être regardées que comme des fictions des poëtes, qui, selon le génie de leur art, exagérant tout, représenterent ces lieux comme autant de portes ou d'entrées de l'enfer, à l'occasion de leur aspect horrible, ou de la mort certaine dont étoient frappes tous ceux qui avoient le malheur ou l'imprudence de s'en trop approcher. Voyez Enfer, (Mythol.)
Les premiers Chrétiens, qui regardoient la terre comme un plan d'une vaste étendue, & le ciel comme un arc élevé ou un pavillon tendu sur ce plan, crurent que l'enfer étoit une place soûterraine & la plus éloignée du ciel, de sorte que leur enfer étoit placé où sont nos antipodes. Voyez Antipodes.
Virgile avoit eu avant eux une idée à-peu-près semblable.
. . . . . . . . . tum Tartarus ipse
Bis patet in præceps tantum, tenditque sub umbras,
Quantus ad æthereum c?li suspectus Olympum.
Tertullien, dans son livre de l'ame, représente les Chrétiens de son tems comme persuadés que l'enfer étoit un abysme situé au fond de la terre ; & cette opinion étoit fondée principalement sur la croyance de la descente de Jesus-Christ aux Lymbes. Matth. XII. v 40. V. Lymbes, & l'article suivant Enfer.
Whiston a avancé, sur la localité de l'enfer, une opinion nouvelle. Selon lui, les cometes doivent être considérées comme autant d'enfers destinés à voiturer alternativement les damnés dans les confins du Soleil, pour y être grillés par ses feux, & les transporter successivement dans des régions froides, obscures, & affreuses, au-delà de l'orbite de Saturne. Voyez Comete.
Swinden, dans ses recherches sur la nature & sur la place de l'enfer, n'adopte aucune des situations cy-dessus mentionnées ; & il en assigne une nouvelle. Suivant ses idées, le Soleil lui-même est l'enfer local ; mais il n'est pas le premier auteur de cette opinion : outre qu'on pourroit en trouver quelques traces dans ce passage de l'Apocalypse, chap. xvj. V. 8 & 9. Et quartus angelus effudit phialam suam in Solem, & datum est illi æstu affligere homines & igni, & æstuaverunt homines æstu magno. Pythagore paroît avoir eu la même pensée que Swinden en plaçant l'enfer dans la sphere du feu, & cette sphere au milieu de l'univers. D'ailleurs Aristote de c?lo, lib. II. fait mention de quelques philosophes de l'école italique ou pythagoricienne, qui ont placé la sphere du feu dans le Soleil, & l'ont même nommée la prison de Jupiter. Voyez Pythagoriciens.
Swinden, pour soûtenir son système, entreprend de déplacer l'enfer du centre de la terre. La premiere raison qu'il en allegue, c'est que ce lieu ne peut contenir un fond ou une provision de soufre ou d'autres matieres ignées, assez considérable pour entretenir un feu perpétuel & aussi terrible dans son activité que celui de l'enfer ; & la seconde, que le centre de la terre doit manquer de particules nitreuses qui se trouvent dans l'air, & qui doivent empêcher ce feu de s'éteindre : « Et comment, ajoûte-t-il, un tel feu pourroit-il être éternel & se conserver sans fin dans les entrailles de la terre, puisque toute la substance de la terre en doit être consumée successivement & par degrés » ?
Cependant il ne faut pas oublier ici que Tertullien a prévenu la premiere de ces difficultés, en mettant une différence entre le feu caché ou interne & le feu public ou extérieur. Selon lui, le premier est de nature non-seulement à consumer, mais encore à réparer ce qu'il consume. La seconde difficulté a été levée par S. Augustin, qui prétend que Dieu, par un miracle, fournit de l'air au feu central. Mais l'autorité de ces peres, si respectable en matiere de doctrine, n'est pas irréfragable quand il s'agit de Physique : aussi Swinden continue à montrer que les parties centrales de la terre sont plûtôt occupées par de l'eau que par du feu ; ce qu'il confirme par ce que dit Moyse des eaux soûterraines, Exode, chap. xx. ?. 4. & par le Pseaume XXIII. ?. 2. Quia super maria sundavit eum (orbem), & super flumina præparavit eum. Il allegue encore qu'il ne se trouveroit point au centre de la terre assez de place pour contenir le nombre infini de mauvais anges & d'hommes réprouvés. Voyez Abysme.
On sait que Drexelius, de damnatorum carcere & rogo, a confiné l'enfer dans l'espace d'un mille cubique d'Allemagne, & qu'il a fixé le nombre des damnés à cent mille millions : mais Swinden pense que Drexelius a trop ménagé le terrein ; qu'il peut y avoir cent fois plus de damnés ; & qu'ils ne pourroient qu'être infiniment pressés, quelque vaste que soit l'espace qu'on pût leur assigner, au centre de la terre. Il conclut qu'il est impossible d'arranger une si grande multitude d'esprits dans un lieu si étroit, sans admettre une pénétration de dimension ; ce qui est absurde en bonne philosophie, même par rapport aux esprits : car si cela étoit, il dit qu'il ne voit pas pour quoi Dieu auroit préparé une prison si vaste pour les damnés, puisqu'ils auroient pû être entassés tous dans un espace aussi étroit qu'un four de Boulanger. On pourroit ajoûter que le nombre des réprouvés devant être très-étendu, & les réprouvés devant un jour brûler en corps & en ame, il faut nécessairement admettre un enfer plus spacieux que celui qu'a imaginé Drexelius, à moins qu'on ne suppose qu'au jugement dernier Dieu en créera un nouveau assez vaste pour contenir les corps & les ames. Nous ne sommes ici qu'historiens. Quoi qu'il en soit, les argumens qu'allegue Swinden, pour prouver que le Soleil est l'enfer local, sont tirés :
1°. De la capacité de cet astre. Personne ne pouvant nier que le Soleil ne soit assez spacieux pour contenir tous les damnés de tous les siecles, puisque les Astronomes lui donnent communément un million de lieues de circuit : ainsi ce n'est pas la place qui manque dans ce système. Le feu ne manquera pas non plus, si nous admettons le raisonnement par lequel Swinden prouve, contre Aristote, que le Soleil est chaud, page 208 & suiv. « Le bon-homme, dit-il, est saisi d'étonnement à la vûe des Pyrénées de soufre & des océans athlantiques de bitume ardent, qu'il faut pour entretenir l'immensité des flammes du Soleil. Nos Æthnas & nos Vésuves ne sont que des vers luisans ». Voilà une phrase plus digne d'un gascon que d'un savant du nord.
2°. De la distance du Soleil, & de son opposition à l'empyrée, que l'on a toûjours regardé comme le ciel local. Une telle opposition répond parfaitement à celle qui se trouve naturellement entre deux places, dont l'une est destinée au séjour des anges & des élûs, & l'autre à celui des démons & des réprouvés, dont l'une est un lieu de gloire & de bénédictions, & l'autre est un lieu d'horreur & de blasphèmes. La distance s'accorde aussi très-bien avec les paroles du mauvais riche, qui dans S. Luc, chap. xvj. V. 23. voit Abraham dans un grand éloignement, & avec la réponse d'Abraham dans ce même chap. V. 26. & in his omnibus inter nos & vos chaos magnum firmatum est, ut hi qui volunt hinc transire ad vos non possint, neque indè huc transmeare. Or Swinden, par ce chaos ou ce goufre, entend le tourbillon solaire. Voyez Tourbillon.
3°. De ce que l'empirée est le lieu le plus haut, & le Soleil le lieu le plus bas de l'univers, en considérant cette planete comme le centre de notre système, & comme la premiere partie du monde créé & visible ; ce qui s'accorde avec cette notion, que le Soleil a été destiné primitivement non-seulement à éclairer la terre, mais encore à servir de prison & de lieu de supplice aux anges rebelles, dont notre auteur suppose que la chûte a précédé immédiatement la création du monde habité par les hommes.
4°. Du culte que presque tous les hommes ont rendu au feu ou au Soleil ; ce qui peut se concilier avec la subtilité malicieuse des esprits qui habitent le Soleil, & qui ont porté les hommes à adorer leur throne, ou plûtôt l'instrument de leur supplice.
Nous laissons au lecteur à apprécier tous ces systèmes ; & nous nous contentons de dire qu'il est bien singulier de vouloir fixer le lieu de l'enfer, quand l'Ecriture, par son silence, nous indique assez celui que nous devrions garder sur cette matiere.
III. Il ne conviendroit pas également de demeurer indécis sur une question qui intéresse essentiellement la foi : c'est l'éternité des peines que les damnés souffriront en enfer. Elle paroît expressément décidée par les Ecritures, & quant à la nature des peines du sens, & quant à leur durée qui doit être interminable. Cependant, outre les incrédules modernes qui rejettent l'un & l'autre point, tant parce qu'ils imaginent l'ame mortelle comme le corps, que parce que l'éternité des peines leur semble incompatible avec l'idée d'un Dieu essentiellement & souverainement bon & miséricordieux ; Origene, dans son traité intitulé, ???? ?????, ou de principiis, donnant aux paroles de l'Ecriture une interprétation métaphorique, fait consister les tourmens de l'enfer, non dans des peines extérieures ou corporelles, mais dans les remords de la conscience des pécheurs, dans l'horreur qu'ils ont de leurs crimes, & dans le souvenir qu'ils conservent du vuide de leurs plaisirs passés. S. Augustin fait mention de plusieurs de ses contemporains qui étoient dans la même erreur. Calvin & plusieurs de ses sectateurs l'ont soûtenu de nos jours ; & c'est le sentiment général des Sociniens, qui prétendent que l'idée de l'enfer, admis par les Catholiques, est empruntée des fictions du paganisme. Nous trouvons encore Origene à la tête de ceux qui nient l'éternité des peines dans la vie future : cet auteur, au rapport de plusieurs peres, mais sur-tout de S. Augustin, dans son traité de la cité de Dieu, liv. X X I. chap. xvij. enseigne que les hommes, & les démons même, après qu'ils auront essuyé des tourmens proportionnés à leurs crimes, mais limités toutefois quant à la durée, en obtiendront le pardon & entreront dans le ciel. M. Huet, dans ses remarques sur Origene, conjecture que la lecture de Platon avoit gâté Origene à cet égard.
L'argument principal sur lequel se fondoit Origene, est que toutes les punitions ne sont ordonnées que pour corriger, & appliquées comme des remedes douloureux, pour faire recouvrer la santé aux sujets à qui on les inflige. Les autres objections sur lesquelles insistent les modernes sont tirées de la disproportion qui se rencontre entre des crimes passagers & des supplices éternels, &c.
Les phrases qu'employe l'Ecriture pour exprimer l'éternité, ne signifient pas toûjours une durée infinie, comme l'ont observé plusieurs interpretes ou critiques, & entre autres Tillotson, archevêque de Cantorbéry.
Ainsi dans l'ancien Testament, ces mots, à jamais, ne signifient souvent qu'une longue durée, & en particulier jusqu'à la fin de la loi judaïque. Il est dit, par exemple, dans l'Epître de S. Jude, ?. 7. que les villes de Sodome & Gomorre ont servi d'exemple, & qu'elles ont été exposées à la vengeance d'un feu éternel, ignis æterni p?nam sustinentes, c'est-à-dire d'un feu qui ne pouvoit s'éteindre avant que ces villes fussent entierement réduites en cendres. Il est dit aussi, dans l'Ecriture, que les générations se succedent, mais que la terre demeure à jamais ou éternellement ; terra autem in æternum stat. En effet, M. le Clerc remarque qu'il n'y a point de mot hébreu qui exprime proprement l'éternité ; le terme holam n'exprime qu'un tems dont le commencement ou la fin sont inconnus, & se prend dans un sens plus ou moins étendu, suivant la matiere dont il est question. Ainsi quand Dieu dit, au sujet des lois judaïques, qu'elles doivent être observées laholam, à jamais, il faut sous-entendre qu'elles le seront aussi long-tems que Dieu le jugera à propos, ou pendant un espace de tems dont la fin étoit inconnue aux Juifs avant la venue du Messie. Toutes les lois générales, ou celles qui ne regardent pas des especes particulieres, sont établies à perpétuité, soit que leur texte renferme cette expression, soit qu'il ne la renferme pas ; ce qui toutefois ne signifie pas que la puissance législatrice & souveraine ne pourra jamais les changer ou les abréger.
Tillotson soûtient, avec autant de force que de fondement, que dans les endroits de l'Ecriture où il est parlé des tourmens de l'enfer, les expressions doivent être entendues dans un sens étroit & d'une durée infinie ; & ce qu'il regarde comme une raison décisive, c'est que dans un seul & même passage (en S. Matth. chap. xxv.), la durée de la punition des méchans se trouve exprimée par les mêmes termes dont on se sert pour exprimer la durée du bonheur des justes, qui, de l'aveu de tout le monde, doit être éternel. En parlant des réprouvés, il y est dit qu'ils iront au supplice éternel, ou qu'ils seront livrés à des tourmens éternels : & en parlant des justes, il est dit qu'ils entreront en possession de la vie éternelle ; & ibunt hi in supplicium æternum, justi autem in vitam æternam.
Cet auteur entreprend de concilier le dogme de l'éternité des peines avec ceux de la justice & de la miséricorde divine ; & il s'en tire d'une maniere beaucoup plus satisfaisante que ceux qui avoient tenté avant lui de sauver les contrariétés apparentes qui résultent de ces objets de notre foi.
En effet, quelques Théologiens, pour résoudre ces difficultés, avoient avancé que tout péché est infini, par rapport à l'objet contre lequel il est commis, c'est-à-dire par rapport à Dieu ; mais il est absurde de prétendre que tous les crimes sont aggravés à ce point par rapport à l'objet offensé, puisque dans ce cas le mal & le démérite de tout péché seroient nécessairement égaux, en ce qu'il ne peut y avoir rien au-dessus de l'infini que le péché offense. Ce seroit renouveller un des paradoxes des Stoïciens ; & par conséquent on ne pourroit fonder sur rien les degrés de punition pour la vie à venir : car quoiqu'elle doive être éternelle dans sa durée, il n'est pas hors de vraissemblance qu'elle ne sera pas égale dans sa violence, & qu'elle pourra être plus ou moins vive, à proportion du caractere ou du degré de malice qu'auront renfermé tels ou tels péchés. Ajoutez que pour la même raison le moindre péché contre Dieu étant infini, par rapport à son objet, on peut dire que la moindre punition que Dieu inflige est infinie par rapport à son auteur, & par conséquent que toutes les punitions que Dieu infligeroit seroient égales, comme tous les péchés commis contre Dieu seroient égaux ; ce qui répugne.
D'autres ont prétendu que si les méchans pouvoient vivre toûjours, ils ne cesseroient jamais de pécher. « Mais c'est là, dit Tillotson, une pure spéculation, & non pas un raisonnement : c'est une supposition gratuite & dénuée de fondement. Qui peut assûrer, ajoûte-t-il, que si un homme vivoit si long-tems, il ne se repentiroit jamais » ? D'ailleurs la justice vengeresse de Dieu ne punit que les péchés commis par les hommes, & non pas ceux qu'ils auroient pû commettre ; comme sa justice rémunérative ne couronne que les bonnes ?uvres qu'ils ont faites réellement, & non celles qu'ils auroient pû faire, ainsi que le prétendoient les Sémi-Pélagiens. Voyez Sémi-Pélagiens.
C'est pourquoi d'autres ont soûtenu que Dieu laisse à l'homme le choix d'une félicité ou d'une misere éternelle, & que la récompense promise à ceux qui lui obéissent, est égale à la punition dont il menace ceux qui refusent de lui obéir. On répond à cela, que s'il n'est point contraire à la justice de porter trop loin la récompense, parce que cette matiere est de pure faveur, il peut être contraire à la justice de porter la punition à l'excès. On ajoûte que dans ce cas l'homme n'a pas sujet de se plaindre, puisqu'il ne doit s'en prendre qu'à son propre choix. Mais quoique cette raison suffise pour imposer silence au pécheur, & lui arracher cet aveu, qu'il est la cause de son malheur, perditio tua ex te, Israel ; on sent qu'elle ne résout pas pleinement l'objection tirée de la disproportion entre le crime & le supplice.
Voyons comment Tillotson, mécontent de tous ces systèmes, a entrepris de résoudre cette difficulté.
Il commence par observer que la mesure des punitions par rapport aux crimes, ne se regle pas seulement ni toûjours sur la qualité & sur le degré de l'offense, & moins encore sur la durée & sur la continuation de l'offense, mais sur les raisons d'?conomie ou de gouvernement, qui demandent des punitions capables de porter les hommes à observer les lois, & de les détourner d'y donner atteinte. Parmi les hommes, on ne regarde point comme une injustice de punir le meurtre & plusieurs autres crimes qui se commettent souvent en un moment, par la perte ou privation perpétuelle de l'état de citoyen, de la liberté, & même de la vie du coupable ; de sorte que l'objection tirée de la disproportion entre des crimes passagers & des tourmens éternels, ne peut avoir ici aucune force.
En effet, la maniere de regler la proportion entre les crimes & les punitions, est moins l'objet de la justice, qu'elle n'est l'objet de la sagesse & de la prudence du législateur, qui peut appuyer ses lois par la menace de telles peines qu'il juge à propos, sans qu'on puisse à cette occasion l'accuser de la plus legere injustice : cette maxime est indubitable.
La premiere fin de toute menace n'est point de punir, mais de prevenir ou faire éviter la punition. Dieu ne menace point afin que l'homme peche & & qu'il soit puni, mais afin qu'il s'abstienne de pécher & qu'il évite le châtiment attaché à l'infraction de la loi ; de sorte que plus la menace est terrible & imposante, plus il y a de bonté dans l'auteur de la menace.
Après tout, il faut faire attention, ajoûte le même auteur, que celui qui fait la menace se reserve le pouvoir de l'exécuter lui-même. Il y a cette différence entre les promesses & les menaces, que celui qui promet donne droit à un autre, & s'oblige à exécuter sa parole, que la justice & la fidélité ne lui permettent pas de violer : mais il n'en est pas de même à l'égard des menaces ; celui qui menace se reserve toûjours le droit de punir quand il le voudra, & n'est point obligé à la rigueur d'exécuter ses menaces, ni de les porter plus loin que n'exigent l'économie, les raisons, & les fins de son gouvernement. C'est ainsi que Dieu menaça la ville de Ninive d'une destruction totale, si elle ne faisoit pénitence dans un tems limité : mais comme il connoissoit l'étendue de son propre droit, il fit ce qu'il voulut ; il pardonna à cette ville, en considération de sa pénitence, se relâchant du droit de la punir.
Tels sont les raisonnemens de Tillotson, auxquels nous n'ajoûterons qu'une réflexion pour prévenir cette fausse conséquence qu'on en pourroit tirer : savoir, que ce qu'on lit dans l'Ecriture sur les peines de l'enfer, n'est simplement que comminatoire, comme le prétendent les Sociniens. Sans doute tant que l'homme est en cette vie, il peut les éviter ces peines ; mais après la mort, lorsque l'iniquité est consommée, & qu'il n'y a plus lieu au mérite pour fléchir le courroux d'un Dieu outragé & justement irrité, le pécheur peut-il l'accuser d'injustice, de lui infliger des peines éternelles ? puisque pendant la vie il étoit à son choix de les éviter, & de parvenir à une éternelle félicité. D'ailleurs, il est également révelé, & que ces menaces ont déjà été accomplies réellement dans les anges rebelles, & qu'elles seront réellement accomplies dans les réprouvés à la fin des siecles ; ce qui prouve que la raison seule ne suffit pas pour décider cette question, & qu'il faut nécessairement avoir recours à la révélation, pour démontrer l'éternité & la justice des peines de la vie future. (G)
Enfer, ades ou hades, (Théologie.) se prend aussi quelquefois, dans le style de l'Ecriture, pour la mort & pour la sépulture, parce que les mots hébreux & grecs signifient quelquefois l'enfer, ou le lieu dans lequel sont les réprouvés, & quelquefois la sépulture des morts. V. Tombeau & Sepulcre.
Les Théologiens sont divisés sur l'article du symbole des apôtres où il est dit que Notre Seigneur a été crucifié, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, & qu'il est descendu aux enfers, hades ; quelques-uns n'entendent par cette descente aux enfers, que la descente dans le tombeau ou dans le sepulcre. Les autres leur objectent que dans le symbole même, ces deux descentes se trouvent expressément distinguées, & qu'il y est fait mention de la descente du Sauveur dans le sépulcre, sepultus est, avant qu'il soit parlé de sa descente aux enfers, descendit ad inferos. Ils soûtiennent donc que l'ame de Jesus-Christ descendit effectivement dans l'enfer soûterrain ou local, & qu'il y triompha des démons. Autrement les expressions du symbole seroient une pure tautologie.
Les Catholiques ajoûtent que Jesus-Christ descendit dans les lymbes, c'est-à-dire dans les lieux bas de la terre, où étoient détenues les ames des justes morts dans la grace de Dieu avant l'avenement & la passion du Sauveur, & qu'il les emmena avec lui dans le paradis, suivant ces passages d'Osée : ero mors tua, ô mors, & morsus tuus ero, inferne. Et de S. Paul : ascendens Christus in altum, captivam duxit captivitatem. Voyez Lymbes & Ascension. (G)
Enfer, (Poétique.) ou Enfers, s. m. pl. (Myth.) nom général, qui, dans la théologie du Paganisme, désignoit les lieux soûterrains où alloient les ames des hommes, pour y être jugées par Minos, Eaque, & Rhadamanthe. Pluton en étoit le dieu & le roi ; Proserpine son épouse en étoit la déesse & la reine.
Cet endroit contenoit, entre autres demeures, les champs Elysées, & le Tartare environné de cinq fleuves, qu'on nomme le Styx, le Cocyte, l'Achéron, le Lethé, & le Phlégéton. Cerbere, chien à trois têtes & à trois gueules, admirablement dépeint par Virgile, étoit toûjours à la porte des enfers, pour empêcher les hommes d'y entrer & les ames d'en sortir. Avant que d'arriver à la cour de Pluton & au tribunal de Minos, il falloit passer l'Achéron dans une barque conduite par Caron, à qui les ombres donnoient une piece de monnoie pour leur passage. Virgile fait encore de ce batelier un portrait inimitable : « Un air mal-propre, une barbe longue & négligée, la parole rude, des yeux étincelans, les traits d'une vieillesse robuste & vigoureuse ». Tel étoit Caron ; mais lisez les vers de l'original ; je n'en donne qu'une foible esquisse.
Portitor has horrendus aquas & flumina servat,
Terribili squalore Charon, cui plurima mento
Canities inculta jacet, stant lumina flamma ;
Sordidus ex humeris nodo dependet amictus ;
Jam senior, sed cruda deo, viridisque senectus.
Presque tous les peuples du monde ont imaginé un paradis & un enfer, conformément à leur génie ; détail immense de la folie des humains, dans lequel nous n'entrerons point ici ! On peut lire là-dessus Thomas Hyde, Vossius, Marsham, & M. Huet. Borné présentement à la Mythologie, je remarquerai seulement que c'est Orphée, qui au retour de ses voyages d'Egypte, jetta en Grece le plan d'un nouveau système sur ce sujet, & que c'est de lui qu'est venu l'idée des champs Elysées & du Tartare, que tous les auteurs ont suivi, quoiqu'ils ayent extremement varié sur la situation des lieux destinés à punir les méchans, & à récompenser les bons.
C'est pourquoi l'on trouve dans les Poëtes tant d'entrées différentes qui conduisent aux enfers. Voyez sur cela l'article précédent.
En un mot, chacun a choisi pour l'endroit de la position des enfers, dont la religion payenne n'apprenoit rien de certain, le lieu qui lui a paru le plus propre à devenir le séjour du malheur ; & en conséquence, chacun a décrit ce lieu diversement, suivant le caractere de son imagination.
Mais aucun poëte n'a mieux réussi que Virgile. Il a mis dans le plus beau jour tout ce qu'Homere, & après lui Platon, avoient enseigné sur cet article. La description des enfers, du chantre de Mantoüe, est supérieure à celle de l'auteur de l'Odyssée, & encore plus au-dessus de celle de Sylvius Italicus, de Claudien, de Lucain, & de tous les autres qui ont travaillé après lui : c'est une topographie parfaite de l'empire de Pluton ; c'est le chef-d'?uvre de l'art ; c'est le plus beau morceau de l'Enéïde.
Dans cette admirable carte topographique, le poëte divise le séjour des ombres en sept demeures. La premiere est celle des enfans morts en naissant, qui gémissent de n'avoir fait qu'entrevoir la lumiere du jour.
Infantumque animæ flentes in limine primo,
Quos dulcis vitæ exortes, & ab ubere raptos
Abstulit atra dies, & funere mersit acerbo.
Ceux qui avoient été injustement condamnés à perdre la vie, occupent la seconde demeure.
Hos juxtà, falso damnati crimine mortis. Ibid.
Dans la troisieme, sont ceux qui, sans être coupables, mais vaincus par le chagrin & les miseres d'ici-bas, se sont eux-mêmes donné la mort.
Proxima deindè tenent mæsti loca, qui sibi lethum
Insontes peperêre manu, lucemque perosi
Projecere animas : quam vellent æthere in alto
Nunc & pauperiem & duros perferre labores ! &c.
Fata obstant tristique palus inamabilis undâ
Alligat, & novies styx interfusa coercet.
M. de Voltaire, dans ses mêlanges de Littérature & de Philosophie, a traduit ces vers ainsi :
Là sont ces insensés, qui d'un bras téméraire
Ont cherché dans la mort un secours volontaire ;
Ils n'ont pû supporter, foibles & furieux,
Le fardeau de la vie imposé par les dieux.
. . . Ils regrettent le jour, ils pleurent ; & le sort,
Le sort pour les punir les enchaîne à la mort,
L'abysme du Cocyte & l'Achéron terrible
Met entr'eux & la vie un obstacle invincible.
La quatrieme, appellée le champ des larmes, est le séjour de ceux qui avoient éprouvé les rigueurs de l'amour ; Phedre, Procris, Pasiphaë, Didon, &c.
Hîc, quos durus amor crudeli tabe peredit ;
Secreti celant calles, & myrthea circum
Sylva tegit ; curæ non ipsâ in morte relinquunt.
His, Phædram, Procrinque locis, mæstamque Eriphylem,
Crudelis gnati monstrantem vulnera cernit,
Evadnenque, & Papsiphaën, &c.
La cinquieme, est le quartier des fameux guerriers qui avoient péri dans les combats ; Tydée, Adraste, Polybure, &c.
Hîc illi occurrit Tydeus, hîc inclytus armis
Parthenopæus, & Adrasti pallentis imago, &c.
L'affreux Tartare, prison des scélérats, fait la sixieme demeure, environnée du bourbeux Cocyte & du brûlant Phlégéton. Là regnent les Parques, les Furies, &c. & c'est là aussi que Virgile se surpasse lui-même.
. . . . . . . . . . tùm Tartarus ipse
Bis patet in præceps tantum, tenditque sub umbras,
Quantus ad æthereum c?li suspectus Olympum.
Hîc genus antiquum terræ, Titania pubes,
Fulmine dejecti fundo volvuntur in imo. &c.
Enfin la septieme demeure fait le séjour des bienheureux, les Champs Élysées.
His demùm exactis, perfecto munere divæ,
Devenêre locos lætos, & am?na vireta
Fortunatorum nemorum, sedesque beatas, &c.
Je supprime à regret les autres détails admirables que Virgile nous donne des enfers, & je ne pense point à mettre à leur place ceux des auteurs qui l'ont précédé ou qui l'ont suivi ; il vaut beaucoup mieux nous attacher à ramener le système des fictions poétiques à leur véritable origine ; & en recherchant celle de la fable des enfers, démontrer en général qu'elle vient d'Egypte ; après quoi l'on jugera sans peine que la plûpart des circonstances dont on l'a embellie dans la suite, sont le fruit de l'imagination des poëtes grecs & romains.
Non-seulement Hérodote nous apprend que presque tous les noms des dieux sont venus d'Egypte dans la Grece, mais Diodore de Sicile nous explique, par le secours des traditions égyptiennes, la plûpart des fables qu'on a débité sur les enfers.
Il y a, dit cet excellent auteur, (liv. I.) un lac en Egypte au-delà duquel on enterroit anciennement les morts. Après les avoir embaumés, on les portoit sur le bord de ce lac. Les juges préposés pour examiner la conduite & les m?urs de ceux qu'on devoit faire passer de l'autre côté, s'y rendoient au nombre de quarante ; & après une longue délibération, s'ils jugeoient celui dont on venoit de faire l'information, digne de la sépulture, on mettoit son cadavre dans une barque, dont le batelier se nommoit Caron. Cette coûtume étoit même pratiquée à l'égard des rois ; & le jugement qu'on portoit contre eux étoit quelquefois si severe, qu'il y en eut qui furent réputés indignes de la sépulture.
La fable rapporte que le Caron des Grecs est toûjours sur le lac ; celui des Egyptiens avoit établi sa demeure sur les bords du lac Querron. Le Caron des poëtes grecs exigeoit impitoyablement son péage : celui des Egyptiens ne vouloit pas même faire grace au fils du roi ; il devoit justifier au prince régnant, qu'il n'amassoit tant de richesses que pour son service. Le lac des enfers étoit formé d'un fleuve : celui du Querron étoit formé des eaux du Nil. Le premier faisoit neuf fois le tour des enfers, novies Styx interfusa ; jamais pays n'a été plus arrosé que l'Egypte ; jamais fleuve n'a eu plus de canaux que le Nil.
L'idée de la prison du Tartare, dont une partie, selon Virgile, étoit aussi avant dans la terre que le ciel en est éloigné, ne paroît-elle pas prise du fameux labyrinthe d'Egypte, qui étoit composé de deux bâtimens, dont l'un étoit sous terre ? Les crocodiles sacrés que les Egyptiens nourrissoient dans des chambres soûterraines, désignent assez clairement les monstres affreux qu'on met dans le royaume de Pluton.
En un mot, il semble qu'aux circonstances près, on trouve en Egypte tout ce qui compose l'enfer des poëtes de la Grece & de Rome. Homere dit que l'entrée des enfers étoit sur le bord de l'Océan ; le Nil est appellé par ce même poëte ???????. C'est en Egypte qu'on voit les portes du soleil ; elles ne sont autre chose que la ville d'Héliopolis. Les demeures des morts sont marquées par ce grand nombre de pyramides & de tombeaux, où les momies se sont conservées pendant tant de siecles. Caron, sa barque, l'obole qu'on donnoit pour le passage ; tout cela est encore tiré de l'histoire d'Egypte. Il est même très-probable que le nom de l'Achéron vient de l'égyptien Achoucherron, qui signifie les lieux marécageux de Caron ; que le Cerbere a pris sa dénomination de quelqu'un des rois d'Egypte, appellé Chebrès ou Kébron ; qu'enfin le nom du Tartare vient de l'Egyptien Dardarot, qui signifie habitation éternelle ; qualification que les Egyptiens donnoient par excellence à leurs tombeaux.
Mais sans trop appuyer sur ces étymologies, & moins encore sans compter sur de plus recherchées, par lesquelles Bochart, le Clerc, & autres savans, trouvent chez les Egyptiens le système complet des enfers & des champs élysées ; c'est assez d'en connoître la premiere origine, il n'en faut pas demander davantage : de minimis non curandum.
Quant aux voyages que les poëtes font faire à leurs héros dans les enfers, je crois qu'ils n'ont d'autre fondement que les évocations, auxquelles eurent autrefois recours les hommes superstitieux pour s'éclaircir de leur destinée. Orphée, qui avoit été lui-même dans la Thesprotie pour évoquer le phantôme d'Eurydice sa chere épouse, nous en parle comme d'un voyage aux enfers, & prend occasion de-là de nous débiter tous les dogmes de la théologie payenne sur cette matiere. Les autres poëtes ne manquerent pas de suivre son exemple. Bayle, réponse aux questions d'un provincial. Voyez Evocation, Manes.
Quoi qu'il en soit, il arriva que les Grecs, contens d'avoir saisi en général les idées des Egyptiens sur l'immortalité des ames, & leur état après la mort, donnerent carriere à leur génie, & inventerent sur ce sujet quantité de fables dont ils n'avoient aucun modele. L'Italie suivit l'exemple des Grecs, & ajoûta de nouvelles fictions aux anciennes ; telles sont celles du rameau d'or, des furies, des parques, & des illustres scélérats que leurs poëtes placerent dans le Tartare.
Enfin, tant d'auteurs travaillerent successivement & en différens lieux à former le système poétique des enfers, que ce systême produisit un mêlange monstrueux de fables ridicules, dont tout le monde vint à se moquer. Cicéron rapporte que de son tems il n'y avoit point de vieilles assez sottes pour y ajoûter la moindre foi. Dic, quæso, nùm, te illa tenent, triceps apud inferos Cerberus, Cocyti fremitus, & transvectio Acherontis ? Adeòne me delirare censes, ista ut credam ?? Quæ anus tam excors inveniri potest, quæ illa, quæ quondam credebantur, apud inferos portenta, extimescat ? De nat. deor. Juvenal nous assûre de son côté, que les enfans mêmes croyoient à peine l'ancienne doctrine des enfers. Voyez l'article précédent.
Cependant, malgré ce changement dans les opinions des particuliers, la pratique du culte public ne changea point de face, ni du tems de Cicéron, ni du tems de Juvénal. On vit subsister les mêmes fêtes, les mêmes processions & les mêmes sacrifices en l'honneur de Pluton, de Proserpine, & des autres divinités infernales, auxquelles personne ne croyoit plus. Tant il est vrai que les particuliers peuvent en matiere de religion se trouver desabusés, & le même culte public subsister. Polybe fait à ce sujet une réflexion par laquelle je finirai cet article.
« Le plus grand avantage, dit ce judicieux historien, qu'ait eu le gouvernement de Rome sur tous les autres états, est une chose généralement décriée, l'idolatrie & la superstition. Si une société, ajoûte-t-il, étoit formée seulement de gens sages, un tel plan n'auroit pas été nécessaire ; mais puisque la multitude est toûjours agitée de desirs illicites & de passions violentes, il n'y avoit pas d'autre moyen plus sûr de les réprimer que ce secret de fictions & de terreurs. C'étoit donc prudemment & sagement que les Romains inculquerent dans les esprits le culte de leurs dieux, & la crainte des punitions du Tartare ». Liv. VI. p. 497. Voyez Superstition. Article de M. le Chevalier de Jaucourt.
Enfer de Boyle, (Chimie.) vaisseau circulatoire d'un verre fort, composé de plusieurs pieces, qui toutes ensemble font une espece de matras, ayant le col long & étroit & le globe très-applati, imaginé par le célebre Anglois dont il porte le nom, pour faire ce qu'on appelle le mercure fixé per se. Voy. nos Planches. Voyez Mercure. (b)
Wiktionnaire
Nom commun - ancien français
enfer \Prononciation ?\ masculin
-
Enfer.
- En tut enfern n'at si fole ? (Voyage de saint Brendan, édition de Claudin, vers numéro 1415)
-
D'infer froissa les serreures ? (Vie de sainte Marie l'Égyptienne, ms. 23112 de la BnF, f. 337v. b.)
-
(Antiquité) Les Enfers.
-
Berberius est d'enfer portiers
Garder l'entree est son mestiers ? (Roman d'Eneas, ms. 60 français de la BnF, f. 157v. c.)
-
Berberius est d'enfer portiers
Nom commun - français
enfer \??.f??\ masculin
-
(Antiquité) (Au pluriel) Séjour des morts, avant le christianisme.
- Teutatès, Tut-tat, père des hommes. [?] César a cru reconnaître en lui, Dis, dieu des enfers ou Pluton ; mais César ne savait pas que les Gaulois n'avaient point d'enfer, et, par conséquent, pas de dieux infernaux. ? (François-Xavier Masson, Annales ardennaises, ou Histoire des lieux qui forment le département des Ardennes et des contrées voisines, Mézières : imprimerie Lelaurin, 1861, page 61)
- Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, [?], est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, [?]. ? (Prière catholique dite « Je crois en Dieu »)
-
(En particulier) (Au pluriel) Lieux souterrains où les Grecs et les Romains croyaient que les âmes allaient après la mort.
- Orphée alla chercher Eurydice aux Enfers.
- Héraclès descendit aux Enfers.
-
(Religion) Lieu destiné au supplice des damnés.
- Les prêtres, ses confrères, déposèrent ce juge indulgent ; l'un d'eux lui dit : « Mon ami, je ne crois pas plus l'enfer éternel que vous ; mais il est bon que votre servante, votre tailleur, et même votre procureur, le croient. » ? (Voltaire, Dictionnaire philosophique, 1764)
-
Que je le plains, pécheur, en ton heure dernière!
Les maux les plus affreux sont amassés sur toi;
Le noir enfer, séjour rempli d'effroi,
T'attend au bout de la carrière. ? (Mort du pécheur, dans Félix Dupanloup, Manuel des petits séminaires et des maisons d'éducation chrétienne, p.106, 2e éd., 1844) - L'église chrétienne va transformer les fantômes et les revenants en âmes en peine en même temps qu'elle met en place le Purgatoire entre l'Enfer et le Paradis. Les morts ont besoin des vivants et les moines de Cluny mettent en place la fête des morts. ? (Claude Nachin, Les fantômes de l'âme : à propos des héritages psychiques, 1993, page 21)
- [Selon le recueil de superstitions Yü-Li], les méchants sont tués par le tonnerre, ou tourmentés de diverses façons dans l'enfer : plongés dans un trou à fumier ; jetés sur des sabres et des couteaux ; condamnés à la faim et à la soif, à suer leur sang, à revêtir des habits de fer rougi au feu, à être jetés dans la chaux, à être hachés et mis en pièces, à être gelés... ? (Émile Bard, Les Chinois chez eux, Paris : A. Colin et Cie, 1899)
-
(Figuré) (Familier) Lieu où l'on souffre, où l'on est au supplice, où l'on est extrêmement gêné, tourmenté, où il y a beaucoup de confusion et de désordre.
- Rien n'a pu effacer le souvenir de la sauvagerie de la pointe du Raz et de la Baie des Trépassés, et l'horreur fascinante de la mer mugissant dans l'enfer de Plogoff. ? (Alain Gerbault, À la poursuite du soleil; tome 1 : De New-York à Tahiti, 1929)
- C'était l'enfer quand je devais débarquer tout seul des frigos américains, et il y en avait beaucoup. Ils faisaient au moins dans les 40 kilos. C'était très dur aussi quand il fallait se mettre à deux pour superposer tout un stock de lave-linge très lourds aussi. ? (Anonyme, Moi, Anthony, ouvrier d'aujourd'hui, Raconter la Vie (éd. du Seuil), 2014 chap. 3)
- Avoir l'enfer dans le c?ur se dit d'une personne tourmentée de remords, ou agitée par la haine.
-
Je suis une pauvre rate
Ma vie est un enfer.
Mon frère est un bandit
Ma mère une sorcière. ? (Les Enquêtes de Chlorophylle, 1992?1995)
-
(Par métonymie) Démons ; puissances de l'enfer.
- L'enfer en gémit.
- L'enfer se déchaîne contre lui.
- (Figuré) Partie réservée d'une bibliothèque où sont conservés les ouvrages dont la communication est jugée dangereuse, considérés comme licencieux ou « contraires aux bonnes m?urs ». Créé au début du XIXe siècle, il s'agissait au départ d'une simple pièce dans laquelle on enfermait ou cadenassait toutes les ?uvres (livres, médailles, etc.) ou objets le plus souvent à caractère érotique et qui étaient interdits au grand public, mais accessible uniquement sur recommandation.
- Citerne où se recueillent les eaux mêlées au marc d'olive dans les huileries. On en tire une huile de basse qualité dite « huile d'enfer ».
Trésor de la Langue Française informatisé
ENFER, subst. masc.
Enfer au Scrabble
Le mot enfer vaut 8 points au Scrabble.
Informations sur le mot enfer - 5 lettres, 2 voyelles, 3 consonnes, 4 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot enfer au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
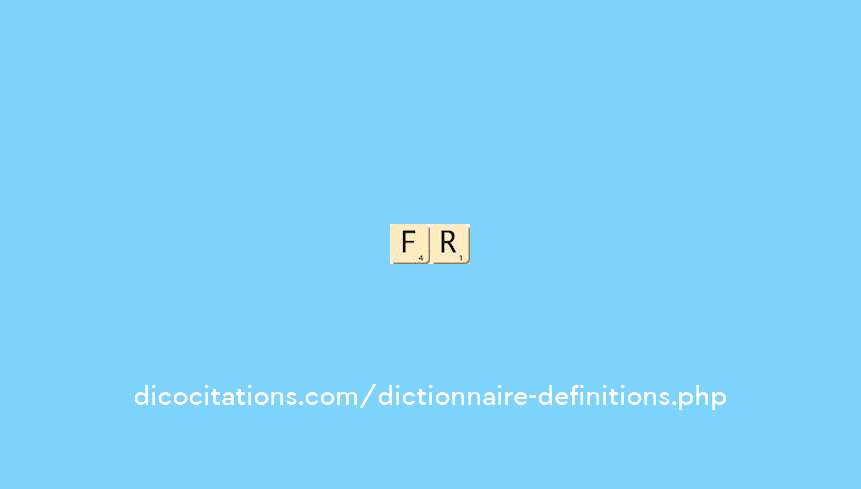
Les mots proches de Enfer
Enfaîter Enfance Enfançon Enfant Enfanté, ée Enfantelette Enfantement Enfanter Enfantillage Enfantin, ine Enfariné, ée Enfariner Enfascié, ée Enfer Enfermé, ée Enfermer Enfermerie Enféronner Enferré, ée Enferrer Enferrure Enfeu Enfeuiller (s') Enfieller Enfièvrement Enfiévrer Enfilade Enfiler Enfileur Enfilure Enfin Enflammé, ée Enflammement Enflammer Enflé, ée Enflement Enfler Enfleurer Enfleuri, ie Enflure Enfoncé, ée Enfoncement Enfoncer Enfonçure Enfondrer Enfontangé, ée Enforcir Enfoui, ie Enfouir Enfouisseur enfance enfances enfançon enfançons enfant enfant-robot enfant-roi enfanta enfantaient enfantait enfante enfanté enfantée enfantées enfantelets enfantement enfantements enfantent enfanter enfantera enfanterai enfantés enfantillage enfantillages enfantin enfantine enfantinement enfantines enfantins enfantons enfants enfants-robots enfants-rois enfarinait enfarine enfariné enfariné enfarinée enfarinée enfariner enfarinés enfarinés enfer enferma enfermai enfermaient enfermais enfermait enfermant enfermeMots du jour
Logographique Apostiller Travailler Cliquetis Sottise Ondulation Divulguer Sinus Sophisme Sous-entendre
Les citations avec le mot Enfer
- L'amour est toujours nouveau. Peu importe que l'on aime une fois, deux fois, dix fois, dans sa vie. On se trouve toujours devant une situation inconnue. L'amour peut nous mener en enfer ou au paradis, mais il nous mène toujours quelque part.Auteur : Paulo Coelho - Source : Sur le bord de la rivière Piedra je me suis assise et j'ai pleuré (1994)
- Un poète est un monde enfermé dans un homme.Auteur : Victor Hugo - Source : La Légende des siècles (1859), Un poète
- Les montagnes et les forêts qui s'élèvent entre nous et un être chéri, les murs qui le renferment dans leur enceinte, ont pour nous un charme bien touchant, et se présentent à nos regards comme un voile sacré qui nous dérobe l'avenir et le passé.Auteur : Johann Paul Friedrich Richter, dit Jean-Paul - Source : Pensées extraites de tous les ouvrages de Johann Paul Friedrich Richter dit Jean-Paul
- N’en déplaise à l’Église qui prétend gouverner notre jugement autant que régir nos actions, il me semble que le mal ne loge ni aux Enfers, ni chez les protestants, ni entre les cuisses des femmes, mais en chacun de nous.
Auteur : Eve de Castro - Source : Le Roi des ombres (2012)
- Maudit soit le premier dont la verve insensée - Dans les bornes d'un vers renferma sa pensée, - Et, donnant à ses mots une étroite prison, - Voulut avec la rime enchaîner la raison.Auteur : Nicolas Boileau-Despréaux - Source : Satires (1660-1711)
- L'étude socio-technique des mécanismes de contrôle, saisis à leur aurore, devrait être catégorielle et décrire ce qui est déjà en train de s'installer à la place des milieux d'enfermement disciplinaires, dont tout le monde annonce la crise. Il se peut que de vieux moyens, empruntés aux anciennes sociétés de souveraineté, reviennent sur scène, mais avec les adaptations nécessaires. Ce qui compte, c'est que nous sommes au début de quelque chose. Dans le régime des prisons : la recherche de peines de « substitution » au moins pour la petite délinquance, et l'utilisation de colliers électroniques qui imposent au condamné de rester chez lui à telles heures. Dans le régime des écoles : les formes de contrôle continu, et l'action de la formation permanente sur l'école, l'abandon cotres pondant de toute recherche à l'Université, l'introduction de l' « entreprise » à tous les niveaux de scolarité. Dans le régime des hôpitaux : la nouvelle médecine « sans médecin ni malade » qui dégage des malades potentiels et des sujets à risque, qui ne témoigne nullement d'un progrès vers l'individuation, comme on le dit, mais substitue au corps individuel ou numérique le chiffre d'une matière « dividuelle » à contrôler. Dans le régime d'entreprise : les nouveaux traitements de l'argent, des produits et des hommes qui ne passent plus par la vieille forme-usine. Ce sont des exemples assez minces, mais qui permettraient de mieux comprendre ce qu on entend par crise des institutions, c'est-à-dire l'installation progressive et dispersée d'un nouveau régime de domination. Auteur : Gilles Deleuze - Source : Post-scriptum sur les sociétés de contrôle, in L 'autre journal, n°1, mai 1990
- L'amour ressemble curieusement à la foi. Sauf qu'on se retrouve toujours en enfer.Auteur : Umar Timol - Source : Les Affreurismes (2005)
- Aujourd'hui, j'écris le genre de livres que les touristes du monde entier emportent avec eux en vacances mais qui les fait s'enfermer dans leur chambre pour savoir ce qui va arriver aux personnages.Auteur : Harlan Coben - Source : Interview dans Lire, juin 2005.
- Il a ajouté qu’il fallait bien réfléchir. Que la vie, ça tenait à ces choix minuscules qui pouvaient tout changer. Qu’il ne fallait pas se laisser enfermer dans la colère, l’entêtement, le doute. Parce qu’on n’a qu’une vie et qu’on est finalement seuls à l’écrire. Auteur : Adèle Bréau - Source : Frangines (2021)
- Tel qui soûla de sang ses rêves et son fer,
Aujourd'hui pardonné son opprobre s'efface.
C'est ainsi que sur nous Dieu fait tonner Sa grâce.
Ne force pas qui veut les portes de l'Enfer.Auteur : Paul-Jean Toulet - Source : Les Contrerimes (1979), Coples, IX - Toutes les analyses politiques, économiques et climatiques tendent à révéler que la terre tourne à l'enfer.Auteur : Marc Lévy - Source : Sept jours pour une éternité... (2003)
- Par les temps qui courent, l'enfer recrute bien plus que le paradis.Auteur : Eric Giacometti - Source : Le Septième Templier (2011)
- L'amour n'est pas un feu qu'on renferme en une âme: - Tout nous trahit, la voix, le silence, les yeux, - Et les feux mal couverts n'en éclatent que mieux.Auteur : Jean Racine - Source : Andromaque (1667), II, 2, Oreste
- Je ne mourrai pas seul. Vous m'accompagnerez,
Mes ombres. Avec moi vous vous dissiperez,
Dans la grande nuit sans aurore.
Avec nous dans la tombe à jamais enfermés
Les êtres disparus que nous aurons aimés,
Puissent-ils nous aimer encore !Auteur : Emile Henriot - Source : Les Jours raccourcissent : Poésies (1954) - Si le paradis est un avant-goût d'éternité dans l'instant présent, alors l'enfer est une éternité de chagrin dans l'instant présent.Auteur : Toni Bentley - Source : Ma reddition (2006)
- On est enfermé à perpétuité avec ses fantasmes comme les fous de l'Antiquité avec leurs serpents.Auteur : Philippe Bouvard - Source : Mille et une pensées (2005)
- Descends, descends en enfer, et dis que c'est moi qui t'y envoie...Auteur : William Shakespeare - Source : Henry VI, V, 6, Gloucester
- Chacun se croit seul en enfer et c'est cela l'enfer.Auteur : René Girard - Source : Mensonge romantique et vérité romanesque (1961)
- Atticus avait usé de tous les moyens dont disposent les hommes libres pour sauver Tom Robinson. Mais Atticus n'avait pas eu accès à la cour secrète que renferment les coeurs des hommes.Auteur : Harper Lee - Source : Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur (2005)
- Dans la nuit du tombeau, j'enfermerai ma honte.Auteur : Jean Racine - Source : Iphigénie en Aulide (1674)
- Qui sait si Dieu ne sera pas sensible toujours plus à son Enfer qu'à son Ciel? Celui qui aime songe au rien qu'on lui refuse, quand on lui a déjà presque tout donné.Auteur : Marcel Jouhandeau - Source : Algèbre des valeurs morales (1935)
- PENSÉE : Réflexion, maxime, précepte, enfermant plus de mots que de sens. L'art d'écrire des pensées est très ancien. Son origine remonte à l'époque où les écrivains ont commencé d'être cocus. Certains s'y sont entièrement consacrés. Voici quelques modèles de pensées : « Ceux qui s'appliquent trop aux petites femmes deviennent rapidement incapables de grandes choses » (PASCAL) Auteur : Georges-Armand Masson - Source : L'amour, de ah ! jusqu'à zut !
- Je suis avec la plus grande attention les efforts des «antipsychiatres» pour briser le cercle du «grand renfermement».Auteur : Simone de Beauvoir - Source : Tout compte fait (1972)
- Un capitalisme sans banqueroute est comme un christianisme sans enfer.Auteur : Frank Borman - Source : Dans The Observer, 9 mars 1986.
- S'il nous fait un aveu, s'il peut citer une de nos phrases, si on glisse un ongle dans son affaire, tout est fichu: on sera enfermés dans la camisole du mensonge.Auteur : Gilles Martin-Chauffier - Source : Une vraie Parisienne (2007)
Les citations du Littré sur Enfer
- Il [le vers alcmanien] renferme les quatre premiers pieds de l'hexamètre ; le dernier est toujours un dactyleAuteur : QUICHERAT - Source : ib.
- La peau, se retirant sur elle-même, fera dresser les cheveux, dont elle enferme la racine, et causera ce mouvement qu'on appelle horreurAuteur : BOSSUET - Source : Conn. II, 12
- Le temps a été court, je l'avoue ; mais l'opération de la grâce a été forte ; mais la fidélité de l'âme a été parfaite.... la grâce, cette excellente ouvrière, se plaît quelquefois à renfermer en un jour la perfection d'une longue vieAuteur : BOSSUET - Source : Duch. d'Orl.
- Quel climat renfermait un si rare trésor ?Auteur : Jean Racine - Source : ib. III, 4
- Ma mère m'a toujours regardée comme un être pensant dont il fallait cultiver l'âme, et non comme une poupée qu'on ajuste, qu'on montre et qu'on renferme le moment d'aprèsAuteur : Voltaire - Source : Dial. 12
- Les ardoises de nos montagnes renferment souvent des rognons solides beaucoup plus durs que les lits feuilletés dans lesquels ils ont été formésAuteur : SAUSSURE - Source : Voy. Alpes, t. IV, p. 114, dans POUGENS
- .... Quels abîmes ouverts Exhalent jusqu'à moi les vapeurs des enfers ?Auteur : Corneille - Source : Tois. d'or, III, 5
- Quand l'enfer eut produit la goutte et l'araignée : Mes filles, leur dit-il, vous pouvez vous vanter D'être pour l'humaine lignée Également à redouterAuteur : Jean de La Fontaine - Source : Fabl. III, 8
- En sorte que du petit corps [la glande pinéale] où elle [l'âme] est enfermée, elle tient à tout et voit tout l'univers se venir, pour ainsi dire, marquer sur ce corps, comme le cours du soleil se marque sur un cadranAuteur : BOSSUET - Source : Conn. III, 8
- Virgile ne place pas Phèdre aux enfers, mais dans ces bocages de myrtes où vont errant ces amantes qui même dans la mort n'ont pas perdu leurs soucisAuteur : CHATEAUBR. - Source : Génie, II, III, 3
- Le docte saint Jean Chrysostome a renfermé en un petit mot une sentence remarquable, quand il a dit....Auteur : BOSSUET - Source : Sermons, Véritable convers. 1
- Tous ces desguisemens sont vaines mascarades Qui aux portes d'enfer presentent leurs aubadesAuteur : D'AUB. - Source : Tragiques, Princes.
- [Dieu] qui fait même de ses serviteurs les maîtres du monde et de tout ce que le monde enfermeAuteur : MASS. - Source : Car. Lazare.
- Moi-même il m'enferma dans des cavernes sombresAuteur : Jean Racine - Source : Phèd. III, 5
- Chacun s'en aperçut ; car d'enfermer sous l'ombre Une telle aise, le moyen,...Auteur : Jean de La Fontaine - Source : Pet. ch.
- Sommes-nous chez les Turcs pour renfermer les femmes ?Auteur : Molière - Source : Éc. des mar. I, 2
- Je pense qu'avec eux tout l'enfer est chez moiAuteur : BOILEAU - Source : ib. VI
- La ligne des mots latins et celle des mots français qui sont dessous, sont enfermées entre deux réglets, afin qu'on ne puisse pas les confondre avec celles qui sont dessus ou dessousAuteur : DUMARS. - Source : Oeuv. t. I, p. 95
- Et les Alpes de loin, s'élevant dans la nue, D'un long amphithéâtre enferment ces coteaux Où le pampre en festons rit parmi les ormeauxAuteur : Voltaire - Source : Épître à Horace.
- Avant qu'un peu de terre, obtenu par prière, Pour jamais sous la tombe eût enfermé MolièreAuteur : BOILEAU - Source : Ép. VII
- J'attrape des papillons, des bêtes à bon Dieu, des cancouëles et toute sorte de bêtes que j'enferme dans une boîteAuteur : A. THEURIET - Source : Rev. des Deux-Mondes, 1er nov. 1875, p. 91
- Appellerai-je homme d'esprit celui qui, borné ou renfermé dans quelque art ou même dans une certaine science....Auteur : LA BRUY. - Source : 12
- Sans raison quelconque, comme bestes effarouchées, ilz s'alloient eulx mêmes enferrerAuteur : AMYOT - Source : P. Aemil. 33
- La matière ou l'étendue renferme en elle deux propriétés ou deux facultés : la première faculté est celle de recevoir différentes figures, et la seconde est la capacité d'être mueAuteur : MALEBR. - Source : Rech. vér. I, 1
- Pie IV offre à Catherine de Médicis, régente de France, cent mille écus d'or et cent mille autres en prêt, avec un corps de Suisses et d'Allemands catholiques, si elle veut exterminer les huguenots de France, faire enfermer dans la Bastille Montluc, évêque de Valence, soupçonné de les favoriser, et le chancelier de l'Hospital, fils d'un Juif, mais qui était le plus grand homme de France, si ce titre est dû au génie, à la science et à la probité réuniesAuteur : Voltaire - Source : Moeurs, 172
Les mots débutant par Enf Les mots débutant par En
Une suggestion ou précision pour la définition de Enfer ? -
Mise à jour le mercredi 11 février 2026 à 09h39

- Eau - Ecologie - Economie - Ecouter - Ecrire - Ecriture - Education - Égalité - Egalite - Ego - Egoisme - Elegance - Elevation - Elitisme - Embobiner - Emergence - Emotion - Energie - Enfance - Enfant - Enfer - Engager - Ennemi - Ennui - Enseignement - Enseigner - Envie - Environnement - Ephemere - Epouse - Épouse - Époux - Epoux - Epreuve - Eprouver - Éprouver - Equilibre - Erotisme - Erreur - Erudiction - Esclave - Espace - Espece - Espérance - Esperance - Esperer - Espérer - Espoir - Esprit - Essentiel - Estime - Etat - Eternel - Eternite - Ethique - Ethologie - Etonnement - Etrange - Etre - Etudier - Europe - Evidence - Evolution - Exces - Excuses - Exhibitionnisme - Exil - Existence - Exister - Experience - Expliquer - Exponentiel - Extase - Extra+terrestre
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur enfer
Poèmes enfer
Proverbes enfer
La définition du mot Enfer est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Enfer sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Enfer présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
