Définition de « rate »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot rate de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur rate pour aider à enrichir la compréhension du mot Rate et répondre à la question quelle est la définition de rate ?
Une définition simple : (fr-rég|?at) rate (f)
Définitions de « rate »
Trésor de la Langue Française informatisé
RATE, subst. fém.
ANAT. Organe lymphoïde volumineux, situé dans l'abdomen, sous le diaphragme gauche, constitué d'une pulpe rouge formée de sinus gorgés de sang (d'apr. Man.-Man. Méd. 1977). Grosse rate; ablation, obstruction, lésion de la rate; rate hypertrophiée. La greffe de la rate, par exemple, se réalise avec un pourcentage considérable de réussites (Cuénot, J. Rostand,Introd. génét., 1936, p. 79).Wiktionnaire
Nom commun - ancien français
rate \Prononciation ?\ féminin
-
(Zoologie) Ratte (animale).
-
Tant as mangiet compeus de soris et de rates ? (Aiol, édition de Normand et Raynaud, page 259.)
-
Tant as mangiet compeus de soris et de rates ? (Aiol, édition de Normand et Raynaud, page 259.)
Nom commun 2 - français
rate \?at\ féminin (pour un mâle, on dit : rat)
-
(Zoologie) Femelle du rat.
- Je vous ordonne donc à tous, sous peine de déplaire à votre très humble Grand-Maître, de vous procurer le plus clandestinement possible chacun vingt rats ou vingt rates pleines, si Dieu le permet. ? (Honoré de Balzac, Les Célibataires : (troisième histoire) Un Ménage de garçon, tome 6, A. Houssiaux, Paris, 1855, page 215)
Nom commun 1 - français
rate \?at\ féminin
-
(Anatomie) Viscère mou, situé dans l'hypocondre gauche, entre l'estomac et les fausses côtes.
- Pyrrus, Roi des Epirotes, guérissoit, dit Plutarque, tous les Rateleux en leur touchant seulement la rate avec le gros doigt de son pié droit ; [?]. ? (Jean Meslier, Le Testament, chap. XIII, édition de Rudolf Charles, t.1, p.81, 1864)
- Les lésions de la fièvre typhoïde intéressent l'appareil lymphatique, depuis le tissu lymphoïde intestinal (follicules clos et plaques de Peyer) jusqu'aux ganglions mésentériques et à la rate. ? (Jules Guiard, Les Parasites inoculateurs de maladies, Paris : Flammarion, 1918, p.295)
- À l'intérieur de son abdomen la paroi de sa rate achevait de se déchirer, doublant l'hémorragie qui s'était déjà déclarée. ? (Marc Lévy, À une seconde près, nouvelle, supplément au magazine « Elle », 1999, page 44.)
- La rate est un organe rempli de cellules sanguines. Elle fabrique des cellules qui détruisent les microbes véhiculés par le sang lorsqu'un animal est atteint d'une infection grave. Ces cellules produisent des anticorps permettant à l'animal de lutter contre la maladie. ? (Bill Forse, Christian Meyer, et al., Que faire sans vétérinaire ?, Cirad / CTA / Kathala, 2002, page 35)
- Un pirate sachant pirater doit savoir pirater sans sa rate. ? (Famille Pirate, 1999-2004 (épisode 12))
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
T. d'Anatomie. Viscère mou, situé dans l'hypocondre gauche, entre l'estomac et les fausses côtes. Avoir la rate gonflée, dilatée, obstruée. Avoir mal à la rate. Une maladie de la rate. Les globules rouges du sang se forment et se détruisent dans la rate. Fig. et fam., Désopiler, épanouir, dilater la rate, Divertir, réjouir, faire rire. Voilà une histoire, un conte qui est propre à désopiler la rate. Il nous a fait un conte qui nous a bien épanoui la rate. Il aime à rire et à se dilater la rate. Fig. et fam., Se fouler la rate, Se fatiguer au travail. Il ne s'est pas foulé la rate à faire cet ouvrage.
Littré
-
1 Terme d'anatomie. Viscère situé dans l'hypocondre gauche, sous les fausses côtes.
Ce qui marque une intempérie dans le parenchyme splénétique, c'est-à-dire la rate
, Molière, Mal. imag. II, 9.Au milieu du souper, Cadoc se plaignit d'un mal de rate violent
, Voltaire, Zadig, 2.Vous avez bon foie, Dieu vous sauve la rate, se dit ironiquement à celui qui tient quelque discours ridicule et peu vraisemblable.
Populairement. Il ne se foule pas la rate, voy. FOULER, n° 8.
-
2Dans l'ancienne physiologie, la rate était regardée comme le siége de la bile noire ou atrabile?; de là le rôle que l'opinion vulgaire lui faisait jouer dans la bonne ou la mauvaise humeur?; on disait que la rate envoie des fumées, des vapeurs au cerveau.
Je n'aurais pas ces bons intervalles dont vous voyez que je jouis quelquefois, et, au lieu que je guéris les autres du mal de rate [les fais rire], j'en mourrais moi-même
, Voiture, Lett. 58.La troisième [maladie appelé hypocondriaque]? laquelle procède? particulièrement de la rate, dont la chaleur et l'inflammation porte au cerveau de notre malade beaucoup de fuligines épaisses et crasses, dont la vapeur noire et maligne cause dépravation aux fonctions de la faculté princesse
, Molière, Pourc. I, 11.Je vous demande pardon, mon cousin, je ne suis pas si traitable sur son absence [de Mme de Grignan] que sur la vôtre?; sa Provence me désole, et ma rate se mêle dans toutes nos séparations
, Sévigné, à Bussy, 19 mai 1677.Qu'est-il donc arrivé de funeste à Mélanthe?? rien au dehors, tout au dedans?; ses affaires vont à souhait, tout le monde cherche à lui plaire?; quoi donc?? c'est que sa rate fume
, Fénelon, t. XIX, p. 449.Familièrement. Épanouir la rate, désopiler la rate, dilater la rate, divertir, faire rire.
Je crois que cela [une plaisanterie] ne vaut rien du tout à écrire?; mais cela se présenta follement à la rate de votre pauvre frère
, Sévigné, 16 oct. 1680.Tu épanouiras la rate de tous mes sujets
, Voltaire, Dial. 27.Un rédacteur plaisant vous aurait dilaté la rate outre mesure
, Grimm, Corresp. t. II, p. 17.On dit aussi avec le pronom personnel Il aime à s'épanouir la rate.
La Puisieux s'en est épanoui la rate [d'une petite méchanceté faite par Mme de Sévigné à Mme d'Arpajon]
, Sévigné, 13 mars 1671.Je ne sais vraiment pas quel sujet vous croyez avoir de vous tant épanouir la rate
, Dancourt, Chev. à la mode, IV, 2.Décharger sa rate, dire ce qu'on a sur le c?ur.
Il faut qu'enfin j'éclate, Que je lève le masque et décharge ma rate
, Molière, F. sav. II, 7.
HISTORIQUE
XIIIe s. Levez-vous sus, dame Hersent, Fetes li un petit de haste [broche] De deux roignons et d'une rate
, Ren. 250.
XVIe s. Cest humeur est attiré par la rate pour la nutrition d'icelle et expurgation du sang
, Paré, Introd. 6.
Encyclopédie, 1re édition
RATE, s. f. en Anatomie, est un viscere mou, spongieux, d'une couleur rouge foncé, ou plutôt livide, qui ressemble ordinairement à la figure d'une langue, & qui est quelquefois triangulaire & quelquefois arrondi. Voyez les Pl. d'Anatom. & leur explication.
Ordinairement il n'y a qu'une rate, quelquefois cependant on en trouve deux, & même trois. Elle est située dans l'hypocondre gauche, entre les fausses côtes & l'estomac ; elle est un peu convexe du côté des côtes, & concave vers l'estomac. Communément sa longueur est de six pouces, sa largeur de trois, & son épaisseur d'un pouce. Elle est attachée avec l'omentum, qui avec les vaisseaux sanguins la joignent à l'estomac & au rein gauche, & quelquefois au diaphragme.
Elle est couverte de deux membranes ; la membrane externe vient du péritoine & n'est attachée à la tunique interne que par le moyen des vaisseaux sanguins. La membrane interne est composée de fibres admirablement entrelacées, c'est de-là probablement que viennent ce grand nombre de cellules ou de vésicules qui forment la principale masse de la rate, quoique Malpighi les attribue plutôt aux conduits veineux. Les cellules communiquent les unes aux autres & se dégorgent dans le tronc de la veine splénique. Elles sont garnies en-dedans, suivant Malpighi, de différentes petites glandes jointes ensemble, dont 6, 7, ou 8 forment une espece de petites glandes conglomérées, auxquelles les arteres & les veines paroissent se terminer.
Les vaisseaux sanguins sont l'artere splénique qui vient de la céliaque, & la veine splénique qui renvoye le sang au foie par la veine porte. Voyez Splénique.
Ses nerfs viennent du plexus splénique proche le fond de l'estomac : aussi-tôt que les vaisseaux entrent dans la rate, ils sont tous enveloppés d'une membrane ou enveloppe commune, & distribués abondamment dans toute la substance de la rate. De plus il y a quantité de vaisseaux lymphatiques.
Les anastomoses qui sont entre les arteres & les veines de la rate, sont plus visibles dans cet endroit qu'en toute autre partie du corps, & on observe que ce viscere reçoit à proportion beaucoup plus de sang que les autres parties. Voyez Anastomose.
L'usage de la rate a été bien contesté de tout tems, soit à cause que la dissection n'en fait point appercevoir l'usage immédiat, soit parce qu'on trouve que tous les animaux à qui on la coupe ne laissent pas de vivre sans rate. Tout ce qui arrive, par exemple, aux chiens à qui on l'a coupée, c'est qu'ils sont plus alertes qu'à l'ordinaire, qu'ils urinent plus souvent ; qu'ils sont plus affamés qu'auparavant, & que pendant les premiers jours ils sentent des nausées & qu'ils vomissent : on ajoute que pour faire un bon coureur il faut lui ôter la rate.
C'est pourquoi quelques-uns ont imaginé que la rate ne servoit que d'un poids pour entretenir l'équilibre du corps ; d'autres qu'elle ne servoit qu'à faire la symmétrie ; d'autres croient que c'est un poids inutile & une des superfluités de la nature ; d'autres que c'est une fosse commune dans laquelle le sang dépose ses parties grossieres ; d'autres enfin que c'est un feu dont la chaleur anime l'action de l'estomac.
Plusieurs anciens ont dit qu'elle étoit le réservoir de la bile noire ou humeur mélancolique ; c'est pourquoi quelques-uns d'entr'eux l'appellent l'organe du rire. Voyez Rire, Hypocondriaque, &c.
M. Cowper tire de la grande quantité de sang qui se trouve dans la rate, & de ses inosculations apparentes, une conjecture bien naturelle sur son usage, ou du-moins sur son méchanisme particulier. Il pense donc que la rate n'est qu'un organe subordonné qui aide à la circulation, & croit que du concours du sang artériel & de celui des veines, il résulte une impétuosité qui se communique au sang des veines, & qui facilite son passage à-travers les ramifications de la veine porte à la veine cave ; car autrement ce sang seroit tellement interrompu par les ramifications doubles de la veine porte, qu'il ne lui resteroit pas assez de force pour aller au c?ur. Voyez Circulation.
L'action ou l'effet de la rate, suivant Boerhaave, est de recevoir le sang nouveau des arteres, de le préparer dans ses glandes, & le répandre dans ses cellules ; de reporter le sang qui est resté après cette préparation aux petites veines, & de-là à la veine splénique ; de mêler les humeurs ainsi préparées avec les sucs nerveux, & de les préparer, atténuer, & unir plus intimement ensemble en une même humeur.
Malpighi, & après lui le docteur Keil, & quelques autres, prétendent que la rate est un viscere qui aide au foie à faire la secrétion, &c. de la bile. Nous avons observé qu'à cause de la proximité du foie & du c?ur, & de la vîtesse du mouvement du sang dans l'aorte, une humeur composée de particules, qui se combine aussi lentement que le fait la bile, ne pourroit pas être préparée, si la vîtesse du sang n'étoit pas diminuée en faisant plusieurs tours pour passer à-travers l'estomac, les intestins, & l'omentum, &c. jusqu'au foie.
De plus, le docteur Keil conjecture que ces parties ne suffisoient pas pour recevoir tout le sang qui devoit être envoyé au foie ; c'est pourquoi la nature a formé la rate dans les cavités de laquelle le sang étant répandu par une petite artere, se meut du moins aussi lentement que tout ce qui passe au foie d'une autre maniere, au moyen de quoi les particules qui composent la bile dans le sang qui passe par le rameau splénique, ont plus d'occasion, par une circulation si longue & si lente, de s'unir, qu'elles n'en auroient si elles avoient été portées par les branches de la céliaque directement au foie ; par conséquent sans la rate le foie n'auroit pas pû préparer une aussi grande quantité de bile qu'il en faut, c'est-à-dire que la nature en demande. Voyez Bile ; voyez aussi Foie.
Je n'ajouterai qu'un petit nombre de remarques.
On ne sauroit donner une description exacte de la rate, parce que sa figure & son volume varient beaucoup, par conformation naturelle, par l'âge, par maladies ; elle paroit même grosse ou petite lorsque par l'ouverture du cadavre, l'estomac est vuide ou plein ; si l'estomac est plein, il la resserre ; s'il est vuide, il lui permet de s'étendre ; mais Van-Horne l'a une fois trouvée d'une grosseur extraordinaire, pesant plus de cinq livres ; d'autres fois elle se trouve presque réduite à rien. M. Littre a fait voir à l'académie des Sciences une rate d'homme entierement pétrifiée ; elle tenoit comme de coutume à ses vaisseaux & ligamens ordinaires, & elle pesoit une once & demi. Le même Littre fit aussi voir une partie de la membrane d'une autre rate d'homme devenue osseuse.
Ce viscere est communément attaché au bord du diaphragme par un ligament membraneux particulier ; mais dans quelques sujets on trouve d'autres ligamens différens des vaisseaux courts qui l'attachent à l'estomac & au colon.
Riolan dit avoir vû la rate dans l'hypocondre droit, & le foie dans le gauche. Guy-Patin raconte aussi que dans un voleur qui fut roué à Paris en 1650, on trouva le foie du côté gauche, & la rate du côté droit ; mais on ne peut guere compter sur le récit de Pline, ni sur celui de Gui-Patin, parce que ce dernier ne cite aucun témoignage confirmatif, & que les auteurs contemporains n'en ont fait aucune mention. Nos anatomistes modernes, qui dans l'Europe ont ouvert entre eux des milliers de cadavres depuis cent ans, n'ont jamais écrit qu'ils eussent vû ce phénomene.
D'autres auteurs ont prétendu qu'il y a des hommes auxquels la rate manque naturellement. Hollier, Dulaurens, Kerkring, ont appuyé ce conte du poids de leurs dissections ; mais quelque forts que semblent des témoignage affirmatifs, de pareilles observations sont trop suspectes pour les admettre, tant qu'elles ne seront pas confirmées par les dissections postérieures.
Il est d'autres anatomistes qui nous disent au-contraire avoir trouvé quelquefois dans le corps humain deux & même trois rates bien conformées ; mais leur témoignage ne mérite aucune créance. Il paroit même que les especes de petites rates particulieres vues par M. Winslow, n'étoient que des appendices de la rate, & des jeux de la nature.
Comme quelques expériences ont justifié que la rate n'étoit pas absolument essentielle à la vie des animaux, on a vû, dans le dernier siecle, des chirurgiens s'aviser de dire que l'homme tireroit des avantages de se faire ôter la rate ; mais ce système barbare & ridicule, eut d'autant moins d'approbateurs, que les chiens sur lesquels ils imaginerent de faire leurs expériences pour prouver leur opinion, souffrirent de grands dérangemens dans tout leur corps, languirent, & moururent bien-tôt après. (D. J.)
Rate, (Physiolog.) la rate située dans l'hypocondre gauche, pendante sous le diaphragme, adhérente au rein gauche, à l'épiploon, & en quelque maniere à l'estomac, est exposée dans cette situation à la pression du diaphragme & des muscles de l'abdomen. Elle reçoit un sang pur, artériel, qui ne fait que de sortir du c?ur ; la céliaque, quelquefois l'aorte même lui fournit une artere, de laquelle le foie, le pancréas, le duodenum, le ventricule, reçoivent aussi leurs vaisseaux artériels ; d'où il est constant que le sang ainsi distribué à la rate par une infinité de rameaux, est tout-à-fait semblable à celui qui est porte aux autres parties qu'on vient de nommer.
Comme l'injection prouve qu'il y a un passage directement ouvert de ces arteres dans les veines, il paroit que les extrémités des artérioles spléniques ne se terminent pas toutes de la même maniere, mais qu'il regne ici une variété assez considérable, que cependant aucun art n'a pu démontrer jusqu'à présent, sur-tout à cause de la grande friabilité de ce viscere.
Il est néanmoins évident que la rate est construite comme tous les lieux du corps où se font des secrétions, & que conséquemment il s'en fait certainement en cette partie. Les vaisseaux lymphatiques qu'on y trouve environnant toute la tunique vaginale, rampant entre les deux sur les membranes propres spléniques, s'écartant çà & là de l'artere splénique ; ces vaisseaux, dis-je, sont en plus petite quantité dans ce viscere que dans les autres ; & comme ils ne pénetrent point dans l'intérieur, il suit qu'ils prennent leur origine des vaisseaux qui servent à nourrir le corps de la rate.
Si dans une rate lavée, dont on a exactement lié la veine, on souffle de l'air par l'artere dans toute la substance de ce viscere, & qu'ensuite après avoir lié l'artere, & laissé la rate se dessécher à l'air, on la disseque ; outre les arteres, les veines, & les nerfs, on voit en l'examinant bien, plusieurs cellules vuides, distendues, distinctes, composées de membranes élevées en droite ligne, de figure & de capacité diverses, lesquelles s'ouvrent les unes dans les autres par un orifice, & même dans ses plus grands trous faits au sinus veineux.
Les parois des membranes qui forment ces cellules sont arrosées de très-petites arteres ; on y voit de plus une grande quantité de corps ovales blancs, mous, disposés en forme de grappes glanduleuses, dont toutes les propriétés montrent sensiblement que ces grains servent à exprimer les glandes.
Quoique la rate ait à peine aucun mouvement sensible, qu'elle ne soit point douée d'un sentiment exquis, & qu'on n'observe pas même qu'elle en ait besoin, elle a cependant plusieurs grands & différens nerfs destinés pour elle seule, & qui se distribuent dans toute sa masse. C'est pourquoi il est très-vraissemblable que ces petits tuyaux nerveux s'y déchargent de leur humeur subtile, qui se mêle ensuite aux autres liqueurs veineuses qu'on y trouve.
Il suit de ce détail, que la principale action de la rate paroit consister en ce que, 1°. le sang artériel pur, abondant en lymphe, prépare une lymphe très subtile dans les petites glandes de ce viscere, l'y sépare, la verse dans les cellules par ses émonctoires particuliers, & en décharge aussi peut-être une partie dans la veine splénique. 2°. Le sang qui reste après cette action semble être porté dans les petites veines, & de-là dans les veines communes. 3°. L'autre troupe d'artérioles qui tapisse les parois des membranes, verse peut-être dans les cellules ouvertes des membranes, un sang plein de lymphe, & qui vient d'être atténué dans ce tissu artériel, comme il arrive dans les corps caverneux. 4°. Il est aussi croyable que les nerfs y portent, y déposent, y mettent, y fournissent sans cesse une grande quantité d'esprits. 5°. Que toutes ces humeurs, ainsi préparées, confusément mêlées, après avoir croupi un moment, sont comprimées, mêlées, atténuées, & souffrent la même élaboration que dans le poumon, par la forte action du sang artériel, par l'impétuosité du suc nerveux, par la contraction des deux membranes propres de la rate, & de sa tunique vaginale, par le renversement des fibres qui sont ici très-nombreuses, par l'agitation du diaphragme, des muscles, des vaisseaux, & des visceres abdominaux.
Le sang qui est fluide en cet endroit, disons riche en esprit & en lymphe, qui forme difficilement des concrétions, intimement mêlé, se séparant avec peine en parties hétérogenes, acquiert par ces causes une couleur rouge pourpre, & sort ainsi coloré de ce viscere par la grande veine splénique : tel est donc l'effet de la rate ; mais comme toute l'humeur qui y est préparée va dans la veine porte & au foie, il est évident que la rate travaille pour ce dernier viscere.
En effet, le foie & la rate semblent être dans une mutuelle dépendance l'un de l'autre. 1°. Dans les animaux auxquels on a enlevé la rate, on trouve le foie augmenté en volume, obstrué, flétri, ulcéré, défiguré ; ces changemens se sont trouvés quelquefois réunis & quelquefois séparés ; c'est-à-dire qu'on a trouvé dans quelques chiens ces assemblages de maux, & que dans d'autres on n'a rencontré qu'un seul de ces vices. 2°. Il est certain que la bile n'est plus la même dans les animaux auxquels on a enlevé la rate, la quantité est moindre, la couleur est blanchâtre, la consistance en est plus épaisse : on a trouvé les molécules de cette bile, comme des grumeaux de fromage. 3°. Il est donc évident que le foie & la bile ont besoin du sang de la rate, c'est-à-dire d'un sang plus fluide, & qui ait plus de lymphe & de sérosité, ou qui-soit préparé d'une façon particuliere comme le sang de la rate.
On peut juger par ce récit, si les diverses opinions qu'on a avancées sur les usages de la rate, sont des opinions bien fondées : les uns ont dit que la rate n'avoit d'autre usage que de servir de contre-poids au foie, en donnant plus de pesanteur à l'hypocondre gauche ; mais ceux qui raisonnoient ainsi ignoroient la véritable situation du foie qui couvre l'estomac en partie, & qui se jette quelquefois extraordinairement dans l'hypocondre gauche ; quelle étoit donc la nécessité de cet équilibre ? Peut-on dire d'ailleurs qu'un corps aussi petit que la rate par rapport au foie, puisse balancer ce viscere ?
Ceux qui ont imaginé que la rate n'étoit qu'un jeu de la nature ou un fardeau inutile, ont encore parlé avec moins de fondement ; sa perfection, les vûes raisonnées & constantes qu'on trouve dans sa structure animale, ne permet pas qu'on raisonne ainsi : les effets que produit l'absence de la rate, auroient dû inspirer un sentiment bien différent ; les chiens auxquels on enleve ce viscere, deviennent tristes, maigrissent, ont une bile visqueuse, un sang noirâtre & épais.
Les chimistes qui ont prétendu qu'il se filtroit dans la rate une âcreté vitale, sont encore plus chimériques, car il n'y a pas le moindre acide dans la rate, & le lait ne s'y caille jamais. Vains jouets de l'imagination, disparoissez à la vûe des vérités anatomiques.
Est-il probable qu'on soit impuissant & stérile quand la rate est détruite ? Non sans doute, & c'est plutôt le contraire. Les parties génitales sont éloignées de la rate de tout le péritoine. De plus, on sait que les chiennes sans rate ne sont pas moins fécondes ni moins avides du mâle. Tant qu'on ne raisonnera pas sur des principes tirés de la structure des parties, on ne fera que des systèmes propres à nous égarer.
Je pardonnerois plutôt aux anciens qui ont établi dans la rate le trône des ris, de la joie, & le siége des plaisirs du siecle de Saturne ; du-moins est-il vrai que quand la rate fait bien ses fonctions, on dort mieux, on est plus gai & plus content, mais c'est que rien ne gêne le cours du sang & des esprits.
Après tout, notre système physiologique sur la rate peut seul être en état de satisfaire à plusieurs questions, autrement assez obscures ; par exemple,
Que font la situation, le volume, le voisinage de la rate, la façon dont elle est suspendue ? Que nous apprennent la situation, la naissance, la capacité de l'artere splénique ? Je réponds, que la rate, voisine du diaphragme, du c?ur, de l'estomac, & des muscles du bas-ventre qui l'entourent, est ainsi placée pour mieux recevoir l'action de toutes ces parties. Ce viscere est ainsi suspendu afin de pouvoir être également comprimé de toutes parts, par rapport aux besoins du sang qui s'y filtre. L'artere splénique, la plus grande des arteres du bas-ventre, libre dans son trajet, est avantageuse à la rate, parce qu'elle fournit promptement une grande abondance de sang qui circule avec rapidité.
Pourquoi un animal qui a la rate coupée devient-il plus lascif ? La situation de l'artere spermatique en donne la raison. Le sang de l'aorte ne pouvant plus passer par l'artere splénique liée & bouchée, est forcé de couler plus abondamment dans les vaisseaux spermatiques ; ainsi la secrétion étant augmentée, augmente le desir de l'évacuer ; mais comme le manque de rate coûte beaucoup au foie, cette lasciveté est de peu de durée.
D'où vient que le même animal à qui on a coupé la rate pisse très-souvent ? C'est parce que la lymphe qui couloit par l'artere céliaque dans la rate, est obligée d'entrer dans les arteres émulgentes qui sont peu éloignées de l'artere céliaque.
D'où vient que les animaux qui n'ont point de rate sont plus voraces que les autres ? Cela doit arriver, tant parce qu'il se filtre plus de suc gastrique, une des causes de la faim, que parce que la contraction du ventricule augmente, & toujours par la même raison, qui est que le sang de la céliaque entre en plus grande quantité dans les rameaux qui se distribuent à l'estomac ; ainsi le ventricule étant évacué plus promptement, la voracité renaît ; mais elle dure peu, parce que la chylification se dérange.
D'où viennent les borborigmes, les nausées, les vomissemens qui arrivent les premiers jours qu'on a fait l'extirpation de la rate à quelque animal ? La situation des nerfs spléniques & stomachiques en donnent la raison. Le cours du sang & des esprits dans les intestins est entierement troublé ; telle portion qui en reçoit plus que de coutume, se contracte plus vivement, & l'air qui séjourne entre deux barrieres nouvelles, est poussé fortement & par secousses.
Par quelle raison, après l'extirpation de la rate, l'animal qui a souffert cette opération, est-il abattu, triste & tourmenté de la soif ? Je répons que cet animal a souffert des douleurs violentes qui ont dû troubler toute l'économie des parties voisines ; les nerfs sympathiques en restent ébranlés, & les impressions de la douleur subsistent long tems.
On remarque aussi que le foie grossit, ou se flétrit, ou s'enflamme dans les animaux qui n'ont pas de rate ; si ce viscere est en bon état, il doit grossir, par la même raison qu'un rein grossit quand l'autre est perdu ; mais s'il est mal disposé, il peut se flétrir ou s'enflammer, parce qu'il se trouve privé d'une grande quantité de lymphe qui lui venoit de la veine splénique.
On observe encore qu'après l'extirpation de la rate, l'hypocondre droit paroît plus élevé ; cela procede de ce qu'on a extirpé la partie qui élevoit l'hypocondre gauche ; outre qu'alors le foie s'augmente communément par la plus grande quantité de sang qui y circule.
On demande enfin par quelle raison les hypocondriaques & les spléniques sont sujets à tous les maux & accidens dont on vient de parler. Pour quelle raison sont-ils pâles, & pourquoi cependant sont-ils quelquefois provoqués à rire sur des riens ?
Les hypocondriaques en qui la rate obstruée ne fait pas ses fonctions, doivent être sujets à-peu-près aux mêmes symptomes que les animaux auxquels on a enlevé la rate ; c'est à-peu-près la même chose dans l'économie animale que la rate manque, ou qu'elle ne fasse pas ses fonctions.
La pâleur vient peut-être 1°. de ce que les veines mesentériques qui sont extrèmement grosses, retiennent une grande quantité de sang : 2°. de ce que le sang trop épais ne sauroit entrer dans le réseau qui colore la peau.
Quoique les hypocondriaques soient ordinairement fort tristes, il leur arrive cependant de rire le plus dans certaines occasions & sur des bagatelles ; c'est parce qu'alors le sang regorge dans les artères diaphragmatiques. On conçoit encore que les esprits refluent alors des nerfs de la rate dans les nerfs du diaphragme qui sont voisins, & l'on sait que le ris ne manque pas de survenir quand les nerfs du diaphragme viennent à être ébranlés. (Le Chevalier de Jaucourt.)
Rate maladie de la, (Médecine.) le viscere attaché dans l'hypocondre gauche, suspendu au diaphragme, contenant dans ses cellules une grande quantité de sang moins disposé à s'épaissir que partout ailleurs, est le viscere qu'on nomme la rate ; ce viscere dépourvu d'un émonctoire particulier, & doué d'un mouvement propre, est sujet à grand nombre de maladies.
1°. Il est vrai que l'absence & le défaut de cette partie, quand le volume du foie se trouve plus considérable qu'à l'ordinaire, prouve qu'elle n'est pas absolument nécessaire à la vie, mais elle l'est à la santé.
2°. Les grandes blessures de la rate sont communément mortelles. La contusion & la compression qu'elle peut éprouver, produit une dureté très-difficile à résoudre : c'est le chef-d'?uvre de l'art d'y réussir.
3°. Ceux qui ont la rate enflée, sont appellés vaporeux, rateleux ; souvent on confond cette maladie avec la mélancolie, la colique, ou le gonflement de la partie gauche du foie ; souvent aussi l'enflure vient d'hydropisie, d'hydatides ; & alors la rate est attaquée de relâchement & de froideur. Les sujets qui se trouvent dans ces divers cas, sont ordinairement soulagés, lorsqu'il leur survient une diarrhée, à moins que cette diarrhée ne soit produite par la compression du réservoir lombaire. Ces sortes de tumeurs, à raison de leurs différentes causes, sont d'un traitement trop difficile ; l'enflure de la rate accompagnée de dureté, de skirrhe, d'écrouelles, exige des topiques résolutifs internes & externes joints à des douces frictions.
4°. On traite de même l'obstruction de la rate ; pour ce qui regarde son inflammation, la douleur, l'abscès, l'ulcere, & la corruption qui y surviennent, ce sont autant de maux dont le traitement ne s'éloigne pas de la méthode curative générale, à moins qu'on n'ait à prévenir avec grand soin le dépôt de l'humeur dans la cavité du bas-ventre. La douleur de la colique qu'on guérit par des émolliens & des minoratifs, est assez souvent attribuée à la rate. Quant à celle qui paroît à la suite d'une violente course, elle se dissipe d'elle-même par le repos, au cas qu'elle ne soit point accompagnée de fievre, d'inflammation, & d'autres symptomes fâcheux. (D. J.)
Rate retranchement de la, opération de Chirurgie par laquelle on extirperoit la rate. Le vulgaire ignorant imagine qu'on peut rendre un homme habile à la course, en le dératant, c'est-à-dire, en lui extirpant la rate. Ce viscere est sujet à des engorgemens considérables de sang qu'on soulage par l'application des sangsues aux veines hémorrhoïdales, à des skirres qu'on résout par des emplâtres ou cérats émolliens & discussifs. Fabrice d'Aquapendente, célebre chirurgien médecin de Padoue, rapporte des cures admirables de ce genre opérées par ses soins. Les anciens croyoient guérir les maux de rate, en cautérisant avec un fer rouge, en divers endroits, la peau sur la région de ce viscere. On a porté plus loin les tentatives cruelles & téméraires. Il y a cent cinquante ans qu'un particulier avoit acquis une certaine vogue en Italie par une opération sur la rate ; il couvroit l'hypocondre gauche d'une feuille de papier ; il appliquoit dessus le tranchant d'une hache, qu'il frappoit d'un grand coup de marteau : les malades s'en retournoient dans l'espérance d'être guéris. Fabrice d'Aquapendente assure qu'un pauvre homme fut tué par cette opération, parce que la hache ayant été frappée trop rudement, le papier, l'abdomen & la rate furent fendus du coup. Quand on considere la situation de la rate dans l'abdomen, & les connexions qu'elle a par le moyen de ses vaisseaux & de sa membrane, avec l'estomac, le diaphragme, l'épiploon, le péritoine, &c. on concevra bien qu'il n'est pas possible de faire l'extirpation de ce viscere, sans exposer celui à qui l'on feroit cette opération, au danger de mourir d'hémorrhagie dans l'opération même, ou fort peu de jours après, par l'inflammation de tous les visceres circonvoisins avec lesquels il a des rapports médiats ou immédiats. Cependant le chevalier Leonard Fioraventi prétend avoir extirpé la rate à une femme de Palerme avec le plus grand succès, & que cette rate pesoit plus de trente-deux onces. Plusieurs auteurs qui regardent Fioraventi comme un charlatan du premier ordre, tiennent cette observation pour très-suspecte. On sait que les animaux sur lesquels on a fait l'expérience de l'extirpation de la rate, sont tous morts peu de tems après par le vice du foie. On en a tiré des inductions sur les usages particuliers & relatifs de ces deux parties si essentielles à la digestion. Voyez Rate, terme d'anatomie. (Y)
Étymologie de « rate »
Génev. râte?; du néerland. rate, rayon de miel (que d'ailleurs Diez rapporte au latin radius, rayon de miel), par comparaison avec la texture lâche et celluleuse de la rate.
- (Nom commun 1) (1150) Attesté dans Le Roman de Thèbes[1]. Étymologie incertaine[2]. L'hypothèse de Friedrich Christian Diez, qui fait venir le mot du moyen néerlandais rate (« rayon de miel, gâteau de miel (dans une ruche) ») en comparant avec l'aspect de l'organe, est critiquée par Walther von Wartburg et Oscar Bloch[3], critique reprise par le Trésor de la Langue Française informatisé[2].
- (Nom commun 2) ? voir rat
rate au Scrabble
Le mot rate vaut 4 points au Scrabble.
Informations sur le mot rate - 4 lettres, 2 voyelles, 2 consonnes, 4 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot rate au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
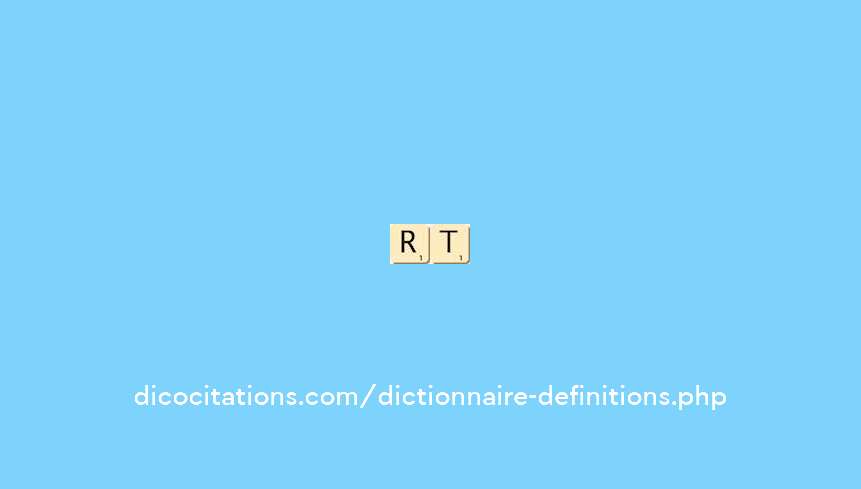
Les rimes de « rate »
On recherche une rime en AT .
Les rimes de rate peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en at
Rimes de boites Rimes de nitrates Rimes de étroite Rimes de benoîte Rimes de porte-cravate Rimes de scélérate Rimes de Zelzate Rimes de aromate Rimes de automate Rimes de casse-pattes Rimes de auvergnate Rimes de sourates Rimes de spath Rimes de pornocrates Rimes de bureaucrates Rimes de date Rimes de télépathe Rimes de grattes Rimes de triphosphate Rimes de abatte Rimes de mainate Rimes de sprats Rimes de cassate Rimes de kilowatts Rimes de blattes Rimes de fiat Rimes de névropathe Rimes de agate Rimes de chlorhydrate Rimes de ingrates Rimes de asiate Rimes de bureaucrates Rimes de scélérate Rimes de casemates Rimes de cronstadt Rimes de délicate Rimes de droites Rimes de dilatent Rimes de barattent Rimes de abattes Rimes de grattes Rimes de pirates Rimes de ratent Rimes de calfate Rimes de pénates Rimes de pâtes Rimes de ébattent Rimes de aromates Rimes de fat Rimes de sociopathesMots du jour
boites nitrates étroite benoîte porte-cravate scélérate Zelzate aromate automate casse-pattes auvergnate sourates spath pornocrates bureaucrates date télépathe grattes triphosphate abatte mainate sprats cassate kilowatts blattes fiat névropathe agate chlorhydrate ingrates asiate bureaucrates scélérate casemates cronstadt délicate droites dilatent barattent abattes grattes pirates ratent calfate pénates pâtes ébattent aromates fat sociopathes
Les citations sur « rate »
- L'Europe a toujours eu les meilleures et les plus belles Universités du monde. C'est là que sont nées nos plus belles idées, celles qui ont inspiré nos plus grandes oeuvres : les notions de liberté, de dignité humaine, de fraternité.Auteur : Romain Gary - Source : Education européenne (1945)
- Je vais vous dire à quoi sert un bureaucrate, à l'ère de la communication instantanée, à l'âge de la vitesse-lumière. Il sert à bloquer l'information.Auteur : Maurice Georges Dantec - Source : Les Racines du mal (1995)
- Beaucoup d'orateurs parlent pour parler, quelques-uns pour bien parler, tous pour faire parler.Auteur : Jean Antoine Petit, dit John Petit-Senn - Source : Bluettes et boutades (1846)
- Et tes pieds s'endormaient dans mes mains fraternelles.Auteur : Charles Baudelaire - Source : Les Fleurs du Mal (1857), XXXVI - Le balcon
- Je cherche la région cruciale de l'âme où le Mal absolu s'oppose à la fraternité.Auteur : André Malraux - Source : Le Miroir des limbes (1976)
- Isocrates a escrit un plaidoyer en la defense de Alcibiades, touchant une couple de chevaulx.Auteur : Jacques Amyot - Source : Alcibiade, 18
- Les plus silencieux s'avèrent souvent les meilleurs orateurs dès qu'on leur en donne l'occasion.Auteur : Bernard Werber - Source : Les Thanatonautes
- C'est une vengeance douce à celui qui aime beaucoup de faire, par tout son procédé, d'une personne ingrate une très ingrate.Auteur : Jean de La Bruyère - Source : Les Caractères (1696), 19, IV, Du coeur
- Je refuse à Viviani le titre de véritable orateur. C'est un débagouleur prodigieux, un acrobate de la récitation.Auteur : Louis Farigoule, dit Jules Romains - Source : Les Hommes de bonne volonté (1932-1946)
- Sur les photographies, les vivants mêmes sont transformés en cadavres parce qu'à chaque fois que se déclenche l'obturateur, la mort est déjà passée. Auteur : Jérôme Ferrari - Source : À son image
- Des républicains de l'espèce dite « républicains farouches » ne sont autres que des autocrates retournés. Ils disent : « La République, c'est nous ! » absolument comme Louis XIV disait : « L'Etat, c'est moi ! »Auteur : Victor Hugo - Source : Choses vues (1887-1900)
- Pour les vaniteux les autres hommes sont des admirateurs.Auteur : Antoine de Saint-Exupéry - Source : Sans référence
- Comme Goethe, je trouve les apôtres de la liberté assez antipathiques, car ce qu'ils cherchent, c'est le droit pour eux à l'arbitraire. L'histoire des peuples fourmille d'exemples de libérateurs devenus tyrans...Auteur : Maurice Denuzière - Source : Louisiane, III - Bagatelle (1981)
- Je m'voyais déjà en haut de l'affiche
En dix fois plus gros que n'importe qui mon nom s'étalait
Je m'voyais déjà adulé et riche
Signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaientAuteur : Charles Aznavour - Source : Je m’voyais déjà, 1960 - Selon moi, il y a trois personnes responsables de l'immense gâchis du quinquennat qui se termine : (le chef de l'État) François Hollande, qui a décidé de la politique à conduire, Emmanuel Macron, qui a été son conseiller et l'inspirateur d'une pensée qui a très largement fracturé la gauche, et (l'ex-Premier ministre) Manuel Valls. Auteur : Anne Hidalgo - Source : « Anne Hidalgo dénonce l'« immense gâchis du quinquennat » », Anne Hidalgo, Europe 1, 12 janvier 2017
- Les orateurs qui s'emportent sans motifs me rappellent ces navires représentés dans de méchantes gravures, avec toutes les voiles enflées sur une mer unie comme une glace.Auteur : Jean Antoine Petit, dit John Petit-Senn - Source : Bluettes et boutades (1846)
- Je ne crois pas avoir raté une seule occasion d'être triste. (Ma vocation d'homme.)Auteur : Emil Cioran - Source : Des larmes et des saints (1937)
- Une stratégie vieille comme le monde, toujours aussi efficace, cependant: Diviser pour régner en maître absolu.Auteur : Lionelle Nugon-Baudon, dite Andrea H. Japp - Source : Une ombre plus pâle (2009)
- Combien le socialisme, avec ses utopies de dévouement, de fraternité, de communauté, de travail attrayant, est encore au-dessous de l'antagonisme propriétaire, qu'il se flatte de détruire, et que cependant il ne cesse de copier ! Auteur : Pierre Joseph Proudhon - Source : Système des contradictions économiques ou Philosophie de la misère (1846)
- Malraux écrivait: Je cherche cette région cruciale de l'âme où le mal absolu s'oppose à la fraternité. J'ai vu et éprouvé cette fraternité.Auteur : Patrick Clervoy - Source : Dix semaines à Kaboul - Chroniques d'un médecin militaire (2012)
- Chacun rate sa vie, à sa manière, selon ses moyens et ses convictions.Auteur : Léon Aréga - Source : Le Débarras (1967)
- De nos mains, non de l'indolence, viendra la lumière (Iliade, XV, 741)
dit Homère par la bouche de ses guerriers.
À quelle place peuvent prétendre ces concepts incongrus dans une société du bien-être individuel et de la sûreté collective ? Sont-ils à jamais remisés dans les greniers des lunes ?
« Les langues antiques sont langues mortes », entend-on ordinairement. Ces expressions aussi ?
Pis que tous, l'un de ces mots paraît avoir été oublié au fond d'une strate archéologique : l'héroïsme. Dans les poèmes, il domine.
L' Iliade et L'Odyssée sont les chants du dépassement. Auteur : Sylvain Tesson - Source : Un été avec Homère
- La fable de Faust et de Méphisto correspond à une réalité beaucoup plus sérieuse qu'on ne le croit. Il y a toujours en nous de quoi faire un adorateur de Satan et si nous ne le sommes pas en théorie, nous le sommes dans la pratique de chaque jour.Auteur : Julien Green - Source : Jeunes Années (1985)
- Dans un roman, tu serais le narrateur en désaccord avec le personnage. L'auteur qui désapprouve en quelque sorte.Auteur : Paola Calvetti - Source : L'Amour est à la lettre A (2009)
- La brusquerie fait tout rater! C'est la précipitation qui culbute tous les pronostics!... Les plus fructueuses entreprises sont celles qui mûrissent très lentement!...Auteur : Louis-Ferdinand Destouches, dit Céline - Source : Mort à crédit (1936)
Les mots proches de « rate »
Rat Ratafia Ratatiner (se) Rate Rate Raté, ée Raté, ée Râteau Râtelée Râteler Râtelier Ratelle Râtelures Rateuse Ratier, ière Ratière Ratification Ratifier Ratine Ratiocinatif, ive Ratiocination Ratiociner Ration Rational Rationalisme Rationalité Rationnaire Rationnel, elle Rationner Ratissage Ratisser Ratissoire Ratissure Raton Ratopolis Rattachage Rattachement Rattacher Rattaquer Ratteindre Ratteler Rattendre Rattendrir Rattiser Rattrapage Rattraper Rature RaturerLes mots débutant par rat Les mots débutant par ra
rat rat-de-cave rata rata ratafia ratage ratages ratai rataient ratais ratait ratant rataplan ratatinai ratatinaient ratatinais ratatinait ratatine ratatiné ratatiné ratatinée ratatinée ratatinées ratatinées ratatinent ratatiner ratatinerait ratatineront ratatinés ratatinés ratatouille ratatouilles rate rate raté raté raté râteau râteaux ratée ratée ratée ratées ratées ratées râtelait râtelées râteler râtelier râteliers
Les synonymes de « rate»
Les synonymes de rate :- 1. manque
2. carence
3. déficit
4. offense
- 1. loupé
2. manqué
3. loupage
4. ratage
5. avorté
6. perdu
7. failli
8. offensé
9. loser
10. perdant
synonymes de rate
Fréquence et usage du mot rate dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « rate » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot rate dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Rate ?
Citations rate Citation sur rate Poèmes rate Proverbes rate Rime avec rate Définition de rate
Définition de rate présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot rate sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot rate notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 4 lettres.
