Définition de « scie »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot scie de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur scie pour aider à enrichir la compréhension du mot Scie et répondre à la question quelle est la définition de scie ?
Une définition simple : (fr-rég|si) scie (f)
Expression : donner de la voie à une scie si les chiens avaient des scies, il n’y aurait plus de poteaux
Approchant : sciable, sciage, scialet, sciant, scier, scierie, scieur, sciotte, sciure
Définitions de « scie »
Trésor de la Langue Française informatisé
SCIE, subst. fém.
Wiktionnaire
Nom commun - français
scie \si\ féminin
-
Outil, instrument ou machine possédant une lame dentée (rectiligne ou circulaire) et dont on se sert pour scier.
- Les bûcherons manient la hache, la scie ou la tronçonneuse.
-
(Musique) Lame d'acier vibrante sous l'archet et que l'on plie plus ou moins pour obtenir les différentes notes.
- Un jeune aveugle [?] joue de l'accordéon, accompagné par un homme plus âgé qui joue de la scie avec un archet. ? (Green, Journal, 1949)
-
(Bijouterie) Disque mince de bronze phosphoreux, utilisé pour fragmenter les diamants.
- Exemple d'utilisation manquant. (Ajouter)
-
(Poterie) Fil de fer servant à détacher une poterie du tour.
- Exemple d'utilisation manquant. (Ajouter)
-
(Vieilli) Phrase, moquerie, farce faite pour scier, exaspérer quelqu'un.
- La facétie.... prit les proportions d'une scie d'atelier, d'une scie dont chaque dent s'aiguisait aux dépens de mes côtes. ? (Pontmartin, les Jeudis de M. Charbonneau)
- C'était de tous les consommateurs le seul qui avait pu résister au vacarme effroyable que faisaient les bohémiens. Les scies les plus farouches l'avaient trouvé inébranlable, il restait là toute la soirée, fumant sa pipe. ? (Murger, Scènes vie boh., 1851)
- Vieille mélodie, air, rengaine usée ou répétition fastidieuse d'un propos, que l'on est fatigué d'entendre.
- Elle chantait des couplets d'opérette, des romances en vogue, des scies désopilantes. ? (Paul Adam, Chair molle, 1885)
- Alors, elle vous injurie du matin au soir, ne comprend rien, ne sait rien, jacasse sans fin, chante à tue-tête la chanson de Musette (oh ! la chanson de Musette, quelle scie !), se bat avec le charbonnier, raconte à la concierge les intimités de son ménage, confie à la bonne du voisin tous les secrets de l'alcôve, débine son mari chez les fournisseurs. ? (Guy de Maupassant , Au printemps, dans La maison Tellier, 1891, réédition Le Livre de Poche, page 215)
- Ainsi affublés, ils se dénommeraient « les Derviches du Désert », et les principaux morceaux de leur répertoire seraient pris parmi les scies en vogue. ? (H. G. Wells, La Guerre dans les airs, 1908, traduction d'Henry-D. Davray et B. Kozakiewicz, Mercure de France, Paris, 1910, page 18 de l'édition de 1921)
- Les titres volaient sur les lèvres. On reconnaissait la "Tennessee Waltz" et l'on tapait des mains en cadence pour une scie particulièrement idiote qui avait fait fureur juste à la fin des années 40, en 1949 : "Bibidi-Bodidi-Boo". ? (Philippe Labro, L'Étudiant étranger, Gallimard, 1986, page 247.)
-
Personne ou chose désagréable ou ennuyeuse.
- Je ne me suis tant ennuyée que depuis cinq mois que je suis dans cette cage dorée. Quelle scie ! ? (Émile Gaboriau, L'Argent des autres , 1874)
- Être enfermé quand Paris existe, quand il y a tant de choses à faire, mener sa petite vie de bigote campagnarde, quelle scie, quelle scie ! ? (Bernanos, Lettres, 1904)
- La conjonction rebattue entre l'amour et la mort est une scie du XIXe siècle et du romantisme. ? (Philippe Sollers, Éloge de l'infini, Gallimard, p. 822)
-
(Ichtyologie) Poisson-scie.
- Laissez donc tranquilles ces malheureux cétacés. Ils ont bien assez de leurs ennemis naturels, les cachalots, les espadons et les scies, sans que vous vous en mêliez. ? (Jules Verne, Vingt mille lieues, t. 2, 1870)
-
-
(Héraldique) Meuble représentant l'outil du même nom dans les armoiries. Elle est généralement représentée comme une scie de bûcheron, également appelée passe-partout. Elle est donc constituée d'une lame longue, large et souple, droite sur le dessus et arquée côté dents, avec une poignée à chaque extrémité permettant la saisie à deux mains. On trouve parfois des scies égoïnes ou des scies de menuisier (lame fine mise sous tension par une structure en bois).
- D'argent à une cognée et une scie de gueules, passées en sautoir, soutenues par deux coupeaux de sinople mouvants de la pointe, qui est de la commune de Bourbach-le-Haut du Bas-Rhin ? voir illustration « armoiries avec une scie »
- (Héraldique) Pièce représentant une lame de scie. Voir feuille de scie.
-
(Héraldique) Meuble représentant l'outil du même nom dans les armoiries. Elle est généralement représentée comme une scie de bûcheron, également appelée passe-partout. Elle est donc constituée d'une lame longue, large et souple, droite sur le dessus et arquée côté dents, avec une poignée à chaque extrémité permettant la saisie à deux mains. On trouve parfois des scies égoïnes ou des scies de menuisier (lame fine mise sous tension par une structure en bois).
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Lame d'acier dentelée qui, par un mouvement de va-et-vient ou de rotation, entame et divise peu à peu les matières dures, comme le bois, la pierre, etc. Une scie droite. Une scie circulaire. Scie à ruban. Scie à métaux. Le manche, la monture d'une scie. Les dents de scie. Il y a des scies sans dents pour refendre les pierres dures, le marbre, etc. Une scie à scier de long et à refendre. Scie de charpentier, de menuisier, de marbrier. Une scie de chirurgien. Graisser une scie. Une scie édentée. Ce bois est si dur que la scie n'y saurait mordre. Une scie mécanique, Celle qu'une machine actionne. Le trait de la scie, La marque que l'on fait sur l'endroit du bois ou de la pierre qu'on veut scier. Il se dit aussi de la Place que se fait la scie à mesure qu'elle avance. Trait de scie, Chaque coupe qui est faite dans un morceau de bois, dans un bloc de pierre. Cette voie de bois a été coupée à trois traits de scie, Chaque bûche a été partagée en quatre morceaux.
SCIE désigne, en termes de Musique, un Instrument en forme de scie dont on joue en faisant vibrer la lame. Il désigne, en termes d'Histoire naturelle, un Poisson de mer dont le museau se prolonge en une lame plate garnie de pointes des deux côtés. Il se dit figurément, dans le langage familier, d'une Chose ennuyeuse par sa répétition monotone. C'est une scie, une vraie scie. Il se dit aussi, dans un sens analogue, d'une Plaisanterie, d'une mystification Souvent répétée. Une scie d'atelier. Monter une scie.
Littré
-
1Instrument employé pour diviser certains corps solides, et dont la partie essentielle est, le plus généralement, une lame métallique taillée en petites dents.
Les scies ordinaires sont montées sur un châssis en bois et la tension de la lame est obtenue par la torsion d'une corde.
Et derrière son dos qui tremble sous le poids, Il attache une scie en forme de carquois
, Boileau, Lutr. II.Scie à refendre, scie dont la lame assez large peut être inclinée sur le plan du châssis.
Scie à chantourner, scie dont la lame est très étroite, ce qui permet de découper le bois suivant des courbures prononcées.
Scie à main, petite scie emmanchée ou montée sur un châssis très simple.
Scie à bras, grande scie des scieurs de long?; elle se man?uvre verticalement, et son emploi exige deux hommes.
Scie à tronçonner, scie employée pour couper des troncs d'arbres ou de fortes pièces de bois. La scie passe-partout, destinée au même usage, se compose d'une lame dont les dents sont taillées de manière à agir dans les deux sens?; cette lame n'est pas montée sur un châssis, mais porte une poignée à chacune de ses extrémités.
Scie anglaise, petite lame extrêmement étroite, à laquelle on communique un mouvement alternatif au moyen d'une pédale, et qui sert à faire des découpures dans des plaques de bois très minces.
Scie mécanique, scie qui reçoit son mouvement d'une machine. Scie à mouvement alternatif. Scie circulaire?; cette dernière se compose d'un disque métallique monté sur un arbre qui lui communique un mouvement de rotation?; on l'emploie pour couper des pièces de bois de peu d'épaisseur ou des pièces de métal, des rails de chemins de fer principalement.
Scie à ruban, scie qui se compose d'une lame étroite et flexible enroulée sur des poulies qui la mettent en mouvement.
-
2Instrument analogue qu'on emploie en chirurgie. Scie droite, espèce de large couteau dont le tranchant est remplacé par des dentelures, et dont le dos est surmonté dans toute sa longueur par une tige de fer qui maintient la lame et lui donne la pesanteur convenable.
Scie à chaînette, scie qui consiste en une petite chaîne semblable à une chaîne de montre, mais dont les paillons (petites lames allant d'un chaînon à l'autre) sont armés de dents sur un de leurs bords, de manière à former une série de petites scies articulées les unes à la suite des autres.
Scie circulaire ou à molette, scie qui consiste en un disque dentelé, qui autrefois était mû par un axe central, mais qui aujourd'hui, par suite de nombreuses modifications, reçoit son impulsion de la circonférence au moyen de diverses roues à engrenages et agit ainsi avec une force beaucoup plus grande.
-
3 Terme de marbrerie. Lame de fer doux sans dents, pour débiter la pierre et le marbre.
Les marbres divisés ont crié sous la scie
, Saint-Lambert, Sais. IV. -
4Trait de la scie, la marque faite sur l'endroit qu'on veut scier.
Le trait de la scie, se dit aussi de ce que la scie emporte du bois ou de la pierre qui est sciée.
Trait de scie, chaque coupe qui est faite dans un morceau de bois, dans un bloc de pierre. Cette voie de bois a été coupée en deux traits de scie, c'est-à-dire que chaque bûche a été partagée en trois morceaux.
-
5Sorte de supplice usité dans l'antiquité, en Orient.
Ayant fait sortir les habitants, il [David] les coupa avec des scies, fit passer sur eux des chariots avec des roues de fer
, Sacy, Bible, Rois, II, XII, 31.Il était très difficile de distinguer le faux prophète du véritable?; c'est pourquoi Manassé, roi de Juda, fit périr Isaïe par le supplice de la scie
, Voltaire, M?urs, introduction. -
6Fil de fer avec lequel le potier de terre détache l'ouvrage de la surface du tour.
Plaque de fer ronde dont le lapidaire se sert pour user les pierres.
- 7Un fer de scie, deux scieurs de long manoeuvrant ensemble une scie. La journée d'un fer de scie est de tant.
- 8 Terme de médecine. Bruit de scie, en auscultation, bruit ressemblant au frottement d'une scie sur du bois?; on le perçoit surtout dans les maladies du c?ur et les lésions des orifices cardiaques.
-
9 Terme d'histoire naturelle. Poisson de mer dont le museau se prolonge en une sorte de lame garnie de pointes des deux côtés.
Mouches à scie, groupe des hyménoptères porte-scie.
-
10 Terme de marine. Action de scier.
Faire scie-vogue, virer de bord.
Quatre de leurs galères vinrent essayer leurs coursiers [canons de coursier]?; mais le Sceptre tira un coup de canon de 36 de sa sainte-barbe, qui les obligea au plus vite à faire scie-vogue
, Relat. du combat de Lipari, 8 janv. 1676, dans JAL. -
11Scie de gondole, lame haute et large en fer, qui est à l'avant des gondoles, ainsi nommée parce qu'elle présente des dentelures?; c'est un ornement (en italien, ferro della gondola).
En cet instant, au fond de ce canal obscur, brilla la scie d'une gondole
, Musset, Nouv. le Fils du Titien, ch. IV. -
12 Populairement, chose fatigante, ennuyeuse. Quelle scie d'aller là?!
Scie d'atelier, et, quelquefois par abréviation, scie, tourment, mystification, refrain d'une monotonie préméditée, et répété d'autant plus de fois qu'il paraît agacer celui qu'on veut mortifier.
La facétie? prit les proportions d'une scie d'atelier, d'une scie dont chaque dent s'aiguisait aux dépens de mes côtes
, Pontmartin, les Jeudis de M. Charbonneau.Monter une scie, organiser contre quelqu'un un ennui que tout le monde lui répète.
HISTORIQUE
XIIIe s. Et sachiez que en flun de Nile est une maniere de delfins qui ont sor le dos une eschine autele comme soie, dont il ocient le cocodril
, Latini, Trésor, p. 188. Or y faut il chaudiere et sie
, Choses qui faillent en ménage.
XIVe s. Mais nos François savoient trestout le convenant, Si orent aporté mainte sie trenchant, Emmanchées à plomb
, Guesclin. 19449. Commissures [du crâne] faites com dens de sée
, H. de Mondeville, f° 12 verso. Une piece de pré contenant environ XVI sées [scies, autant qu'un coupeur peut couper, scier]
, Du Cange, secare.
Encyclopédie, 1re édition
SCIE, s. f. (Hist. nat. Ichthiolog.) pristis, serra, Pl. XIII. fig. 1. très-grand poisson de mer auquel on a donné le nom de scie, parce qu'il a la partie antérieure de la tête terminée par un os long, dur, mince & large, qui a de longues dents de chaque côté, ce qui lui donne beaucoup de ressemblance avec une scie dentée des deux côtés. La face supérieure de cet os est rude, & il a une couleur cendrée. Ce poisson est mis au rang des cétacés, on le trouve dans la mer des Indes. Rondelet, hist. nat. des poissons, part. I. liv. XVI. Voyez Poisson.
Scie, la, (Géog. mod.) en latin moderne Seja, petite riviere de France en Normandie, au pays de Caux, où elle a sa source. Elle arrose plusieurs villages, & se rend dans la mer près de Dieppe, à sept lieues de son origine. (D. J.)
Scie, s. f. (Outil de méchanique.) instrument pour fendre & diviser en plusieurs pieces diverses matieres solides, comme le marbre, la pierre, le bois & l'ivoire, &c. La scie est un des outils des plus utiles qui ayent été inventés pour la méchanique. La fable en attribue l'invention à Icare, qui, non moins ingénieux que son pere Dédale, enrichit comme lui les arts encore naissans de plusieurs découvertes qui ont servi à les perfectionner. On dit qu'il l'inventa sur le mode le de l'arête d'un poisson plat, tel, par exemple, qu'est la sole. La scie est de fer avec des dents, mais différemment limées & tournées, suivant l'usage auquel elle est destinée. Il y a aussi des scies sans dents, qui servent au sciage des marbres & des pierres.
Les ouvriers qui se servent le plus communément de la scie sont pour les bois les Bucherons, les Scieurs de long, les Charpentiers, les Menuisiers, les Ebenistes, les Tourneurs & les Tablettiers ; & pour les pierres les Marbriers, les Sculpteurs, les Scieurs de pierre, &c. Les Lapidaires ont pareillement leur scie, aussi-bien que les ouvriers qui travaillent en pieces de rapport, mais elle ne ressemble presque en rien aux autres. Les dents de toutes ces sortes de scies s'affutent & se liment avec une lime triangulaire, en engageant la feuille de la scie dans une entaille d'une planche, & l'y affermissant avec une espece de coin de bois.
Toutes les feuilles de scie se vendent par les Quincaillers, qui les tirent de Forez & de Picardie : on en trouve aussi chez eux de toutes montées, particulierement de celles pour la marquetterie, & pour les Tablettiers & Peigniers, dont la monture est toute de fer. (D. J.)
Scie, (Critique sacrée.) le supplice de la scie étoit en usage chez les Hébreux, si l'on en croit la plûpart des commentateurs ; c'est, selon eux, par ce supplice que David fit punir les Ammonites de Rebbath qui avoient maltraité ses ambassadeurs, seravit eos, dit la vulgate II. Rois, xij. 31. mais cette excessive cruauté entre avec peine dans mon esprit. Le mot hébreu signifie-t-il uniquement il les fit scier ? Je sai qu'on traduit aussi, ils ont été sciés, le mot ??????????, dont se sert S. Paul aux Hébreux, chap. xj. vers. 37. Cependant il est clair par l'histoire de Susanne, que le terme ?????????? désigne un supplice qui s'exécutoit par le sabre, & non par une scie. Il te coupera par le milieu, vers. 55. ce qui est exprimé plus bas par ces mots, l'ange de Dieu ayant un sabre, te coupera par le milieu, ???????? ???? ?????? ?? ?????, vers. 60. Or ce passage prouve que chez les Hébreux l'on coupoit un homme avec un sabre, & non avec une scie. Nonobstant cette remarque, je ne prétens pas dire que le supplice de la scie soit sans exemple dans le monde. Hyde, de relig. veter. Pers. cap. xiv. p. 128. rapporte que le roi de Perse Giemsched étant devenu un tyran cruel, Dubak, prince arabe, le poursuivit, le vainquit, le fit mettre entre deux planches & le fit scier. Abulfeda confirme le même fait. (D. J.)
Scie, instrument de Chirurgie, pour scier les os dans l'amputation des membres. Voyez Amputation.
Pour examiner cet instrument dans toutes ses parties, il faut la diviser en trois pieces. Voyez Pl. XXI. fig. 1. La premiere est l'arbre de la scie, la seconde est le manche, & le troisieme est le feuillet. L'arbre de la scie est ordinairement de fer, il est fort artistement limé & orné de plusieurs façons qui donnent de l'agrément à l'instrument ; mais l'essentiel est de la considérer sous trois différentes pieces. La principale suit la longueur du feuillet, & doit avoir (pour une scie d'une bonne grandeur) onze pouces quelques lignes de long.
Les extrémités de cette piece sont coudées, pour donner naissance à deux branches de différente structure ; la branche antérieure a environ 4 pouces 8 lignes de long ; elle s'avance plus en avant, & son extrémité s'éloigne d'un pouce 8 lignes de la perpendiculaire qu'on tireroit du coude sur le feuillet. Elle représente deux segmens de cercle, lesquels s'unissent ensemble, forment en-dehors un angle aigu, & leur convexité regarde le dedans de la scie.
Le commencement du premier cercle forme avec la piece principale un angle qui est plus droit qu'obtus ; la fin du second cercle est fendue de la longueur d'un pouce 5 lignes pour loger le feuillet qui y est placé de biais, & qui forme avec ce cercle un angle aigu.
L'extrémité de ce second segment de cercle est encore percée par un écrou, comme nous allons le dire.
La branche postérieure a un pouce de moins que l'antérieure ; les deux segmens de cercle qu'elle forme sont moins alongés & plus circulaires. Le premier fait un angle droit avec la piece principale, & le second en fait de même avec le feuillet : ce second cercle se termine à une figure plate des deux côtés, arrondie à sa circonférence, & percée par un trou quarré. L'union de ces deux segmens de cercles ne forme pas en-dehors un angle aigu, comme à la branche antérieure, mais ils semblent se perdre dans une pomme assez grosse, terminée par une mitre taillée à pans, lesquelles pieces paroissent être la base de toute la machine.
Il sort du milieu de la mitre une soie de près de quatre pouces de long, qui passe dans toute la longueur du manche.
La seconde partie de la scie est le manche, il est sait de même que celui que nous avons fait remarquer au couteau d'amputation ; mais sa situation n'est pas la même, car au-lieu de suivre la ligne qui couperoit la scie en deux parties égales suivant sa longueur, il s'en éloigne d'un demi-pouce, & s'incline vers la ligne qui seroit prolongée de l'axe du feuillet ; méchanisme qui rend la scie fort adroite, & fait tout autant que si le manche étoit contigu au feuillet, sans pour cela la rendre plus pesante.
L'avance recourbée, ou le bec du manche de la scie est encore tourné du côté des dents du feuillet, afin de servir de borne à la main du chirurgien. Ce manche est percé dans le milieu de son corps suivant sa longueur, ce qui sert à passer la soie de l'arbre qui doit être rivée à son extrémité postérieure.
Le feuillet & les pieces qui en dépendent sont la troisieme partie de la scie.
Ce feuillet est un morceau d'acier battu à froid, quand il est presque entierement construit, afin qu'en resserrant par cette méchanique les pores de l'acier, il devienne plus élastique ; sa longueur est d'un bon pié sur treize ou quatorze lignes de large ; son épaisseur est au-moins d'une bonne ligne du côté des dents, mais le dos ne doit pas avoir plus d'un quart de ligne.
On pratique sur la côte la plus épaisse de ce feuillet de petites dents faites à la lime, & tournées de maniere qu'elles paroissent se jetter alternativement en-dehors, & former deux lignes paralleles ; ce qui donne beaucoup de voie à l'instrument, & fait qu'il passe avec beaucoup de facilité & sans s'arrêter.
La trempe des feuillets de scie doit être par paquets & même recuite, afin qu'elle soit plus douce, que la lime puisse mordre dessus, & qu'elle ne s'engrene point, comme nous l'avons démontré en parlant des couronnes du trépan.
Les extrémités du feuillet sont percées, afin de l'assujettir sur l'arbre par des méchaniques différentes ; car son extrémité antérieure est placée dans la fente que nous avons fait observer à la fin du second segment de cercle de la branche antérieure, & elle y est assujettie par une vis qui la traverse en entrant dans le petit écrou que nous avons fait pratiquer à l'extrémité de cette branche.
L'autre extrémité du feuillet est plus artistement arrêtée sur la branche postérieure, elle y est tenue, pour ainsi dire, comme par une main, qui n'est autre chose qu'une avance plate, légerement convexe en-dehors, & fendue pour loger le feuillet qui y est fixé par une petite vis qui traverse les deux lames de cette main & le feuillet. Cette main qui couvre environ huit lignes du feuillet, paroît s'élever de la ligne diamétrale d'un base ronde, qui est comme la mitre du feuillet : cette mitre est adoucie, très-polie & légerement convexe du côté de la main, mais plane & moins artistement limée à sa surface postérieure, afin de s'appuyer juste sur le trou quarré de la branche postérieure.
On voit sortir du milieu de cette surface postérieure de la mitre une espece de cheville différemment composée, car sa base est une tige quarrée de quatre lignes de hauteur, & proportionnée au trou quarré de la branche postérieure : le reste de cette cheville a un pouce de longueur, il est rond & tourné en vis ; on peut le regarder comme la soie du feuillet.
Enfin la troisieme piece dépendante du feuillet est un écrou : son corps est un bouton, qui après de cinq lignes de hauteur, & six ou sept d'épaisseur : sa figure intérieure est une rainure en spirale qui forme l'écorce, & l'extérieur ressemble à deux poulies jointes l'une auprès de l'autre.
Il part de la surface postérieure de cet écrou deux aîles, qui ont environ neuf lignes de longueur, & qui laissent entr'elles un espace assez considérable pour laisser passer la soie du feuillet ou de sa mitre.
L'usage de cet écrou est de contenir la vis, afin qu'en tournant autour il puisse bander & détendre le feuillet de la scie.
La maniere de se servir de la scie dont nous venons de faire la description, est de la prendre par son manche, de façon que les quatre doigts de la main droite l'empoignent, pour ainsi dire, & que le pouce soit alongé sur son pan intérieur.
On porte ensuite l'extrémité inférieure du pouce de la main gauche ou le bout de l'ongle sur l'os qu'on veut scier & dans l'endroit où on veut le couper ; puis on approche la scie de cet endroit de l'os, & par conséquent auprès de l'ongle qui sert comme de guide à la scie, & l'empêche de glisser à droite ou à gauche, ce qui arriveroit immanquablement sans cette précaution, & pourroit causer des dilacérations aux chairs qui auroient des suites, dont le détail nous meneroit trop loin.
On pousse ensuite la scie légerement & doucement en avant, puis on la tire à soi avec la même légereté & la même douceur ; ce qu'on continue doucement & à petits coups, jusqu'à ce que sa voie & sa trace soit bien marquée.
Quand une fois la scie a bien marqué sa voie ou sa trace sur l'os, pour-lors on ôte le pouce de la main gauche de l'endroit où nous l'avions posé, & l'on empoigne, pour ainsi dire, le membre qu'on veut couper avec la main gauche ; ce qui sert comme de point d'appui au chirurgien. Il ne faut plus alors scier à petits coups, mais à grands coups de scie, observant toujours de scier légerement & de ne pas trop appuyer la scie ; car en appuyant, ses petites dents entrent dans l'os & l'arrêtent ; ce qui fait que les chirurgiens ne scient qu'avec peine & par secousses. Garengeot, traité d'instr. de Chirurgie.
Il y a de petites scies sans arbre, dont les lames très-solides sont convexes & montées sur un manche, pour scier dans l'opération du trépan les ponts ou intervalles qui restent entre l'application de deux couronnes, & avec lesquelles on peut scier des pointes d'os, & ceux du tarse & du métatarse. (Y)
Scie a repercer, en terme de Bijoutier, est un instrument de fer formant un quarré allongé en le considérant monté de sa feuille, sans avoir egard au manche. Cette feuille se prend entre deux mâchoires, dont l'une immobile a un trou tarrodé ; & l'autre qui s'écarte & s'approche pour serrer ou lâcher la feuille ne l'est point ; le manche est fait de trois pieces, d'un morceau de fer qui répond à la cage de la scie, est tarrodé presque dans toute sa longueur, d'un écrou de bois dans lequel il entre, & d'une autre envelope de bois qui couvre cet écrou. Voyez petite Scie de marqueterie, Pl. de Marqueterie.
Scie grande & petite, outil de Charron ; c'est un outil qui est de la longueur de cinq ou six piés, dont les charrons se servent pour rogner le bois qu'ils travaillent pour le partager & mettre à la longueur qui leur est nécessaire ; cet outil n'a rien de particulier, & est fait comme les scies des charpentiers, &c. excepté qu'il faut être deux pour s'en servir, c'est-à-dire, que quand un ouvrier pousse, l'autre la tire.
Scie a main, outil de Charron ; c'est une lame de fer dentelée comme les scies ordinaires, qui est de la longueur d'un pié, emmanchée dans une poignée de bois de la longueur de trois à quatre pouces ; les charrons s'en servent pour rogner des petits morceaux de bois qui sont en place.
Scie a refendre, outil de Charron ; cet outil est exactement fait comme la scie des scieurs de long, & sert aux charrons pour refendre les ormes entiers & autres bois de charronnage.
Scie de Charpentier, est une feuille d'acier ou de fer dentée, montée sur deux montans de bois, une traverse au milieu, paralelle à la feuille de scie ; au bout des montans est une corde en quatre paralelles à la traverse & une languette au milieu, qui sert à faire bander la scie. Voyez les Planches.
La scie est un instrument ou outil très-nécessaire à la méchanique, & même le plus utile qu'on ait pu inventer ; car par son usage on ménage beaucoup toutes les matieres que l'on débite, que ce soit du bois, du marbre, des pierres précieuses, des métaux, &c. & dont les morceaux ne seroient d'aucune utilité, si l'on étoit obligé de les jetter bas à coups de ciseau.
Scie, est un instrument qui sert aux charpentiers à scier leurs bois de longueur ; elle a ordinairement quatre piés & demi ; ils en ont de plus petites pour les petits ouvrages. Voyez les fig. Planches du Charpentier.
Scie à main, couteau en scie ou sciotte ; les charpentiers s'en servent quand la scie ne peut leur servir.
Scie des coupeurs de bois, (Eaux & Forêts.) les scies dont on se sert dans les forêts pour débiter les plus gros arbres, s'appellent des passe-partout ; ils n'ont qu'une manche à chaque bout de la feuille : cette feuille a les dents fort détournées, c'est-à-dire, ouvertes à droite & à gauche. (D. J.)
Scie des Ebénistes, (Ebénisterie.) les ébénistes qui sont du corps des menuisiers, outre toutes les scies qui servent à la menuiserie, en ont encore une particuliere, qui s'appelle scie à contourner. Cette scie est montée sur un archet d'acier fort élevé, afin que les feuilles des divers bois qu'ils contournent, puissent passer entre cet archet, & la feuille dentelée de la scie. (D. J.)
Scie, en terme de Graveur en pierres fines ; c'est une espece de boule qui a la lame très-mince, dont on se sert pour refendre, ou même pour séparer tout-à-fait les pierres. Voyez les figures, Planches de la Gravure.
Scie, petite scie, voyez les fig. & les Pl. l'Horlogerie ; les Horlogers s'en servent pour scier des pieces fort délicates ; ces sortes de scies sont montées comme les grandes, & n'en different que par leur grandeur.
Scie des Lapidaires, (Joaillerie.) les scies des Lapidaires, qui ont le nom de scie, non pas qu'elles aient quelque rapport par la figure à aucune des scies dont on vient de parler, mais parce qu'elles servent à user, & pour ainsi dire, à scier les pierres précieuses sur le touret ; ces scies, dis-je, sont de petites plaques de fer, en forme de ce qu'on appelle une pirouette avec quoi jouent les enfans, attachées au bout d'une broche aussi de fer. Les lapidaires ont encore une espece de scie pour scier le diamant, qui ne consiste qu'en un fil de fer ou de léton, aussi délié qu'un cheveu bandé sur un petit arc d'acier ou de bois. On s'en sert avec de la poudre de diamant bien broyée avec de l'eau ou du vinaigre. Les ouvriers en pieces de rapport usent aussi de cette sorte de scie pour les pierres les plus précieuses : pour les plus grosses pieces ils ont une petite scie, dont la feuille n'a point de dents. (D. J.)
Scie des sardiniers, (Outil de jardinier.) ils s'en servent pour retrancher le bois qui est sec & vieux, & par conséquent fort dur, & capable de gâter la serpette, avec laquelle on ne peut aisément couper de grosses branches. Il ne faut jamais, dit la Quintinie, employer la scie à retrancher des branches, qu'un coup de serpette peut couper adroitement. Il faut que la scie soit droite, qu'elle soit d'un acier dur & bien trempé. Il faut qu'elle ait de la voie, c'est-à-dire, qu'elle ait les dents écartées & bien ouvertes, l'une allant d'un côté, & l'autre de l'autre, & qu'avec cela le dos soit fort mince ; tout-au-moins doit il être moins gros & moins matériel que les dents, autrement la scie ne passera pas aisément, parce que les dents en seront aussitôt engorgées, si bien qu'à s'en servir, on se lasse en un moment, & on n'avance guere.
Il n'est point nécessaire que les scies pour l'usage ordinaire de tailler soient larges. Un bon demi-pouce de largeur leur suffit ; ils ne les faut guere longues, c'est assez qu'elles aient environ quinze pouces de longueur. Le manche peut être rond, attendu que pour pousser une droite ligne devant soi, on ne doit pas craindre qu'il tourne dans la main, comme fait une serpette à manche rond ; il sera assez gros, pourvu qu'à l'endroit de la plus grande grosseur, qui est à l'extrémité où se vient ranger la pointe de l'alumelle quand on la ferme, il ait environ deux pouces & sept à huit lignes de tour, & que par l'autre extrémité il ait un peu moins de deux pouces ; ces sortes de scies se plient, ne font aucun embarras, & sont portatives comme des serpettes, le tranchant se serrant dans le manche. (D. J.)
Scie a main, (Lutherie.) dont les facteurs de clavecins se servent, est une lame d'acier de dentée, que l'on emmanche dans un manche courbé aBC, dont la poignée BC va en relevant, pour que les doigts de l'ouvrier ne frottent point contre l'ouvrage. Cette scie est propre à scier les entailles des sautereaux où sont placées les languettes. Voyez Sautereau & la fig. 13. Pl. de Lutherie.
Scie a main de Maçon, (Maçonnerie.) on appelle autrement les scies à main dont se servent les maçons & poseurs de pierre de tailles, des couteaux à scier ; les unes ont des dents, & les autres n'en ont point. (D. J.)
Scie de marqueterie, servant à découper & chantourner les plaques, est un parallélogramme de fer, dont la lame est un des petits côtés, elle est montée sur les chassis par le moyen de deux chevilles qui ont la tête fendue, & l'autre extrémité en vis. Une de ces vis a un écrou à oreilles, & dont on se sert pour tendre la lame. L'autre vis a son écrou caché dans l'intérieur du manche. Voyez les fig. Pl. de Marqueterie.
Scie a refendre, outil de Marqueterie, est composée d'un grand chassis de bois entre & parallélement aux grands côtés duquel est la lame, large de quatre pouces ou environ, & attachée à deux boîtes au-travers desquelles passent les petits côtés du chassis : une des boîtes a encore un autre trou pour mettre la clé qui sert à donner de la bande à la lame. Voyez les fig. Pl. de la Marqueterie.
Scie des Menuisiers, (Menuiserie.) de tous les divers ouvriers qui se servent de la scie, ce sont les ménuisiers qui en ont la plus grande quantité, & de plus de différentes especes. Les principales sont la scie à refendre, qui leur est commune avec tous les autres ouvriers en bois ; la scie à débiter, la scie à tenons, la scie à tourner, la scie à enraser, la scie à main, & la scie à cheville. Voyez l'article Menuiserie & les articles suivans. (D. J.)
Scie a refendre, elle sert au menuisier à fendre les bois de long ; elle est composée de deux montans & deux traverses, dans les bouts desquelles les montans sont assemblés à tenons & mortaises ; à la traverse du haut est une boîte, & à celle du bas un étrier de fer auquel la scie est attachée ; elle est posée au milieu des deux traverses, & est parallele aux deux montans ; à la boîte il y a une mortaise dans laquelle on met une clé pour faire tendre la feuille de scie. Voyez les fig. Pl. de Menuiserie.
Scie a tenons ; elle est comme la scie à débiter, & n'en differe qu'en ce qu'elle est plus petite, & a les dents plus serrées ; elle sert pour couper les tenons.
Scie, (Menuiserie.) pour les fosses ou creux, pour les corps des arbres lorsqu'ils sont trop gros, & que les scies montées n'y peuvent passer, pour les pieux à rase terre, &c. c'est une grande feuille de scie avec une main à chaque bout. On nomme cette scie passe-par-tout ; elle est beaucoup d'usage parmi les Bucherons.
Scie en archet, est comme celle à chantourner, si ce n'est qu'elle est plus petite, qu'elle a une main pour la tenir qui porte son tourillon ; elle sert aussi à chantourner de petits ouvrages.
Scie a chantourner, la feuille en est fort étroite, & elle est montée sur deux tourillons qui passent dans les bras. Son usage est pour couper les bois suivant les ceintres. Voyez les fig. Pl. de Menuiserie.
Scie a chevilles, est un couteau à scie, qui a un manche coudé ; elle sert à couper les chevilles. Voyez les fig. Pl. de Menuiserie.
Scie a débiter, c'est celle qui sert aux Menuisiers à couper tous leurs bois suivant les mesures, & c'est ce qu'ils appellent débiter les bois. La monture consiste en deux bras ou montans, une traverse au milieu. Au bout des bras d'un côté est la feuille de scie parallele à la traverse ; à l'autre extrémité des bras est une corde qui va d'un bout à l'autre, & qui est en plusieurs doubles ; au milieu est un gareau qui sert à faire tendre la scie, & qui l'arrête sur la traverse. Voyez les fig. Pl. de Menuiserie.
Scie a main, ou a couteau, est plus large du côté de la main, n'a point de monture que la main avec laquelle on la tient pour s'en servir ; l'on s'en sert lorsque la scie montée ne peut passer. Voyez les fig. Pl. de Menuiserie.
Scie a raser, c'est une feuille de scie attachée sur un bout de planche d'un pié ou quinze pouces de long, laquelle sert à arraser les bas des portes, contrevents, &c. pour faire les tenons qui doivent entrer dans les emboîtures. Voyez les fig. Pl. de Menuiserie.
Scie a revuider, en terme de metteur en ?uvre, est la même que la scie à repercer des Bijoutiers. Elle est comme elle garnie d'une feuille fort étroite, qui peut aisément se contourner au gré de l'artiste sur l'ouvrage qu'il revuide. Voyez Revuider & les Pl. du metteur en ?uvre.
Scie a couteau, (Orfévrerie.) ce n'est autre chose qu'une lame de couteau taillé en scie.
Scie a guichet, (Serrurerie.) ce que les Serruriers appellent scie à guichet, est une petite scie à main, en forme de couteau dentelé, dont ils se servent pour faire dans les portes, tiroirs ou guichets de bois, les entrées des serrures qu'ils y veulent placer & attacher. (D. J.)
Scie des Tabletiers, (Tabletterie.) les Tabletiers, Peigniers & autres ouvriers, ont des especes de scies à main, qui ont une monture de fer à-peu-près comme les scies communes, mais sans corde. La feuille en est ferme & un peu large, & les dents sans être renversées ; elles servent à débiter le buis & les autres bois durs. (D. J.)
Scie des Tailleurs de pierre, (sciage de pierres.) les Tailleurs & Scieurs de pierre ont de deux sortes de scies, les unes à dents & les autres sans dents. Celles avec des dents sont tout-à-fait semblables aux passe-partous, hors qu'elles n'ont pas les dents détournées ; elles servent à scier la pierre tendre. Les scies sans dents dont on scie les pierres dures, & dont les Marbriers & Sculpteurs se servent aussi pour débiter leurs marbres, ont une monture semblable à celle des scies à débiter des Menuisiers, mais proportionnée à la force de l'ouvrage & de la scie, y en ayant de telles, que deux hommes ont assez de peine à les élever pour les mettre en place. La feuille de ces scies est fort large & assez ferme pour scier le marbre & la pierre, en les usant peu-à-peu par le moyen du sable & de l'eau que le scieur y met avec une longue cuilliere. (D. J.)
Scie du Tonnelier ; les Tonneliers se servent de deux sortes de scies dans les ouvrages de leur métier, savoir la scie ordinaire & la scie à main.
La scie ordinaire est composée de deux parties, qui sont la feuille & la monture. La feuille est une bande de fer ou d'acier bien mince de deux ou trois doigts de largeur, & qui d'un côté est garnie de dents depuis un bout jusqu'à l'autre. Il y a deux trous aux deux extrémités. La monture est composée de trois pieces de bois, dont la plus longue est enmortoisée par ses deux bouts dans le milieu des deux autres qui sont placées en travers. Les deux traverses sont fendues à une de leurs extrémités pour y insérer la feuille de la scie, qu'on y assujettit par deux chevilles de fer ; à l'autre extrémité elles ont une entaille pour recevoir une corde qui va de l'une à l'autre. Cette corde a dans son milieu une petite barre de bois, au moyen de laquelle on peut tortiller la corde & la raccourcir, ce qui force les deux extrémités des traverses à s'approcher l'une de l'autre. Cela ne peut pas se faire sans que les deux autres bouts des traverses ne s'éloignent, & par conséquent sans bander la feuille de la scie ; ce qui l'assujettit, la rend ferme & l'empêche de plier quand on s'en sert.
La scie à main est une feuille de fer ou d'acier d'une ligne d'épaisseur, garnie de dents d'un côté, & qui par un bout se termine par une queue droite enfoncée dans un manche de bois.
Étymologie de « scie »
Voy. SCIER?; wallon, sôie?; picard, soye?; ital. sega.
- (Vers 1200) Déverbal de scier[1].
scie au Scrabble
Le mot scie vaut 6 points au Scrabble.
Informations sur le mot scie - 4 lettres, 2 voyelles, 2 consonnes, 4 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot scie au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
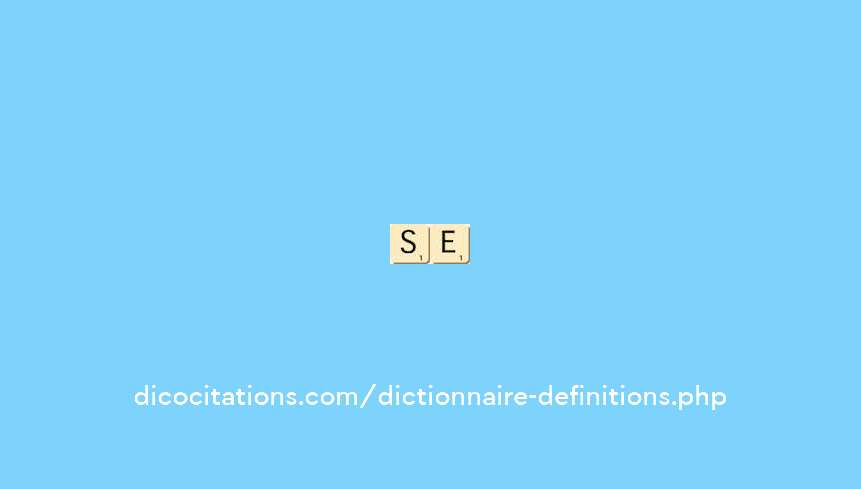
Les rimes de « scie »
On recherche une rime en SI .
Les rimes de scie peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en si
Rimes de cachexie Rimes de fléchie Rimes de adouci Rimes de radoucie Rimes de durcis Rimes de vichy Rimes de maxis Rimes de péripétie Rimes de dyslexie Rimes de farcie Rimes de gonococcie Rimes de désépaissis Rimes de hématie Rimes de soucies Rimes de décatie Rimes de chient Rimes de défraîchies Rimes de autopsies Rimes de farcies Rimes de affranchi Rimes de fléchi Rimes de sourcils Rimes de obscurcis Rimes de par-ci Rimes de assit Rimes de minutie Rimes de minci Rimes de nécropsie Rimes de sushi Rimes de éclaircie Rimes de emergency Rimes de roussis Rimes de grossie Rimes de réussit Rimes de péripéties Rimes de si Rimes de adoucis Rimes de associent Rimes de apprécies Rimes de grossie Rimes de anorexie Rimes de procuraties Rimes de mamamouchi Rimes de démocraties Rimes de rassis Rimes de maxi Rimes de Robechies Rimes de imprécis Rimes de assis Rimes de orthodoxieMots du jour
cachexie fléchie adouci radoucie durcis vichy maxis péripétie dyslexie farcie gonococcie désépaissis hématie soucies décatie chient défraîchies autopsies farcies affranchi fléchi sourcils obscurcis par-ci assit minutie minci nécropsie sushi éclaircie emergency roussis grossie réussit péripéties si adoucis associent apprécies grossie anorexie procuraties mamamouchi démocraties rassis maxi Robechies imprécis assis orthodoxie
Les citations sur « scie »
- La science n'avance que parce qu'il existe de ces héros qui savent, quand il le faut, se jeter dans le maquis du réel hors des avenues tracées.Auteur : Julien Benda - Source : Lettres à Mélisande pour son éducation philosophique (1925)
- J'ai toujours un espoir parce que je crois en l'homme. C'est peut-être stupide. La voie de l'homme est d'accomplir l'humanité, de prendre conscience de soi-même.Auteur : Aimé Césaire - Source : Interview par Patrice Louis, Magazine Lire, 1 juin 2004
- L'être humain au premier jour est un monstre sans conscience car sans conscience d'autrui. Nous avons tous commencé par être des tyrans. C'est la vie, en nous contredisant, qui nous a domestiqués.Auteur : Eric-Emmanuel Schmitt - Source : La Part de l'autre (2001)
- Je laisserais bien mon corps à la science, mais j'ai peur que les services fiscaux usent de leur droit de préemption.Auteur : Jean Gouyé, dit Jean Yanne - Source : J'me marre (2003)
- n pourrait croire que l'existence d'une conscience est indispensable à l'équilibre des civilisations, poursuivit-il. Eh bien, je me propose d'inventer un système où la conscience sera universelle. Auteur : Dean Koontz - Source : La chambre des murmures (2019)
- Comme les grandes oeuvres, les sentiments profonds signifient toujours plus qu'ils n'ont conscience de le dire.Auteur : Albert Camus - Source : Le mythe de Sisyphe (1942)
- Le goût est la conscience littéraire de l'âme.Auteur : Joseph Joubert - Source : Pensées (1774-1824)
- On ne peut apprendre une science à moins qu'on ne sache pertinemment de quoi il s'agit.Auteur : Aldous Huxley - Source : Le meilleur des mondes (1932)
- La nouveauté formidable de l'Allemagne nazie, c'est que la pensée magique s'est adjoint la science et la technique.Auteur : Louis Pauwels - Source : Le matin des magiciens (1960)
- Lorsque, grâce à la vigilance, le savant a cessé d’être négligent, il s’élève alors jusqu’au séjour de la Science ; et, de là, joyeux et sage, du même œil que celui qui est sur une montagne regarde ceux qui sont dans la plaine, il regarde la foule affligée et sotte. Auteur : Bouddha - Source : Le Dhammapada
- La science est l'esthétique de l'intelligence.Auteur : Gaston Bachelard - Source : La Formation de l'esprit scientifique (1938)
- On ne connaît pas complètement une science tant qu'on n'en sait pas l'histoire.Auteur : Auguste Comte - Source : Cours de philosophie positive
- Peut-être découvrirons-nous un jour que la même logique est à l'oeuvre dans la pensée mythique et dans la pensée scientifique, et que l'homme a toujours pensé aussi bien.Auteur : Claude Lévi-Strauss - Source : Anthropologie structurale (1958)
- ... si les pièces du jeu d'échecs étaient douées de conscience, elles admettraient volontiers le libre arbitre de leurs mouvements, c'est-à-dire leur rationalité finaliste.Auteur : Miguel de Unamuno - Source : Du sentiment tragique de la vie (1913)
- Je n'ai point dit que les sciences fussent plus redevables aux Français qu'à aucune des autres nations; j'ai dit seulement, et cela est vrai, que l'astronomie physique leur est aujourd'hui plus redevable qu'aux autres peuples.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Lettre à Voltaire, 13 mai 1759
- Certes, pour échapper aux obsessions de l'insupportable conscience, la plupart de ceux qui occupaient la salle avaient, depuis longtemps, assassiné leurs «âmes», espérant, ainsi, un peu plus de bien-être.Auteur : Auguste, comte de Villiers de l'Isle-Adam - Source : Contes cruels (1883), A s'y méprendre
- L'argent mal acquis ne vaut jamais ce qu'il coûte, et la bonne conscience ne coûte jamais ce qu'elle vaut.Auteur : Jean Antoine Petit, dit John Petit-Senn - Source : Bluettes et boutades (1846)
- Parvenu à son grade à coups de rengagements, de larmoiements et de platitudes, il promenait à travers la vie l'âpre conscience de sa non-valeur et sa sourde rancune d'idiot.Auteur : Georges Courteline - Source : Sans référence
- Quand on est complètement inconscient le temps n'existe pas, il passe au rythme d'un claquement de doigts, on se réveille et hop on se réveille de nouveau sans la moindre notion du laps de temps qui s'est écoulé dans l'intervalle.Auteur : Dalton Trumbo - Source : Johnny s'en va-t-en guerre (1971)
- Quand conscient et inconscient se font écho; notre Univers devient fort beau.Auteur : Daniel Desbiens - Source : Maximes d'Aujourd'hui
- La fin de l'humanité, c'est de produire des grands hommes; le grand oeuvre s'accomplira par la science, non par la démocratie. Rien sans grands hommes; le salut se fera par des grands hommes.Auteur : Ernest Renan - Source : Dialogues et fragments philosophiques (1876), III, Rêves
- Si vous aimez, ce n'est pas cet amour qui fait partie de votre destinée; c'est la conscience de vous-même que vous aurez trouvée au fond de cet amour qui modifiera votre vie.Auteur : Maurice Maeterlinck - Source : La Sagesse et la destinée (1898)
- - C'est quoi, cette inscription ? Souviens-toi que l'on a deux vies ? - C'est une vieille parole de sagesse chinoise : on a deux vies et la seconde commence lorsqu'on prend conscience qu'on n'en a qu'une.Auteur : Guillaume Musso - Source : L'instant présent (2015)
- Claire est un papillon, Edouard, un magnifique papillon que tu aurais aimé épingler dans ta vie. Mais... comme tous les papillons, elle veut brûler les étapes, parce qu'elle a la conscience aigüe que sa vie sera brève.Auteur : Jérôme Camut - Source : Les Voies de l'ombre, 4. Rémanence (2010)
- Contre la philosophie digestive de l'empirio-criticisme, du néo-kantisme, contre tout «psychologisme», Husserl ne se lasse pas d'affirmer qu'on ne peut pas dissoudre les choses de la conscience.Auteur : Jean-Paul Sartre - Source : Situations I (1947)
Les mots proches de « scie »
Sciable Sciage Sciatique Scie Sciemment Science Scientifique Scier Scieur Scille Scillitique Scindement Scinder Scintillant, ante Scintillation Scintillement Scintiller Scion Scissile Scission Scissure SciureLes mots débutant par sci Les mots débutant par sc
scia sciage sciaient sciais sciait scialytique sciant sciant sciatique sciatique scie scie scié Sciecq sciée sciées sciemment science science-fiction sciences sciène scient scientificité scientifique scientifique scientifiquement scientifiques scientifiques scientisme scientiste scientiste scientologie scientologue scientologues Scientrier scier sciera scierait scièrent scierie scieries scieront scies scies sciés scieur Scieurac-et-Flourès scieurs sciez Sciez
Les synonymes de « scie»
Les synonymes de scie :- 1. harle
- 1. égoïne
2. rengaine
3. ritournelle
4. tube
5. refrain
6. leitmotiv
7. antienne
8. rabâchage
9. sciotte
synonymes de scie
Fréquence et usage du mot scie dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « scie » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot scie dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Scie ?
Citations scie Citation sur scie Poèmes scie Proverbes scie Rime avec scie Définition de scie
Définition de scie présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot scie sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot scie notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 4 lettres.
